Les Promenades De Louzy
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2017
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2017 Arrondissements - cantons - communes 79 DEUX-SEVRES INSEE - décembre 2016 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2017 Arrondissements - cantons - communes 79 - DEUX-SEVRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction.....................................................................................................79-V 18, boulevard Adolphe Pinard 75675 Paris cedex 14 Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................79-1 Tél. : 01 41 17 50 50 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 79-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes..........................................................79-3 INSEE - décembre 2016 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

Bilan Scientifique 2 0 1 6 Deux-Sèvres
NOUVELLE-AQUITAINE BILAN DEUX-SÈVRES SCIENTIFIQUE Travaux et recherches archéologiques de terrain 2016 392 N°Nat. N° P. 206377 CHICHÉ Prieuré de la Poraire BOUVART Patrick EP SD 6 394 Prospection inventaire dans le 206356 COMBRAND SAINT-DIDIER Guillaume BEN PRD 5 394 Bocage Bressuirais Château du Coudray-Salbart, Tour de 206413 ÉCHIRÉ MONTIGNY Adrien INRAP FPr 8 395 Bois-Berthier 206432 LOUZY Le Château AUDÉ Valérie INRAP OPD 1 396 206372 MAULÉON Le Tail MAGUER Patrick INRAP OPD 4 396 206357 MAULÉON Saint-Aubin-de-Baubigné, Les Vaux PRIMAULT Jérôme MCC RAR 3 397 206478 MELLE Inventaire des caves LACROZE Emmanuel BEN PRD 12 398 206433 PARTHENAY Bassins d’assainissement BOLLE Annie INRAP OPD 7 399 206500 PÉRIGNÉ Ferme éolienne BAKKAL-LAGARDE Marie-Claude INRAP OPD 14 400 206370 ROM Lais LECONTE Sonia INRAP OPD 11 400 206399 SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE Cloître de l’abbaye Tranche 1 BUTAUD Paul EP FPr 9 401 206547 SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE Cloître de l’abbaye Tranche 2 SAUVAITRE Natacha EP FPr 10 401 393 NOUVELLE-AQUITAINE BILAN DEUX-SÈVRES SCIENTIFIQUE Travaux et recherches archéologiques de terrain 2016 Époque moderne, CHICHÉ Époque contemporaine Prieuré de La Poraire Le lieu-dit la Poraire est situé dans la commune de Ainsi, il est actuellement impossible de traiter les questions Chiché. En 2005, la famille de Canecaude y est devenue spécifiques aux communautés présentes dans un prieuré propriétaire de bâtiments identifiables à un prieuré simple. L’absence de sols médiévaux et de vestiges d’une simple de l’ordre de Fontevraud. Le 24 juillet 2012, leur table d’autel serait imputable aux transformations opérées intérêt patrimonial est partiellement reconnu par un lors de la conversion de l’édifice en étable. -

Departement Des Deux Sevres
BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 21 NOVEMBRE 2017 PROCES VERBAL N°10 ...-2017-11-21-... Transmis en Sous- BUREAU COMMUNAUTAIRE Préfecture le : ___________________________________ SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2017 Retour le : à Thouars – Centre Prométhée Date de la convocation : 15 NOVEMBRE 2017 Affiché le : ________________________________________________________________________________________________________ Nombre de délégués en exercice : 42 Présents : 28 Excusé avec procuration : / Absents : 14 Votants : 28 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Secrétaire de la séance : Mme ENON Sylvie Présents : M. PAINEAU - Vice-Présidents : MM. BONNEAU, DORET, MORICEAU R, BEVILLE, CLAIRAND, JOLY, RAMBAULT, BLOT, HOUTEKINS, CHARRE et Mme ARDRIT - Délégués : Mme ENON, MM. GREGOIRE, SAUVETRE, DECHEREUX, BAPTISTE, ROCHARD Ch, MILLE, Mmes BABIN, GELEE, MM. MORICEAU Cl, PETIT, BOULORD, Mme GRANGER, MM. NERBUSSON, COCHARD et DUGAS. Excusés avec procuration : / Absents : MM. ROCHARD S, MEUNIER, BIGOT, Mme RENAULT, MM. BREMAND, DUHEM, SINTIVE, COLLOT, Mmes RIVEAULT, ROUX, MM. PINEAU, FOUCHEREAU, GIRET et FERJOU. ______________________________________________________________________________________________________________________________ Le compte-rendu de la présente séance a été affiché conformément à l'article L.2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le quorum -

Fiche Structure : Alliance Villes Emploi
Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr TERRITOIRE Pays : France Région : Nouvelle Aquitaine Département : (79) Deux-Sèvres Ville : Thouars Liste des communes couvertes : Argenton-Château ((79) Deux-Sèvres), Argenton-l'Église ((79) Deux-Sèvres), Bouillé-Loretz ((79) Deux-Sèvres), Bouillé-Saint-Paul ((79) Deux-Sèvres), Brie ((79) Deux-Sèvres), Brion-près-Thouet ((79) Deux-Sèvres), Cersay ((79) Deux-Sèvres), Coulonges-Thouarsais ((79) Deux-Sèvres), Étusson ((79) Deux-Sèvres), Geay ((79) Deux-Sèvres), Genneton ((79) Deux-Sèvres), Glénay ((79) Deux-Sèvres), Chapelle-Gaudin (La) ((79) Deux-Sèvres), Coudre (La) ((79) Deux-Sèvres), Breuil-sous-Argenton (Le) ((79) Deux-Sèvres), Louzy ((79) Deux-Sèvres), Luché-Thouarsais ((79) Deux-Sèvres), Luzay ((79) Deux-Sèvres), Massais ((79) Deux-Sèvres), Mauzé-Thouarsais ((79) Deux-Sèvres), Missé ((79) Deux-Sèvres), Moutiers-sous-Argenton ((79) Deux-Sèvres), Oiron ((79) Deux-Sèvres), Pas-de-Jeu ((79) Deux-Sèvres), Pierrefitte ((79) Deux-Sèvres), Saint-Aubin-du-Plain ((79) Deux-Sèvres), Saint-Clémentin ((79) Deux-Sèvres), Saint-Maurice-la-Fougereuse ((79) Deux-Sèvres), Saint-Pierre-des-Échaubrognes ((79) Deux-Sèvres), Saint-Varent ((79) Deux-Sèvres), Sainte-Radegonde ((79) Deux-Sèvres), Sainte-Gemme ((79) Deux-Sèvres), Saint-Cyr-la-Lande ((79) Deux-Sèvres), Saint-Jacques-de-Thouars ((79) Deux-Sèvres), Saint-Jean-de-Thouars ((79) Deux-Sèvres), Saint-Léger-de-Montbrun ((79) Deux-Sèvres), Saint-Martin-de-Mâcon ((79) Deux-Sèvres), Saint-Martin-de-Sanzay ((79) Deux-Sèvres), Sainte-Verge -

National Regional State Aid Map: France (2007/C 94/13)
C 94/34EN Official Journal of the European Union 28.4.2007 Guidelines on national regional aid for 2007-2013 — National regional State aid map: France (Text with EEA relevance) (2007/C 94/13) N 343/06 — FRANCE National regional aid map 1.1.2007-31.12.2013 (Approved by the Commission on 7.3.2007) Names of the NUTS-II/NUTS-III regions Ceiling for regional investment aid (1) NUTS II-III Names of the eligible municipalities (P: eligible cantons) (Applicable to large enterprises) 1.1.2007-31.12.2013 1. NUTS-II regions eligible for aid under Article 87(3)(a) of the EC Treaty for the whole period 2007-2013 FR93 Guyane 60 % FR91 Guadeloupe 50 % FR92 Martinique 50 % FR94 Réunion 50 % 2. NUTS-II regions eligible for aid under Article 87(3)(c) of the EC Treaty for the whole period 2007-2013 FR83 Corse 15 % 3. Regions eligible for aid under Article 87(3)(c) of the EC Treaty for the whole period 2007-2013 at a maximum aid intensity of 15% FR10 Île-de-France FR102 Seine-et-Marne 77016 Bagneaux-sur-Loing; 77032 Beton-Bazoches; 77051 Bray-sur-Seine; 77061 Cannes-Ecluse; 77073 Chalautre-la-Petite; 77076 Chalmaison; 77079 Champagne-sur-Seine; 77137 Courtacon; 77156 Darvault; 77159 Donnemarie-Dontilly; 77166 Ecuelles; 77167 Egligny; 77170 Episy; 77172 Esmans; 77174 Everly; 77182 La Ferté-Gaucher; 77194 Forges; 77202 La Genevraye; 77210 La Grande-Paroisse; 77212 Gravon; 77236 Jaulnes; 77262 Louan- Villegruis-Fontaine; 77263 Luisetaines; 77275 Les Marêts; 77279 Marolles-sur-Seine; 77302 Montcourt-Fromonville; 77305 Montereau-Fault-Yonne; 77325 Mouy-sur-Seine; 77333 Nemours; 77379 Provins; 77396 Rupéreux; 77403 Saint-Brice; 77409 Saint-Germain-Laval; 77421 Saint-Mars-Vieux- Maisons; 77431 Saint-Pierre-lès-Nemours; 77434 Saint-Sauveur-lès-Bray; 77452 Sigy; 77456 Soisy-Bouy; 77467 La Tombe; 77482 Varennes-sur-Seine; 77494 Vernou-la-Celle-sur-Seine; 77519 Villiers-Saint-Georges; 77530 Voulton. -

Plateforme D'accompagnement Et De Répit En Nord Deux-Sèvres
Plateforme d’accompagnement et de répit en Nord Deux-Sèvres EHPAD l’Épinette Saint-Martin- Hôpital local Somloire Bouillé-Loretz de Sanzay Mortagne-sur-Sèvre 02 41 46 30 31 02 51 65 12 30 8 places Argenton- Brion- Saint- l’Église près- Cyr- Genneton la- Tourtenay 6 places Val-en-Vignes Thouet Lande A Saint-Maurice- Étusson B Louzy Saint-Martin- Sainte- de-Mâcon Verge Thouars Sainte- Saint-Léger- Saint-Pierre- Radegonde de-Montbrun des- Mauzé- 3 Pas-de-Jeu Échaubrognes Argentonnay Thouarsais Saint-Jacques- de-Thouars Saint-Jean- de-Thouars Missé Oiron Voulmentin Mauléon Coulonges- Nueil- Saint- Thouarsais Luzay Taizé 1 les-Aubiers Aubin- Brie du-Plain Luché- Thouarsais Sainte- La Petite- Gemme Boissière Saint-Varent Saint- Généroux Saint- Saint-Amand- Jouin- Le Pin Brétignolles Irais de- sur-Sèvre Geay Marnes Bressuire Pierrefitte Glénay Availles- Marnes Combrand Thouarsais Cirières 2 Montravers Faye-l’Abbesse Airvault Cerizay Boussais 4 Tessonnière Chiché Assais-les-Jumeaux Louin Saint- Boismé Saint- André- Courlay Maisontiers Loup- sur-Sèvre Lamairé Le Saint-Jouin- Chillou de-Milly Chanteloup La Forêt- Amailloux Pressigny sur-Sèvre La Chapelle- Moncoutant Saint-Laurent Doux Saint-Germain- Lageon Aubigny Pugny Clessé de- Longue- Gourgé Le Breuil- 5 Chaume Bernard Lhoumois 4 Adilly Viennay Moutiers-sous- Neuvy- Oroux Thénezay Hôpital local Chantemerle Largeasse Bouin Fénery La Châtaigneraie La Chapelle- Trayes Châtillon- Saint-Étienne sur-Thouet 02 51 53 65 43 Pougne- Saint-Aubin- La Peyratte La Ferrière- Hérisson le-Cloud en- Saint- Parthenay -
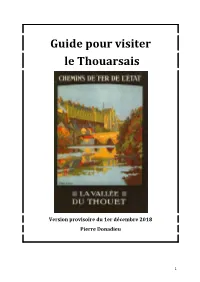
Guide Pour Visiter Le Thouarsais
Guide pour visiter le Thouarsais Version provisoire du 1er décembre 2018 Pierre Donadieu 1 Ce guide s’adresse à tous ceux qui souhaitent trouver des informations sur les bonnes raisons de visiter le Thouarsais. Les 31 communes choisies sont celles de la Communauté de communes du Thouarsais. Il est en cours de rédaction et actualisé périodiquement en général tous les 6 à 12 mois. Vous pouvez proposer des modifications, rectifier des erreurs ou compléter des chapitres en proposant des photos ou des textes. Adressez vous à Pierre Donadieu, un habitant de la commune de Louzy : [email protected] 2 Les illustrations de cette version sont provisoires et incompletes. La source est en general indiquee. Quand elle ne l’est pas, il s’agit d’images prises sur le site Wikipedia consacre aux communes de France. La plupart des sites d’emprunt de textes ou d’images sont indiques. En couverture, carte postale de 1910, publicite de la Compagnie des chemins de fer de l’Etat 3 Sommaire Avant Propos 1- Venir dans le Thouarsais 2- Le Thouarsais 3- Une unite geographique 4- Trois petites regions : le bocage, la plaine, le vignoble 5- Histoire du Thouarsais 6- L’a3me du Thouarsais 7- Les communes du bocage 8- Les communes du vignoble 9- Les communes de la plaine 10-Quelques circuits recommandes (en cours) 11-Les animations par communes (en cours) 12-Les bonnes adresses (en cours) 4 Avant-Propos Au nord du departement des Deux-Sevres, le Thouarsais est meconnu. Trop souvent traverse par les touristes qui ne s’y arre3tent pas, il dispose pourtant d’un insoupçonnable potentiel touristique et de loisirs. -

Commune Nom Prénom Nature Thouars P.Bert 0,50+2X0,25 Lacoux
Commune Nom Prénom Nature Thouars P.Bert 0,50+2x0,25 Lacoux Anna Aiffres Lucie Aubrac Gadolet Julien dir 2 élé TD Aiffres Lucie Aubrac Serdeczny Marie dir 2 mat TP Aiffres Lucie Aubrac Villanneau Sophie adj élé Aiffres Lucie Aulbrac Labruyère Véronique adj mat Aiffres V.Hugo Bourdichon Marie Pierre adj élé Aiffres V.Hugo Tabourin Valérie Déch.Dir. Aiffres V.Hugo 0,50+Bessines 0,50 Jumeaux Aurélie Aigonnay Breton Audrey Brigade TD Aigonnay Watrin Valérie adj élé Marie Airvault E.Pérochon Muller Hélène ZIL TD Airvault E.Pérochon 0,50+Airvault mat 0,50 Lenglin Claire Amuré 0,5 Le Bourdet 0,25 Frontenay RR 0,25 Boubault Natacha Anim ELVE + Cerizay J. Moulin 0,25 x 2 Caillaud Emmanuelle Anim TICE 0,75+Germond Rouvre Metayer Laurent Anim TICE 0,75+Niort les Brizeaux dech IMF Vivier Bernard Arçais Belleme Franck dir 3 élé TP Arçais Gréau Séverine adj élé Argenton l'Eglise Courault Anne-Marie adj mat Argenton l'église Girouard Cynthia Brigade TD Argenton l'église Marquet Hélène Dir TP Argenton les Vallées Dujardin Nadège adj élé Argenton les Vallées Maudet Karen Zil TP Assais les Jumeaux Brémaud Caroline adj mat Azay le Brûlé Choteau Olivier IME Azay le Brûlé Lebreton Raphaël IME Azay le Brûlé Passebon Frédéric IME Azay le Brulé IME brigade stage long Savoureux Claire TP Azay le Brûlé mat 0,25+La Crèche Boisragon 0,25 Mocellin Sylvia Azay/Thouet Sauvestre Pauline adj mat Beaulieu s/s Parthenay Marchal Nathalie adj élé Souchet- Beaussais Triballat Patricia dir 2 élé TD Beauvoir/Niort Pinato Caroline adj mat Beauvoir/Niort 0,50+Niort Pasteur 0,25+Niort -

Dates Horaires Matchs Services Buvettes Fermeture Buvette 15H D2
Dates Horaires Matchs Services buvettes Fermeture buvette 15h D2 Vrère St Léger 1 / Louzy 1 BASTIEN David Dimanche 27/09 15h D4 Louzy 2 / Vrère St Leger 2 CLERC Dorian COUTEAU V 13h D5 Vrines 3 / Louzy 3 GERMOND Cedric 15h D2 Louzy 1 / Pays Thenezeen 1 AMIRAULT Tony Dimanche 11/10 13h D4 St Varent Pierregeay 3 / Louzy 2 RAUTUREAU Christophe BOIZUMAULT A 13h D5 Louzy 3 / Vrère St Leger 3 Joueur D5 15h D2 Ev Le Tallud 2 / Louzy 1 DUVERGER Maguy Dimanche 25/10 15h D4 Louzy 2 / ACS Mahorais 2 BRUNET M MOLE T D5 15h D2 Louzy 1 / Buslaurs Thireuil 1 LECOMTE R Dimanche 1/11 13h D4 Coulonges 2 / Louzy 2 LEMAIRE T BRUNET A 13h D5 Louzy 3 / Brion/Vrère 2 15h D2 Cerizay Port 1 / Louzy 1 AMIRAULT S Dimanche 8/11 15h D4 Louzy 2 / Lutaizien Oiron1 LEITE Fernando AMIRAULT T 12h D5 St Jean Misse 3 / Louzy 3 15h D2 Louzy 1 / St Varent Pierregeay 2 BERGE Yohann Dimanche 15/11 15h D4 Vrines 2 / Louzy 2 BLAY Yohann BERGE Y 13h D5 Louzy 3/ Vergentonnaise 2 15h D2 Louzy 1 / Beaulieu Breuil 1 PROFIL Yohann Dimanche 22/11 15h D4 Vergentonnaise 1 / Louzy 2 THIBAULT Laurent GUIGNARD M 13h D5 Louzy 3 / St Cerbouille 3 15h D2 ACS Mahorais 1 / Louzy 1 BRAND Bruno Dimanche 6/12 15h D4 Louzy 2 / Pays Argentonnay 3 ARCHAMBEAU Jerome ARCHAMBAULT J 13h D5 Pays Argentonnay 4 / Louzy 3 15h D2 Louzy 1 / Inter bocage 2 Ruiz Emmanuel Dimanche 13/12 15h D4 Genneton 1 / Louzy 2 ZARDET P. -

79100 LOUZY FROMAGERIE - CREMERIE Edito Sommaire SARL
un petit coin de paradis ! Bul’t-infos Louzy Après des moments diffi ciles en 2 2 , Michel DORET, Maire et les Conseillers Municipaux de LOUZY, vous offrent leurs meilleurs vœux en vous espérant tous en bonne santé avec des projets pour 2 2 qui, nous le souhaitons, sera l‛année du renouveau. Edition municipaleMairie - 6, rue n°45 de la Mairie - 79100 LOUZYDécembre 2020 FROMAGERIE - CREMERIE Edito Sommaire SARL Nous vivons une situation sanitaire sans précédent. • Edito .............................................p 3 SEIGNEURET Nous devons être vigilants pour maîtriser cette évolution et respecter les mesures rigoureusement. Le personnel • Le Conseil Municipal ........... p 4-7 Spécialité de communal, au niveau de l’école, de la cantine, désinfecte • Les agents communaux ............p 8 fromages de chèvre les locaux régulièrement selon les prescriptions de l’Etat. Aucun regroupement n’est possible dans les salles. La • Budget ..........................................p 9 solidarité s’est développée spontanément, puisqu’au tout début de cette pandémie, une vingtaine de bénévoles • Travaux................................ p 10-13 a fabriqué 1 700 masques, puis 800 destinés à la • Café associatif .................... p14-15 population. Le dernier chantier au sein de l’aménagement des villages est terminé. La • Salle festive rue des Pineaux en mitoyenneté avec Thouars et la participation financière et culturelle .......................... p16-17 et technique du conseil départemental est sécurisée. La chaussée, les trottoirs sont refaits. • Tarif locations des salles ......... p18 présent dans les halles Le café associatif avance à un rythme modéré. La co-activité n’est pas permise. • Etat Civil ................................... p 19 de Thouars du mardi au dimanche le matin La fin du chantier est programmée au printemps. -

Guide Des 12 Boucles Vélo
PARIS NANTES SAUMUR LE THOUET BORDEAUX LA LOIRE Retrouvez toutes les informaࢼons concernant votre séjour vélo. www.valleeduthouet.fr OFFICE DE TOURISME TOURISME DU PAYS THOUARSAIS EN GATINE 32 place Saint-Médard 8 rue de la Vau Saint-Jacques 79100 THOUARS 79200 PARTHENAY 05 49 66 17 65 05 49 64 24 24 [email protected] info@tourisme-gaধne.com www.tourisme-pays-thouarsais.fr www.tourisme-gaধne.com Concepধon : tabularasa.fr & up-media.fr Impression : TTi Services Crédits photos : OLce de tourisme du ays Thouarsais, Tourisme en Gâࢼne, T2A, J.DASAME- Velofrancee, CA2B, Département 79, ADT79, Communauté de Communes du Thouarsais, Communauté de Communes Parthenay Gâࢼne, Communauté de Communes Val de Gâࢼne, GODS, DSNE, Atemporelle, DARRI, AVEC, B.LARGO, communes de la vallée du Thouet, montgolCères Thouarsais. LES 12 PLUS BELLES BALADES À VÉLO EN VALLÉE DU THOUET Vers ANGERS SAUMUR LA LOIRE La vallée du Thouet se découvre à vélo. TOURS Avec plus de 400 km d’iধnéraires, sillonnez paysages préservés et villages authenধques. Traversée de part en part par la Vélo Franceħe (Ouistreham- La Rochelle) www.lavelofranceħe.com, LE THOUET la vallée du Thouet s’est dotée de 12 boucles thémaধques connexes. MONTREUIL-BELLAY 1 VIGNES ET PONTS De 8 km à 42 km, à la demi-journée ou journée, en famille ou entre amis, à chacun son rythme EN ARGENTONNAIS pour découvrir les richesses de la vallée du Thouet. 25 Km D’UN VILLAGE 2 VÉLOROUTE DE À L’AUTRE L’ARGENTONNAIS Louzy 25 Km QUELQUES INFORMATIONS CONCERNANT LA SIGNALETIQUE THOUARS LA PLAINE ENTRE 3 4 AUX PORTES DIVE ET THOUET DU BOCAGE 32 Km Chaque départ de boucle est doté d’un 30 Km SAINT-GÉNÉROUX pupitre comprenant une carte et des points d’intérêt à découvrir sur le parcours. -

Commission Sportive Litiges Et Contentieux Week-End Du 09
PAGE 1/3 COMMISSION SPORTIVE LITIGES ET CONTENTIEUX REUNION RESTREINTE DU 14 FEVRIER 2019 PROCES VERBAL N° 25 Président : Mr. BAUDOUIN Gilles Secrétaire : Mr GODET Jean-Marie Membres Présents : MM. HILLAIRET Patrick - ROUGER Alain Toutes les décisions sont susceptibles d’appel devant le Bureau du District dans les formes réglementaires, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée. Les Frais de Procédure, soit la somme de 73.00 seront débités du compte du club appelant. Pour les décisions concernant les matches de Coupes, le délai est ramené à 2 jours francs ««««« Le Procès-Verbal n° 24 du 07 Février 2019 est adopté à l’unanimité des Membres présents. WEEK-END DU 09/10 FEVRIER 2019 Match n° 50081.2 Louzy – Nueillaubiers en D2 poule Nord Arbitre : Mr. OLIVIER Samuel Réserve du club de Louzy Je soussigné, ROUSSEAU Grégory, licence n° 1109303914, Capitaine du club de Louzy, formule des réserves sur la qualification et/ou la participation de l’ensemble des joueurs du club de Nueillaubiers pour le motif suivant : des joueurs du club de Nueillaubiers sont susceptibles d’avoir participé au dernier match d’une équipe supérieure du club qui ne joue pas le même jour ou le lendemain. Dossier en instance FORFAITS Amende de 30 € Pays Thénezéen en D5 1er Niveau poule D – 1er Forfait ARRETES MUNICIPAUX Reçu les Arrêtés Municipaux des communes de : Azay le Brûlé, Augé, Argentonnay, Argenton l’Eglise, Assais, Ardin, Breuil Bernard, Boismé, Béceleuf, Brioux S/Boutonne, Brion près Thouet, Boussais,