Rapport De Présentation HANGEST Approbation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
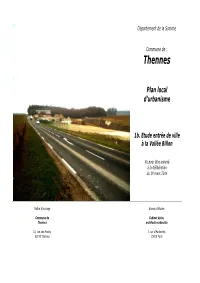
PLU 190314\Thennes.Approbation Le 19-03-14.1B.Etude L111-1-4.Pdf
Département de la Somme Commune de : Thennes Plan local d’urbanisme 1b. Etude entrée de ville à la Vallée Billon Vu pour être annexé à la délibération du 19 mars 2014 Maître d’ouvrage Bureau d’études Commune de Cabinet Avice, Thennes architecte-urbaniste 16, rue des Ecoles, 3, rue d’Hauteville, 80110 Thennes 75010 Paris Principes d’urbanisation le long de la Le développement de l’urbanisation aux abords de la route RD 23 classée à grande circulation départementale n°23 (Article L111.1.4 du code de l’urbanisme) Le site d’étude est occupé de longue date pour la déchetterie construite en 1998 et le dépôt de matériaux pour le service gestionnaire des routes Statut de la route départementale n°23 départementales : Direction départementale de l’Equipement (DDE) puis Conseil général de la Somme (CG80). Depuis quelques mois, une La route départementale n°23 est classée comme axe à grande circulation entreprise de recyclage s’est installée sur l’emprise du dépôt du Conseil par décret du 31 mai 2010. général, et celui-ci a été transféré plus au nord. Le site d’étude et son environnement Or le plan d’occupation des sols de la commune de Thennes classe en zone UFd l’emprise de la déchetterie. Les autres usages sont classés en La zone d’étude se situe à cheval sur les communes de Thennes et Villers- zone ND. aux-Erables et à proximité immédiate de Moreuil. Elle se trouve au bord de la route départementale n°23 reliant les communes de Démuin à Moreuil situées à 7 kilomètres l’une de l’autre. -

The Battle of Moreuil Wood
The Battle of Moreuil Wood By Captain J.R. Grodzinski, LdSH(RC) On 9 October 1918, Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians) fought their last battle of the First World War. Having been in reserve since August 1918, the Strathconas and the other two cavalry Regiments of the Canadian Cavalry Brigade were rushed to the front to exploit a penetration made in the German defences. In just one day, the Brigade advanced ten kilometers on a five kilometer front, capturing four hundred prisoners and numerous weapons. A spirited charge by the Strathconas over 1500 yards of open ground helped clear the village of Clary, southeast of Cambrai. This battle, which commenced at 0930 hours and finished by 1100 hours, assisted in clearing the neighboring Bois de Gattigny and the Bois du Mont-Auxvilles, Where two hundred prisoners were taken and a howitzer and forty machine guns captured. Several squadron-sized charges were made as the Regiments raced forward. The battle moved faster than senior commanders could react to and issue new instructions. This was mobile warfare, the type the cavalry longed for throughout the war. To those in the Canadian Cavalry Brigade and particularly the Strathconas this final action, known as the Battle of Le Cateau, probably brought recollection of a similar, yet more intense fight the previous spring: The Battle of Moreuil Wood on 30 March 1918. January 1918. The war was in its fourth year. Initially a mobile conflict, it quickly became a static slugging match. Intense fighting gave little advantage to either side while the numbers of casualties increased. -

La-Luce (Demuin) (S.I.S.)
Transports Scolaires - année 2020/2021 LA-LUCE (DEMUIN) (S.I.S.) Page 1/4 Horaires valables au mercredi 14 octobre 2020 Transports Scolaires - année 2020/2021 RPI BERTEAUC. DEMUIN DOMART/LUCE THENNES - P84 Ligne: 8-02-101 - Syndicat scolaire: LA-LUCE (DEMUIN) (S.I.S.) - Sens: Aller - Transporteur: SOCIETE CAP Fréquence Commune Arrêt Horaire Lu-Ma-Je-Ve CAYEUX-EN-SANTERRE ABRI 07:50 Lu-Ma-Je-Ve IGNAUCOURT PLACE DES TILLEULS 07:55 Lu-Ma-Je-Ve AUBERCOURT CENTRE 07:58 Lu-Ma-Je-Ve DEMUIN COURCELLES 08:03 Lu-Ma-Je-Ve DEMUIN ECOLE ELEMENTAIRE 08:10 Lu-Ma-Je-Ve HANGARD ABRI RUE DE DEMUIN 08:15 Lu-Ma-Je-Ve DOMART-SUR-LA-LUCE ECOLE 08:20 Lu-Ma-Je-Ve BERTEAUCOURT-LES-THENNES ECOLE 08:25 Lu-Ma-Je-Ve BERTEAUCOURT-LES-THENNES GARDERIE 08:33 Lu-Ma-Je-Ve THENNES ECOLE 08:40 Lu-Ma-Je-Ve BERTEAUCOURT-LES-THENNES ECOLE 08:45 Lu-Ma-Je-Ve CAYEUX-EN-SANTERRE ABRI 09:02 Ligne: 8-02-102 - Syndicat scolaire: LA-LUCE (DEMUIN) (S.I.S.) - Sens: Aller - Transporteur: SOCIETE CAP Fréquence Commune Arrêt Horaire Lu-Ma-Je-Ve BERTEAUCOURT-LES-THENNES GARDERIE 07:50 Lu-Ma-Je-Ve BERTEAUCOURT-LES-THENNES ECOLE 07:55 Lu-Ma-Je-Ve THENNES ECOLE 08:03 Lu-Ma-Je-Ve DOMART-SUR-LA-LUCE ECOLE 08:10 Lu-Ma-Je-Ve HANGARD ABRI RUE DE DEMUIN 08:15 Lu-Ma-Je-Ve DEMUIN ECOLE ELEMENTAIRE 08:20 Lu-Ma-Je-Ve BERTEAUCOURT-LES-THENNES GARDERIE 08:30 Ligne: 8-02-203 - Syndicat scolaire: LA-LUCE (DEMUIN) (S.I.S.) - Sens: Aller - Transporteur: SOCIETE CAP Fréquence Commune Arrêt Horaire Lu-Ma-Je-Ve BERTEAUCOURT-LES-THENNES ECOLE 13:08 Lu-Ma-Je-Ve THENNES ECOLE 13:14 Lu-Ma-Je-Ve DOMART-SUR-LA-LUCE -

Ech T'chou Canard
ETAT CIVIL NAISSANCES Ophélie RENOUX, née le 5 novembre 2002 à Ech T'chou Montdidier. Alexis BEAUDE, né le 7 novembre 2002 à Amiens Canard Pierre DELTOUR, né le 6 décembre 2002 à Amiens DECES Raoul PRIN, décédé le 17 octobre 2002, en sa 79ème année. Paulette CARON, décédée le 27 octobre 2002, en sa 80ème année. Gérard SCHERPEREEL, décédé le 9 novembre 2002, en sa 91ème année. Clotaire BOURSE, décédé le 16 novembre 2002, en sa 81ème année. Permanences du secrétariat de Mairie Lundi, Mardi et Jeudi de 9 h à 10 h 30 Toutes demandes (en dehors des heures de permanence) - peuvent être déposées dans la boîte aux lettres de la Mairie - peuvent être transmises par fax au 03 22 37 02 67 Janvier 2003 - peuvent être enregistrées sur le répondeur au 03 22 37 40 14 - peuvent être adressées par E.mail à l'adresse électronique suivante n° 80 [email protected] Vous pouvez consulter le site internet de la commune Arvillers http://perso.wanadoo.fr/mairie.arvillers et le site de la CCALM : http://www.ccalm.fr.st Permanence sociale avec Monsieur Viltart le vendredi de 9h à 10h LE MOT DU MAIRE Quant aux routes menant au Quesnel ainsi que celle du cimetière, elles seront pour maintenant rénovées après l'hiver. Depuis qu'on en Je présente à tous les habitants mes meilleurs voeux pour l'année parle ! nouvelle et surtout le plus important : La santé ! Les voeux du maire ne seront pas souhaités publiquement, je pense Passons au tri sélectif des déchets ; ce procédé, je vous l'avoue, ne tout simplement que ceci est inutile ; de plus, nous ne pouvons me satisfait pas, notamment pour les personnes âgées et celles sans réunir toute la population donc cela créerait des mécontentements moyen de locomotion. -

Siren : 200070969)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC Avre Luce Noye (Siren : 200070969) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Moreuil Arrondissement Montdidier Département Somme Interdépartemental non Date de création Date de création 01/01/2017 Date d'effet 01/01/2017 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Alain DOVERGNE Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Numéro et libellé dans la voie 144, rue du Cardinal Mercier Distribution spéciale Code postal - Ville 80110 MOREUIL Téléphone Fax Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité additionnelle avec fiscalité professionnelle de zone et avec fiscalité professionnelle sur les éoliennes Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non 1/5 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population Population totale regroupée 22 250 Densité moyenne 57,38 Périmètre Nombre total de communes membres : 47 Dept Commune (N° SIREN) Population 80 Ailly-sur-Noye (218000099) 2 866 80 Arvillers (218000297) 779 80 Aubercourt (218000339) 81 80 Aubvillers (218000354) 149 80 Beaucourt-en-Santerre (218000628) 174 80 Berteaucourt-lès-Thennes (218000891) 446 80 Braches (218001253) 250 80 Cayeux-en-Santerre (218001733) 122 80 Chaussoy-Epagny (218001808) 592 80 Chirmont (218001857) 129 -

Monument Aux Morts D'arvillers
Hauts-de-France, Somme Arvillers place de l' Eglise Monument aux morts d'Arvillers Références du dossier Numéro de dossier : IA80000019 Date de l'enquête initiale : 1990 Date(s) de rédaction : 2011 Cadre de l'étude : patrimoine mémoriel monuments aux morts de la Somme Degré d'étude : étudié Désignation Dénomination : monument aux morts Appellation : de la guerre de 1914-1918 Parties constituantes non étudiées : clôture Compléments de localisation Milieu d'implantation : en village Références cadastrales : . parcelle non cadastrée Historique Le monument aux morts d´Arvillers est un modèle célèbre du catalogue Gourdon (Marbreries Générales, Paris), appelé Soldat au drapeau (n° 2139). L´emplacement et le projet furent choisis par les anciens combattants de la commune. Le monument coûta environ 19 000 francs, récoltés par le comité créé à cet effet en 1923, sous la présidence de l´instituteur, et officiellement dissous en 1925. La souscription publique rapporta 12 300 francs, la municipalité versa en outre 5 000 francs. La construction du monument aux morts fit l´objet d´une délibération municipale (17 novembre 1923) approuvée par l´arrêté préfectoral du 13 décembre 1923. Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle Dates : 1923 (daté par source) Auteur(s) de l'oeuvre : Urbain Gourdon (marbrier, signature) Description Le monument aux morts d´Arvillers se situe à l´extrémité d´un mail. La clôture qui isole le monument de l´espace public est formée de piles en forme de flambeaux reliées par des chaînes. Le monument présente la forme d´une statue en fonte représentant un soldat sur un piédestal en granit belge. -

Comite Technique Place Aupres Du Centre De Gestion De La Fonction Publique Territoriale De La Somme
COMITE TECHNIQUE PLACE AUPRES DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SOMME COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 4 JUIN 2018 Représentants du personnel : 4 élus CGT (Roelens L, Defacque F-N, Gris E et Debeauvais A), 1 élu CFTC. CFDT et FO absents. Représentants des élus : 2 Secrétaire : BRIAULT Francine (représentante des élus). Secrétaire adjoint : ROELENS Linda (représentant du personnel). ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 2 MAI 2018 : Pour : 2 représentants des élus et 1 élu CFTC Contre : 4 élus CGT La CGT vote contre car elle demande depuis plusieurs années, pour permettre plus de lisibilité aux agents, le détail du vote des élus du personnel par syndicat, ce qui est refusé par l’administration. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : Friaucourt (Autorisations spéciales d’absence) : Pour : 2 représentants des élus et 1 élu CFTC Abstention / 4 élus CGT La C.G.T. est favorable à la mise en place d’astreintes pour certains services à condition que cela se fasse conformément à la réglementation en vigueur. Friaucourt (annualisation du temps de travail) : Pour : 2 représentants des élus Contre : 4 élus CGT et 1 élu CFTC La CGT précise que l’agent au regard du planning présenté constate que l’agent ca devoir travailler tous les dimanches ce qui n’est pas légal par ailleurs elle constate que le décompte annuel des heures est inexact. EVOLUTION DES ADMINISTRATIONS : Arvillers, Le Quesnel, Morisel, Hangest en Santerre, Le Plessier Rozainvillers, SISCO RPI de la Luce (Transfert de Personnel) : Pour : 2 représentants des élus Abstention : 1 élu CFTC Contre : 4 élus CGT La CGT concernant les transferts de personnel dans le cadre des transferts de compétences, s’inquiète des conséquences pour les agents concernés en matière d’obligation de mobilité sans garanties d’indemnisation. -

2 Rapport Hangest
Dossier n° E19000080/80 Projet de parc éolien « Champs perdus 2 » sur la commune T.A Amiens d’Hangest - en - Santerre RAPPORT 1 - GENERALITES 1.1) OBJET DE L'ENQUÊTE La présente enquête publique fait suite à la demande d'autorisation environnementale déposée par la Sarl "Parc éolien de Champs Perdus 2", sise à Montpellier (34), en vue d'exploiter un parc éolien comprenant six aérogénérateurs et deux postes de livraison, sur le territoire de la commune d’Hangest-en-Santerre. 1.1) 1-2) CADRE JURIDIQUE Depuis l’ordonnance 2014-355 du 20 mars 2014, promulguée en application de la loi 2014-1 du 2 janvier 2014, la construction d’un parc éolien, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, relève d’une autorisation unique dans les régions Basse- Normandie, Bretagne, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de- Calais et Picardie. Elle est complétée par le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 qui précise que "l'autorisation unique rassemble, outre l'autorisation ICPE elle-même, le permis de construire, l'autorisation de défrichement, la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et l'autorisation au titre du code de l'énergie". Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande, à l'issue d'une procédure d'instruction et d'une enquête publique unique, une autorisation préfectorale couvrant l'ensemble des volets du projet ». L’implantation d’un parc éolien relève du régime de l’autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), rubrique 2980 de la nomenclature, qui implique une instruction (articles L.512.1 à L.512.6-1 et R.512.2 à R.512.45 du Code de l’Environnement), comprenant la présentation du projet en enquête publique. -

État-Civil Informations Conseilmunicipal Vieduvillage
- 1 - ÉTAT-CIVIL INFORMATIONS CONSEIL MUNICIPAL VIE DU VILLAGE État Civil - 2 - Naissances Louison, Lola-Rose, Léontine LENOIR, née le 30 août 2019 à Amiens, domiciliée 38 bis rue Marot à Arvillers. Léna, Mercédès, Christèle ROUSSEAUX, née le 11 novembre 2019 à Amiens, domiciliée 13 rue Tourniche à Arvillers. Ninon, Catherine, Angélique LELIÈVRE, née le 20 novembre 2019 à Amiens, domiciliée 16 rue Là-Haut à Arvillers. Décès Jean FLAMENT, domicilié 20 rue des Vergeaux à Arvillers, décédé le 3 décembre 2019 à Roye, à l’âge de 100 ans. Jean-Marc CHIRAULT, domicilié 51 rue d’Hangest à Arvillers, décédé en son domicile le 22 décembre 2019, dans sa 48ième année. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 10h30. Le 1er samedi de chaque mois (octobre à juin) de 9h à 10h. Permanence sociale avec M.COTTARD le vendredi de 9h à 10h. Merci de respecter les horaires. Toutes demandes (en dehors des permanences) peuvent être : déposées dans la boîte aux lettres de la mairie transmises par fax au 03 22 37 02 67 enregistrées sur le répondeur au 03 22 37 40 14 ou 09 62 26 99 57 adressées par email à l’adresse électronique : [email protected] Pas de permanence de secrétariat Les premiers samedis de juillet, août et septembre. Adresse du site de la commune d’Arvillers : http://pagesperso-orange.fr/mairie.arvillers/ Monsieur Jean Flament, très attaché à Arvillers, était depuis plusieurs années le doyen de notre commune. Comme vous l’avez lu dans l’état-civil, il nous a malheureusement quittés un mois après avoir fêté son centenaire. -

Conditions De Circulation Sur Le Réseau Routier Départemental Jusqu'au 20
Conditions de circulation sur le réseau routier départemental jusqu’au 20 juillet 2021 Amiens, le mardi 13 juillet 2021 Secteur Picardie Maritime RD 925 en agglomération de Valines. Travaux d'assainissement eaux usées terminés le 9 juillet 2021 . Circulation restreinte par signaux tricolores y compris week-end et jours fériés. Limitation de vitesse à 30km/h. RD 933 hors agglomération de Prouville. Travaux de mise en place de réseau sur la parc éolien prévus jusqu’au 16 juillet 2021. Circulation alternée par signaux tricolores de 7h00 à 18h00, hors week-end. Limitation de vitesse à 50km/h. Dépassement interdit. RD 211 en agglomération de Brocourt. Travaux de réfection de l'ouvrage d'art prévus jusqu’au 16 juillet 2021. Circulation interdite. Déviation mise en place par les RD 29 et RD 25 via les communes de Oisemont et Sénarpont. RD 933 hors agglomération de Montigny-les-Jongleurs et Maizicourt. Travaux de remplacement de garde corps sur un ouvrage d’art prévus du 13 au 16 juillet 2021. Circulation alternée par signaux tricolores de 8h00 à 18h00. RD 928 hors agglomération d’Abbeville. Course « Club de Karting » prévu le 27 juillet 2021. Limitation de vitesse à 70km/h. Stationnement interdit. RD 2 hors agglomération de Friville-Escarbotin et Saint-Blimont. Travaux de renouvellement du réseau prévus du jusqu’au 6 août 2021. Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h00 à 18h00, hors week-end et jours fériés. RD 1001 en agglomération de Le Titre. Travaux de réaménagement sur la traverse prévus jusqu’au 14 août 2021. Circulation restreinte par signaux tricolores jours et nuits. -

60 DAVENESCOURT – MOREUIL – AMIENS PROJET HORAIRES VALABLES DU 1Er SEPT
60 DAVENESCOURT – MOREUIL – AMIENS PROJET HORAIRES VALABLES DU 1er SEPT. 2016 AU 7 JUIL. 2017 PERIODE SCOLAIRE PETITES VACANCES Jours de circulation > LMmJVS mS LMmJVS mS GUERBIGNY Place 1 06:20 12:40 1 06:20 12:40 WARSY Mairie 2 06:21 12:41 2 06:21 12:41 DAVENESCOURT Eglise (panneau trait vert) 3 06:30 12:50 3 06:30 12:50 CONTOIRE HAMEL Mairie 4 06:36 12:56 4 06:36 12:56 LE PLESSIER ROZAINVILLERS Avenue des acacias 5 06:44 13:04 5 06:44 13:04 MOREUIL Centre Culturel 6 06:52 13:12 6 06:52 13:12 THENNES Route Principale 7 06:57 13:17 7 06:57 13:17 BERTEAUCOURT LES THENNES Jean Jaurès 8 06:58 13:18 8 06:58 13:18 HAILLES Place de l'Eglise 9 07:05 13:25 9 07:05 13:25 FOUENCAMPS Mairie 10 07:11 13:31 10 07:11 13:31 BOVES Eglise (1) 11 07:20 13:40 11 07:20 13:40 AMIENS Arrêt AMETIS Eglise St Acheul 12 07:33 13:53 12 07:33 13:53 AMIENS Gare Routière 13 07:40 14:00 13 07:40 14:00 Jours de circulation : L Lundi; M Mardi; m Mercredi; J Jeudi; V Vendredi; S Samedi; D Dimanche Attention: Les cars ne circulent pas les jours fériés (lundi de Pentecôte compris). Correspondance entre services trans'80 A BOVES, à 7:20, correspondance avec la ligne 41 en direction d'AMIENS arrêts Collège JM Laurent et Cité scolaire (1): Ne prend pas de voyageurs pour AMIENS. -

La Nouvelle Communauté De Communes Issue
Article lef : La nouvelle communauté de communes issue de la fusion de la communauté de communes Avre Luce Moreuil et de la communauté de communes du Val de Noye est créée à compter du 1er janvier 2017 et est ainsi dénommée : « communauté de communes Avre Luce Noye » Elle est composée des quarante-neuf (49) communes suivantes : AILLY-SUR-NOYE, ARVILLERS, AUBERCOURT, AUBVILLERS, BEAUCOURT-EN- SANTERRE, BERTEAUCOURT-LES- THENNES, BRACHES, CAYEUX-EN-SANTERRE, CHAUSSOY-EPAGNY, CH1RMONT, CONTOIRE, COTTENCHY, COULLEMELLE, DEMUIN, DOMART-SUR-LA-LUCE, DOMMARTIN, ESCLAINVILLERS, FLERS-SUR-NOYE, FOLLEV1LLE, FOUENCAMPS, FRANSURES, FRESNOY-EN-CHAUSSEE, GR1VESNES, GUYENCOURT-SUR-NOYE, PIAILLES, HALLIVILLERS, HANGARD, HANGEST-EN- SANTERRE, IGNAUCOURT, JUMEL, LA FALOISE, LA NEUVILLE- SIRE-BERNARD, LAWARDE-M AUGER-L'HORTOY, LE PLESSIER-ROZA1NVILLERS, LE QUESNEL, LOUVRECHY, MA1LLY-RA1NEVAL, MEZIERES-EN-SANTERRE, MOREUIL, MORISEL, PIERREPONT-SUR-AVRE, QUIRY-LE-SEC, ROGY, ROUVREL, SAUVLLLERS-MONGIVAL, SOURDON, THENNES, THORY, VILLERS-AUX ERABLES issues des deux anciennes communautés de communes fusionnées dont le périmètre de chacune figure en annexe 1 du présent arrêté. Article 2 : Le siège de communauté de communes Avre Luce Noye est fixé 144 rue du Cardinal Mercier à MOREUIL (80110). Article 3 : La communauté de communes Avre Luce Noye est constituée pour une durée illimitée. Article 4 : La représentativité de chaque commune au sein de l'organe délibérant de la communauté de communes Avre Luce Noye sera déterminée par arrêté préfectoral avant le 31 décembre