Histoires De Sachs Et De Corde
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
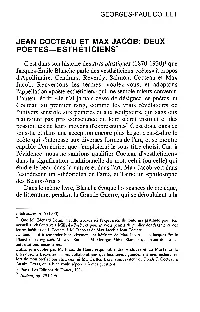
Jean Cocteau Et Max Jacob: Deux Poetes-Esthéticiens*
GEORGES-PAUL COLLET JEAN COCTEAU ET MAX JACOB: DEUX POETES-ESTHÉTICIENS* C'est dans son histoire des Arts plastiques (1870-1930)1 que Jacques-Émile Blanche parle des «esthéticiens-poètes» à propos d'Apollinaire, Cendrars, Reverdy, Salmon, Cocteau et Max Jacob. Renversons les termes, voulez-vous, et adoptons l'appellation «poète-esthéticien» qui me semble mieux convenir. L'auteur écrit: «Je n'ai jamais cessé de désigner les poètes, et Cocteau au premier rang, comme les vrais révélateurs de l'univers sensible aux peintres et aux sculpteurs, qui sans eux n'auraient pas pris conscience de leur secret instinct et des possibilités de leurs moyens d'expression.»2 C'est donc dans ce sens-là, et dans une acception encore plus large, c'est-à-dire le poète qui s'intéresse aux diverses formes de l'art, et se montre capable d'en écrire, que j'emploierai le sous-titre choisi. Car, à l'évidence, nous ne saurions qualifier Cocteau d'«esthéticien» dans la signification traditionnelle du mot: celui (ou celle) qui étudie le beau dans la nature et dans l'art. Max Jacob voit dans l'esthéticien un «théoricien de l'art>>, et Taine un «philosophe des Beaux-Arts.» Dans le même livre, Blanche évoque les séances de musique, de littérature, pendant la Grande Guerre, qui se déroulaient à la Littératures, n° 5 (1990) *. Que M. Édouard Dennit veuille trouver ici l'expression de toute ma gratitude pour son accueil si chaleureux à Milly-la-Forêt, et pour m'avoir pennis de publier des fragments des lettres inédites de J. -

Roditi, Edouard (1910-1992) by John Mcfarland
Roditi, Edouard (1910-1992) by John McFarland Encyclopedia Copyright © 2015, glbtq, Inc. Entry Copyright © 2006 glbtq, Inc. Reprinted from http://www.glbtq.com Poet, translator, literary and art critic, and short story writer, Edouard Roditi was associated with most of the twentieth-century's avant-garde literary movements from Surrealism to post-modernism. For more than sixty years, he produced such an astonishing variety of smart, lively, and moving poetry and prose that nobody objected when he dubbed himself "The Pharaoh of Eclecticism." A member of several predominantly homosexual social circles, Roditi maintained friendships with literary and artistic figures ranging from Paul Bowles and Jean Cocteau to Paul Tchelitchew and Christian Dior. His art and literary criticism held artists and writers to the very highest standards and insisted that intense but uncritical infatuation with flashy new trends could end in disappointment and heartbreak. His Internationalist Birthright Roditi was born in Paris on June 6, 1910. He was the beneficiary of a remarkably rich confluence of heritages--Jewish, German, Italian, French, Spanish, and Greek--and was truly international, both American and European. His father, Oscar, an Italian born in Constantinople, had become a United States citizen after his father emigrated to America and gained citizenship. Although Oscar's father had left the family behind in Europe, all the family in Europe became citizens when he did by virtue of the citizenship statutes in force at that time. Roditi's mother, Violet, had an equally rich family history. She was born in France but became an English citizen in her youth. When she married Oscar, she too became a United States citizen. -

Jean Cocteau's the Typewriter
1 A Queer Premiere: Jean Cocteau’s The Typewriter Introduction Late in April 1941, toward the close of the first Parisian theatre season fol- lowing the Defeat, Jean Cocteau’s La Machine à écrire (The Typewriter) opened, then closed, then reopened at the Théâtre Hébertot. Written in the style of a detective drama, the play starred the actor generally known—at least in the entertainment world at the time—as Cocteau’s sometime lover and perpetual companion, Jean Marais, as identical twin brothers. The re- views are curiously reticent about what exactly occurred at the Hébertot, and historians and critics offer sometimes contradictory pieces of a puzzle that, even when carefully put together, forms an incomplete picture. The fragments are, however, intriguing. Merrill Rosenberg describes how, on the evening of April 29, 1941, the dress rehearsal (répétition génerale), sponsored “as a gala” by the daily Paris-Soir and attended by various “dig- nitaries,” caused in the Hébertot’s auditorium a demonstration by members of the Parti Populaire Français (PPF). This disruption prompted Vichy’s ambas- sador to Paris, Fernand de Brinon, to order the withdrawal of the production (“Vichy’s Theatrical Venture” 136). Francis Steegmuller describes the disor- der that greeted the Typewriter premiere and the revival of Les Parents Terribles (at the Gymnase later that year): “stink bombs exploded in the theatres, and hoodlums filled the aisles and climbed onto the stage, shouting obscenities at Cocteau and Marais as a couple” (442).1 Patrick Marsh too notes that these plays “were seriously disrupted by violent scenes fomented by fascist sym- pathizers and members of the Parti Populaire Français” (“Le Théâtre 1 2 THE DRAMA OF FALLEN FRANCE Français . -

El Ysium Books
EL YS IUM BOOKS Shortlist #10 1. ALCIBIADE (Rocco, Antonio). Alcibiade Enfant a l'Ecole. Amsterdam and Paris: Aux depens d'une Socièté d'Amateurs [Marcel Seheur]. (1936). This uncommon and controversial text on ped- erasty bears an introduction by "Bramatos." The illustrations are not present. Pia 12. One of 250 hand numbered copies, this example #26. Very good in original salmon colored wrappers and contemporary 3/4 leather binding. Quite uncommon. $275. 2. ANONYMOUS. Circusz. [Budapest, c. 1940s]. 16to, 32 pp. An amusing collection of erot- ic circus acts, with rhyming text (in Hungarian). Most of the images involve assorted heterosexual couplings, but one image involves two male performers. Good in somewhat soiled illustrated wrappers, light wear. Undoubtedly an underground production that was only sold in limited numbers. Quite uncommon. $250. 3. ANONYMOUS. Guirlande de Priape. Texte et dessins par deux illustres médecins parisiens. A l'étal de gomorrhe, l'an de grace 1933. Sixteen erotic vignettes are accompanied by twenty quite explicit illus- trations by Jean Morisot. One of the texts is entitled "Soliloque de Corydon" and is attributed to "Victor Hugo." The twenty illustrations are ribald and encompass a range of sexual activities. One of 300 numbered copies. A very good example in original wrappers, chemise and slip- case, with only light wear. Dutel 1684. $250. 4. (ANONYMOUS). A Housemaster and His Boys (By one of them). London: Edward Arnold (1929). 120pp. First hand account of life in a boys school, with details on hazing, etc. Very good in mustard boards, lightly spotted. $120. 5. BERARD, Christian. -

Jean Cocteau and Georges Auric
Jean Cocteau and Georges Auric: The Poésie and Music That Shaped Their Collaboration in the Mélodies, Huit poèmes de Jean Cocteau (1918) Deborah A Moss BMus (Hons) MMus A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) Kingston University March 2021 Abstract Jean Cocteau and Georges Auric: The Poésie and Music That Shaped Their Collaboration in the Mélodies, Huit poèmes de Jean Cocteau (1918) Georges Auric (1899–1983) was the preferred musician of the author, impresario, cinematograph and artistic innovator Jean Cocteau (1889–1963). This was borne out by their fifty-year friendship and working relationship. Auric composed the soundtracks for all of Cocteau’s films. Their long-term alliance was based on mutual admiration and a shared transdisciplinary artistic aesthetic, motivated at the start by a desire to initiate a post-First World War new French musical identity. The collaboration did not fulfil the generally accepted understanding of the term, that of working simultaneously and in close proximity. Their creative processes were most successful when they worked individually and exchanged ideas from a distance through published correspondence and articles. Jean Cocteau’s creative practice spanned all of his artistic disciplines except music. Indeed, he chose not to be restricted by the limitations of any particular art form. Yet, he had a strong musical affinity and music was integral to the shaping of his diverse productions. He longed to be a musician and relied on Georges Auric to fill the musical void in his artistic practice. This thesis explores two mélodies, Hommage à Erik Satie and Portrait d’Henri Rousseau, the first and last, in Auric’s song series Huit poèmes de Jean Cocteau (1918)—one of his early collaborations with Cocteau. -

PDF Hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/60808 Please be advised that this information was generated on 2021-09-27 and may be subject to change. Kronieken voor een nieuwe tijd: Le Roseau d'or als cultureel brandpunt van een katholiek netwerk MATHIJS SANDERS Begin juni 1923 verruilde de filosoof Jacques Maritain zijn woonplaats Ver- sailles voor het Parijse voorstadje Meudon, waar hij een woning had gekocht van het geld dat een in juni 1918 gesneuvelde bewonderaar, de infanterie- korporaal Pierre Villard, hem had nagelaten.' In zijn kielzog volgden den- kers, schrijvers en kunstenaars en aldus werd Meudon in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw een centrum van intellectuele en artistie- ke bedrijvigheid. Zij die Maritain naar Meudon volgden voelden zich aan- getrokken tot het programma dat hij in de jaren na de eerste wereldoorlog ontvouwde, dat van een `renouveau catholique': een herstelbeweging die de moderne cultuur wilde bezielen met de eeuwenoude katholieke filosofie van de scholasticus Thomas van Aquino. Maritain voegde zich in zijn den- ken naar het neothomisme, een beweging binnen de katholieke kerk die met de pauselijke encycliek Aeterni patris van Leo x i i I uit 1878 op gang was gekomen met als doel de katholieke geloofsleer van een stevig wijsgerig fun- dament te voorzien, waarmee deze de moderne tijd zou kunnen doorstaan.2 De beweging die Maritain vanuit Meudon op gang bracht, en die wel is ge- karakteriseerd als een `révolution á rebours', zou niet alleen de westerse cul- tuur van een wisse ondergang moeten redden, maar beoogde ook de eigen- tijdse literatuur te vernieuwen via een eeuwenoude traditie.