Le Sarthon Et Ses Affluents
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

DSDEN De L'orne Service Des Elèves, De La Vie Des Ecoles Et Des Etablissements
DSDEN de l'Orne Service des Elèves, de la Vie des Ecoles et des Etablissements SECTEURS DE RECRUTEMENT DES COLLEGES PUBLICS DE L'ORNE BE CENTRE ORNE BE BOCAGE ORNAIS BE PERCHE PAYS D'OUCHE HORS DEPARTEMENT BE CENTRE ORNE Secteur d' ALENCON : 4 collèges (Honoré de Balzac, Louise Michel, Jean Racine, Antoine de St Exupéry) ALENCON selon quartiers CUISSAI H. de Balzac MENIL ERREUX Saint-Exupéry ST NICOLAS DES BOIS H. de Balzac CERISE Saint-Exupéry DAMIGNY H. de Balzac PACE J. Racine SEMALLE Saint-Exupéry COLOMBIERS H. de Balzac FORGES H. de Balzac RADON H. de Balzac Est : St-Exupéry VALFRAMBERT Est : H. de Balzac LARRE Saint-Exupéry ST DENIS S SARTHON J. Racine Ouest : H. de Balzac CONDE SUR SARTHE Ouest : J. Racine LONRAI H. de Balzac ST GERMAIN DU CORBEIS J. Racine VINGT HANAPS H. de Balzac Communes hors département ARCONNAY '(72) Louise Michel CHENAY '(72) Saint-Exupéry LIGNIERE LA CARELLE Saint-Exupéry SAINT PATERNE '(72) Louise Michel CHASSE '(72) Saint-Exupéry LE CHEVAIN '(72) Saint-Exupéry MONTIGNY '(72) Saint-Exupéry Secteur d' ARGENTAN : 2 collèges (Jean Rostand, François Truffaut) ALMENECHES Jean Rostand JUVIGNY SUR ORNE Jean Rostand MEDAVY Jean Rostand SEVIGNY Jean Rostand ARGENTAN selon quartiers François Truffaut MOULINS SUR ORNE François Truffaut SILLY EN GOUFFERN Jean Rostand LA BELLIERE AUNOU LE FAUCON Jean Rostand Brassens Ecouché OCCAGNES Jean Rostand UROU ET CRENNES Jean Rostand BOISSEI LA LANDE Jean Rostand LE BOURG SAINT LEONARD Jean Rostand SAI Jean Rostand VILLEBADIN Jean Rostand COMMEAUX Jean Rostand LA COCHERE Jean -

La Qualité De L'hôpital Le Confort De Son Domicile
Qualité Qualité •• 02 33 32 91 99 02 33 32 91 99 ✆✆ Sécurité Sécurité Alençon – La Ferté Macé / Domfront Alençon – La Ferté Macé / Domfront La qualité de l’hôpital Continuité des soinsContinuité des soins Le confort de son domicile 135160 - bémographic 02 33 82 83 84 (06-16) iF (06-16) 84 83 82 33 02 bémographic - 135160 SAINT-CLAIR- DE-HALOUZE LIGNOU LONLAY-L'ABBAYE SAINT-BOMER- LES-FORGES LONLAY- LE-TESSON SAINTE- MARIE- ROUELLE LA HAUTE-CHAPELLE SAINT-MAURICE- BEAUVAIN LA- SAUVAGERE DU-DESERT LE CHAMP ROBERT SAINT- CHAMPSECRET DE-LA-PIERRE GILLES- LA CHAUX SAINTE- SAINT-ROCH- DES- SAINT- MARGUERITE- SAINT-MICHEL- DE-CARROUGES SUR-EGRENNE MARAIS DES-ANDAINES JOUE-DU-BOIS MARTIN- PERROU LA L'AIGUILLON JUVIGNY- FERTE-MACE SOUS- LA MOTTE- CARROUGES SAINT- MAGNY-LE- SAINT-MARS-D'EGRENNE LUCE ANDAINE LA BAGNOLES- DESERT FOUQUET CHAHAINS BRICE CHAPELLE- DE-L'ORNE TORCHAMP SAINT-MARTIN- ROUPERROUX AVRILLY D'ANDAINE COUTERNE SAINT- BAROCHE- BEAULANDAIS TESSE- DES-LANDES FONTENAI- SAINT-GERVAIS- FROULAY SAINT-PATRICE- SAINT- DIDIER- LES-LOUVETS BURSARD SOUS-LUCE ANTOIGNY SOUS-ECOUVES DU-PERRON ESSAY SAINT-DENIS- DU-DESERT ELLIER- MANTILLY GENESLAY HALEINE LES-BOIS DE-VILLENETTE MEHOUDIN SAINT-FRAIMBAULT VINGT-HANAPS SAINT-OUEN- LONGUENOE MENIL-ERREUX LE-BRISOULT CIRAL SEPT-FORGES LIVAIE SAINT-NICOLAS- RADON NEUILLY- DES-BOIS FORGES EPINAY- LORE ROCHE- LARRE LE-BISSON LE-COMTE MABILE LA LACELLE HAUTERIVE SEMALLE SAINT-SIMEON GANDELAIN CUISSAI COLOMBIERS MENIL-BROUT SAINT-DENIS- VALFRAMBERT CHASSE SUR-SARTHON ROULLE LONRAI MONTIGNY BLEVES PACE -

Destinataires in Fine Mesdames Et Messieurs Les Maires Des
Destinataires in fine Mesdames et Messieurs les Maires des communes de : Argentan - Aunou le faucon – Avoine – Bailleul – Beauvain – Boischampré - Bouce – Briouze – Brullemail – Carrouges – Chahains – Chanu – Commeaux – Courtomer – Cramenil – Croisilles – Echauffour – Ecouché les vallées - Exmes – Faverolles - Ferrières La Verrerie – Fleure - Fontenai les Louvets - Fontenai sur Orne – Gaprée – Ginai – Godisson – Goulet - Joue du Bois - Joue du Plain - Juvigny sur Orne - La Chaux - La Cochère - La Ferté Macé - La Genevraie - La Lande de Goult - La Lande de Louge - Le Bourg Saint Léonard - Le Champ de la Pierre - Le Grais - Le Menil Ciboult - Le Menil de Briouze - Le Menil Scelleur - Le Menil Vicomte - Le Merlerault - Le Pin Au Haras - Les Authieux du Puits - Les Monts d’Andaine - Les Yveteaux Ligneres – Lignou - Lonlay le Tesson - Louge sur Maire - Magny le Désert - Menil Froger – Moncy- Montsecret-Clairefougère - Montabard – Montgaroult - Montreuil au Houlme - Moulins sur Orne – Necy - Nonant le Pin – Occagnes – Pointel – Ranes – Ri – Ronai – Rouperroux – Sai - Saint Andre de Briouze - Saint Brice sous Ranes - Saint Christophe de Chaulieu - Saint Didier sous Ecouves - Saint Elllier les Bois - Saint Georges d’Annebecq - Saint Germain de Clairefeuille - Saint Germain le Vieux - Saint Hilaire de Briouze - Saint Léonard des Parcs - Saint Martin des Landes - Saint Martin l’Aiguillon - Saint Pierre d’Entremont - Saint Quentin les Chardonnets - Saint Sauveur de Carrouges - Sainte Marguerite de Carrouges - Sainte Marie la Robert - Sainte Opportune -
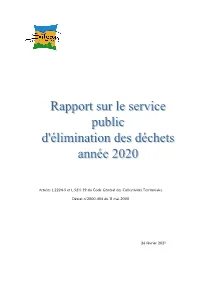
Rapport 2020.Pdf
Articles L.2224-5 et L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales Décret n°2000-404 du 11 mai 2000 26 février 2021 Rapport annuel sur le service public d’élimination des déchets Page 1/17 2019 Sommaire 1. Indicateurs techniques 2 1.1. Indicateurs relatifs à la collecte des déchets 2 1.1.1. Territoire desservi 2 1.1.2. Types de collectes 3 1.1.3. Déchèteries 4 1.1.4. Collectes séparatives 8 1.1.5. Collecte des déchets ne provenant pas des ménages 11 1.2. Production totale 12 1.3. Indicateurs relatifs au traitement des déchets 13 2. Indicateurs financiers 2.1. Modalités d’exploitation du service 13 2.2. Montants des dépenses du service 13 2.3. Autres indicateurs financiers 2.3.1. Régie de rotation de bennes de déchèteries 15 2.3.2. Montants des recettes reçues d’organismes extérieurs 16 2.3.3. Autres recettes 16 2.4. Contributions 16 3. Conclusion 17 Rapport annuel sur le service public d’élimination des déchets Page 2/17 2019 1. Indicateurs techniques 1.1. Indicatifs relatifs à la collecte des déchets 1.1.1. Territoire desservi Le territoire desservi concerne 86 communes représentant 46 305 habitants (population légale municipale). Les communes concernées sont les suivantes : ARGENTAN Argentan Intercom 13823 ST LAMBERT SUR DIVE Argentan Intercom 149 AUNOU LE FAUCON Argentan Intercom 246 TANQUES Argentan Intercom 157 AVOINE Argentan Intercom 218 TOURNAI SUR DIVE Argentan Intercom 307 BAILLEUL Argentan Intercom 608 TRUN Argentan Intercom 1245 BOISCHAMPRE Argentan Intercom 1199 VIEUX PONT Argentan Intercom 198 BOUCE Argentan -

Atlas Des Paysages De L'orne | Unité Paysagère Des Crêtes Forestières D’Andaine
Unité paysagère ATLAS DES PAYSAGES DE L’ORNE 10 Les crêtes forestières d’Andaine Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Normandie www.normandie.developpement-durable.gouv.fr Atlas des paysages de l'Orne | Unité paysagère des crêtes forestières d’Andaine Sommaire Pages Introduction 3 Caractéristiques de l’unité paysagère 3 Structure paysagère n°1 : les marches de la forêt d‘Andaine 6 Structure paysagère n°2 : la vallée bocagère mixte de la Vée, entre les crêtes 9 Structure paysagère n°3 : les vallonnements bocagers des Déserts 12 Matériaux et architecture 15 Qualification de l’unité paysagère 17 L'unité paysagère telle qu'elle est perçue localement 17 Les éléments structurants et ponctuels reconnus 17 Entre modèles locaux et globaux, des motifs d’attachement partagés 18 ou plus confidentiels Les limites de l’unité paysagère 18 Les dynamiques paysagères à l’oeuvre 21 Dynamiques paysagères analysées par les paysagistes 22 Légers vallonnements et forte présence du bocage. Vers Bagnoles de l'Orne. Les dynamiques perçues lors des ateliers 27 Entre dynamiques réelles et dynamiques perçues 28 Atouts / faiblesses / opportunités / menaces 28 Atouts et opportunités 29 Faiblesses et menaces 29 Liste des communes concernées en tout ou partie 29 Photo de couverture : Fond de vallée, avec une maille bocagère arborée assez dense, qui encadre des parcelles pâturées. Vers La Coulonche. 2 Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Normandie Agence AGAP - Urbanisme & Paysage et Environnement & Société – Sociologie urbaine Introduction Caractéristiques de l’unité paysagère La faille géologique majeure, qui a participé à la création des crêtes d’Andaine, sur environ 30 km de la partie sud de l’unité, marque une limite franche avec la poiraie du Caractériser un paysage vise à décrire les traits caractéristiques Domfrontais plus au sud. -

8. 2. 90 Gazzetta Ufficiale Delle Comunità Europee N. C 30/35
8. 2. 90 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 30/35 Proposta di direttiva del Consiglio del 1989 relativa all'elenco comunitario delle zone agrìcole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia) COM(89) 434 def. (Presentata della Commissione il 19 settembre 1989) (90/C 30/02) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando che la richiesta di cui trattasi verte sulla classificazione di 1 584 695 ha, di cui 8 390 ha ai sensi visto il trattato che istituisce la Comunità economica dell'articolo 3, paragrafo 3, 1511 673 ha ai sensi europea, dell'articolo 3, paragrafo 4 e 64 632 ha ai sensi dell'articolo vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE; 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (*), modificata da ultimo dal regolamento considerando che i tre tipi di zone comunicati alla (CEE) n. 797/85 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, Commissione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE ; che, in effetti, il vista la proposta della Commissione, primo tipo corrisponde alle caratteristiche delle zone montane, il secondo alle caratteristiche delle zone svantag visto il parere del Parlamento europeo, giate minacciate di spopolamento, in cui è necessario considerando che la direttiva 75/271/CEE del Consiglio, conservare l'ambiente naturale e che sono composte di del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle terreni agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni zone -

CC Du Pays Fertois Et Du Bocage Carrougien (Siren : 200071652)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien (Siren : 200071652) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Carrouges Arrondissement Alençon Département Orne Interdépartemental non Date de création Date de création 13/12/2016 Date d'effet 01/01/2017 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président Mme Claudine BELLENGER Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 8 Rue du Crochet Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 61320 CARROUGES Téléphone Fax Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité additionnelle sans fiscalité professionnelle de zone et sans fiscalité professionnelle sur les éoliennes Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non 1/3 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population Population totale regroupée 5 063 Densité moyenne 21,77 Périmètre Nombre total de communes membres : 19 Dept Commune (N° SIREN) Population 61 Beauvain (216100354) 277 61 Carrouges (216100743) 663 61 Chahains (216100800) 85 61 Joué-du-Bois (216102095) 422 61 La Chaux (216101048) 53 61 La Lande-de-Goult (216102160) 194 61 La Motte-Fouquet (216102954) 164 61 Le Champ-de-la-Pierre (216100859) 37 61 Le Ménil-Scelleur (216102715) 88 61 Magny-le-Désert (216102434) 1 443 61 Méhoudin (216102574) -

Rapport D'activité 2014
Rapport d’activité 2014 Orne (61) • 105 communes Antoigny, Aunay-les-Bois, Avrilly, Bagnoles-de-l’Orne, La Baroche-sous-Lucé, Beaulandais, Beauvain, La Bellière, Boitron, Le Bouillon, Bursard, Carrouges, Ceaucé, Le Cercueil, Chahains, Champsecret, Le Champ-de-la-Pierre, La Chapelle-d’Andaine, La Chapelle-près-Sées, La Chaux, Colombiers, La Coulonche, Coulonges-sur-Sarthe, Couterne, Cuissai, Domfront, Dompierre, L’Épinay-le-Comte, Essay, La Ferrière-aux-Étangs, La Ferrière-Béchet, La Ferrière- Bochard, La Ferté-Macé, Fontenai-les-Louvets, Francheville, Gandelain, Geneslay, Haleine, Manche (50) • 6 communes La Haute-Chapelle, Hauterive, Héloup, Joué-du-Bois, Juvigny-sous-Andaine, La-Lacelle, Laleu, La Lande-de-Goult, Larré, Livaie, Lonlay-l’Abbaye, Loré, Lucé, Mantilly, Magny-le-Désert, Barenton, Bion, Ger, St-Cyr-du-Bailleul, Marchemaisons, Méhoudin, Le Ménil-Broût, Ménil-Erreux, Le Ménil-Scelleur, Mieuxcé, La Motte- St-Georges-de-Rouelley, St-Jean-du-Corail Fouquet, Neauphe-sous-Essai, Neuilly-le-Bisson, Pacé, Passais-la-Conception, Perrou, Radon, La Roche-Mabile, Rouellé, Rouperroux, St-Aubin-d’Appenai, St-Bômer-les-Forges, St-Brice, St-Céneri-le-Gérei, St-Christophe-le-Jajolet, St-Denis-de-Villenette, St-Denis-sur-Sarthon, St-Didier-sous-Écouves, St-Fraimbault, St-Gervais-du-Perron, St-Gilles-des-Marais, St-Hilaire- la-Gérard, St-Julien-sur-Sarthe, St-Léger-sur-Sarthe, St-Mars-d’Égrenne, St-Martin-des-Landes, St-Martin-l’Aiguillon, St-Maurice-du-Désert, St-Michel-des-Andaines, St-Nicolas-des-Bois, St-Ouen-le-Brisoult, St-Patrice-du-Désert, St-Roch-sur-Égrenne, St-Sauveur-de-Carrouges, St-Siméon, Ste-Marguerite-de-Carrouges, Ste-Marie-la-Robert, La Sauvagère, Sées, Sept-Forges, Athis-de-l'Orne Tanville, Tessé-Froulay, Torchamp, Les Ventes-de-Bourse, Vingt-Hanaps, Vrigny. -

Ouverture De La Procédure D'indemnisation De La Calamité
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Calamité sécheresse 2020 sur fourrages : Alençon, le 3 mai 2021 ouverture de la procédure d’indemnisation Par arrêté du 26 avril 2021, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a reconnu le caractère de calamité agricole de la sécheresse 2020 pour les pertes sur les fourrages sur 254 communes (voir liste ci-dessous). Cet arrêté fait suite à l’avis du Comité National de Gestion des Risques en Agriculture du 14 avril 2021. Quels sont les dommages indemnisables ? Les dommages indemnisables sont les pertes de récolte sur les prairies situées dans la zone reconnue en calamité. Qui peut être indemnisé ? • Tout exploitant agricole justifiant d'une assurance incendie couvrant les éléments principaux de l'exploitation, • Ayant tout ou partie de ses surfaces en prairies localisées dans la zone reconnue en calamité agricole, • ET démontrant une perte supérieure à 13% de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation. • Seuls peuvent être pris en considération, en vue de leur indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, les dossiers individuels relatifs à des dommages dont le montant des pertes indemnisables atteint la somme minimale de 1000 euros. Modalités pratiques : 2 façons de déposer vos demandes : • Télédéclaration via TéléCALAM : procédure électronique pratique, rapide, sécurisée (utilisation d’un identifiant et d’un mot de passe personnels), sans justificatifs à transmettre sauf un RIB, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; l’accès se fait par internet sur le site : http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr rubrique « TéléCALAM », la téléprocédure est ouverte à compter du 10 mai jusqu’au 15 juin 2021. -

Rapport D'activité 2016
Rapport d’activité 2016 Orne (61) 87 communes et 6 villes-portes Alençon, Argentan, Athis-Val de Rouvre, Aunay-les-Bois, Avrilly, Bagnoles-de-l’Orne-Normandie, Beauvain, Boischampré, Boitron, Bursard, Carrouges, Ceaucé, Chahains, Champsecret, Colombiers, Coulonges-sur-Sarthe, Cuissai, Domfront-en-Poiraie, Dompierre, Écouves, Essay, Fontenai-les-Louvets, Francheville, Gandelain, Hauterive, Héloup, Joué-du-Bois, Juvigny-Val- d’Andaine, La Bellière, La Chapelle-près-Sées, La Chaux, La Coulonche, La Ferrière-aux-Étangs, Manche (50) La Ferrière-Béchet, La Ferrière-Bochard, La Ferté-Macé, La Lande-de-Goult, La Motte-Fouquet, 4 communes et 1 ville-porte La Roche-Mabile, La Lacelle, Laleu, Larré, Le Bouillon, Le Cercueil, Le Champ-de-la-Pierre, Le Mêle-sur-Sarthe, Le Ménil-Broût, Le Ménil-Scelleur, Les Monts d’Andaine, Les Ventes-de- Barenton, Ger, Mortain-Bocage, Saint-Cyr-du-Bailleul, Bourse, Livaie, Lonlay-l’Abbaye, Magny-le-Désert, Mantilly, Marchemaisons, Méhoudin, Ménil- Saint-Georges-de-Rouelley. Erreux, Mieuxcé, Mortrée, Neauphe-sous-Essai, Neuilly-le-Bisson, Pacé, Passais Villages, Perrou, Rânes, Rives-d’Andaine, Rouperroux, Saint-Aubin-d’Appenai, Saint-Bômer-les-Forges, Saint-Brice, Saint-Céneri-le-Gérei, Saint-Denis-sur-Sarthon, Saint-Didier-sous-Écouves, Sainte-Marguerite-de-Carrouges, Sainte-Marie-la-Robert, Saint-Fraimbault, Saint-Gervais-du- Perron, Saint-Gilles-des-Marais, Saint-Hilaire-la-Gérard, Saint-Julien-sur-Sarthe, Saint-Léger- sur-Sarthe, Saint-Mars-d’Égrenne, Saint-Martin-des-Landes, Saint-Martin-l’Aiguillon, Saint- Nicolas-des-Bois, Saint-Ouen-le-Brisoult, Saint-Patrice-du-Désert, Saint-Roch-sur-Égrenne, Saint-Sauveur-de-Carrouges, Sées, Tanville, Tessé-Froulay, Torchamp. -

Concerning the Community List of Less-Favoured Farming Areas Within the Meaning of Directive the Requirements for Less-Favoured
15 . 11 . 89 Official Journal of the European Communities No L 330 / 31 COUNCIL DIRECTIVE of 23 October 1989 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( France ) ( 89 / 587 /EEC ) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Whereas the three types of areas communicated to the Commission satisfy the conditions laid down in Article 3 ( 3 ), Having regard to the Treaty establishing the European ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 / 268 /EEC ; whereas the first meets Economic Community , the requirements for mountain areas, the second meets the requirements for less-favoured areas in danger of Having regard to Council Directive 75 /268 /EEC of 28 April depopulation where the conservation of the countryside is 1975 on mountain and hill farming and farming in certain necessary and which are made up of farming areas which are less-favoured areas (*), as last amended by Regulation ( EEC ) homogeneous from the point of view of natural production No 797/ 85 ( 2 ), and in particular Article 2 ( 2 ) thereof, conditions , and the third meets the requirements for areas affected by specific handicaps ; Having regard to the proposal from the Commission , Whereas, according to the information provided by the Member State concerned , these areas have adequate Having regard to the opinion of the European infrastructure , Parliament ( 3 ), Whereas Council Directive 75 / 271 /EEC of 28 April 1975 HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE : concerning the Community list of less-favoured areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( 4 ), supplemented Article 1 by Directives 76 /401 / EEC ( 5 ), 76 / 631 / EEC ( 6 ), 77 /178 /EEC ( 7 ) and 86-/ 655 /EEC ( 8 ) indicates the areas of The areas situated in the French Republic which appear in the the French Republic which are less-favoured within the Annex form part ofthe Community list ofless-favoured areas meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive within the meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 /268 /EEC ; 75 /268 / EEC . -

61-Ligne 21 2021 2022 Alencon
ALENCON CARROUGES 21 LA-FERTÉ-MACÉ HORAIRES VALABLES DU 1ER SEPTEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022 Lu au Ve Lu (A) Me Me Lu Ma Je Ve Lu Ma Je Ve Période de fonctionnement PS PS PS PS PS PS Correspondance Nomad Train - Correspondance à ALENCON / Gare SNCF * * ALENCON - LYCEE M. DE NAVARRE Rte du Mans 12:10 18:05 ALENCON - Champ Perrier 06:30 12:18 16:35 18:15 ALENCON - Gare Sncf 06:35 12:25 16:40 18:20 ALENCON - LYCEE ALAIN Boulevard Mezeray 06:40 12:30 12:48 16:48 18:25 ALENCON - COLLEGE PUBLIC BALZAC 12:50 16:50 ALENCON - Arrêt Urbain Balzac 06:42 12:31 18:26 DAMIGNY - Arrêt urbain "Pont du Fresne" 06:44 12:33 18:29 LONRAI - Beaubourdel 12:36 12:57 16:57 18:32 LONRAI - Rond point / RD2 06:46 12:39 13:00 17:00 18:35 CUISSAI - Mairie Parking 13:03 CUISSAI - Mairie RD2 06:48 12:44 17:03 18:40 L' OREE D'ECOUVES LIVAIE - Bourg/Aire d'Arrêt 06:56 12:52 17:11 18:48 L' OREE D'ECOUVES LIVAIE - La Baudriére 06:57 12:55 17:14 18:50 ROUPERROUX - Bourg 07:03 12:59 17:18 18:55 SEES - Place de la 2ème DB 06:59 SEES - Gare Sncf 07:07 SEES - Les Choux 07:11 CARROUGES - Collège parking autocars 07:08 07:29 13:04 17:23 18:59 STE MARGUERITE DE CARROUGES - La Babizière 07:14 07:34 13:10 19:05 JOUE DU BOIS - Eglise 07:20 07:39 13:16 19:11 LA FERTE MACE - LYCEE/LP DES ANDAINES 07:30 (1) 07:48 LA FERTE MACE - L.P FLORA TRISTAN 07:53 LA FERTE MACE - E R E A PIERRE MENDES-FRANCE 07:56 LA FERTE MACE - Place Neustadt 07:35 08:05 13:25 19:20 LA FERTE MACE - Ancienne gare SNCF 07:40 07:58 13:30 17:45 (2) 19:25 Horaires donnés à titre indicatif et indépendants des aléas de circulation.