Design Social Et Design D'évènement Dans Le Sud-Est
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

TUNISIA “Magiche Oasi” Primavera 15 Giorni Dal 19 Maggio Al 2 Giugno 2021
TUNISIA “Magiche Oasi” Primavera 15 Giorni Dal 19 maggio al 2 giugno 2021 PROGRAMMA VIAGGIO 1° 2° Giorno - 19 / 20 maggio - Civitavecchia imbarco per Tunisi – Tunisi. Appuntamento al porto di Civitavecchia 3 ore prima della partenza. Pernottamento in nave la prima notte in cabina privata. Arrivo a Tunisi nel pomeriggio/sera del 2° giorno. Pernottamento in parcheggio autorizzato. 3° Giorno - 21 maggio - Tunisi - Kairouan – Km 170 Inizia la nostra avventura in terra tunisina, prima in autostrada e poi su strade a scorrimento veloce raggiungiamo Kairouan dove, accompagnati dalla nostra guida, visitiamo la 4° città santa del mondo islamico, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Kairouan è anche famosa per la produzione di tappeti pregiati. Pernottamento in area sosta custodita o parcheggio hotel. 4° Giorno 4 – 22 maggio – Kairouan – Matameur - Km 290 Scendendo sempre verso sud percorriamo territori con ampie coltivazioni di ulivi e, successivamente, aree sempre più desertiche per raggiungere il granaio fortificato di Metameur. Pernottamento nel granaio fortificato. 5° Giorno – 23 maggio - Matameur - Djerba – Metameur – Km 190 Ci trasferiamo all’isola di Djerba con le sue abitazioni bianche dall’architettura influenzata dai diversi popoli che l’hanno abitata: Berberi, Arabi ed Ebrei. Visitiamo i mercati di artigianato. Rientro a Metameur in serata Pernottamento nel granaio fortificato. 6° Giorno – 24 maggio - Metameur - Chenini – Douiret – Ksar Ouled Soltane – Metameur – Km 216 Ci spostiamo ancora a sud sino all’ antico abitato di Chenini adagiato sul pendio di una montagna. Proseguiremo per il caratteristico villaggio di Douiret e di seguito per le bellissime gorfas ristrutturate di Ksar Ouled Soltane. Ritorniamo a Metameur in serata. -

Tour Tunisia 2019
BMW Motorrad Club Visconteo PROGRAMMA www.mcvisconteo.it TOUR TUNISIA 2019 DAL 26 OTTOBRE AL 04 NOVEMBRE 2019 DESCRIZIONE TOUR Tour In Tunisia On/Off di Motorizzonti Dal 26/10/2019 al 04/11/2019 Splendido tour di 10 giorni nello spettacolare territorio della Tunisia. Tour on-road adatto a coppie, percorso tutto in asfalto, visite a cittadine caratteristiche del paese e luoghi di interesse culturale ricco di storia. La possibilità di fare una variante in off-road di 3 giorni (con un minimo di 6 persone), affrontando percorsi adatte alle nostre bicilindriche. Via dei Missaglia ,89 – 20142 Milano Associato BMW Motorrad Tel. 02.51.88.32.12 – Fax. 02.51.88.32.11 FederClub Italia, Coni ed FMI [email protected] C.F. 97259760151 P.IVA 07682790964 BMW Motorrad Club Visconteo PROGRAMMA www.mcvisconteo.it PROGRAMMA PRELIMINARE Giorno 26 Ottobre 2019 Imbarco da Genova Giorno 27 Ottobre 2019 Porto di Tunisi – Hammamet Km 80 Via dei Missaglia ,89 – 20142 Milano Associato BMW Motorrad Tel. 02.51.88.32.12 – Fax. 02.51.88.32.11 FederClub Italia, Coni ed FMI [email protected] C.F. 97259760151 P.IVA 07682790964 BMW Motorrad Club Visconteo PROGRAMMA www.mcvisconteo.it Giorno 28/10/2019 Hammamet – Jerba : Km 460 Lungo la tappa del 28/10/2019 visita di El Jem La città fu costruita, come molti altri insediamenti romani in Tunisia, al posto di vecchi centri punici. Grazie ad un clima meno arido di quello attuale, la romana Thysdrus prosperò nel secondo secolo, quando divenne un importante centro per la coltivazione e l'esportazione di olio di oliva. -

Gabès, Matmata & the Ksour
© Lonely Planet 217 GABÈS, MATMATA GABÈS, MATMATA Gabès, Matmata & THE KSOUR & the Ksour Covering a good chunk of territory from the Gulf of Gabès to the Libyan border, this fairly remote region of southern Tunisia is a forbidding landscape of inhospitable desert, though not the sandy sort that inspires poetry and romantic fantasies. Recognisable to anyone who has travelled in the western part of the United States and to Star Wars fans, the land here ranges from scrub brush flats to low mountain escarpments, all of which looks like the ends of the earth. The area receives few visitors, most on lightning-quick Land Rover ‘safaris’ of the under- ground troglodyte dwellings of Matmata and one or two of the ruined hilltop Berber vil- lages around Tataouine. It’s easy to find yourself staring at the empty fortress-like homes imagining what life would be like, so isolated not only by distance from other settlements but by the mere physical challenge of visiting the neighbours. Each of the villages has at least one ksar (the plural is ksour), the wonderfully idiosyncratic fortified stronghold that is the region’s trademark. Gabès, the terminus of the rail line, is the de facto transport centre and, while its palmeraie (palm grove) is an attractive place in which to get lost, the city’s industrial character holds few visitors in its thrall. HIGHLIGHTS Go underground, literally, visiting or even sleeping in a troglodyte dwelling in Matmata Matmata ( p223 ) Hike to the top of one of the hilltop ksour Metameur (fortified strongholds; p232 ) south of Tataouine Fall asleep in a ghorfa (a distinctive Tataouine structure once used to store grain) near Metameur ( p234 ) 218 GABÈS, MATMATA & THE KSOUR •• Gabès lonelyplanet.com History There are no commercial flights from Tunis The Ksour district, centred on the hills of or elsewhere in the country. -
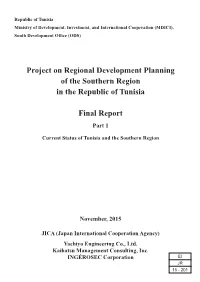
Project on Regional Development Planning of the Southern Region In
Project on Regional Development Planning of the Southern Region in the Republic of Tunisia on Regional Development Planning of the Southern Region in Republic Project Republic of Tunisia Ministry of Development, Investment, and International Cooperation (MDICI), South Development Office (ODS) Project on Regional Development Planning of the Southern Region in the Republic of Tunisia Final Report Part 1 Current Status of Tunisia and the Southern Region Final Report Part 1 November, 2015 JICA (Japan International Cooperation Agency) Yachiyo Engineering Co., Ltd. Kaihatsu Management Consulting, Inc. INGÉROSEC Corporation EI JR 15 - 201 Project on Regional Development Planning of the Southern Region in the Republic of Tunisia on Regional Development Planning of the Southern Region in Republic Project Republic of Tunisia Ministry of Development, Investment, and International Cooperation (MDICI), South Development Office (ODS) Project on Regional Development Planning of the Southern Region in the Republic of Tunisia Final Report Part 1 Current Status of Tunisia and the Southern Region Final Report Part 1 November, 2015 JICA (Japan International Cooperation Agency) Yachiyo Engineering Co., Ltd. Kaihatsu Management Consulting, Inc. INGÉROSEC Corporation Italy Tunisia Location of Tunisia Algeria Libya Tunisia and surrounding countries Legend Gafsa – Ksar International Airport Airport Gabes Djerba–Zarzis Seaport Tozeur–Nefta Seaport International Airport International Airport Railway Highway Zarzis Seaport Target Area (Six Governorates in the Southern -

The Wealth of Heritage and Cultural Tourism in Tunisia Through Two Different Cases: the Archipelago of Kerkena and the Mountains of Southeastern Tunisia”
Journal of Tourism and Heritage Research (2020), vol, nº 3, nº 1 pp. 107-135. Kebaïli Tarchouna M.. & Kebaili, S. “The wealth of heritage and cultural tourism in Tunisia through two different cases: the archipelago of Kerkena and the mountains of southeastern Tunisia” THE WEALTH OF HERITAGE AND CULTURAL TOURISM IN TUNISIA THROUGH TWO DIFFERENT CASES: THE ARCHIPELAGO OF KERKENA AND THE MOUNTAINS OF SOUTHEASTERN TUNISIA Mounira Kebaïli Tarchouna, docteur en géographie, Faculté des Lettres des Arts et des Humanités de Manouba, Tunis Tunisie. [email protected] Samir Kebaili, docteur en géographie, Faculté des Lettres et sciences humaines de Sfax, Tunisie. [email protected] Summary : Tunisia is a country in North Africa located on the southern shore of the Mediterranean and bordering the Sahara Desert. This situation gave it a landscape diversity, although it covers only 163610 km², and it attracted several civilizations. The age of human occupation in Tunisia, its history, its passage through several civilizations and its geography, are at the origin of the wealth and diversity of its heritage. To show this heritage richness we have chosen two particular examples each having a different site from the other: The archipelago of Kerkena, located on the east coast of Tunisia in the east center, and the mountains of South East Tunisia. The particularity of Kerkena is manifested by the fixed fisheries owned by fishermen and that of the mountains of southeastern Tunisia by troglodyte houses and "Ksour". The adaptation of the inhabitants of Kerkena to their island environment has marked this archipelago by the importance of fishing activity, especially fixed fisheries that designate an original artisanal fishing technique. -

IFRIQAYA Notes for a Tour of Northern Africa in September-October 2011
IFRIQAYA notes for a tour of northern Africa in September-October 2011 Miles Lewis Cover illustration: the Castellum of Kaoua. Gsell, Monuments Antiques, I, p 105. CONTENTS Preamble 5 History 6 Modern Algeria 45 Modern Tunisia 58 Modern Libya 65 Timeline 65 Pre-Roman Architecture 72 Greek & Roman Architecture 75 Christian Architecture 87 Islamic Architecture 98 Islamic and Vernacular Building Types 100 Pisé and Concrete 102 The Entablature and Dosseret Block 104 Reconstruction of the Classical Language 107 LIBYA day 1: Benghazi 109 day 2: the Pentapolis 110 day 3: Sabratha 118 day 4: Lepcis Magna & the Villa Sileen 123 day 5: Ghadames 141 day 6: Nalut, Kabaw, Qasr-el-Haj 142 day 7: Tripoli 144 TUNISIA day 8: Tunis & Carthage 150 day 9: the Matmata Plateau 160 day 10: Sbeitla; Kairouan 167 day 11: El Jem 181 day 12: Cap Bon; Kerkouane 184 day 13: rest day – options 187 day 14: Thuburbo Majus; Dougga 190 day 15: Chemtou; Bulla Regia; Tabarka 199 ALGERIA day 16: Ain Drahram; cross to Algeria; Hippo 201 day 17: Hippo; Tiddis; Constantine 207 day 18: Tébessa 209 day 19: Timgad; Lambaesis 214 day 20: Djémila 229 day 21: Algiers 240 day 22: Tipasa & Cherchell 243 day 23: Tlemcen 252 Ifriqaya 5 PREAMBLE This trip is structured about but by no means confined to Roman sites in North Africa, specifically today’s Libya, Tunisia and Algeria. But we look also at the vernacular, the Carthaginian, the Byzantine and the early Islamic in the same region. In the event the war in Libya has forced us to omit that country from the current excursion, though the notes remain here. -

EUI RSCAS Working Paper 2021
RSC 2021/16 Robert Schuman Centre for Advanced Studies Global Governance Programme-435 The evolving interface between pastoralism and uncertainty: reflecting on cases from three continents Michele Nori European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies Global Governance Programme The evolving interface between pastoralism and uncertainty: reflecting on cases from three continents Michele Nori EUI Working Paper RSC 2021/16 Terms of access and reuse for this work are governed by the Creative Commons Attribution 4.0 (CC- BY 4.0) International license. If cited or quoted, reference should be made to the full name of the author(s), editor(s), the title, the working paper series and number, the year and the publisher. ISSN 1028-3625 © Michele Nori, 2021 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0) International license. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Published in February 2021 by the European University Institute. Badia Fiesolana, via dei Roccettini 9 I – 50014 San Domenico di Fiesole (FI) Italy Views expressed in this publication reflect the opinion of individual author(s) and not those of the European University Institute. This publication is available in Open Access in Cadmus, the EUI Research Repository: https://cadmus.eui.eu Robert Schuman Centre for Advanced Studies The Robert Schuman Centre for Advanced Studies, created in 1992 and currently directed by Professor Brigid Laffan, aims to develop inter-disciplinary and comparative research on the major issues facing the process of European integration, European societies and Europe’s place in 21st century global politics. The Centre is home to a large post-doctoral programme and hosts major research programmes, projects and data sets, in addition to a range of working groups and ad hoc initiatives. -

Vertebrate Microremains from the Early Cretaceous of Southern Tunisia§ Microrestes De Vertébrés Du Crétacé Inférieur Du Sud Tunisien Gilles Cuny A,*, Andrea M
Author's personal copy Geobios 43 (2010) 615–628 Original article Vertebrate microremains from the Early Cretaceous of southern Tunisia§ Microrestes de vertébrés du Crétacé inférieur du Sud tunisien Gilles Cuny a,*, Andrea M. Cobbett b, François J. Meunier c,d, Michael J. Benton b a Natural History Museum of Denmark, 5-7 Øster Voldgade, 1350 Copenhagen K, Denmark b Department of Earth Sciences, University of Bristol, Wills Memorial Building, Queen’s Road, Bristol BS8 1RJ, UK c UMR 5178 du CNRS, biodiversité et dynamique des communautés aquatiques, département des milieux et peuplements aquatiques, Muséum national d’histoire naturelle, 43, rue Cuvier, 75231 Paris cedex 05, France d UMR 7179 du CNRS, mécanismes adaptatifs : squelette des vertébrés, UPMC, case 7077, 2, place Jussieu, 75251 Paris cedex 05, France Received 14 September 2009; accepted 9 July 2010 Available online 1 October 2010 Abstract Microremains of various sharks, actinopterygians and crocodiles have been recovered from two sites in the Douiret Formation and three sites in the Aïn el Guettar Formation in southern Tunisia. The presence of an actinistian is also suggested based on histological study of hemisegments of lepidotrichia. Convergence in dental enameloid microstructure between neoselachian sharks and actinopterygians sharing a tearing dentition is also documented. The vertebrate assemblage of the Douiret Formation suggests a pre-Aptian age for this formation and the presence of Bernissartia in the Aïn el Guettar Formation confirms faunal exchange between Africa and Europa during the Early Cretaceous. # 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved. Keywords: Continental Intercalaire; Sharks; Actinopterygians; Actinistians; Crocodiles Résumé Des microrestes de plusieurs requins, actinoptérygiens et crocodiles ont été recueillis dans deux sites de la Formation Douiret et trois sites de la Formation Aïn el Guettar dans le Sud tunisien. -

Download Itinerary
ACROSS AFRICA TOURS & TRAVEL 2035 Sunset lake Road Newark Delaware 19702 | (+1)800-205-5754 | Fax 1 (424) 333-0903 | [email protected] The Wonders of Southern Tunisia Adventure 7D/6N Embark on a 7 days trip to discover visit all seven of Tunisia’s UNESCO World Heritage Sites – Dougga, Kairouan, the medinas of Sousse and Tunis, the Punic remains of Kerkuane, magnificent Carthage, and El Djem, the largest Roman amphitheatre in North Africa. Itinerary Day 1 Arrive in Djerba Arrival to Djerba. Reception at the airport and transfer to the hotel. Route: 35 min, 27km Steps: Djerba Accommodation: Overnight at Dar El Bhar hotel or similar Day 2 Discovery of the ksours and berber villages After breakfast, depart via the Roman Road to Tataouine. Visit of the city then continuation towards Ksar Ouled Soltane, filming location of some scenes from the film “Star Wars” and one of the best Ksours in southern Tunisia. Departure for Chenini, a small village embedded in the mountain, famous for its ksours and its houses dug in the walls of the mountains and visit (about 40min on foot) with a local guide who will be happy to share with you the history of his village and its traditions. Lunch in a typical restaurant. After the meal, hike with a local guide between the village of Chenini and the village of Douiret where you will spend the night (about 3 hours). Arrival in Douiret and free time to stroll around the village. Dinner and overnight at a cottage on top of the mountain. Walking time: around 3h Stages: Tataouine Chenini – Douiret Accommodation: Night at Raouf’s cottage Day 3 The night under tent After breakfast, departure to Ksar Ghilane, a small exotic oasis in the Sahara, famous for its natural thermal water source, where you can swim. -

Discovering the Amazigh Architectural Heritage of Tunisia Neila Rhouma, Mohamed Metallaoui
Discovering the amazigh architectural heritage of Tunisia Neila Rhouma, Mohamed Metallaoui To cite this version: Neila Rhouma, Mohamed Metallaoui. Discovering the amazigh architectural heritage of Tunisia. Algerian Journal of Engineering Architecture and Urbanism, 2019, 3. hal-02547360 HAL Id: hal-02547360 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02547360 Submitted on 19 Apr 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Algerian Journal of Engineering Architecture and Urbanism Vol. 3 Nr. 1 2019 Discovering the amazigh architectural heritage of Tunisia RHOUMA Neila, METALLAOUI Mohamed Abdelaziz Received: 17 December 2018 • Revised: 02 February 2019 • Accepted: 01 March 2019 DISCOVERING THE AMAZIGH ARCHITECTURAL HERITAGE OF TUNISIA RHOUMA Neila PHD Student, Anthropology, Science and Technical Arts, Mediterranean House of Human Science (MMSH), Higher Institute of Fine Arts of Nabeul (ISBAN), IDEMEC, Email : [email protected] METALLAOUI Mohamed Abdelaziz PHD Student, architecture and heritage, Paris 7 Diderot University , National School of Architecture Paris-Val de Seine, Email : [email protected] Abstract: Tunisia has always been a welcoming and distinctive land for its cultural mix. Among the various civilizations that crossed it, the Berbers represent the central one that inhabited and cradled it.) They have dotted on this territory signs of their remarkable passage. -

Étude De L'évolution Du Ravinement Dans Les Jessour Du Sud Tunisien
Étude de l’évolution du ravinement dans les jessour du Sud Tunisien grâce aux images aériennes Ninon Blond, Nicolas Jacob-Rousseau, Dalel Ouerchefani, Yann Callot To cite this version: Ninon Blond, Nicolas Jacob-Rousseau, Dalel Ouerchefani, Yann Callot. Étude de l’évolution du ravinement dans les jessour du Sud Tunisien grâce aux images aériennes. Cybergeo : Revue européenne de géographie / European journal of geography, UMR 8504 Géographie-cités, 2019, Environnement, Nature, Paysage, 10.4000/cybergeo.32495. halshs-02407833 HAL Id: halshs-02407833 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02407833 Submitted on 12 Dec 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0 International License Cybergeo : European Journal of Geography Environnement, Nature, Paysage | 2019 Étude de l’évolution du ravinement dans les jessour du Sud Tunisien grâce aux images aériennes Study of the evolution of gullying in the South Tunisian jessour thanks to aerial images Ninon Blond, -

Tunisie, Splendeurs Du Sud
TUNISIE, SPLENDEURS DU SUD Informations Nos atouts Transport : Avion au départ de Nantes Programme avec 4 nuits en circuit et 3 nuits en séjour Type de séjour : Combiné circuit 8 jours / 7 nuits Promenade en calèche Dates du séjour : Découverte des oasis en 4x4 14/05/2021 au 23/05/2021 : 829 € Formule tout inclus en fin de séjour Lieux de départ nous consulter Vous souhaitez un renseignement ? réserver ? CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02 Description de la destination Laissez-vous guider à travers les paysages étonnants du Sud tunisien : entre dunes de sable blanc, lac salé aux mirages pailletés, plages de rêve et lieux de tournages cinématographiques mythiques. Succombez au mélange d’aventure et d’exotisme entre oasis sahariennes et mer turquoise ! 1er jour : Transfert de votre région vers l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport de Djerba-Zarzis. À votre arrivée, accueil par notre représentant, transfert vers votre hôtel à Zarzis en formule tout inclus. Installation, verre de bienvenue. Dîner et nuit. 2ème jour : Départ après le petit-déjeuner pour Medenine et visite de ses ghorfas : ces greniers servaient jadis à entreposer les denrées alimentaires. Visite de ksar El Ferch, l’un des rares anciens ksours de la région de Tataouine qui a su garder tout son charme. Continuation vers Douiret, ancien ksar berbère, très pittoresque avec ses maisons agrippées à la roche, un point de vue sur la vallée, une mosquée éclatante… Continuation par la visite du village troglodytique de Chenini dont les habitations sont creusées dans les parois d’un cirque.