Sacha Guitry Et Les Acteurs De La Comédie-Française
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
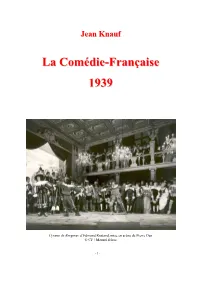
Jean Knauf. La Comédie-Française 1939 PPA
Jean Knauf LLaa CCoommééddiiee--FFrraannççaaiissee 11993399 Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, mise en scène de Pierre Dux © CF / Manuel frères - 1 - - 2 - Avant-propos Le 2 septembre 1939, la France décrète la mobilisation générale et le 3, elle déclare la guerre à l’Allemagne. Conséquence de cet événement, une partie de la troupe partie pour la première fois en tournée en Amérique du Sud, depuis le 20 juin, se trouve bloquée en vue du port de Marseille. Elle rallie Paris le 9 au lieu du 4, consignée à bord du Campana ! 1939 sera la dernière année de l’Administration Bourdet. Les succès se poursuivent sur la lancée des deux années précédentes. Cyrano de Bergerac est joué à 90 reprises. Désormais, André Brunot alterne avec Denis d’Inès dans le rôle-titre et Marie Bell avec Lise Delamare dans le personnage de Roxane 1. Asmodée de François Mauriac connaît toujours le succès (26 représentations, soit un total de 127) de même que Madame Sans-Gêne (22 représentations pour un total de 164). 1939 est bien sûr dominé par le début de la guerre mais c’est aussi le 150° anniversaire de la Révolution française de 1789. Une matinée poétique est consacrée le 17 juin à cet événement. Romain Rolland entre au répertoire à cette occasion avec le Jeu de l’Amour et de la Mort. 2 L’Ile des Esclaves de Marivaux, une œuvre qui préfigure l’esprit de 1789, accompagne la pièce de Romain Rolland. C’est la dix-huitième pièce de Marivaux à entrer au répertoire, un auteur que le XVIII° siècle comprit mal mais à qui le XX° siècle rend enfin justice 3. -

Jean Knauf. La Comédie-Française 1943 PPA
Jean Knauf LLaa CCoommééddiiee--FFrraannççaaiissee 11994433 Répétition du Soulier de satin de Paul Claudel, mise en scène Jean-Louis Barrault © Comédie-Française 1 2 Avant propos Quelle année exceptionnelle que cette année 1943 ! La Comédie-Française créé sept pièces ! Et parmi ces créations plusieurs évènements exceptionnels qui font date dans l’histoire du théâtre, au premier rang desquels Le Soulier de satin de Paul Claudel. Le Soulier de Satin est un théâtre-monde. Cette œuvre-monument constitue une triple révolution : 1. Un texte poétique à l’opposé de toute forme déjà connue. Le drame s’appuie sur des faits connus mais il n’est en rien un drame historique ; une réalité poétisée ; une écriture entre mélodrame et symbolisme ! Paul Claudel ne fait-il pas référence à une des pièces les plus étonnantes de Shakespeare, Troïlus et Cressida ? C’est tout un rapport au temps et à l’histoire qui est bouleversé. 2. Ce théâtre-monde implique un rapport à un espace multiple. D’où la nécessaire révolution au plan de la scénographie car l’action se situe toujours ici et ailleurs, en Espagne et en Afrique. “J’ai été l’ouvrier d’un rêve“ , dit Don Pélage. La frontière entre réalité et imaginaire se brouille dans ce théâtre écrit à l’aune du siècle d’or espagnol et des influences orientales que Claudel connaît si bien ; 3. Le comédien doit alors trouver un jeu, une diction, des postures … aptes à rendre des situations loin des conventions du réalisme psychologique. Qu’une pièce comme Le Soulier de satin ait été créée à la Comédie-Française en 1943, pendant l’occupation, dans une mise en scène d’un jeune sociétaire, Jean-Louis Barrault, ne cesse de surprendre. -

Toronto Slavic Quarterly. № 49. Summer 2014
TRANSLATIONS Maksimilian Voloshin Tree Articles on the Theatre Edited and notes by Zahar Davydov, translation by Ralph Lindheim Faces and Masks When one happens to see works from the French theatre on the Russian stage, then no mater how well they are produced, trans lated, and played, a tormenting feeling of deep and inescapable disharmony always remains. No French play can slip into the forms of the Russian stage so that these forms ft it completely, like a case for a geodesic instru ment, the way they ft Gogol's, Ostrovsky's and Chekhov's plays. Whereas the Russian stage fnds authentic and welldefned forms for the German Hauptmann, for the Belgian Maeterlinck, and for the Pole Przybyszewski, at times even more successfully than the stages of their homelands, the least complex French com edies, which enjoy wild success in Paris, lose their lustre and wither; their witicisms fall fat and their subtleties seem banal. The very same thing happens when a French theatre atempts to put on a Russian play or a German one. The productions of Hauptmann and Tolstoi in the theatre of Antoine 1, despite all the eforts of this talented director and the relative elasticity of the ma terial he had available, were complete failures. And in these fail ures one senses not an accidental, conceptual error but a deeply rooted historical impossibility. The French theatre is a musical instrument, organically formed and therefore extremely complex, very precise, and not at all fex ible. It corresponds so mathematically precisely to the style of © Ralph Lindheim, translation from Russian, 2014 © TSQ № 49. -

Surviving Antigone: Anouilh, Adaptation, and the Archive
SURVIVING ANTIGONE: ANOUILH, ADAPTATION AND THE ARCHIVE Katelyn J. Buis A Thesis Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS May 2014 Committee: Cynthia Baron, Advisor Jonathan Chambers ii ABSTRACT Dr. Cynthia Baron, Advisor The myth of Antigone has been established as a preeminent one in political and philosophical debate. One incarnation of the myth is of particular interest here. Jean Anouilh’s Antigone opened in Paris, 1944. A political and then philosophical debate immediately arose in response to the show. Anouilh’s Antigone remains a well-known play, yet few people know about its controversial history or the significance of its translation into English immediately after the war. It is this history and adaptation of Anouilh’s contested Antigone that defines my inquiry. I intend to reopen interpretive discourse about this play by exploring its origins, its journey, and the archival limitations and motivations controlling its legacy and reception to this day. By creating a space in which multiple readings of this play can exist, I consider adaptation studies and archival theory and practice in the form of theatre history, with a view to dismantle some of the misconceptions this play has experienced for over sixty years. This is an investigation into the survival of Anouilh’s Antigone since its premiere in 1944. I begin with a brief overview of the original performance of Jean Anouilh’s Antigone and the significant political controversy it caused. The second chapter centers on the changing reception of Anouilh’s Antigone beginning with the liberation of Paris to its premiere on the Broadway stage the following year. -

Tournée Saison 2019-2020
TOURNÉE SAISON 2019-2020 Pascal Legros Organisation, en accord avec Le Théâtre Edouard VII, présente 87 rue Taitbout 75009 Paris 01 53 20 00 60 www.plegros.com DIFFUSION Matthias LEGROS 06 78 53 05 50 [email protected] ENCORE UN INSTANT / Tournée 2019-2020 ENCORE UN INSTANT Une pièce de FABRICE ROGER-LACAN --- Mise en scène BERNARD MURAT Avec MICHELE LAROQUE FRANCOIS BERLEAND LIONEL ABELANSKI VINNIE DARGAUD --- Au Théâtre Edouard VII jusuq’au dimanche 23 Juin 2019 --- En tournée d’Octobre à Décembre 2019 Pascal Legros Organisation 87 rue Taitbout 75009 Paris 01 53 20 00 60 / www.plegros.com ENCORE UN INSTANT / Tournée 2019-2020 ENCORE UN INSTANT La pièce. En amour, il est des miracles qu’on ne peut expliquer. Même après trente ans de mariage, Suzanne (Michèle Laroque) et Julien (François Berléand) sont toujours fou amoureux l’un de l’autre. Une couple complice et heureux. Suzanne est une actrice adulée du public. Une adoration qui, parfois, va jusqu’au fétichisme de son jeune locataire Simon (Vinnie Dargaud). Pour son retour sur les planches, elle hésite à jouer dans la nouvelle pièce de Max (Lionel Abelanski), spécialement écrite pour elle. Ce que veut Suzanne, c’est être seule, encore un instant, avec Julien. Julien qu’elle aime et qui l’aime, Julien qui râle et qui rit, Julien qui vit mais que personne ne voit ni n’entend. Sauf Suzanne… Une pièce de Fabrice Roger-Laca, HUMOUR, DÉLIRES ET TENDRESSE Mise en scène Bernard Murat Avec Michèle Laroque, François Berléand, ALTERNENT POUR VOUS FAIRE RIRE Lionel Abelanski, Vinnie Dargaud -
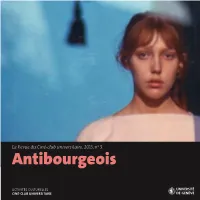
Antibourgeois
La Revue du Ciné-club universitaire, 2015, no 3 Antibourgeois ACTIVITÉS CULTURELLES CINÉ-CLUB UNIVERSITAIRE Sommaire Histoire(s) du cinéma antibourgeois I: les origines ....................................................................... 3 Le charme discret de la satire buñuellienne ..... 11 Histoire(s) du cinéma antibourgeois II: l’apogée .................................................................................15 Peut-on faire du cinéma antibourgeois? ...........27 Histoire(s) du cinéma antibourgeois III: le déclin......................................................................................31 Eyes Wide Shut: le masque de la bourgeoisie moderne ............... 37 Programmation ............................................................ 41 Illustration Teorema, Pier Paolo Pasolini, 1968 Remerciements Recevoir gratuitement Antoine de Baecque, Marcos Mariño Groupe de travail du Ciné-club universitaire La Revue du Ciné-club universitaire Pietro Guarato, Rayan Chelbani, Lionel Dewarrat, Joan GestÍ, chez vous? Nathalie Gregoletto, Emilien Gür, Diana Barbosa Pereira, Lou Perret Activités culturelles de l’Université responsable: Ambroise Barras coordination: Christophe Campergue Abonnez-vous! édition: Véronique Wild graphisme: Julien Jespersen en 1 minute sur culture.unige.ch/revue Éditorial La grande bouff e, Marco Ferreri, 1973. par Pietro Guarato «Je suis jeune et riche et cultivé; et je suis mal- de la bourgeoisie: la puissance corruptrice de l’argent, heureux, névrosé et seul. [...] J’ai eu une éducation la fausseté des -

GAUMONT PRESENTS: a CENTURY of FRENCH CINEMA, on View Through April 14, Includes Fifty Programs of Films Made from 1900 to the Present
The Museum of Modern Art For Immediate Release January 1994 GAUNONT PRESENTS: A CENTURY OF FRENCH CINEMA January 28 - April 14, 1994 A retrospective tracing the history of French cinema through films produced by Gaumont, the world's oldest movie studio, opens at The Museum of Modern Art on January 28, 1994. GAUMONT PRESENTS: A CENTURY OF FRENCH CINEMA, on view through April 14, includes fifty programs of films made from 1900 to the present. All of the films are recently restored, and new 35mm prints were struck especially for the exhibition. Virtually all of the sound films feature new English subtitles as well. A selection of Gaumont newsreels [actualites) accompany the films made prior to 1942. The exhibition opens with the American premiere of Bertrand Blier's Un deux trois soleil (1993), starring Marcello Mastroianni and Anouk Grinberg, on Friday, January 28, at 7:30 p.m. A major discovery of the series is the work of Alice Guy-Blache, the film industry's first woman producer and director. She began making films as early as 1896, and in 1906 experimented with sound, using popular singers of the day. Her film Sur la Barricade (1906), about the Paris Commune, is featured in the series. Other important directors whose works are included in the exhibition are among Gaumont's earliest filmmakers: the pioneer animator and master of trick photography Emile Cohl; the surreal comic director Jean Durand; the inventive Louis Feuillade, who went on to make such classic serials as Les Vampires (1915) and Judex (1917), both of which are shown in their entirety; and Leonce Perret, an outstanding early realistic narrative filmmaker. -

La Comédie-Française 1941
Jean Knauf LLaa CCoommééddiiee--FFrraannççaaiissee 11994411 Programme de Feu la Mère de Madame de Georges Feydeau, mise en scène de Fernand Ledoux, 27 octobre 1941 - © Comédie-Française 1 2 Avant-propos Jacques Copeau, agréé par le gouvernement de Vichy, est révoqué par les autorités allemandes. Il quitte l’administration du théâtre le 7 janvier 1941. Marie-Agnès Joubert conclut assez justement : « L’administration de Jacques Copeau ne fut finalement qu’une parenthèse, aussi bien dans l’histoire du Théâtre-Français que dans la carrière de l’intéressé. Les ouvrages consacrés à Copeau demeurent d’ailleurs étrangement discrets sur cet épisode de sa vie. En janvier 1941, acteurs et témoins de cette aventure sans lendemain souhaitèrent tourner la page au plus vite. Jacques Copeau reprit le chemin de Pernand-Vergelesses … »1 Léon Lamblin, sous-secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts, le remplace entre le 13 janvier et le 2 mars 1941. Directeur du Musée Carnavalet et responsable des matinées poétiques, Jean- Louis Vaudoyer est nommé administrateur à compter du 4 mars 1941. Grand ami d’Edouard Bourdet, Vaudoyer n’est ni un auteur de théâtre, ni un artisan de la scène, c’est un homme de grande culture, amateur d’art et de poésie. Il prend la direction de la maison à un des pires moments de son histoire. La troupe a perdu Yonnel – qui rentrera en octobre après que le Commissariat aux questions juives eût déclaré qu’il ne pouvait être considéré comme juif, Béatrice Bretty dont Jérôme Carcopino 2 exige la mise à la retraite, Véra Korène, Robert Manuel, Henri Echourin, Henri-Paul Bonifas doivent quitter la Société en application des lois de Vichy… La Société se trouve ainsi privée d’éléments importants dans la tragédie comme dans la comédie. -

The Example of Jean Cocteau AUTHOR: Joyce Anne Funamoto, B
THE SEARCH FOR NEW EXPRESSION IN THE THEATRE: THE EX~lPLE OF JEAN COCTEAU THE SEARCH FOR NEW EXPRESSION IN THE THEATRE: THEEXM1PLE OF JEAN COCTEAU by JOYCE ANNE FUNAMOTO, B. A., B. ED. A Thesis Submitted to the School of Graduate Studies in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree Master of Arts McMaster University June 1981 I~~STER OF ARTS (1981) McMASTER UNIVERSITY ( Roman ce Languages) Hamilton, Ontario. TITLE: The Search for New Expression in the Theatre: The Example of Jean Cocteau AUTHOR: Joyce Anne Funamoto, B. A. (MCMaster University) B. Ed. (University of Toronto) SUPEHVISOR: Dr. B. S, Pocknell NUMBER OF PAGES: iv, 117 SCOPE AND CONTENTS: The purpose of this paper is to examine the theatre of Jean Cocteau in its search for new expression. The first chapter presents Jean Cocteau's precursors and their parallels with his theatre, and his early fOlJmation in the theatre. The second chapter deals with his contemp- oraries in the areas of dance, music and art. Chapter three treats the plays of Jean Cocteau in the light of their sources and innovations. ii ACKNOWLEDGEMENTS My sincere thanks goes to Dr. B. S. Pocknell, whose patience, encouragement and enthusiasm will continue to provide inspiration. I would also like to express my debt to Professor N. Jeeves for his careful reading and guidance. iii TABLE OF CONTENTS Page LIST OF PHOTOGRAPHS 1 INTRODU CTION 2 CHAPTER I - COCTEAU'S PRECURSORS AND HIS EARLY 5 FORMATION IN THE THEATRE CHAPTER II - COCTEAU AND HIS CONTEMPORARIES 33 CHAPTER III - THE DEVELOPMENT OF JEAN COCTEAU'S 59 THEATRE CONCLUSION 98 APPENDIX A 103 APPENDIX B 105 APPENDIX C 107 APPENDIX D 109 APPENDIX E· III BIBLIOGRAPHY 113 iv LIST OF PHOTOGRAPHS Photo 1 - Le Dicu Bleu. -

Jacqueline Delubac, Le Choix De La Modernité
1 JacQueline Delubac, le choix de la modernité Exposition Rodin, lam, du 7 novembre 2014 Picasso, Bacon au 16 février 2015 « J’ai un bon œil, j’ai eu le bonheur d’avoir un assez bon instinct et d’acheter des peintures de Poliakoff, de Fautrier, de Dubuffet qui étaient peu connus et j’ai la joie de les avoir acquises quand tout le monde se moquait de moi. » 3 Jacqueline Delubac JACQUELINE DELUBAC, LE CHOIX DE LA MODERNITÉ. RODIN, LAM, PICASSO, BACON 7 NOVEMBRE 2014 – 16 FÉVRIER 2015 En insistant sur l’audace des choix de Jacqueline Delubac, l’exposition présente à la fois la comédienne, la femme « la plus élégante de Paris », mais aussi et surtout l’amatrice d’art qui légua trente-huit œuvres de première importance au musée des Beaux-Arts de sa ville natale en 1997. Pour l’occasion, ce bel ensemble est complété de nombreux prêts provenant de musées et de collections particulières français et étrangers. L’exposition est une invitation à parcourir une reconstitution de l’appartement de Jacqueline Delubac, pour retracer la carrière et la vie de la collectionneuse, à la rencontre de ses choix résolument modernes. Jacqueline Delubac ( Lyon, 27 mai 1907 – Paris, 14 octobre 1997 ) quitte Valence pour Paris dans les années 1920, où sa carrière théâtrale débute réellement en 1931 avec une pièce de Sacha Guitry ( 1885 – 1957 ). Devenue la troisième épouse de l’auteur en 1935, elle emménage dans son hôtel particulier et vit entourée d’œuvres d’art. À la scène comme à la ville, Jacqueline Delubac incarne alors l’élégance et l’avant-garde de la mode. -

Fonds Octave Mirbeau
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE D’ANGERS FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES FONDS OCTAVE MIRBEAU Catalogue rédigé par Patricia M’Bengue SEPTEMBRE 2004 PRESENTATION DU FONDS OCTAVE MIRBEAU • Chronologie d’Octave Mirbeau • Sommaire du catalogue du Fonds Octave Mirbeau • Catalogue • Bibliographie CHRONOLOGIE D’OCTAVE MIRBEAU Texte de l’exposition réalisée sous la direction de Pierre Michel avec la collaboration de Laurence Tartreau-Zeller, Jean-François Nivet, Claude Herzfeld, Jacky Mérigaud, Janine Fumet et Jean Kremer – 1998. Société Octave Mirbeau – 10 bis rue André Gautier – 49000 Angers ANNEES D’APPRENTISSAGE Enfance 1848. Le 16 février, naissance à Trévières (Calvados) d’Octave-Marie-Henri Mirbeau. Son père, Ladislas-François, est officier de santé. 1849. En septembre, la famille Mirbeau vient s’installer à Rémalard (Orne). Chez les jésuites de Vannes 1859. Le 12 octobre, il entre comme pensionnaire au collège Saint-François-Xavier de Vannes. Il y passe quatre ans d’« enfer ». 1863. Il quitte le collège le 9 juin, renvoyé dans des conditions plus que suspectes, qu’il évoquera dans Sébastien Roch (1890). Du spleen au notariat 1864. Poursuit ses études, médiocres, à la pension Saint-Vincent de Rennes. 1865. Prépare son baccalauréat à la pension Delangle (Caen). 1866. Le 7 mars, devient bachelier ès lettres à la troisième tentative. S’inscrit le 14 novembre à la Faculté de Droit de Paris. Amitié avec Alfred Bansard des Bois. 1867. Se morfond dans l’étude de Maître Robbe, notaire à Rémalard. Échoue à son examen de droit. 1868-1869. Mène à Paris une vie de plaisirs. S’endette. Doit rentrer à Rémalard. 1870. Le 8 juillet, mort de sa mère. -

Cinefiles Document #20621
Document Citation Title Rétrospective Sacha Guitry Author(s) Source Locarno International Film Festival Date 1993 Type program note Language French German English Italian Pagination No. of Pages 20 Subjects Guitry, Sacha (1885-1957), St. Petersburg, Russia (Federation) Film Subjects Je l'ai été trois fois, Guitry, Sacha, 1952 La poison (Poison), Guitry, Sacha, 1951 Deburau, Guitry, Sacha, 1951 La Malibran, Guitry, Sacha, 1944 Faisons un rêve (Let us dream), Guitry, Sacha, 1936 Mon père avait raison (My father was right), Guitry, Sacha, 1936 Le nouveau testament (The new testament), Guitry, Sacha, 1936 Ceux de chez nous, Guitry, Sacha, 1915 WARNING: This material may be protected by copyright law (Title 17 U.S. Code) Bonne chance (Good luck), Guitry, Sacha, 1935 Le trésor de Cantenac (The treasure of Cantenac), Guitry, Sacha, 1950 Toâ, Guitry, Sacha, 1949 Le roman d'un tricheur (The story of a cheat), Guitry, Sacha, 1936 Aux deux colombes, Guitry, Sacha, 1949 Le comédien, Guitry, Sacha, 1948 Le destin fabuleux de Désirée Clary (The fabulous destiny of Desiree Clary), Guitry, Sacha, 1942 Remontons les Champs-Elysées (Champs-Elysées), Guitry, Sacha, 1938 Quadrille, Guitry, Sacha, 1938 Désiré, Guitry, Sacha, 1937 Les trois font la paire (Three make a pair), Guitry, Sacha, 1957 Les perles de la couronne (Pearls of the crown), Guitry, Sacha, 1937 Le mot de Cambronne, Guitry, Sacha, 1937 Ils étaient neuf célibataires (Nine bachelors), Guitry, Sacha, 1939 Le diable boiteux (The lame devil), Guitry, Sacha, 1949 Pasteur, Guitry, Sacha, 1935 Donne-moi tes yeux, Guitry, Sacha, 1943 MCDXXIX-MCMXLII (de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain), Guitry, Sacha, 1944 Assassins et voleurs (Lovers and thieves), Guitry, Sacha, 1957 Si Paris nous était conté, Guitry, Sacha, 1956 Napoléon, Guitry, Sacha, 1955 Tu m'as sauvé la vie (You saved my life), Guitry, Sacha, 1950 Si Versailles m'etait conté (Royal affairs in Versailles), Guitry, Sacha, 1954 La vie d'un honnête homme (The virtuous scoundrel), Guitry, Sacha, 1953 WARNING: This material may be protected by copyright law (Title 17 U.S.