Dossier De Presse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Salvador DALI Et ÉRIS
Carmela Di Martine - mai 2019 Salvador DALI et ÉRIS Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, premier marquis de Dalí de Púbol, né à Figueras le 11 mai 1904, 8 h 45. Il est mort dans la même ville, le 23 janvier 1989. Peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain catalan de nationalité espagnole, il est considéré comme l'un des principaux représentants du surréalisme, et comme l'un des plus célèbres peintres du XXe siècle. Dominantes astrales . Soleil en Taureau maison XI, signe gouverné par Vénus située les mêmes signe et maison. La nature, la nourriture. L’artiste manuel. Ascendant Cancer, signe gouverné par la Lune en Bélier maison X. Famille, mémoire, l’Histoire, le peuple, vive imagination, rêve. MC Poissons, signe gouverné par Neptune en Cancer maison XII (des Poissons). L’imagination débordante. Éris Éris n’est pas que provocation, elle encourage, stimule, incite à l’action, au combat. Elle nous encourage à nous dépasser pour accéder à un au-dessus de notre niveau, pour atteindre un au- delà. Elle est la révélation. Elle nous provoque donc pour que nous progressions. Progression individuelle nécessaire à l’évolution collective. 1 Carmela Di Martine - mai 2019 Salvador Dali et Éris Éris 24° 20’ Poissons (la peinture) maison IX (quête d’un monde supérieur) est en : . Conjonction MC 26° 45’ Poissons et Lune 2° 28’ Bélier. Éris guide, oriente donc la destinée de Dali. Elle provoque sa carrière, stimule toutes les planètes en aspects avec elles, qui activeront autant de talents nécessaires à ses peintures qui le rendront célèbre. Éris en sera l’inspiratrice. -

The Madonna of Portlligat
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018 Cat. no. P 660 The Madonna of Portlligat Date: c. 1950 Technique: Oil on canvas Dimensions: 275.3 x 209.8 cm Signature: Signed lower right: SALVADOR DALI Location: Fukuoka Art Museum, Fukuoka (Japan) Catalogue Raisonné of Paintings by Salvador Dalí Page 1 of 7 | Cat. no. P 660 Provenance Sir James Dunn Lady Dunn Fernando Guereta, New York Minax International Co. & Inc., Tokyo Credi Saison,Tokyo Observations *The "I Bienal Hispanoamericana de Arte” (1st Biennial of Latin American Art) was held in Madrid and Barcelona. In Madrid from 12th October 1951 to 28th February 1952, although we know that Dalí’s works were exhibited only during the shorter period of time we have indicated in the Exhibitions section. In Barcelona, during March 1952, although we know that Dalí’s works were exhibited for the longer period of time we have indicated in the Exhibitions section. Exhibitions 1950, New York, Carstairs Gallery, "The Madonna of Port-Lligat", 27/11/1950 - 10/01/1951, no reference 1951, Paris, Galerie André Weil, Exposition Salvador Dali, 22/06/1951 - 04/08/1951, no reference 1951, London, The Lefevre Gallery, Dalí, December 1951, cat. no. 1 1952, Basel, Kunsthalle Basel, Phantastische Kunst des XX.Jahrhunderts, 30/08/1952 - 05/10/1952, cat. no. 70 1952, Madrid, Salas de la Sociedad Españoña de Amigos del Arte, 1º Bienal Hispanoamericana de Arte *, 22/01/1952 - 24/02/1952, no reference 1952, Barcelona, Museo de Arte Moderno, I Bienal Hispanoamericana de Arte *, March 1952, cat. no. 1 1954, Roma, Sale dell'Aurora Pallavicini, Mostra di quadri disegni ed oreficerie di Salvador Dalí, 01/03/1954 - 30/06/1954, cat. -

La Vieillesse De Guillaume Tell (The Old Age of William Tell)
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2007 Cat. no. P 285 La vieillesse de Guillaume Tell (The Old Age of William Tell) Date: 1931 Technique: Oil on canvas Dimensions: 98 x 140 cm Signature: Signed and dated lower center left: a Gala Salvador Dali 1931 Location: Private collection Catalogue Raisonné of Paintings by Salvador Dalí Page 1 of 3 | Cat. no. P 285 Provenance Viscount and viscountess of Noailles Exhibitions 1932, Paris, Pierre Colle, Exposition Salvador Dalí, 26/05/1932 - 17/06/1932, cat. no. 1 1956, Knokke Le Zoute, Casino de Knokke Le Zoute, Salvador Dalí, 01/07/1956 - 10/09/1956, cat. no. 8 1957, Paris, Musée National d'Art Moderne, Depuis Bonard, 23/03/1957, cat. no. 66 1972, Munich, Haus der Kunst, Der Surrealismus, 1922-1942, 11/03/1972 - 07/05/1972, cat. no. 84 1979, Paris, Centre Georges Pompidou, Musée National d'Art Moderne, Salvador Dalí: rétrospective, 1920-1980, 18/12/1979 - 21/04/1980, cat. no. 83 2002, París, Centre Pompidou, La Révolution surréaliste, 06/03/2002 - 24/06/2002, no reference 2012, Paris, Centre Pompidou, Dalí, 21/11/2012 - 25/03/2013, p. 129 Bibliography René Crevel, Dalí ou l'anti-obscurantisme, Éditions Surréalistes, Paris, 1931, il. IX, il. X (detail) "Les exposicions-documental", Art, 31/01/1934, Barcelona, p. 127 James Thrall Soby, After Picasso, Dodd, Mead, New York, 1935, il 55 Album Surréaliste, Shuzo Takiguchi, Tiroux Yamanaka, Tokio, 1937, il. 27 James Thrall Soby, Salvador Dalí, The Museum of Modern Art, New York, 1941, p. 41 Salvador Dalí, Vida secreta de Salvador Dalí, Poseidón, Buenos Aires, 1944, il. -
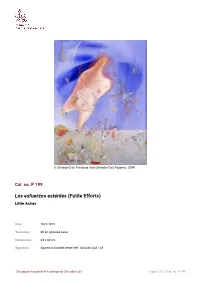
Futile Efforts) Little Ashes
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2004 Cat. no. P 199 Los esfuerzos estériles (Futile Efforts) Little Ashes Date: 1927-1928 Technique: Oil on plywood panel Dimensions: 64 x 48 cm Signature: Signed and dated center-left: Salvador Dali / 28 Catalogue Raisonné of Paintings by Salvador Dalí Page 1 of 7 | Cat. no. P 199 Location: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid Catalogue Raisonné of Paintings by Salvador Dalí Page 2 of 7 | Cat. no. P 199 Provenance Spanish State, on deposit at the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid Exhibitions 1929, Madrid, Jardín Botánico, Exposición de Pinturas y Esculturas de Españoles Residentes en París, 20/03/1929 - 25/03/1929, cat. no. 56 1929, París, Galerie Goemans, Dalí, 20/11/1929 - 05/12/1929, cat. no. 10 1931, Paris, Pierre Colle, Exposition Salvador Dalí, 03/06/1931 - 15/06/1931, cat. no. 2 1965, New York, Gallery of Modern Art, Salvador Dalí, 1910-1965, 18/12/1965 - 13/03/1966, cat. no. 22 1968, New York, The Museum of Modern Art, Dada, surrealism, and their heritage, 27/03/1968 - 09/06/1968, cat. no. 57 1980, London, The Tate Gallery, Salvador Dalí, 14/05/1980 - 29/06/1980, cat. no. 31 1983, Madrid, Museo Español de Arte Contemporáneo, 400 obras de Salvador Dalí del 1914 al 1983, 15/04/1983 - 29/05/1983, cat. no. 122 1987, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, El Siglo de Picasso, 29/01/1987 - 13/03/1988, cat. no. 58 1987, Paris, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Cinq siècles d'art espagnol : le siècle de Picasso, 10/10/1987 - 03/01/1988, cat. -

La Profanation De L'hostie (Profanation of the Host)
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2004 Photo © Hans Kaczmarek Nov. 86 USA: © Salvador Dalí Museum Inc., St. Petersburg, FL, 2007 Cat. no. P 243 La profanation de l'hostie (Profanation of the Host) Date: c. 1930 Technique: Oil on canvas Dimensions: 100 x 73 cm Signature: Unsigned and undated Catalogue Raisonné of Paintings by Salvador Dalí Page 1 of 5 | Cat. no. P 243 Location: The Dali Museum, St. Petersburg (Florida) Catalogue Raisonné of Paintings by Salvador Dalí Page 2 of 5 | Cat. no. P 243 Provenance Jean Cocteau Julien Levy, New York Sidney Janis Gallery, New York Justin K. Thannhauser E. and A. Reynolds Morse, Cleveland (Ohio) Exhibitions 1931, Paris, Pierre Colle, Exposition Salvador Dalí, 03/06/1931 - 15/06/1931, cat. no. 12 1940, New York, Julien Levy Gallery, A decade of painting : 1929-1939, 23/01/1940 - 25/02/1940, cat. no. 39 1944, New York, Art of this Century, First Exhibition in American Art of this Century, April 1944, cat. no. 2 1946, Boston, The Institute of Modern Art, Four Spaniards : Dali, Gris, Miro, Picasso, 24/01/1946 - 03/03/1946, cat. no. 19 1953, Santa Barbara, Santa Barbara Museum of Art, Fiesta Exhibition Picasso, Gris, Miro, Dali, 14/08/1953 - 30/08/1953, cat. no. 56 1965, New York, Gallery of Modern Art, Salvador Dalí, 1910-1965, 18/12/1965 - 13/03/1966, cat. no. 31 2007, St. Petersburg, Fl., Salvador Dalí Museum, Dalí and the Spanish Baroque, 02/02/2007 - 24/06/2007, cat. no. 15 Bibliography René Crevel, Dalí ou l'anti-obscurantisme, Éditions Surréalistes, Paris, 1931, il. -
Salvador Dali, Un Catalan Universel Eliseo Trenc Professeur À L'université De Reims
Salvador Dali, un catalan universel Eliseo Trenc Professeur à l'université de Reims Si des affirmations aussi péremptoires que « Toute mon ambition sur le plan pictural consiste à matérialiser avec la plus impérialiste rage de précision les images de l'irrationnalité concrète » ou « L'activité paranoïaque critique est une force organisatrice et productive de hasard objectif » nous déconcertent quelque peu, si la théâtralité, l'excentricité du personnage public dissimulent trop souvent le caractère sérieux du système de pensée élaboré par le peintre tout au long de sa vie, il n'en reste pas moins, comme le montre ce parcours biographique, que la singularité de son imaginaire s'enracine dans le contexte culturel et scientifique de la première moitié du XXe siècle. Figure emblématique du surréalisme, dandy dont nous devons à André Breton, excédé par son mercantilisme, l'anagramme d'« Avida Dollars », génial manipulateur de tous les snobismes, Dali reste, incontestablement, l'un des personnages et des peintres les plus fascinants du XXe siècle. Enfances Salvador Dali est né le 11 mai 1904 dans la petite ville de Figueras, capitale de l'Ampurdan, dont son père était le notaire. Il reçoit le même nom que son frère décédé quelques mois avant, situation qu'il exploita génialement pour s'inventer une nature angélique : puisqu'il pouvait voir sa tombe au cimetière de Figueras, il était paradoxalement à la fois vivant et mort, donc immortel. Déjà très gâté par ses parents marqués par la perte de leur premier fils, il commence dès l'enfance à manifester des penchants mégalomaniaques et un goût pour les déguisements physiques et moraux. -

1 Dalí Museum, Saint Petersburg, Florida Integrated Curriculum Tour
Dalí Museum, Saint Petersburg, Florida Integrated Curriculum Tour Form Education Department, 2014 TITLE: “Salvador Dalí: Middle School Dalínian Science” SUBJECT AREA: (VISUAL ART, LANGUAGE ARTS, SCIENCE, MATHEMATICS, SOCIAL STUDIES) Visual Art (Next Generation Sunshine State Standards listed at the end of this document) GRADE LEVEL(S): Grades: 6-8 DURATION: (NUMBER OF SESSIONS, LENGTH OF SESSION) One session (30 to 45 minutes) Resources: (Books, Links, Films and Information) Books: • The Dalí Museum Collection: Oil Paintings, Objects and Works on Paper. • The Dalí Museum: Museum Guide. • The Dalí Museum: Building + Gardens Guide. Links: • Florida Art Education Association: www.faea.org 1 • National Art Education Association: www.arteducators.org • National Core Art Standards: www.nationalartstandards.org • www.thedali.org • http://www.thedali.org/education/resources.php Films: • Dalí Condensed: 5 lecture series, Peter Tush, Curator of Education Dali Museum You Tube Site. • The Dalí Dimension, Decoding the Mind of a Genius, Psychoanalysis, Relativity Theory, DNA & Genetics, Mathematics, Nuclear Physics. Information: Leonardo da Vinci (1452-1519) • Italian polymath, scientist, mathematician, engineer, inventor, anatomist, painter, sculptor, architect, botanist, musician and writer. Leonardo has often been described as the archetype of the Renaissance man. • Painstaking observations and carried out research in fields ranging from architecture and civil engineering to astronomy to anatomy and zoology to geography, geology and paleontology. • Leonardo had a device for waking. • Spring Device, geometric perspective. • c. 1478: Studies of Self-Propelled cart, Codex Atlanticus. • 1480: Parachute. • 1480: Archimedes screws and pumps to draw up water. • 1485: Drawing of a flying machine. • 1485: Scythed Assault Chariot. • 1487: Canon Foundry. • 1490: Study of Horses. -

Dali Art Frauds Target Directv Home
Vol. 16 No. 2 Summer 2006 FOR THE DALI AFICIONADO AND SERIOUS COLLECTOR Dali Art Frauds Target DirecTV Home Shopping Enthusiasts from Art Business News, 5-6-2006 Over the last few months we've been contacted by several consumers who bought Dali prints from satellite TV shopping shows, only to discover that the prints were forgeries. The buyers came to us for appraisals, and were, understandably distraught to learn that they'd purchased fakes. When we looked into the matter further, we learned that these forgeries were being sold on television every day, and we took the story to the media. Below is a reprint of the story as it appeared in Art Business News -- Ed. AN JUAN CAPISTRANO, CA - Two unsuspecting art INSIDE collectors -- and possibly hundreds of others --recently SSdiscovered that the signed Salvador Dalí prints they had just purchased were forgeries. Other than having an Dali Sighting appreciation for Dalí's work, the only thing the two men had PAGE 2 in common was that they had purchased the art from television shopping shows on DirecTV. Upon investigation, a Dalí expert determined that these shows have been selling Events and dozens of fakes. The original Nose of Nero, 1947. Exhibitions Collectors bought signed prints on PAGE 3 “Both men called me within two weeks of one another,” shopping shows that were forgeries. says Bruce Hochman, director of the Salvador Dalí Gallery in San Juan Capistrano, CA, and author of the only official Salvador Dalí print price guide. “They asked me to appraise the Dali, Hitchcock pieces, which turned out to be absolutely, without question, forgeries. -

The Tragic Myth of Millet's 'Angelus'
©Dawn Adès, 2007 & 2016 The Tragic Myth of Millet’s ‘Angelus’ By Dawn Adès 1. The documents In 1963 Dali finally published a book he had written in the early 1930s: The Tragic Myth of Millet’s “Angelus”. The book had, apparently, been lost. Its original impetus, as Dali explained in his text, was an obsession with Millet’s famous 19th century painting of peasant piety, the Angelus, which appeared suddenly in his imagination in full colour and loaded with unconscious meaning: “the most troubling, the most enigmatic, the densest, the richest in unconscious thoughts that has ever been.”1 The Angelus haunts his work at the time and the extraordinary text, which treats Dali’s obsession as a psychoanalytical case study, has long been recognised for the light it sheds on his paintings of the 1930s but has often been taken as a retrospective account. It was, in fact, a major experimental surrealist work in its own right which deserves to take its place among publications such as Breton and Eluard’s L’Immaculée Conception (1930) and Breton’s Les vases communicants (1932). When the book was published in 1963, Dali wrote a new Prologue which claimed that the manuscript had been mislaid when he and Gala left Arcachon hurriedly in 1940 “a few hours before the German invasion”. Finding it again twenty-two years later, Dalí continues, he read it and decided to publish it as it was, “without changing a comma.”2 A group of manuscripts, including the final typescript of the book complete with corrections and revisions by André Breton, which were among Dali’s papers when he died and are now housed at the Fundacion Gala-Salvador Dalí in Figueres, provide incontrovertible proof that The Tragic Myth was written as he claims in the 1930s, that it Avant-garde Studies Issue 2, Fall 2016 1 ©Dawn Adès, 2007 & 2016 was then ready for publication and that when he did finally do so in 1963 he didn’t change a comma. -

Salvador Dali
Contact: Norman Keyes Directeur Media Relaties (215) 684-7862 [email protected] HET PHILADELPHIA MUSEUM OF ART PRESENTEERT EEN RETROSPECTIEVE TENTOONSTELLING OVER SALVADOR DALÍ IN FEBRUARI 2005 Philadelphia is de enige locatie in de Verenigde Staten voor de tentoonstelling Salvador Dalí, de meest complete terugblik op de artiest ooit. Salvador Dalí (1904-1989), één van de meest invloedrijke kunstenaars in de twintigste eeuw, is het onderwerp van een grote tentoonstelling in februari in het Philadelphia Museum of Art. Salvador Dalí is de eerste uitvoerige tentoonstelling sinds de kunstenaar is overleden en omarmt ieder aspect van zijn creatieve leven als een schilder, schrijver, publicist, filmmaker, theoreticus en ontwerper van objecten, balletten en tentoonstellingen. Het omvat meer dan 200 werken, waaronder zijn schilderijen uit de 20er en 30er jaren, die in een context worden geplaatst met zijn vroege en meer recente werk. Er zijn 150 schilderijen, een enorme verzameling foto’s, sculpturen, geschriften, en er is een sectie met foto’s en informatie over de kunstenaar. Al deze werken komen uit publieke en private collecties in de Verenigde Staten, Europa, Brazilië, Mexico en Japan. Salvador Dalí wordt georganiseerd door de Palazzo Grassi uit Venetië en het Philadelphia Museum of Art in samenwerking met de Gala-Salvador Dalí Stichting uit Figueras te Spanje. De laatste heeft 2004 tot wereldwijd Dalí Eeuw Jaar uitgeroepen. De retrospectieve tentoonstelling zal eerst in Venetië van 12 september 2004 tot 9 januari 2005 plaatsvinden en reist dan door naar Philadelphia, waar het tentoongesteld wordt van 16 februari tot 15 mei 2005. Anne d’Harnoncourt, directeur van het Philadelphia Museum of Art, zegt: “ons museum is vereerd deel te nemen in de Dalí Eeuw en samen te werken met de Gala-Salvador Dalí Stichting. -
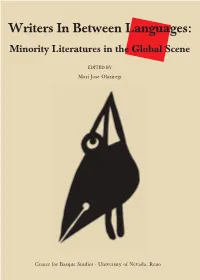
Writers in Between Languages
5 Minority Literatures in the Global Scene Writers In Between Languages: This book is a collection of the contributions made by Basque Writers In Between Languages: writers and American and European academics to the internatio- nal symposium, “Writers in Between Languages: Minority Lite- ratures in the Global Scene,” held May 15–17, 2008 at the Center Minority Literatures in the Global Scene for Basque Studies, University of Nevada, Reno, in the United States. Our symposium attempted to think about the consequen- ces of bilingualism for writ ers in a minority language, like Basque, EDITED BY in that they are located in that “in-between” of different cultural Mari Jose Olaziregi and identity communities and subjected to constant exchange and recognition of differences. One could say that practically all the current 800,000 Basque-speakers or euskaldunak who live on both sides of the Pyrenees in Spain and France are bilingual. And that this bilingualism is formed in conjunction with such widely spoken languages as Spanish and such prestigious languages in literary circles as French; lan guages that, in turn, have been displaced by the enormously central and legitimizing place that English occupies in the current global framework. The sympo- sium attempted, moreover, to debate the consequences implied by linguistic extra-territorialization for many authors in a minority language, the realignment implied by the hegemony of Eng lish for E all other literatures, and the options open to a minority author to DIT E get their voice heard in the World Republic of Letters. Together D BY with the above themes, certain aspects of the academic study of a minority literature such as that of Basque completed the list of Mari Jose subjects we intended to examine. -

La Madona De Portlligat)
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018 Núm. cat. P 660 The Madonna of Portlligat (La Madona de Portlligat) Data: c. 1950 Tècnica: Oli sobre tela Dimensions: 275.3 x 209.8 cm Signatura: Signat a la part inferior dreta: SALVADOR DALI Localització: Fukuoka Art Museum, Fukuoka (Japó) Catàleg Raonat de Pintures de Salvador Dalí Pàgina 1 de 7 | Núm. cat. P 660 Procedència Sir James Dunn Lady Dunn Fernando Guereta, Nova York Minax International Co. & Inc., Tòquio Credi Saison, Tòquio Observacions * La “I Bienal Hispanoamericana de Arte” es va celebrar a Madrid i Barcelona. A Madrid del 12 d’octubre de 1951 al 28 de febrer de 1952, encara que sabem que les obres del pintor van ser exposades només durant el lapse de temps que reflectim en l’apartat d’exposicions. A Barcelona durant el mes de març del 1952, encara que sabem que les obres del pintor van ser exposades durant un període més llarg, que és el que consignem a l’exposició. Exposicions 1950, New York, Carstairs Gallery, "The Madonna of Port-Lligat", 27/11/1950 - 10/01/1951, sense número 1951, Paris, Galerie André Weil, Exposition Salvador Dali, 22/06/1951 - 04/08/1951, sense número 1951, London, The Lefevre Gallery, Dalí, desembre 1951, núm. cat. 1 1952, Basel, Kunsthalle Basel, Phantastische Kunst des XX.Jahrhunderts, 30/08/1952 - 05/10/1952, núm. cat. 70 1952, Madrid, Salas de la Sociedad Españoña de Amigos del Arte, 1º Bienal Hispanoamericana de Arte *, 22/01/1952 - 24/02/1952, sense número 1952, Barcelona, Museo de Arte Moderno, I Bienal Hispanoamericana de Arte *, març 1952, núm.