Universite Abou-Bekr Belkaïd - Tlemcen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Une Cellule Anti-Harragas
A la une / Actualité pour dissuader les candidats à l’émigration clandestine Une cellule anti-harragas C’est l’ampleur prise ces derniers mois par ce phénomène qui a poussé les responsables à mettre en place cette structure. Le phénomène de l’émigration clandestine s’est amplifié ces derniers mois, et ce, depuis le début de la saison estivale, au niveau de la côte de l’extrême-ouest du pays, en particulier les zones de Honaine, Ghazaouet et Marsat Ben M’hidi, ainsi que les wilayas de Tlemcen et Aïn Témouchent avec Béni-Saf et Bouzedjar, qui ont enregistré un nombre important de candidats à la harga. À cet effet, et pour y faire face, une cellule de sécurité et de crise, composée des représentants de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale et des gardes-côtes, vient d’être mise sur pied tout récemment afin d’assurer un travail de coordination. Il s’agit, dans un premier temps, de parvenir à dissuader les jeunes Algériens de recourir à cette aventure à haut risque qu’est la tentative d’émigration clandestine. Par ailleurs, nous apprenons que cette cellule aura pour mission principale le suivi des mouvements et des différents passages des harragas, qui devront en même temps être soumis à des enquêtes approfondies quant à leurs origines, mais également les motifs qui les ont amenés à faire ce choix extrême aux conséquences parfois dramatiques. L’importance de rassembler toutes les informations nécessaires sur ce phénomène qui prend de l’ampleur dans la région ouest du littoral est aussi l’un des objectifs de cette cellule, et ce, pour permettre aux différents responsables concernés de prendre les mesures s’imposant en pareille circonstance. -

Journal Officiel Algérie
N° 64 Dimanche 19 Safar 1440 57ème ANNEE Correspondant au 28 octobre 2018 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale.................................. 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction...... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 19 Safar 1440 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 octobre 2018 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 18-262 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali sur l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine juridique et judiciaire, signé à Alger, le 15 mai 2017............... -

Journal Officiel N°2020-59
N° 59 Dimanche 16 Safar 1442 59ème ANNEE Correspondant au 4 octobre 2020 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: 1 An 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Edition originale................................... 1090,00 D.A 2675,00 D.A Tél : 021.54.35..06 à 09 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction.... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER (Frais d'expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 16 Safar 1442 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 4 octobre 2020 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 20-274 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux -

Télécharger Article
Genetics and Biodiversity Journal Journal homepage: http://ojs.univ-tlemcen.dz/index.php/GABJ Original Research Paper EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF SCRAPIE DISEASE IN LOCAL SHEEP POPULATION IN ALGERIA. Kalai S M*, Amara Y, Ameur Ameur A, Gaouar SBS Laboratory Pathophysiology and Biochemistry of Nutrition (PpBioNut), Department of Biology, SNV-STU Faculty, University of Tlemcen. *Corresponding Author: Kalai SM, University of Tlemcen ine, Algeria; Email: [email protected] Article history: Received: 28 November 2016, Revised: 5 December 2016, Accepted: 22 January 2017 Abstract The aim of this study is to carry out a field survey for a better knowledge of the current state of our sheep population in Algeria; especially Tlemcen region in relation to scrapie and and the factors favoring their appearance (Nedroma, Ghazaouet, Honain, Bab El Assa, Maghnia, El Gor, Sebdou, Sid Jilali and Laaricha) This survey is carried out according to phenotypic observations of the individuals to detect possible presence of Symptoms of scrapie. Down results obtained show that there are no signs of prion disease in the surveyed herds. Keywords: Epidemiology; Scrapie; sheep; Algeria . Introduction Scrapie is an insidious, degenerative disease affecting the central nervous system (CNS) of sheep and goats. The disease is also called la tremblante (French:trembling), Traberkrankheit (German: trotting disease), or rida (Icelandic: ataxia or tremor); it is also known by numerous other names. The disease was first recognised as affecting sheep in Great Britain and other countries of Western Europe over 250 years ago. The first reports of the existence of scrapie appear in eighteenth and nineteenth century literature from England and Germany. -

Ressources En Eau Et Urbanisation Cas Du Groupement Urbain Tlemcen
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministére de l’enseignement supérieur Et de la recherche scientifique Faculté de technologie Département de l’hydraulique Mémoire De magister en hydraulique Option : Mobilisation et protection des ressources en eau RESSOURCES EN EAU ET URBANISATION CAS DU GROUPEMENT URBAIN TLEMCEN Présenté par : SMAIL FOUZIA SOUTENU DEVANT LE J URY Président : Benmansour A. Professeur Uni .Tlemcen Encadreur : Adjim F. Professeure Uni .Tlemcen Examinateur : Megnounif A. M.C.A Uni .Tlemcen Examinateur : Chiboub F.A. Professeur Uni .Tlemcen Invité d’Honneur : Rouissat B. M. A .A. Uni. Tlemcen Dédicaces Je dédie ce travail à la mémoire de ma mère et de mon père pour tout ce qu’ils ont fait pour moi. Merci A mon cher mari pour ces encouragements et sa patience. Aux êtres les plus chères, mes enfants : Farah et Manel A mes frères et sœurs je leurs souhaite une vie pleine de bonheur… A ma belle mère, mes beaux frères et belles sœurs A mes amies et mes voisines; qui ont toujours cru en moi ; ce qui m’a donné confiance pour élaborer ce travail et m’a permis de me surpasser. REMERCIEMENT Je remercie tout d’abord mon encadreur, Pr.Adjim F. pour tous ses encouragements et sa patience, c’est grâce à Dieu puis à elle que j’ai pu continuer mes recherches et pu terminer ce mémoire. Mon choix s’est porté sur Mr Rouissat comme invité d’honneur pour enrichir le débat, grace à son expérience pratique et théorique et sa compétence dans le domaine. Grâce à lui j’ai pu réaliser une étude professionnelle. -
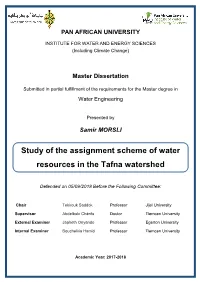
MT-Samir MORSLI.Pdf (4.618Mb)
PAN AFRICAN UNIVERSITY INSTITUTE FOR WATER AND ENERGY SCIENCES (Including Climate Change) Master Dissertation Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master degree in Water Engineering Presented by Samir MORSLI Study of the assignment scheme of water resources in the Tafna watershed Defended on 05/09/2018 Before the Following Committee: Chair Tekkouk Saddok Professor Jijel University Supervisor Abdelbaki Chérifa Doctor Tlemcen University External Examiner Japheth Onyando Professor Egerton University Internal Examiner Bouchelkia Hamid Professor Tlemcen University Academic Year: 2017-2018 Study of the assignment scheme of water resources in the Tafna watershed Declaration I SAMIR MORSLI, hereby declare that this thesis represents my personal work, realized to the best of my knowledge. I also declare that all information, material and results from other works presented here, have been fully cited and referenced in accordance with the academic rules andethics Signed Date 31/07/2018 SAMIR MORSLI This thesis has been submitted for examination with our approval as the University supervisor. Signature Date31/07/2018 Prof. ABDELBAKI CHERIFA Study of the assignment scheme of water resources in the Tafna watershed Dedication It is with the help of all powerful that I come to term of this modest work that I dedicate: To those who have cared for me since my birth to make me a person full of love for science and knowledge; my dear parents who have been able to give me happiness, Who knew how to guide my steps towards a safe future, who have never stopped encouraging me to undertake these studies and achieve this goal. -

17 Joumada Ethania 1434 28 Avril 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 7
17 Joumada Ethania 1434 28 avril 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 7 Décret exécutif n° 13-158 du 4 Joumada Ethania 1434 3. Jijel Centrale CC - El Milia (2ème ligne). correspondant au 15 avril 2013 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative 4. El Milia - Oued Athmania . à la réalisation de lignes hautes et très hautes tensions. 5. El Milia - Salah Bey. ———— 6. Coupure à Biskra 400/220 kv de la ligne 400 kv Aïn Le Premier ministre, Beida - Hassi Messaoud. Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines ; 7. Biskra - Salah Bey. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; 8. Aïn Arnat - Oued Athmania . Vu la loi n° 90 -30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; 9. Coupure à Aïn Arnat de la ligne El Milia - Salah Bey. Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant 10. Marsat - Poste blindé n° 2 Arzew Zone Industrielle. les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 11. Messerghine Centrale - Messerghine Poste (1ère Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 ligne). correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation ; 12. Messerghine Centrale - Messerghine Poste (2ème ligne). Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la 13. Messerghine - Petit Lac. protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; 14. Zahana - Poste blindé n° 1 Arzew Zone Industrielle. -

Etude De L'impact De La Consanguinité Sur L'avortement Et La Mortalité Dans
www.didac.ehu.es/antropo Etude de l’impact de la consanguinité sur l’avortement et la mortalité dans la population de Sabra (ouest algérien) Study of the impact of consanguinity on abortion and mortality in the population of Sabra (western Algeria) Abdellatif Moussouni1,2, Ammaria Aouar2,3, Salima Otmani2, Nafissa Chabni4, Adel Sidiyekhlef 2 1Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques (station de Tlemcen), Algérie. 2Laboratoire d’Anthropologie des Religions et de leur Comparaison, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université Abou bekr Belkaïd de Tlemcen, Algérie. 3Laboratoire de Valorisation de l’Action de l’Homme pour la Protection de l’Environnement et Application en Santé Public (équipe Environnement et Santé), Faculté des Sciences, Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen, Algérie. 4 Service d’Epidémiologie et de Démographie, CHU de Tlemcen, Algérie. Auteur chargé de la correspondance: Abdellatif Moussouni, Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques (station de Tlemcen), Algérie. [email protected]. Mots-clés: Population, Sabra (Algérie), mariage consanguin, avortement, mortalité, Méditerranée. Keywords: Population, Sabra (Algeria), consanguineous marriage, abortion, mortality, Mediterranean. Résumé Le mariage consanguin fait référence aux unions contractées entre deux personnes ayant au moins un ancêtre commun. Ce mariage a été pratiqué depuis l'existence précoce des humains. Aujourd’hui ce comportement matrimonial est largement pratiqué dans plusieurs communautés avec des taux variables dont les plus élevés sont enregistrés dans les pays arabo-musulmanes. Des recherches menées auprès de ces populations et celles du monde entier ont montré un impact de la consanguinité sur les paramètres de santé dû principalement à l’augmentation de l’homozygotie. -

Composante 4 Remplir Cette Partie
Comment [m1]: Les pages d'introduction n'ont pas été remplies, ce qui ne permet pas une comparaison générale avec les autres sites proposés. Merci de Composante 4 remplir cette partie. Comment [m2]: Impression générale : La fiche semble inachevée. De nombreuses Optimisation et valorisation du rôle d’atténuation des forêts méditerranéennes informations manquent et quelques phrases n'ont pas été achevées. Nous recommandons aux rédacteurs de plus Merci de limiter la longueur de cette fiche - Composante 4 - à 6 pages rentrer dans les détails, de mieux présenter notamment les données disponibles (date, auteur, précision, méthode, données source…) et d’exprimer plus clairement les activités qui sont envisagées. Contexte Description du site concerné par les activités de la composante 4 Si le territoire concerné par la composante 4 ne représente qu’une partie du site, préciser : Délimitation/localisation du Monts des traras partie nord Est de la wilaya de Tlemcen tterritoire et spécificités X1 : 83 ; x2 : 110 ; y1196 y2 : 222 Comment [m3]: Pouvez-vous préciser Superficie du tterritoire concerné 8450 Ha le système de coordonnées utilisé ? par la composante 4 Communes concernées : Ghazaouet,Dar Yaghmoracene ; Ain Kebira, Honaine, Nedroma, Fillaoucene Superficie des espaces boisés sur 1700 ha le territoire concerné par la composante 4 Population vivant sur le territoire 8229 habitants concerné par la composante 4 et population usagère Justification de la délimitation du territoire concerné par les activités de la composante 4 (par rapport à la situation de dégradation du site, les pressions existantes, etc.) Entité homogène, espèce naturelle ( Comment [m4]: Phrase inachevée Gestion des espaces boisés Modes ou instruments de gestion spécifiques au territoire (plan d’aménagement, plan de gestion, Inexistant etc.) Etudes socio-économiques Existe-t-il pour le territoire des données socio-économiques qui permettent de recenser et Enquête ménage dans le cadre de la stratégie ,du décrire la population ? Les développement Rural ( Comment [m5]: Phrase inachevée décrire. -

Complexe Résidenciel Et Touristique À Mersa Ben M'hidi
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique جامعة عبد الحميد بن باديس وﻻية مستغانم Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem كلية العلوم والتكنلوجيا Faculté des Sciences et de la Technologie MEMOIRE DE FIN D’ETUDE DE MASTER ACADEMIQUE Filière : Architecture Spécialité : Habitat et Projet Urbain Thème : Complexe Résidenciel et Touristique à Mersa Ben M’hidi Présenté par : REDJOUH Essaad Soutenu le 04/03 / 2019 devant le jury composé de : Président : Mr. LEGHRIB et Mr. BENBOUZIANE Examinateur : Mr. MEGUDAD Encadreur : Mr. CHACHOUR Madjid TABLE DES MATIERES Introduction ........................................................................................................................................................... 002 Choix du site ......................................................................................................................................................... 002 Problématique……………………………………………………………………………………………003 CHAPITRE 01 : Quelques Notions Sur Le Tourisme………………………………………………..004 1-Généralité .......................................................................................................................................................... 005 1-1- Définitions ..................................................................................................................................................... 005 I-2-Aperçu historique sur le tourisme dans le monde ..................................................................................... -

Heavy Metals in the Three Fish Species from Honaine Bay in Western Part of Algerian Coast
International Journal of Current Engineering and Technology E-ISSN 2277 – 4106, P-ISSN 2347 – 5161 ©2015 INPRESSCO®, All Rights Reserved Available at http://inpressco.com/category/ijcet Research Article Heavy Metals in the Three Fish Species from Honaine Bay in Western Part of Algerian Coast Wacila Benguedda*, †, Nacéra Dali youcef, † and Rachid Amara‡ †Universite De Tlemcen, Departement D’ecologie Et Environnement, Laboratoire De Valorisation Des Actions De L’homme Pour La Protection De L’environnement Et Application En Sante Publique, DZMS. Faculte SNV-STU.Nouveau Pole .ROCADE2.Mansourah BP 119 Imama - Tlemcen, Algeria, Tel :00 213 40 91 59 09 Mobile : 00 213 67 00 33 2 99 ‡Universite Du Littoral – Cote D'opale, Departement De Biologie, Laboratoire D’oceanographie Et De Geosciences, umr cnrs 8013, 32 av foch 62930, Wimereux, France Accepted 20 June 2015, Available online 29 June 2015, Vol.5, No.3 (June 2015) Abstract Contents of heavy metals have been detected in the gonads, muscle, liver and gill of three fish species (Sarpa salpa, Diplodus vulgaris, Trachurus trachurus) in of Honaine coast (in the western coast of Algeria) subsequently the relationships between fish size (length and weight) and metal concentrations in the tissues were investigated by linear regression analysis. The concentrations of some metals in some tissues exceeded the acceptable levels for a food source for human consumption. The results of this study showed that the metals present in the bay were taken up by three fish species through food and water, and regardless of their biological needs showed high metal concentrations. The highest values were found in the liver of Trachurus trachurus (TT). -

Aba Nombre Circonscriptions Électoralcs Et Composition En Communes De Siéges & Pourvoir
25ame ANNEE. — N° 44 Mercredi 29 octobre 1986 Ay\j SI AS gal ABAN bic SeMo, ObVel , - TUNIGIE ABONNEMENT ANNUEL ‘ALGERIE MAROC ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: MAURITANIE SECRETARIAT GENERAL Abonnements et publicité : Edition originale .. .. .. .. .. 100 D.A. 150 DA. Edition originale IMPRIMERIE OFFICIELLE et satraduction........ .. 200 D.A. 300 DA. 7 9 et 13 Av. A. Benbarek — ALGER (frais d'expédition | tg}, ; 65-18-15 a 17 — C.C.P. 3200-50 ALGER en sus) Edition originale, le numéro : 2,50 dinars ; Edition originale et sa traduction, le numéro : 5 dinars. — Numéros des années antérleures : suivant baréme. Les tables sont fourntes gratul »ment aux abonnés. Priére dé joindre les derniéres bandes . pour renouveliement et réclamation. Changement d'adresse : ajouter 3 dinars. Tarif des insertions : 20 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANGAISE) SOMMAIRE DECRETS des ceuvres sociales au ministére de fa protection sociale, p. 1230. Décret n° 86-265 du 28 octobre 1986 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux siéges & pourvoir pour l’élection a l’Assemblée fonctions du directeur des constructions au populaire nationale, p. 1217. , ministére de la formation professionnelle et du travail, p. 1230. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général da la planification Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux et de. la gestion industrielle au ministére de fonctions du directeur de la sécurité sociale et lindustrie lourde,.p.