Histoire De L'enseignement Primaire Dans La Commune De Saint Maurice
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Colombe Bulletin Novembre 2018 Version 2
La Colombe Bulletin, Novembre 2018 Calendrier des messes Octobre à Décembre 2018 Paroisse Saint Laumer du Perche Dates Samedi 18 h 00 Dimanche 9 h 30 Dimanche 11 h Ardelles ; Belhomert : Boissy-les-Perche ; Champrond-en-Gâtine ;La Chapelle-Fortin ; Digny . OCTOBRE La Ferté-Vidame : fontaine-Simon ;La Framboisière ;Jaudrais ; Lamblore ;La Loupe ; Sam 6 Octobre Meaucé - La Ferté Vidame Louvilliers-les-Perche ;Manou ; Meaucé . Le Mesnil Thomas ; Montireau ; Montlandon ; Morvilliers ; Dim 7 Octobe La Loupe - Senonches La Puisaye ;Les ressuintes ; Rohaire ; Saint Eliph ;Saint-Maurice-Saint-Germain Saint Victor-de-Buthon ;La Saucelle ; Senonches ; Tardais ; Vaupillon ; La Ville-aux-Nonains Sam 13 Octobre St Victor - Lamblore Dim 14 Octobre La Loupe - Senonches Accueil et Secrétariat Belhomert - La Ferté Sam 20 Octobre [email protected] Vidame La Loupe Marie-Paule, Alain et Dim 21 Octobre St Eliph FP - Senonches Mesnil Thomas - Yprianne Sam 27 Octobre La Ferté Vidame tél :02 37 81 10 11 Dim 28 Octobre Montlandon - Senonches mardi et samedi : 10h -12h N NOVEMBRE E JEUDI 1 er mercredi et vendredi :16h-18h ; La Loupe-Senonches- Novembre Père Jean Pierre Omva Edou Senonches :Nelly Dubesset , Vendredi 2 La Loupe - Senonches Novembre 06 40 23 24 43 tél :02 37 37 76 45 Sa. 3 Novembre La Ferté - Vidame vendredi, samedi de 10h à 12h 18 rue de l’église D . 4 Novembre Vaupillon (10h30) (FP) – Senonches 28240 La loupe La Ferté Vidame : Anne, Marie Odile , S .10 Novembre La Ferté - Vidame E .mail : Brigitte et Dominique La Loupe (10h) -

Télécharger Le
DÉPARTEMENT D’EURE ET LOIR VILLE DE LA LOUPE CONSEIL MUNICIPAL Séance du 28 mai 2019 L’an deux mil dix-neuf, le 28 mai, à vingt heures après convocation légale en date du 22 mai 2019, les membres du Conseil Municipal se sont réunis à la mairie de LA LOUPE sous la présidence de Monsieur GÉRARD, Maire de LA LOUPE. Etaient présents : M. GERARD Maire, Mme VARENNE, M. THOMAS, Mme CORDIER, M. FOUCAULT, Mme BRANDELON, M. LAMBERT, Adjoints, M. GLATIGNY, M. GEORGES, M. LAFOY, Mme BOUIX-ECHIVARD, M. BOUSTIERE, Mme TOULEMONDE, Mme RENAULDON, Mme LEGRAND, M. CHANTELOUP, M. TRAN-DIHN-NHUAN, Conseillers Municipaux. Pouvoirs : M. JEROME donne pouvoir à M. GLATIGNY, M. LE GUERNIGOU donne pouvoir à Mme VARENNE Excusées : Mme THOMAS, Mme PROUST, M. HEMERY Secrétaire de séance : Mme VARENNE Sur proposition de M. le Maire, une minute de silence est effectuée en hommage à Annie GUITTET. Le Procès-verbal du Conseil Municipal du 02 avril 2019 est approuvé à l’unanimité. Délibération n°1 Résultats de l’opération « Un projet pour ta Ville » Suite au lancement de l’opération « Un projet pour ta Ville », 9 projets ont été recensés. Pour rappel, une somme de 15 000 € a été allouée à cette opération dans le cadre du budget primitif 2019. Parmi les propositions reçues, il est proposé au Conseil de retenir deux thématiques de travail : - Centre-ville et Place de l’Hôtel de Ville : sur la base des projets n°1 et n°2 (réglementation, circulation des piétons et cyclistes, animations du centre-ville) Il est proposé au Conseil de constituer un groupe de travail et de réflexion sur le sujet associant : les élus intéressés, les porteurs du projet, les services municipaux concernés (Police, techniques…) - Le numérique et le codage : sur les base des projets n°4, n°5 et n°9 (formation des parents au numérique, stages et semaine du codage). -

Communautés De Communes Et D'agglomérations
Communautés de communes et d'agglomérations Gu ainville Gilles La Ch aussée-d 'Ivry Le Mesnil-Simo n ¯ Ou lin s Saint-Ouen-March efroy Anet Sau ssay Bonco urt Berchères-sur-Vesgre So rel-M oussel Rouvres Saint-Lub in -d e-la-Haye EURE Pays Houdanais Bû Abon dant (partie E&L) Havelu Serville Marchezais Go ussainville Montreuil Damp ierre-su r-Avre Saint-Lub in -d es-Jo ncherets Cherisy Saint-Rémy-su r-Avre Vert-en-Drouais Bro ué Dreux Pays de Bérou -la-Mulotière Germainville Lou villiers-en-Drou ais Sainte-Gemme-Moronval Boutigny-Pro uais Boissy-en-Drou ais VerneuMionltigny-sur-Avre Revercourt Prudemanche La Ch apelle-F orainvilliers Mézières-en-D rou ais Escorpain Allainville Verno uillet (partie E&L) Luray Ou erre Rueil-la-Gadelière Fessan villiers-Mattanvilliers Saint-Lub in -d e-Cravant Écluzelles Laons Garan cières-en-Drouais Garnay Les Pin th ières Charp ont Brezo lles Saint-Laurent-la-Gâtine Cro isilles Boissy-lès-Perche Châtain co urt Beauche Crécy-Cou vé Faverolles Rohaire Dreux Tréon Marville-Mo utiers-B rûlé Cru cey-Villages Villemeux-sur-Eu re Bréchamps Sau lnières Les Ch âtelets agglomération Saint-Ang e-et-Torçay Aunay-sou s-C récy La Ch apelle-F ortin Morvilliers Fon taine-les-Ribou ts Chaud on Coulombs Sen an tes Le Bo ullay-Mivoye La Man celière Lamb lo re Pu iseux Lormaye Saint-Lucien La Saucelle Maillebois Le Bo ullay-Thierry Le Bo ullay-les-Deux-Églises Orée du Nogen t-le-Roi Saint-Jean -de-Rebervilliers Lou villiers-lès-Perche Ormo y Perche La Puisaye Villiers-le-Mo rhier La Ferté-Vid ame Saint-Martin-de-Nigelles Saint-Sau -

La Loupe Autres Communes 2013/2014 A.D.M.R
Edition n°12 Informations essentielles : la loupe autres communes 2013/2014 A.D.M.R. Perche 28 11 impasse de la Cerisaie 02 37 81 42 26 - 02 37 29 90 59 St Éliph ..................... Ecole Mixte 6 Grande Rue 02 37 81 03 09 Bibliothèque square Pfalzgrafenweiler 02 37 29 94 37 Mairie 6 Grande Rue 02 37 81 18 23 Centre des Finances Publiques - Trésorerie 13 rue de l’Église 02 37 81 01 31 Collège Jean Monnet 56 avenue Dunois 02 37 53 58 70 St Maurice St Germain. Collège St François - Lycée Professionnel et Lycée Horticole et Paysager Notre Dame des Jardins Communauté de Communes des Portes du Perche 18 rue de la Gare 02 37 81 29 59 Le Château des Vaux 02 37 53 70 70 École Maternelle Les Ecureuils rue Jean Moulin 02 37 81 01 46 Ecole Primaire 2 rue de la Mairie 02 37 37 06 48 École Privée Maternelle & Primaire Notre-Dame 34 rue de l’Église 02 37 81 09 91 Mairie 2 rue de la Mairie 02 37 37 02 17 École Primaire Roland Garros 1 rue Georges Guynemer 02 37 81 12 53 La Maison Maternelle E.S.A.T. rue Pasteur 02 37 29 09 80 St Victor de Buthon ... Ecole Primaire 9 rue de la Liberté 02 37 81 35 89 LA LOUPE 28240 La Poste 7 rue de la Gare 36 31 Mairie 9 rue de la Liberté 02 37 81 15 04 Mairie place de l’Hôtel de Ville 02 37 81 10 20 L’Urgence Maison de Retraite EHPAD & Accueil de Jour Alzheimer Vaupillon ................. -

6.2 Plan De Zonage Vallée De L'eure
GpSDUWHPHQWDOH 22 rural 91 N Q 24 C.R. dit du 25 Pont Q 382 Hardoin 87 27 Chemin 2 26 Hardouin rural Q de 86 Q dit 92 53 de Chuisnes la 5LYLqUH +HQULqUH de 54 28 Ni LA RIVIERE NEUVE Neuve 55 4 Landelles 5 467 52 N 29 &KHPLQGH)HUGH3DULVj%UHVW 391 la Pont 56 468 50 51 469 6.2 Plan de zonage LES PIECES DE LA HENRIERE j A 30 j 470 1 37 (Chemin j A 572 sĂůůĠĞĚĞůΖƵƌĞ Dangeau UR2 du 33 471 Landelles 31 rural 32 57 rural Grand-Champ Echelle 1:2000eme Q 472 15 Q de dit 392 Chemin 568 Chemin de la 85 Q 393 20 Rat 571 LE CAMP 567 21 S.t-Marc rural au 36 488 de 394 38 Chemin Terriere A Moulin 10 dit 395 Courville-sur-Eure 22 au UR2 570 j 63 Q 489 par la 473 GH3OXYLJQRQj 16 &KkWLOORQ Plan Local d'Urbanisme 11 rural de 529 ƉƉƌŽƵǀĠƉĂƌĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚƵ Conseil Municipal en date LES PUISSOTS 411 Q +HQULqUH du 19 mars 2014 474 530 sƵƉŽƵƌġƚƌĞĂŶŶĞdžĠăůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ Chemin Chuisne du Conseil Municipal en date rural Ni Courville-sur-Eure du 19 mars 2014 5RXWHGpSDUWHPHQWDOHQ 531 535 15 6 64 CheminN 81 7 422 421 534 532 Chemin Ruisseau Rats 343 LES PIECES DE LA HENRIERE de 342 83 533 453 &KHPLQUXUDOQGLWGX3ULHXUp du UR1527 Rue Prieure 61 LE CAMP 8 aux rural LA CROIX DU SALUT 19 Grillon 46 82 45 41 Saint-Marc de UR1i 26 60 32 32 62 Moulin Dessous 524 LEGENDE 523 Tan du Q 522 383 521 dit &5Q 47 384 525 Q 58 31 14 dit LES GLANDS 30 rural 528 59 Q 385 &5Q j du UA Limite de zone 13 Chemin Sud 405 386 Chemin Saint-Marc Bois du 406 LES VOIX BASSES 387 rural 10 Croix N 362 23 EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS A REALISER des la 25 Q 508 388 j 340 Moulin 379 (PSODFHPHQWUpVHUYpSRXURXYUDJHSXEOLFLQVWDOODWLRQG LQWpUrWJpQpUDO LE DESSOUS DE GRILLON 339 544 1 9 de A DXWLWUHGHO DUWLFOH/GX&RGHGHO XUEDQLVPH Fourches 337 338 36 389 374 31 376 Chuisnes336 Pluvignon 30 rural 18 Rue du 345 du delaCroix duSalut UR1i de 543 Rue (PSODFHPHQWUpVHUYpSRXUPL[LWpVRFLDOHDXWLWUHGHO DUWLFOH/E GX&RGHGH 38 de 520 la Croix 516 du Salut 346 &5Q O XUEDQLVPHDXPRLQVGXQRPEUHWRWDOGHVORJHPHQWVUpDOLVpVGDQVOD]RQHGRLWrWUH 320 Q Ai j des logements locatifs sociaux. -

Ogent-Le-Rotrou
FICHE CANTONALE CANTON DE NOGENT-LE-ROTROU CANTON Nouveau canton DE JANVILLE CANTON CANTON DE Nogent-le-Rotrou Le canton de Nogent-le-Rotrou c’est : Une circonscription électorale née en 1790, remaniée en 1801. 10 COMMUNES Futur Canton N°13 limite de l’actuel canton de Nogent-le-Rotrou Argenvilliers, Brunelles, Champrond-en-Perchet, La Gaudaine, Margon, Nogent-le-Rotrou, Saint-Jean-Pierre- Fixte, Souancé-au-Perche, Trizay-Coutretot-Saint-Serge, N°13 NOGENT-LE-ROTROU Vichères. Son chef-lieu de canton est Nogent-le-Rotrou 2 (10 884 hab.) 441,3 KM Les communes sont regroupées au sein de la Communauté de communes du Perche. 2 28 313 HABITANTS 141,4 KM Nogent-le-Rotrou est l’un des 4 cantons de l’arrondisse- 2 ment de Nogent-le-Rotrou. 64,1 HABITANTS/ KM Présence de : gendarmerie, Poste, Trésor public, collège, 15 212 HABITANTS centre d’exploitation routier, Espace Cyber Emploi, pom- 30 KM 2 piers, établissements personnes âgées et handicapées, 107,6 HABITANTS/ KM entre les communes les plus éloignées d’Est en Ouest équipements sportifs et culturels. En tant que sous-préfecture, ce canton bénéficie d’une forte 39 KM présence bancaire et de services sociaux de proximité. entre les communes les plus éloignées du Nord au Sud RÉPARTITION DE LA POPULATION 33 COMMUNES* PAR TRANCHES D’ÂGE 90 ans et plus : 1,2 % Argenvilliers, Belhomert-Guéhouville, Brunelles, Champrond-en-Gâtine, Champrond-en-Perchet, Chassant, Combres, 75-89 ans : 11,7 % Les Corvées-les-Yys, Coudreceau, La Croix-du-Perche, Fontaine-Simon, Frétigny, Happonvilliers, La Gaudaine, La 0-14 ans : 15,1 % Loupe, Manou, Margon, Marolles-les-Buis , Meaucé, Montireau, Montlandon, Nogent-le-Rotrou, Nonvilliers-Gran- 60-74 ans : 18,2 % ghoux, Saint Denis-d’Authou, Saint-Eliph, Saint Jean-Pierre-Fixte, Saint Maurice-Saint Germain, Saint Victor-de-Bu- 15-29 ans : 16,4 % thon, Souancé-au-Perche, Thiron-Gardais, Trizay-Coutretot-Saint-Serge, Vaupillon, Vichères. -

La Loupe À 1/50 000
NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE LA LOUPE À 1/50 000 par G. MOGUEDET avec la collaboration de Y. MARCHAND, V. MASSON, H. PAPIN S. VAUTHIER, F. CHARNET, B. LEMOINE 2000 Éditions du BRGM Service géologique national Références bibliographiques. Toute référence en bibliographie à ce document doit être faite de la façon suivante : – pour la carte : MOGUEDET G., MARCHAND Y., MASSON V., PAPIN H., VAUTHIER S. (2000) – Carte géol. France (1/50 000), Feuille La Loupe (253). Orléans : BRGM. Notice explicative par Moguedet G., Marchand Y., Masson V., Papin H., Vauthier S., Charnet F., Lemoine B. (2000), 102 p. – pour la notice : MOGUEDET G., MARCHAND Y., MASSON V., PAPIN H., VAUTHUER S., CHARNET F., LE MOINE B. (2000) – Notice explicative, Carte géol. France (1/50 000), feuille La Loupe (253). Orléans : BRGM, 102 p. Carte géologique par Moguedet G., Marchand Y., Masson V., Papin H., Vauthier S. (2000). ISBN : 2-7159-1253-6 SOMMAIRE Pages RÉSUMÉ 5 ABSTRACT 7 INTRODUCTION 9 SITUATION ADMINISTRATIVE 9 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET HUMAIN 10 CADRE GÉNÉRAL - PRÉSENTATION DE LA CARTE 12 TRAVAUX ANTÉRIEURS - CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT DE LA CARTE 13 DESCRIPTION DES TERRAINS 15 TERRAINS NON AFFLEURANTS 15 TERRAINS AFFLEURANTS 17 Formations secondaires 17 Formations tertiaires 31 Formations superficielles tertiaires et quaternaires 31 CONDITIONS DE FORMATION DES GRANDES ENTITÉS GÉOLOGIQUES 43 ÉVOLUTION TECTONIQUE 46 SYNTHÈSE GÉODYNAMIQUE RÉGIONALE ET GÉODYNAMIQUE RÉCENTE 48 GÉOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT 53 OCCUPATION DU SOL 53 Les sols 53 Végétation 57 Histoire forestière 58 RESSOURCES EN EAU 61 Cycle hydrogéologique 61 Aquifères 62 Alimentation en eau potable 65 RISQUES NATURELS 69 SUBSTANCES UTILES, CARRIÈRES 71 ÉLÉMENTS DE GÉOTECHNIQUE 80 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 81 PRÉHISTOIRE, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 81 ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE 83 SITES CLASSIQUES ET ITINÉRAIRE 86 GLOSSAIRE 86 DOCUMENTS CONSULTABLES 87 BIBLIOGRAPHIE 87 REMERCIEMENTS 96 AUTEURS 97 ANNEXE ANNEXE 1 - OUVRAGES DE PRODUCTION D’EAU DES DÉPARTEMENTS DE L’ORNE ET DE L’EURE-ET-LOIR 99 LISTE DES FIGURES Fig. -
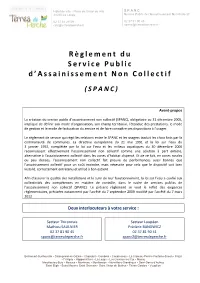
Règlement SPANC
Hôtel de ville - Place de l’hôtel de ville S.P.A.N.C 28240 La Loupe Service Public de l’ Assainissement Non Collectif 02 37 81 29 59 02 37 81 90 45 [email protected] [email protected] Règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif ( S P A N C ) Avant-propos La création du service public d’assainissement non collectif (SPANC), obligatoire au 31 décembre 2005, implique de définir son mode d’organisation, son champ territorial, l’étendue des prestations, le mode de gestion et le mode de facturation du service et de faire connaître ces dispositions à l’usager. Le règlement de service qui régit les relations entre le SPANC et les usagers traduit les choix faits par la communauté de communes. La directive européenne du 21 mai 1991 et la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, complétée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 reconnaissent effectivement l’assainissement non collectif comme une solution à part entière, alternative à l’assainissement collectif dans les zones d’habitat dispersé. Et de ce fait, en zones rurales ou peu denses, l’assainissement non collectif fait preuve de performances aussi bonnes que l’assainissement collectif pour un coût moindre, mais nécessite pour cela que le dispositif soit bien installé, correctement entretenu et utilisé à bon escient. Afin d’assurer la qualité des installations et le suivi de leur fonctionnement, la loi sur l’eau a confié aux collectivités des compétences en matière de contrôle, dans le cadre de services publics de l’assainissement non collectif (SPANC). -

La Loupe. E. 4059
LA LOUPE. E. 4059. (Registre.) — In-folio, papier, 812 feuillets. 1574-1615. — Pierre Seigneur, tabellion de la châtellenie de la Loupe. — Répertoire. — Marchés du seigneur de la Loupe avec : Renaud Moynard, maître maçon et « architecteur, » pour faire la conduicte du logis et bastiment que Monsieur veult faire eslever au lieu de la Louppe (23 fév. 1574) ; — Robert Mousset, tailleur de pierres, pour livrer sur le trou de la Carellière de Sainct-Jacques près Bertouville, paroisse de Sainct-Victor, troys cens quartiers de pierre blanche (6 juill. 1574); — Pierre Vasseur, tailleur de pierres, pour livrer vingt marches de pierre blanche taillées d'assemblage prises à la Carellière » (14 juin 1575); — Gilbert Crossonneau, maître charpentier, pour la » charpenterie qu'il conviendra faire et dresser sur et au-dedans des murailles du chasteau et maison seigneurialle de la Louppe » (6 juill. 1576) ; — François le Pescheux, couvreur en ardoises et plombier, pour couvrir d'ardoises la charpenterie du chasteau de Monsieur, depuys le bout vers et juxtc le coulombier jusques à l'escallier dudict logis (23 oct. 1576); — Marin Chevallier, menuisier, pour fournir neuf croisées au chasteau de la Louppe (3 avr. 1581) ; — Antoine Prévost, teinturier, et Roger Goulet, drappier à Verneuil, pour fournir de draps taints en noyr pour faire la tante et tapisserye qu'il faudra faire tant au dedans de l'église de la Louppe, avecq la salle du chasteau, l'entrée de l'escallyer dudit lieu, le tout pour la sollempnité du service de quarentain qui sera fait pour l'âme de deffuncte dame Loyse de Raillard, vivante espouse de Mr de la Louppe, qui décedda au chasteau le jeudy 20e jour de décembre 1584 (25 janv. -

Souvenir D'un Avenir : La Mémoire Des Images D'eure-Et-Loir
04.03.2016 - Château-Renault COMMUNIQUÉ DE PRESSE Souvenir d’un avenir : La Mémoire des images d’Eure-et-Loir Espace Valladon – 11 mars 2016 - 20h30 Dans le cadre de l’opération La Mémoire des images d’Eure-et-Loir, Ciclic, en partenariat avec le Conseil départemental d’Eure-et-Loir et la commune de La Bazoche-Gouët, propose la projection de deux documentaires tournés dans le Perche avec ses habitants : 17 juin 1944... Le ciel était bleu à La Loupe de Vincent Reignier et Regarder vers les images de Seigneur de Vianney Lambert, réunis autour d’un projet intitulé Souvenir d’un avenir. Cette séance de projection, en présence des réalisateurs, est proposée : le vendredi 11 mars 2016 à 20h30 à l’espace Valladon (salle des Arcades) à La Bazoche-Gouët Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles) AU PROGRAMME 17 juin 1944... Le ciel était bleu à La Loupe (20 min) : À partir des témoignages audio de quelques-uns des rescapés, enregistrés en 1994, le film raconte le bombardement de la ville de La Loupe le 17 juin 1944 en mêlant images d’aujourd’hui tournées en Super 8 et photos d’archives. Un film réalisé par Arthur Bourbon (16 ans), Dorian Caldart (11 ans), Mélinda Jubault (11 ans), Jules Bourbon (11 ans), Hugo Lucien (16 ans), Alyson Da Silva (13 ans), lors d’un atelier cinéma encadré par Vincent Reignier. Regarder vers les images de Seigneur (1h15) : Robert Seigneur de Bast, cinéaste amateur, a filmé pendant plusieurs décennies à Authon-du-Perche et ses environs. Ses images, en 16 mm, dessinent le portrait d’un territoire et celui d’un cinéaste devenu une figure locale. -

Cidre Du Perche » Avis De Consultation Publique Lors De Sa Séance Du 15 F
Appellation d’origine Protégée « Perche» ou « cidre du Perche » Avis de consultation publique Lors de sa séance du 15 février 2018, le comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’INAO a décidé la mise en consultation publique du projet d’aire géographique de l’appellation d’origine susmentionnée. Cette aire géographique concerne 106 communes réparties sur es départements de l’Orne, l’Eure-et-Loire et la Sarthe. La liste des communes proposées est précisée ci-dessous : Dans le département de l’Eure et Loire (28) ARGENVILLIERS , AUTHON-DU-PERCHE , BEAUMONT-LES-AUTELS , BELHOMERT- GUEHOUVILLE , BETHONVILLIERS , BRUNELLES , CHAMPROND-EN-PERCHET , CHARBONNIERES , COUDRAY-AU-PERCHE , COUDRECEAU , LES ETILLEUX , FRETIGNY , LA GAUDAINE , LA LOUPE , MARGON , MAROLLES-LES-BUIS , MEAUCE , MIERMAIGNE , MONTIREAU , MONTLANDON , NOGENT-LE-ROTROU , SAINT-BOMER , SAINT-DENIS- D'AUTHOU , SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE , SAINT-VICTOR-DE-BUTHON , SOIZE , SOUANCE-AU- PERCHE , TRIZAY-COUTRETOT-SAINT-SERGE, VAUPILLON, VICHERES Dans le département de l’Orne (61) Communes prises en entier : APPENAI-SOUS-BELLEME, BAZOCHES-SUR-HOENE, BELFORET-EN-PERCHE, BELLAVILLIERS, BELLEME, BELLOU-LE-TRICHARD, BERD'HUIS, BIZOU, BRETONCELLES, CETON, CHAMPEAUX-SUR-SARTHE, LA CHAPELLE-MONTLIGEON, LA CHAPELLE-SOUEF, COMBLOT, CORBON, COULIMER, COURGEON, COURGEOUT, COUR- MAUGIS-SUR-HUISNE , DAME-MARIE, FAY, FEINGS, FERRIERES- LA- VERRERIE, IGE, LOISAIL, LA MADELEINE-BOUVET, LE MAGE, MAHERU, MAUVES-SUR-HUISNE, -

Monographie De Meaucé
Histoire de l’enseignement primaire dans la commune de Meaucé – Canton de la Loupe Département d’Eure-et-Loir – Monographie de 1899 – CHARLES (instituteur) C.R.G.P.G. Juillet 2012) 1 Archives départementales d’Eure-et-Loir Chapitre 1 er – Histoire très sommaire de la commune Meaucé appelé Marcetum vers 1250, Manceium vers 1260, Meaussé en 1630 ; Meaucez en 1689, comme son étymologie semble l’indiquer (mauvaise terre, mauvais pays), était autrefois un pays couvert en grande partie de bois. D’ailleurs, plusieurs noms de villages semblent justifier cette opinion «crisloup, la louvetterie, la brosse (brousse, broussailles, bois), le haut bois ». La commune de Meaucé est située dans la partie nord ouest du canton de la Loupe , arrondissement de Nogent le Rotrou, département d’Eure et Loir. C’est un pays découvert, a peu près uni, assis sur un faible plateau qui s’élève entre deux petits ruisseaux : le ruisseau de la Loupe qui coule du sud au nord et le ruisseau du livier ou de l’étang des personnes qui coule de l’ouest à l’est et va rejoindre celui de la Loupe à peu près à la limite de la commune à l’est. La superficie de la commune compte 1134 hectares dont 39 hectares de bois seulement. Le village de Meaucé est à 3 kilomètres au nord de la Loupe, chef lieu de canton, à 23 kilomètres à l’est de Nogent le Rotrou, chef lieu d’arrondissement, à 38 kilomètres à l’ouest de Chartres (chef lieu de département) et à 120 kilomètres à l’ouest de Paris.