BLIDA Ou BLIDAH Ou EL BOULAIDA
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Citrus Farming in Algeria: Farmers’ Behavior Towards Research and Extension Agenda
African Journal of Agricultural Research Vol. 5(15), pp. 1993-2001, 4 August, 2010 Available online at http://www.academicjournals.org/AJAR ISSN 1991-637X ©2010 Academic Journals Full Length Research Paper Citrus farming in Algeria: Farmers’ behavior towards research and extension agenda Khaled Laoubi1*, Melkhir Boudi2 and Masahiro Yamao1 1Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University, Japan. 2University of Amar Telidji, Laghouat, Algeria. Accepted 22 April, 2010 The objective of this paper was to assess the behavior of Algerian citrus farmers with respect to agricultural research under the current extension and research system. Surveys were conducted at technical institute, extension service, and among 75 randomly selected stratified citrus farmers using closed structured questionnaires in 5 selected municipalities in the Blida province. The results of farm- level data analysis showed that identical management and farming practices in citrus farms resulted in variable production. The difference in production was found to be mainly due to the variety of citrus types planted. This fact, in addition to the socio-economic farmers’ constraints, suggests that the techniques adopted were non-profitable and highlights the failure of extension activities. At extension level, the socio-economic condition of the agents made them unable to fulfill their extension role. In addition, the agents’ lack of experience, training and specialization, financial resources and demonstration plots, hindered the implementation of the extension programs. Furthermore, the agents have no relationships with technical institutes or with agricultural research results. Work and experiments in the experimental stations of technical institutes that led to innovative results were not promoted. As consequences, farmers and sellers of agricultural products are still the primary sources of agricultural information. -

July 2013 Global Catastrophe Recap 2 2
July 2013 Global Catastrophe Recap Table of Contents Executive0B Summary 3 United2B States 4 Remainder of North America (Canada, Mexico, Caribbean, Bermuda) 4 South4B America 5 Europe 5 6BAfrica 6 Asia 6 Oceania8B (Australia, New Zealand and the South Pacific Islands) 8 8BAAppendix 9 Contact Information 14 Impact Forecasting | July 2013 Global Catastrophe Recap 2 2 Executive0B Summary . Thunderstorms prompt flooding in the greater Toronto metropolitan region; economic losses top USD1.0 billion . Seasonal rains cause significant flooding across Asia as economic cost approaches USD8.0 billion . Strong earthquakes strike China, Indonesia and New Zealand Strong thunderstorms brought record rainfall across Canada’s greater Toronto metropolitan region, prompting significant flooding and power outages. No fatalities or serious injuries were reported. The floods caused widespread damage to personal and commercial properties, vehicles and infrastructure - including in downtown Toronto. Total economic losses were estimated to approach CAD1.7 billion (USD1.65 billion), with roughly half of those losses covered by insurance (CAD850 million (USD825 million)). This marked the second billion-dollar natural disaster event to occur in Canada in 2013. (The first was an extensive flood event that inundated the province of Alberta in June.) Additional periods of severe weather were also noted in Canada, with damage from winds gusting to 100 kph (60 mph) and large hail recorded in the provincial regions of Ontario, Quebec, Alberta, Saskatchewan and Manitoba. Three stretches of severe weather affected the United States, with the vast majority of the damage occurring due to straight-line winds and hail. The number of tornado touchdowns during the month was again below normal, as 2013 remains one of the least tornadic years in U.S. -

« Ecosystems, Biodiversity and Eco-Development »
University of Sciences & Technology Houari Boumediene, Algiers- Algeria Faculty of Biological Sciences Laboratory of Dynamic & Biodiversity « Ecosystems, Biodiversity and Eco-development » 03-05 NOVEMBER, 2017 - TAMANRASSET - ALGERIA Publisher : Publications Direction. Chlef University (Algeria) ii COPYRIGHT NOTICE Copyright © 2020 by the Laboratory of Dynamic & Biodiversity (USTHB, Algiers, Algeria). Permission to make digital or hard copies of part or all of this work use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than Laboratory of Dynamic & Biodiversity must be honored. Patrons University of Sciences and Technologies Faculty of Biological Sciences Houari Boumedienne of Algiers, Algeria Sponsors Supporting Publisher Edition Hassiba Benbouali University of Chlef (Algeria) “Revue Nature et Technologie” NATEC iii COMMITTEES Organizing committee: ❖ President: Pr. Abdeslem ARAB (Houari Boumedienne University of Sciences and Tehnology USTHB, Algiers ❖ Honorary president: Pr. Mohamed SAIDI (Rector of USTHB) Advisors: ❖ Badis BAKOUCHE (USTHB, Algiers- Algeria) ❖ Amine CHAFAI (USTHB, Algiers- Algeria) ❖ Amina BELAIFA BOUAMRA (USTHB, Algiers- Algeria) ❖ Ilham Yasmine ARAB (USTHB, Algiers- Algeria) ❖ Ahlem RAYANE (USTHB, Algiers- Algeria) ❖ Ghiles SMAOUNE (USTHB, Algiers- Algeria) ❖ Hanane BOUMERDASSI (USTHB, Algiers- Algeria) Scientific advisory committee ❖ Pr. ABI AYAD S.M.A. (Univ. Oran- Algeria) ❖ Pr. ABI SAID M. (Univ. Beirut- Lebanon) ❖ Pr. ADIB S. (Univ. Lattakia- Syria) ❖ Pr. CHAKALI G. (ENSSA, Algiers- Algeria) ❖ Pr. CHOUIKHI A. (INOC, Izmir- Turkey) ❖ Pr. HACENE H. (USTHB, Algiers- Algeria) ❖ Pr. HEDAYATI S.A. (Univ. Gorgan- Iran) ❖ Pr. KARA M.H. (Univ. Annaba- Algeria) ❖ Pr. -

Bouda - Ouled Ahmed Timmi Tsabit - Sebâa- Fenoughil- Temantit- Temest
COMPETENCE TERRITORIALE DES COURS Cour d’Adrar Cour Tribunaux Communes Adrar Adrar - Bouda - Ouled Ahmed Timmi Tsabit - Sebâa- Fenoughil- Temantit- Temest. Timimoun Timimoun - Ouled Said - Ouled Aissa Aougrout - Deldoul - Charouine - Adrar Metarfa - Tinerkouk - Talmine - Ksar kaddour. Bordj Badji Bordj Badj Mokhtar Timiaouine Mokhtar Reggane Reggane - Sali - Zaouiet Kounta - In Zghmir. Aoulef Aoulef - Timekten Akabli - Tit. Cour de Laghouat Cour Tribunaux Communes Laghouat Laghouat-Ksar El Hirane-Mekhareg-Sidi Makhelouf - Hassi Delâa – Hassi R'Mel - - El Assafia - Kheneg. Aïn Madhi Aïn Madhi – Tadjmout - El Houaita - El Ghicha - Oued M'zi - Tadjrouna Laghouat Aflou Aflou - Gueltat Sidi Saâd - Aïn Sidi Ali - Beidha - Brida –Hadj Mechri - Sebgag - Taouiala - Oued Morra – Sidi Bouzid-. Cour de Ghardaïa Cour Tribunaux Communes Ghardaia Ghardaïa-Dhayet Ben Dhahoua- El Atteuf- Bounoura. El Guerrara El Guerrara - Ghardaia Berriane Sans changement Metlili Sans changement El Meniaa Sans changement Cour de Blida Cour Tribunaux Communes Blida Blida - Ouled Yaïch - Chréa - Bouarfa - Béni Mered. Boufarik Boufarik - Soumaa - Bouinan - Chebli - Bougara - Ben Khellil – Ouled Blida Selama - Guerrouaou – Hammam Melouane. El Affroun El Affroun - Mouzaia - Oued El Alleug - Chiffa - Oued Djer – Beni Tamou - Aïn Romana. Larbaa Larbâa - Meftah - Souhane - Djebabra. Cour de Tipaza Cour Tribunaux Communes Tipaza Tipaza - Nador - Sidi Rached - Aïn Tagourait - Menaceur - Sidi Amar. Kolea Koléa - Douaouda - Fouka – Bou Ismaïl - Khemisti – Bou Haroum - Chaïba – Attatba. Hadjout Hadjout - Meurad - Ahmar EL Aïn - Bourkika. Tipaza Cherchell Cherchell - Gouraya - Damous - Larhat - Aghbal - Sidi Ghilès - Messelmoun - Sidi Semaine – Beni Milleuk - Hadjerat Ennous. Cour de Tamenghasset Cour Tribunaux Communes Tamenghasset Tamenghasset - Abalessa - Idlès - Tazrouk - In Amguel - Tin Zaouatine. Tamenghasset In Salah Sans changement In Guezzam In Guezzam. -

INFO 482 DALMATIE 1/ Le Village De DALMATIE Devenu OULED YAÏCH
INFO 482 DALMATIE « Non au 19 mars » VOICI quelques articles de presse ou de donateurs retenus à votre attention : 1/ Le village de DALMATIE devenu OULED YAÏCH à l’indépendance Localité de l’algérois située à 4 km à l’Est de BLIDA et à 42 km, au Sud-ouest, d’ALGER. Période turque 1515-1830 (Si plus voir INFO 359) La ville de Blida est fondée au 16e siècle par le marabout Sidi Ahmed el Kebir avec la participation de musulmans andalous qui s'installent à Ourida (premier nom de Blida) et transforment alors les terres incultivables en vergers grâce aux plantations d'orangers et l'art de l’irrigation. Ils apportent également à la région, l'art de la broderie sur cuir. [Tombeau de Sidi-Ahmed El-Kebir, fondateur de la ville] Le colonel TRUMELET dans son ouvrage Blida : récits selon légende, la tradition et l’histoire publié en 1887, a consacré un chapitre sur les origines récentes de la ville. Renonçant l’hypothèse que celle-ci soit construite sur les ruines romaines ou antique, il avança la date de 1535 comme date de sa fondation par SIDI-AHMED EL-KEBIR. Pour cet auteur, Blida était du domaine privé de OULED SOLTANE, avant que SIDI EL-KEBIR est venu l’a peuplée des maures-Andalous évadés de l’Espagne… Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://blida.unblog.fr/2007/10/28/la-tribu-de-ouled-soltane/ Période française 1830-1962 Pénétrée par CLAUZEL dès 1830, occupée définitivement en 1839, BLIDA devint ville de garnison. -

La Mitidja Par R.Darnatigues
1 La Mitidja Essai sur la connaissance de ses origines Promenade dans les villages de la colonisation D'après l'étude réalisée par Julien FRANCK, la MITIDJA, au début de l'ère quaternaire, était une mer intérieure qui fut comblée par les alluvions apportées par les torrents qui descendaient des monts et collines environnants. Son premier nom fut peut-être MATIDIA. L'écrivain Edouard CAT, dans son essai sur la province romaine l'attribue à une nièce de TRAJAN qui possédait de grandes propriétés dans cette plaine, vers l'an 100 de notre ère. Notons qu'il a été trouvé de très nombreuses traces de la période romaine à OUED-EL-ALLEUG, BOUFARIK, EL-AFFROUN, BERBESSA, ainsi que des ruines d'un important camp près de MOUZAIAVILLE et des vestiges de silos bien cimentés à ATTATBA. Selon d'autres écrivains, il faudrait trouver l'origine du nom de cette région dans une ancienne ville forte située sur la route de MILIANA à ACHIR et dont l'emplacement est dificile à déterminer. Cette ville fut détruite vers la fin de la révolte d'IBN GHANIA au cours de la lutte entre les ALMORAVIDES et les ALMOHADES Le géographe arabe Léon L'AFRICAIN, vers 1550, écrit : "La plaine qui entoure EL- DJEZAIR et que l'on appelle la METIDJA, produit un grain en toute perfection '. En 1725, l'historien LAUGIER DE TASSY, dans son livre "HISTOIRE DU ROYAUME D'ALGER ", désigne cette région sous le nom de MUTIDJA. En 1830, d'après l'historien CLAUZOLLES, dans son livre : "HISTOIRE DE LA RÉGENCE D'ALGER", édité en 1843, elle est devenue la METIDJA. -
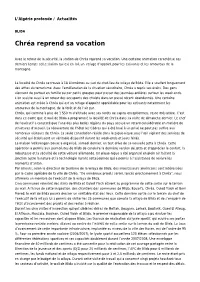
Chréa Reprend Sa Vocation
L’Algérie profonde / Actualités BLIDA Chréa reprend sa vocation Avec le retour de la sécurité, la station de Chréa reprend sa vocation. Une certaine animation caractérise ces derniers temps cette station qui est en fait un refuge d’appoint pour les estivants et les amoureux de la montagne. La localité de Chréa se trouve à 18 kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya de Blida. Elle a souffert longuement des affres du terrorisme. Avec l’amélioration de la situation sécuritaire, Chréa a repris ses droits. Des gens viennent de partout en famille ou par petits groupes pour passer des journées entières surtout les week-ends. L’on assiste aussi à un retour des occupants des chalets dans un passé récent abandonnés. Une certaine animation est créée à Chréa qui est un refuge d’appoint appréciable pour les estivants notamment les amoureux de la montagne, de la forêt et de l’air pur. Chréa, qui culmine à plus de 1 550 m d’altitude avec ses forêts de sapins exceptionnels, reste irrésistible. C’est dans ce cadre que le wali de Blida a programmé la localité de Chréa dans sa visite de dimanche dernier. Le chef de l’exécutif a constaté que l’une des plus belles régions du pays accuse un retard considérable en matière de structures d’accueil. La réouverture de l’hôtel les Cèdres qui a été loué à un privé ne peut pas suffire aux nombreux visiteurs de Chréa. La seule consolation réside dans le pique-nique sous l’œil vigilant des services de sécurité qui établissent un véritable dispositif durant les week-ends et jours fériés. -

Les Habitants De Bouinan S'opposent Au Projet De La
A la une / Actualité Actualité Les habitants de Bouinan s’opposent au projet de la nouvelle ville Les habitants de la ville de Bouinan affichent leur colère et s’opposent au projet de la nouvelle ville de Bouinan. Hier, lors de la visite du ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Environnement et de la Ville, Amara Benyounès, dans la wilaya de Blida pour examiner les nouveaux projets en phase de préparation, quelques dizaines de citoyens de la ville de Bouinan se sont rapprochés du ministre pour lui exprimer leur refus de céder le moindre mètre carré au profit du projet de la nouvelle ville. Accompagnée de Mohamed Ouchane, wali de Blida, la délégation ministérielle a entamé sa tournée par le site de la nouvelle ville de Bouinan. Le ministre a été surpris par l’arrivée des citoyens, venus exiger la levée de l’interdiction de construction dans cette zone réservée au projet de la nouvelle ville depuis 2003. “Ce sont nos terres et nous ferons ce que nous voulons de notre bien. Nous sommes prioritaires sur nos terres”, revendiquent-ils non sans colère. La réaction agressive des citoyens a contraint la délégation à écourter la présentation du plan d’aménagement de la nouvelle ville où sont prévus, notamment, 5 000 logements AADL et 3 900 autres ENPI. Le deuxième point visité est la décharge publique de Chabir, à Boufarik, un point noir au niveau de la commune. Une fois la décharge éradiquée à la fin du mois de juin prochain, l’assiette foncière dégagée servira à d’autres projets : un centre d’examen pour permis de conduire, une station urbaine et un parc d’attractions. -

Pharmaciens Prives Blida
Pharmaciens installé á titre privé BLIDA Nom Prénom Adresse Commune Tél. ACHOUR Thouria Bd Amara Youcef Blida 025.39.11.21 AKLI Nadia 04 Bd Takarli Abderezak Blida AMAMRI Karima 70 Rue Ahmed Megherbi Blida BENDAOUD Samia 25 Rue Didouche Mourad Blida 025.39.35.97 BENGUERGOURA Sadjia 39 chemin des petits lots Blida BENHAFAF A/El Krim HLM Ben Boulaid Bt 26 Blida 02541.58.69 BENMALEM Omar 37 Bd Amara Youcef Blida 025.40.65.55 BENSLAMA Lila 14 Rue des Martyrs Blida 025.41.02.69 BENTURKI Rabah Cité 24 Fevrier Zabana Blida 025.39.34.49 BOUKHET Nasredine Bd larbi Tebessi Blida 025.41.94.46 BOURAS Samia 2 Rue El Bey Khaled Blida 025.41.54.88. BENSALEM Zouina 24 BD des 20 mètres Blida 0770.41.75.05 BENHAMIDA Farah Bd Yousfi AEK N°2 Blida 025.41.66.20 CHENOUFI Afaf Cité des frères Djenadi Blida CHERGUELAINE Mohamed 36 Bd Laichi Abdellah Blida 025.41.24.59 DENENE Mohamed 07 AV Amara Youcef Blida 025.39.25.80 OUEZRI Malika 9 Bd, Colonel Lotfi Blida GUECHI Mounia Bd Kritli Mokhtar Blida 025.41.09.89 KADI Cherif Bd Larbi Tebessi Blida KHETIB Tadj Eddine Cité Brakni BT :A N°03 Blida 025.39.29.56 LAICHI Maamar 135 Av Yousfi AEK Blida MADANI Moussaoui Cité 142 Logts Blida 025.39.23.19 MELIANI Hind Mahdia 122 Bd Kritli Mokhtar Blida 025.32.19.22 OULED ROUIS Cherifa 2 Av Mekerkeb Benyoucef Blida RECHOUM Salah Rue 19 Juin Blida ZEBAYRI Abdelkrim 07 Bd des 20 mètres Blida 025.41.08.12 ZEMOURI F/ djahida Cité naimi Zabana Blida 025.41.70.70 ZERROUKI Hacina Cité le plan zabana Blida 025.40.73.23 ZERROUKI Meriem Cité 19 Juin Blida HOUMAR Salima Bd Kritli Mokhtar -

Pays : Algérie Nom Du Site : Parc National De Chréa Date : Juin 2012
Fiche d'identification de site pilote Pour le projet « Optimiser la production de biens et services par les écosystèmes boisés méditerranéens dans un contexte de changements globaux » Pays : Algérie Nom du site : Parc national de Chréa Date : Ju in 2012 Informations générales Dans ces fiches, on entend par « site » la zone couverte par l’ensemble des activités des composantes choisies, alors que « territoire » désigne une zone du site où sont mises en œuvre les activités d’une composante en particulier. Exemple de délimitation de territoires au sein du site Description du site Localisation administrative Situé à mi-distance entre le chef lieu des wilayas de Blida et de Médéa, le Parc National chevauche entre les wilayas de Blida, Médéa, selon le nouveau découpage territorial datant de 1984 par le décret n° 9-306 du 24/08/1991. La wilaya de Blida compte prés de 17857 Ha soit 67,1% de la superficie totale. Elle regroupe principalement les reliefs septentrionaux des djebels Mouzaia, Guerroumane et Ferroukha situés successivement dans les communes de Ain Romana, Chiffa, Bouarfa, Blida, Chréa, Ouled Yaïch, Bouinan, Soumaâ et Hammam Melouane .La commune de Chréa est totalement englobée dans le territoire du Parc national de Chréa. La wilaya de Médéa, compte prés de 8650 Ha soit 32,6% de la superficie totale. Elle regroupe en particulier les reliefs méridionaux des djebels Mouzaia, les versants nord et sud et adrets des djebels Azrou Mouch, de Sidi Mohamed, ainsi que toutes les topographies de Koudiat El Kalàa, Koudiat Alloua, et Koudiat El Guettara. Il est à noter que la commune d'El- Hamdania est totalement englobée dans le territoire du Parc. -

Blida Et Sa Périphérie
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement Programme d’Aménagement Côtier (PAC) "Zone côtière algéroise" Maîtrise de l’urbanisation et de l’artificialisation des sols Projet d'aménagement Rapport: Etude prospective de l’urbanisation – Phase 2 – Programme d'Actions Prioritaires Centre d'Activités Régionales Décembre 2004 Note Le présent rapport s’inscrit dans le cadre du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) issu du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), fondé sur la base légale de la Convention de Barcelone. Il intervient à la suite d’un accord relatif au PAC de la zone côtière algéroise, signé le 7 octobre 2001 entre le Gouvernement algérien représenté par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et le PNUE. Produit de l’activité thématique "Maîtrise de l’urbanisation et de l’artificialisation des sols, le présent rapport conclut la première partie de la seconde phase de l’étude intitulée "Etude prospective de l’urbanisation". Ce rapport est le fruit du travail d’une équipe pluridisciplinaire composée de: M. Kamel TOUATI, architecte urbaniste; M. Abdelkader HARFOUCHE, agronome spécialiste en foresterie; M. Youcef BOUHADAD, géologue, spécialiste en sismotectonique; M. Hafid HAMMACHE, staticien. La mise en forme du document final a été assurée par Mlle Fahima BENEUS, architecte urbaniste, et M. Reda BENMAHIEDDINE, spécialiste en SIG. L’animation du groupe, la coordination des tâches ainsi que la rédaction finale du rapport ont été assurées par le chef d’équipe, M. Kamel TOUATI. Enfin, l’ensemble de ce travail a bénéficié des orientations de M. -

BOUFARIK « NON Au 19 Mars »
INFO 680 BOUFARIK « NON au 19 mars » BOUFARIK La commune de BOUFARIK est située au Nord de son chef lieu BLIDA au centre de la Mitidja sur la ligne de partage du bassin de l'oued EL-HARRACH à l'Est, de La CHIFFA et du MAZAFRAN à l'Ouest. La ville est située à 35 km au Sud-ouest d'ALGER et à 13 km au Nord-est de BLIDA. Connue pour ses oranges, elle est aussi le lieu de naissance de la boisson Orangina. C’est en 1936 qu’un docteur pharmacien espagnol du nom de TRIGO MIRALLES a mis au point, sous le soleil d’Algérie, une boisson pétillante et rafraîchissante à base de jus et de pulpe d’orange baptisée Naranjina (petite orange en espagnol). Informé de l’invention, un homme d’affaire français, Léon BETON, racheta aussitôt la marque et le concept. Rebaptisée Orangina, la petite bouteille ronde devint rapidement célèbre dans toute l’Algérie, où Jean-Claude BETON (le fils de Léon) créera en 1951 à BOUFARIK la Compagnie française des produits Orangina, aujourd’hui filiale de Pernod-Ricard et présidée par Jacques PFISTER. Jean-Claude BETON décédé le 2 décembre 2013 à Marseille ; il avait 89 ans. C'est en 1953 qu’apparu la première pub (on disait réclame à l’époque), une affiche de Bernard VILLEMOT montrant sur fond bleu, la petite bouteille et un verre posés sur une table surmontée d’un parasol formé d’un zeste d’orange. Le mythe était né. Plus tard, en phase avec l’histoire commune de l’Algérie et la France, Orangina s’installera à Marseille, en 1956… Récolte des oranges à BOUFARIK, la capitale des Oranges.