Magny-En-Vexin
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Répertoire Des Sections D'inspection Du Travail
Val d’Oise DDTEFP : Immeuble Atrium – 3 boulevard de l’Oise – 95014 CERGY PONTOISE Standard : 01 34 35 49 49 Directeur départemental : Jean LE GAC ; - Sec 01 34 35 48 51 Données février 2010 - Découpage février 2010 Sec Secteur Inspecteur ou Contrôleurs Coordonnées tion Directeur adoint 1 Ableiges, Aincourt, Ambleville, Amenucourt, Arronville, Arthies, Artheuil, Avernes, Banthelu, Berville, Boisemont, Julie COURT Thierry BOIROT Tel sec 01 34 35 49 33 Boissy l’Aillerie, Bray et Lû, Bréançon, Brignancourt, Buhy, Cergy le Haut, Cergy Saint-Christophe, Charmont, Chars, Marielle GUEZOU Fax 01 34 22 13 62 Chaussy, Chérence, Cléry en Vexin, Commeny, Condécourt, Cormeilles en Vexin, Courcelles sur Viosne, Courdimanche, Ennery, Épiais Rhus, Frémainville, Frémécourt, Frouville, Gadancourt, Genainville, Génicourt, Gouzangrez, Grisy les Plâtres, Guiry en Vexin, Haravilliers, Haute-Isle, Hédouville, Hérouville, Hodent, Jouy le Moutier, Labbebille, La Chapelle en Vexin, La Roche Guyon, Le Bellay en Vexin, Le Heaulme, Le Perchay, Livilliers, Longuesse, Magny en Vexin, Marines, Maudetour en Vexin, Menouville, Menucourt, Montgeroult, Montreuil sur Epte, Moussy, Nesles la Vallée, Neuilly en Vexin, Nucourt, Omerville, Ronquerolles, Sagy, Saint Clair sur Epte, Saint Cyr en Arthies, Saint Gervais, Santeuil, Seraincourt, Théméricourt, Theuville, Us, Vallangoujard, Vetheuil, Vienne en Arthies, Vigny, Villiers en Arthies, Wy dit Joli Village 2 Argenteuil, Mériel, Montsoult, Villiers Adam Martine MILLOT Fatima BAIBOU Tel sec 01 34 35 49 29 Nathalie LASMARRIGUES -

Balado Balado Saison 2016 Balado LIGNE a Du Vexin Français ALLER RETOUR Du 15 Mai Au
Depuis Paris : Accès aux gares de Cergy par le RER A. Accès à la gare de Pontoise par le RER C, les Transiliens H (Paris-Nord) et J (Paris Saint-Lazare). Balado Balado saison 2016 Balado LIGNE A du Vexin français ALLER RETOUR du 15 mai au Cergy-Préfecture Gare RER (Quai E) 09:53 11:30 25 septembre Cergy-Saint-Christophe Gare RER 10:01 11:38 Transport Vélo Cergy-le-Haut Gare routière 10:06 11:43 • Service gratuit. Pour des raisons de logistique, la réservation Tous les dimanches Vigny Mairie 10:18 11:55 de ce service doit être effectuée au plus tard le mercredi soir Parc naturel régional du Vexin français Venez découvrir le charme et les principaux sites précédent votre trajet. Théméricourt Maison du Parc 10:23 12:00 touristiques du Vexin français en empruntant le Baladobus, Guiry-en-Vexin Lavoir 10:33 12:10 Réservation auprès de Tim’Bus au 01 34 46 88 00 un service de transport saisonnier, économique et pratique ! Wy-dit-Joli-Village Eglise 10:35 12:12 [email protected] Guiry-en-Vexin Bois de Morval 10:38 12:15 Deux itinéraires au départ de Cergy-Pontoise : Magny-en-Vexin Aventure Land 10:45 12:22 SAISON 2016 Tarifs - Forfait journée • La ligne A chemine à travers le plateau agricole jusqu’à Magny-en-Vexin Gare routière 10:50 12:27 15:30 17:05 • Adultes : 4 € Transport vélo gratuit Magny-en-Vexin. Magny-en-Vexin Aventure Land 15:35 17:10 • Enfants (4 à 10 ans) : 2 € sur réservation • La ligne B mène directement à la vallée de Seine. -

Magny-En-Vexin 95420
95-45 AVERNES MAGNY-EN-VEXIN La validation, c’est obligatoire ! Magny-en-Vexin Avant de monter dans le bus, Charmont préparez votre passe Navigo Banthelu ou votre ticket. Clery en Vexin en Clery Clery Guiry validez-les Wy dit Joli Village Joli dit Wy systématiquement Gadancourt pour éviter Avernes une amende. MAGNY-EN-VEXIN AVERNES En période scolaire En période Horaires valables à compter du 12 novembre 2019 2019 novembre 12 du compter à valables Horaires 95-45 Informations pratiques Pourquoi & points de vente valider ? Contact Bon à savoir Points de vente - Aucun service les samedis, 01 34 46 88 00 dimanches et jours fériés, ni pendant MAGNY-EN-VEXIN clients.timbus@ les vacances scolaires. AGENCE TIM BUS Votre geste de validation ratpdev.com - Faire signe au conducteur pour 7, rue des Frères Montgolfier permet à Île-de-France Mobilités www.timbus.fr l’arrêt du véhicule. Arrêt le plus proche : Rue de Crosne de mieux connaître la fréquentation TIM BUS - Nos conducteurs s’efforcent BAR-PMU « LE LONGCHAMP » ZA de la Demi-Lune en permanence de respecter des lignes et ainsi adapter 4, rue de Paris 7, rue des Frères ces horaires. Les conditions de Arrêt le plus proche : Rue de Crosne les services à vos besoins. Montgolfier circulation peuvent toutefois causer 95420 MAGNY-EN-VEXIN occasionnellement des retards. BAR-TABAC « LE PAVEMA » Conseil départemental 30, rue de Paris du Val d’Oise : Arrêt le plus proche : Rue de Crosne 01 34 25 30 81 Boutique Transport : Cergy Préfecture 01 34 41 92 99 - 10/2019 15829 : Point de rechargement de votre forfait Navigo. -

Carte Touristique
Carte 2017 touristique Parc naturel régional du Vexin français Légende A Limite du Parc naturel régional BC DE FGHI J Gisors Maison du Parc Nord Commune du Parc naturel régional Chaumont-en-Vexin Commune partenaire du Parc naturel régional 1 Ouest Est Ville-porte du Parc naturel régional Pays de Thelle Commune classée plus beau village de France N184 Sud Méru N184 Aérodrome A15 Vers Rouen Vexin français SNCF N184 Vers Gisors A15 Gare N184A15 N184 Paris-Londres Voie ferrée des 2 vexin au pays de nacre Vers Beauvais Vers Beauvais N184 N184 N184 N184A15 Retrouvez cet itinéraire cyclable Vers Amiens N184A15 SNCF Voie routière Avenue verte Paris-Londres Calais N184 sur www.pnr-vexin-francais.fr Vers Beauvais A15A15 A15 Vers Gisors N184A15 A15 Retrouvez cet itinéraire cyclable Saint-Clair-sur-Epte Voie autoroutière Cudron A15 sur www.avenuevertelondonparis.com Marais A15 Itinéraire pédestre Oise 2 Buhy du Rabuais D1 N1 Voie verte et véloroute 4 Berville La Chapelle-en-Vexin A16 Office de Tourisme Arronville D151 Montreuil-sur-Epte 6 D8 Buttes(alt. de Rosne217 m) Point d’information touristique 7 Vers Chantilly Neuilly- Senlis Saint-Gervais Haravilliers D92 37 en-Vexin D188 Point de vue D Ronquerolles Le Heaulme Table d’orientation Nucourt Chars Butte de Marines Magny-en-Vexin D915 D924 Route cyclotouristique de Sausseron A D28 D22 Ambleville ube y Le Bellay- St-Jacques de Compostelle Theuville Hédouville Arboretum, verger conservatoire tte de Magn Menouville Chaussée Jules César en-Vexin Bois du Moulin Frouville Observatoire ornithologique de -

Liste Des Missions Locales Du Val D'oise
Liste des Missions Locales du Val d'Oise Mission locale Adresse CP Ville téléphone Pour les personnes habitant Mission locale 4 rue Notre Dame 95100 ARGENTEUIL 01 34 11 40 00 Argenteuil, Bezons ARGENTEUIL / BEZONS Franconville, Ermont, Eaubonne, le Plessis-Bouchard, Saint Prix, Mission Locale de la Beauchamp, Sannois, Montlignon, 30 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE 01 39 32 66 03 Vallée de Montmorency Herblay, Montigny-Lès Cormeilles, Cormeilles-en-Parisis, La Frette-sur -Seine Pierrelaye, Mery-sur Oise, GIP - Mission Locale de Frepillon, Bessancourt, Bethemont 2 place de la Gare 95150 TAVERNY 01 34 18 99 00 Taverny la Foret, Chauvry, Saint Leu La Foret, Taverny Andilly, Bouffemont, Deuil la Barre, Domont, Enghien les Bains, Mission Locale Ezanville, Groslay, Maffliers, 42 rue Haute 95170 DEUIL LA BARRE 01 30 10 10 50 SeinOise Margency, Moisselles, Montmagny, Montmorency, Piscop, Saint Gratien, Saint Brice Sous Foret Sarcelles, Goussainville, Garges les Gonesse, Gonesse, Villiers le Bel, Arnouville les Gonnesse, Mission Locale Val 18 avenue du 8 mai 1945 95200 SARCELLES 01 39 33 18 30 Bonneuil en France, Attainville, d’Oise Est Villiers le Sec, Plessis Gassot, Le Thillay, Bouqueval, Ecouen, Le Mesnil Aubry Beaumont-sur-Oise, Persan, Parmain, Asnieres sur Oise, L’Isle Adam, Meriel, Champagne sue Mission Locale Oise, Presles, Bruyère sur Oise, 36 rue Albert Ier 95260 BEAUMONT SUR OISE 01 30 28 76 90 Milnovoise –Reflexe 95 Saint Martin du Tertre, Butry sur Oise, Nesles la Vallée, Baillet en France, Belloy en France, Mours, Sagy, Ronquerolles, Noisy sur Oise Cergy, Pontoise, Eragny, Courdimanche, Magny en Vexin, Neuville-sur-Oise, Saint Gervais, Association A.V.E.C. -

Île-De-F Rance
ÎLE-DE-F RANCE Paris (75) Seine-et-Marne (77) Yvelines (78) Essonne (91) Hauts-de-Seine (92) Seine-Saint-Denis (93) Val-de-Marne (94) Val-d’Oise (95) Paris (75) Événements Grand Public Page 3 Événements Élus Événements Professionnels Page 6 Événements Étudiants Événements Scolaires Page 10 Événements Autres Publics Page 11 Paris (75) sam 21 nov sam 21 nov du sam 21 au dim 29 nov Paris Paris Paris Fête du nouveau avec du Repair café Donnez vos livres dans un vieux : ateliers de mairie de Paris Point-Livres ! Organisation d’un Repair café sur les Déchets d’Équipe- RecycLivre.com réparation, agora avec ments Électriques et Électroniques (DEEE), les vêtements et les jouets. Déposez vos livres dans un Point-Livres. Pour connaître la micro ouvert... liste des Point-Livres participants, rendez-vous sur le Mairie du 15ème arrondissement de Paris Emmaüs Coup de main 31, rue Péclet 75015 Paris nouveau site www.Point-Livres.com ! Après-midi de restitution de la récolte de témoignages des 7, rue de la Boule rouge 75009 Paris habitants du quartier de la Porte de Montreuil sur leur perception du « déchet » et de la consommation circulaire sam 21 nov réalisée par la compagnie Caribou. Ce temps fort, alliant lun 23 nov installation plastique et mise en scène des paroles Paris recueillies, proposera des alternatives concrètes pour Paris redonner vie aux déchets. Collecte de déchets Recyclerie de Paris 20ème Animations ludiques sur la Place de la Porte de Montreuil (au croisement de la rue des dangereux Docteurs Déjerine et de la rue Mendelssohn) Place de la Porte de Montreuil 75020 Paris mairie de Paris prévention des déchets PikPik Environnement- FNE Mise en place d’une déchetterie mobile. -
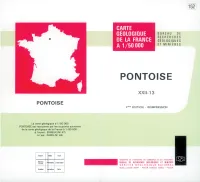
Notice Explicative
NOTICE EXPLICATIVE INTRODUCTION La feuille Pontoise offre une série assez complète des terrains nummuli- tiques ; seul le Thanétien est absent. Les vallées de la Seine, de l'Oise et les rivières adjacentes, entaillent plus ou moins profondément les terrains tertiaires et en permettent l'étude. La feuille comprend une grande partie de l'anticlinal de Vigny. Les son- dages ont permis, en de nombreux points. de reconnaître le sommet de la craie sous la couverture tertiaire et d'avoir ainsi une idée assez nette de la tectonique. Malheureusement, ces travaux sont trop rares, entre la vallée de l'Oise et la Butte de l'Hautil. pour que l'on puisse préciser la terminaison de l'axe anticlinal de Vigny. DESCRIPTION SOMMAIRE DES ASSISES X. Les remblais sont rares, localisés aux abords immédiats des villes. Ils n'entrent que pour une part infime dans la structure subactuelle des terrains. Notons le relèvement du confluent de l'Oise et de la Seine par apport de dragages effectués dans la Seine. E. Éboulis. Les amas naturels provenant du démantèlement des assises tertiaires sur les versants sont assez nombreux. Ils sont sableux (Stampien) ou calcaires (Lutétien). De véritables éboulements de falaise du Lutétien s'observent le long de la vallée de la Seine, au pied- de la butte de l'Hautil. Les limons des plateaux ont glissé sur les pentes, jusqu'au fond des vallées secondaires actuelles, Les Sables de Beauchamp se sont parfois étalés sur les calcaires grossiers (Éragny). Les zones d'éboulis de pied de falaise les plus abondants ont été indiquées par un signe distinctif sur la carte. -

Liste Des Supermarchés Concernés
CODE VILLE ADRESSE NOM DU POSTAL SUPERMARCHÉ 1000 BOURG EN BRESSE 1, boulevard John KENNEDY BOURG EN BRESSE KENNEDY 1130 NANTUA 23 route de Genève NANTUA - Genève 1150 LAGNIEU Route du Port Chemin des Gravières LAGNIEU 1200 CHATILLON EN 1792 Route de la Plaine CHATILLON EN MICHAILLE MICHAILLE Plaine 1500 AMBERIEU EN avenue de la Libération 70 AMBERIEU EN BUGEY BUGEY Libération 2000 LAON avenue Pierre Mendès France 161 LAON Mendès 2100 SAINT QUENTIN Rue du Maréchal Foch 21 SAINT QUENTIN Foch 2200 SOISSONS Avenue de LAON 43 SOISSONS - Laon 2300 CHAUNY Rue André Ternynck 122 CHAUNY - Ternynck 2800 LA FERE Boulevard Saint Firmin LA FERE 3150 VARENNES SUR Avenue de Chazeuil 90 VARENNES SUR ALLIER ALLIER Chazeuil 3200 VICHY 41 avenue Poincaré VICHY Poincaré 3500 SAINT POURCAIN 18 route de Montmarault ST POURCAIN SUR SUR SIOULE SIOULE Montmarault 3600 COMMENTRY Rue Jean Alexis Bayet rue de la COMMENTRY Commune de Paris 4000 DIGNE LES BAINS Rte Napoléon DIGNE LES BAINS Napoléon 4200 Sisteron Allée des Genets 30 SISTERON - Genets 5000 GAP avenue d'Embrun 90 GAP Embrun 5120 SAINT MARTIN DE Pré du Fauré SAINT MARTIN DE QUEYRIERES QUEYRIERES Fauré 6000 NICE Angle avenue Francois Mitterand Rue NICE - Mitterand Roquebillière 6270 VILLENEUVE RD 6007 2040 VILLENEUVE LOUBET - LOUBET Départemental 7 6300 NICE 6 Rue Arnaldi - Impasse Guidotti NICE Arnaldi 6530 Le Tignet Route de Draguignan 355 LE TIGNET Draguignan 7000 Privas Boulevard du Vivarais Lieudit Le Lac Sud PRIVAS Vivarais 7260 Rosières Quartier des Sablas ROSIERES Sablas 8200 SEDAN Rue des Forges -

Le Service De Soins Infirmiers À Domicile
Accès aux bureaux du SSIAD sur le site de Magny-en-Vexin : 3ème étage bâtiment des Campanules, via le boulevard des Ursulines Le Service de GHI du Vexin : 38 rue Carnot - 95420 Magny-en-Vexin En voiture Soins Infirmiers à Domicile • Depuis Pontoise : autoroute A15 puis D14, direction Rouen. Sortie Magny-en-Vexin, direction centre ville. du Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin • Depuis Mantes : D983, direction Beauvais. • Coordonnées GPS : 49,15459 - 1,78495 En bus • À partir des gares de Cergy Saint-Christophe, Cergy le Haut ou Pontoise : Ligne 9504, en direction de Bray et Lû. À Magny-en-Vexin, descendre à l’arrêt « Place d’armes ». En centre ville, prendre la direction du Centre hospitalier du Vexin (rue Carnot). Cadre de santé : Florence CORDARO Téléphone : 01 34 79 43 72 (répondeur lu tous les jours) Co 186/V7/08.01.19 ou 01 34 79 43 17 (en cas d’urgence) Courriel : [email protected] Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin Adresse postale : BP 50039 - 95420 Magny-en-Vexin Tél. : 01 34 79 44 44 - www.ghi-vexin.fr Site de Magny-en-Vexin : 38, rue Carnot, 95420 Magny-en-Vexin Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val-d’Oise Cette visite permet d’évaluer les besoins et de définir le rythme et les horaires des soins. Ceux-ci seront déterminés en fonction de l’ensemble des personnes prises Le Service des Soins Infirmiers à Domicile en charge par le SSIAD, de leurs degrés d’autonomie, de leurs incontinences et de leurs isolements. Un dossier est alors constitué. -

Annuaire Des Organisateurs Locaux Du Val D'oise (95)
Annuaire des Organisateurs locaux du Val d'Oise (95) Service d'Inscription en ligne Service d'Inscription et de disponible paiement en ligne disponibles Inscriptions en ligne : https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/circuits-speciaux- scolaires/ Communes de Etablissement pouvant être Communes des résidence Nom de l'Organisateur Local desservi par l'Organisateur établissements Adresses OL CP COMMUNES TEL des élèves Local scolaires ABLEIGES École le Bourg Ableiges Ableiges Rue Gilles de Maupéou 95450 ABLEIGES 01.34.66.01.12 LA VILLENEUVE ST MARTIN École François Vaudin La Villeneuve St Martin Ambleville École primaire Ambleville AMBLEVILLE Hodent HODENT École maternelle Hodent 3 Grande Rue 95420 HODENT 01.34.67.03.23 OMERVILLE Omerville École primaire Omerville Arthies École Arthies ARTHIES Wy dit Joli Village BANTHELU École Wy dit Joli Village Rue de la Mairie 95420 ARTHIES 01.34.67.22.26 Cléry CLÉRY EN VEXIN École La Fontaine Cléry WY DIT JOLI VILLAGE Banthelu Attainville ATTAINVILLE Collège Aimé Césaire Ezanville 2 rue Daniel Renault 95570 ATTAINVILLE 01.39.91.05.36 Moisselles MOISSELLES École Vavasseur AUVERS SUR OISE Auvers sur Oise École Chaponval Auvers sur Oise 17 rue du Général de Gaulle 95430 AUVERS SUR OISE 01.30.36.60.17 École des Aunaies Berville BERVILLE École Berville 28 rue de la Mairie 95640 HARAVILLIERS 01.30.39.74.02 Haravilliers HARAVILLIERS École Les Hameaux Haravilliers Béthemont la Forêt BÉTHEMONT LA FORÊT École Béthemont la Forêt Grande Rue 95560 CHAUVRY 01.34.69.26.09 Chauvry CHAUVRY École Chauvry Boissy -

Nom Commercial
NOM COMMERCIAL ADRESSE1 ADRESSE 2 CP Destination AGGLOM GARAGE AUBIN 28 route de Dijon BP 44 21702 NUITS-ST-GEORGES CEDEX NUITS-ST-GEORGES SOVELEX 472 boulevard Jean-Charles Contel ZAC les Hauts de Glos 14100 GLOS LISIEUX DIVINOR CAEN Rue du Marais RN 13 14630 FRENOUVILLE CAEN DIVINOR SAINT-LÔ 243 rue Léon Jouhaux ZI La Capelle 50000 SAINT-LÔ SAINT-LÔ DIVINOR UTILITAIRES 105 rue Gustave Nicolle 76600 LE HAVRE LE HAVRE ETOILE 67 9 rue de la Maison Rouge ZI Nord 67600 SELESTAT STRASBOURG ETOILE 25 Rue de l'If BP 3039 25045 BESANÇON CEDEX BESANÇON ETOILE 21 VI 1 bis rue Gay Lussac BP 30076 21302 CHENÔVE CEDEX DIJON ETOILE 90 SERVICES 29 avenue d'Alsace BP 167 90003 BELFORT CEDEX BELFORT ETOILE 70 SERVICES Rue Victor Dollé Parc Technologia BP 343 70006 VESOUL CEDEX VESOUL GARAGE SAINT LOUP 34 Route Nationale 6 71240 SAINT-LOUP-DE-VARENNES CHALON-SUR-SAÔNE AGRICO POIDS LOURDS 1804 route de Genève 01150 LEYMENT AMBÉRIEU-EN-BUGEY SVI 01 531 route de Strasbourg VIRIAT BP 122 01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX BOURG-EN-BRESSE SVI 01 ST MARTIN ZA Les Pellants 01430 SAINT MARTIN DU FRESNE NANTUA SVI 39 ZAC de la Levanchée 39570 COURLAOUX LONS-LE SAUNIER SVI 69 Les Vernailles D 306 BP 20 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE S.O.M.A.L.I 36 route de Paris Les Grands Chemins Nord 33500 LES BILLAUX LIBOURNE ETOILE PRO ORLEANS 12 rue de la Mouchetière ZI d'Ingré BP 7 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE CEDEX ORLEANS ETOILE PRO MONTARGIS Route Nationale 60 45700 VILLEMANDEUR MONTARGIS ETOILE PRO TOURS 36 à 46 rue Pierre et Marie Curie ZI de Saint-Symphorien -

Journal N°38
n° 38 Couleurs mars 2010 du Vexinfrançais Le journal du Parc naturel régional du Vexin français 6 juin 2010 : Fête du Parc à Jambville Le Vexin français, territoire pilote de l’économie durable PNRVF-Journal38.indd 1 26/02/10 11:54 Vie du Parc Sommaire Le Parc acteur économique du Vexin Éditorial Agnès Lanthier, « Protéger en développant, développer en protégeant », tel un nouveau directeur pour le Parc est le message adressé aux participants lors des journées nationales des Parcs naturels régionaux de 2009. Depuis le 4 janvier, le Parc naturel régional du Vexin français a accueilli son nou- Vie du Parc . p. 3. veau directeur, Agnès Lanthier. Paysagiste de formation, celle-ci a élargi ses compé- Concilier protection et développement de son territoire est tences à l’environnement et exercé en atelier d’urbanisme. Elle a débuté son parcours donc bien la vocation d’un Parc, mais c’est aussi son devoir professionnel à l’EPA de Cergy-Pontoise (1982) et connaît bien le Val d’Oise où elle a Dimanche 6 juin : de veiller au juste équilibre entre protection et développement travaillé une grande partie de sa carrière : mairie de Saint-Ouen-l’Aumône en 1984, SAN la Fête du Parc 2010 Dossier afin de permettre aux habitants de vivre le mieux possible de Cergy-Pontoise en 2000, la communauté d’agglomération en 2004 et enfin la com- dans un milieu préservé en ayant la possibilité de trouver du mune d’Osny en octobre 2008, en tant qu’adjointe au directeur des services techniques, célébrera la biodiversité ! Le Vexin français, territoire pilote travail près de chez eux.