Charmed Ou L'art Du Recyclage Postmoderne
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download Issue
Saint Cesar by Richard Rodriguez Pulitzer’s World Living with by James McGrath Morris Microbes By Joel L. Swerdlow The WILSON QUARTERLY and Ari D. Johnson Not a Tourist SURVEYING THE WORLD OF IDEAS by Thomas Swick The Arab Tomorrow by David B. Ottaway Cracks in the Jihad Planet Pakistan by Thomas Rid by Robert M. Hathaway WINTER 2010 $6.95 Wrong Place, Getting What Wrong Time We Deserve Trauma and Violence in the Health and Medical Care Lives of Young Black Men in America John A. Rich, M.D., M.P.H. Alfred Sommer, M.D., M.H.S. “John Rich joins the ranks Former Dean, Johns Hopkins of Rachel Carson, Michael Bloomberg School of Public Harrington and Ralph Nader Health for bringing attention to a pervasive social problem with a One of America’s leading public fresh perspective and warranted health experts finds a host of ills urgency.”—Publishers Weekly in this country’s health care sys- tem. In his blunt assessment of the state of public health in “John Rich, who has devoted so much of his career to the America, Alfred Sommer argues that human behavior has a study of violence—especially in men of color—challenges stronger effect on wellness than almost any other factor. us to see beyond the injuries and the anger and to hear and appreciate the plight of these men and to understand that Humorous, sometimes acerbic, and always well informed, they, like us, seek a place of safety in their lives.” Sommer’s thought-provoking book will change the way you —David Satcher, M.D., Ph.D., 16th Surgeon General of look at health care in America. -

Bank Theft Suspect Killed in Crash
Koch: All join to help N.Y.C. NEW YORK (AP) - Edward Koch, one short step relative obscurity. It.ultimately carried him to a 75,000- campaign to the city's more moderate voters. from City mi after defeating Mario Cuomo (or the Demo- vote victory Monday night when almost 800,000 Demo- He came out for the death penaltv — one of the most cratic mayoral nomination, reminded his jubiliani sup- crats voted. hotly discussed issues during the campaign even though porters today that the nation's largest cltv (aces a diffi- "After Eight Years of Charisma end Four Years of the mayor has no power to impose death — and said the cult and uncertain future the Clubhouse, Why Not Try Competence" Koch's ads National Guard should have been called in to quell loot- "All ol the people, people from every borough, must ing during the blackout this past summer. Join together to rebuild New York," Koch declared after And he benefitted greatly from the support of the capturing 55 per cent of the vote to win a runoff primary large Jewish population here. Koch would be only the and all but assure his election as the city's 105th mayor. The final picture second Jewish mayor in the city's 312-year history. Even In victory, the 52-y ear-old bachelor from Green- NEW YORK (AP) - Final, unofficial totals in the Beame having been the first. wich Village reiterated a campaign theme that sacrifices Democratic mayoral runoff Monday: His victory. Koch said, proved "that you can level must be made "to get the city back on its feet " He said With 4,759 of 4,713 precincts, or t9i per cent, report- with the people of the city, even during a political cam- II It unclear what those sacrifices will be, although he ing: , paign, and New Yorkers are willing to listen to reality." previously has said there may have to be additional lay- Mario Cuomo 354,222, 45 per cent. -

“#Metoo and Evangelicalism: Shattering Myths About Sexual Abuse and Power” Steven R
“#MeToo and Evangelicalism: Shattering Myths about Sexual Abuse and Power” Steven R. Tracy and Andy Maurer1 Presented at the Evangelical Theological Society Annual Meetings Denver, CO, November 13, 2018 Introduction In the 1960s the so called “sexual revolution” created cataclysmic shifts in sexual beliefs and practices in the United States and much of the western world. In the ensuing decades we have continued to witness huge cultural sexual controversies and societal changes. This past year marked the inauguration of what appears to be another seismic sexual shift with the birth of the #MeToo movement. At the core of this unstructured crusade is the assertion that sexual abuse and harassment, particularly of women, is widespread and destructive. Furthermore, one of the dominant, reoccurring themes of #MeToo is the role that power plays in the sexual abuse and harassment of women. This essay will briefly survey and note the impact of the #MeToo movement in secular society and in the evangelical church. It will then explore several common evangelical misunderstandings regarding sexual abuse and harassment unveiled by #MeToo. It will close by suggesting a few action steps for the church. I. Explanation of the #Metoo Movement A. History On October 15th, 2017 Alyssa Milano, an American activist and actor, bombarded by messages and articles detailing sexual assault allegations against Hollywood producer Harvey 1 Steven R. Tracy is professor of theology and ethics at Phoenix Seminary and president of Mending the Soul Ministries. Andy Maurer is a marriage and family therapist in Phoenix, Arizona. 1 Weinstein, tweeted: If you’ve been sexually harassed or assaulted reply to this tweet with “metoo.” Over the next 24 hours Milano’s tweet received 55,000 replies. -
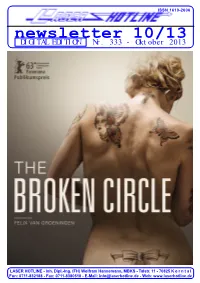
Newsletter 10/13 DIGITAL EDITION Nr
ISSN 1610-2606 ISSN 1610-2606 newsletter 10/13 DIGITAL EDITION Nr. 333 - Oktober 2013 Michael J. Fox Christopher Lloyd LASER HOTLINE - Inh. Dipl.-Ing. (FH) Wolfram Hannemann, MBKS - Talstr. 11 - 70825 K o r n t a l Fon: 0711-832188 - Fax: 0711-8380518 - E-Mail: [email protected] - Web: www.laserhotline.de Newsletter 10/13 (Nr. 333) Oktober 2013 editorial SPIELTRIEB - von links nach rechts: Darstellerin Michelle Barthel, Regisseur Gregor Schnitzler, Darsteller Jannik Schümann Hallo Laserdisc- und DVD-Fans, Video über die Stuttgarter Premiere des DVD und Blu-ray des belgischen liebe Filmfreunde! Films UMMAH- UNTER FREUNDEN, Sensationsfilms THE BROKEN eine kleine Videobotschaft von CIRCLE auftauchen! Lassen Sie sich Nachdem wir den Monat September “UMMAH”-Regisseur Cünyet Kaya überraschen – erhältlich ab 22. Novem- newslettertechnisch einfach ausge- sowie insgesamt 10 Videos vom “09. ber 2013. spart haben, legen wir Ihnen die Okto- Todd-AO 70mm Filmfestival”, in denen ber-Ausgabe dafür gleich in einer Stär- wir die Einführungen zu den gezeigten Cinerama-Freunde aufgepasst: die ke von 96 Seiten vor! Neben allen Filmen festgehalten haben. In Arbeit nächsten beiden Titel im Smilebox-Ver- wichtigen Informationen zu Neuer- befindet sich momentan noch ein Video fahren erscheinen am 22. Oktober 2013. scheinungen aus Deutschland und den über die Preview des deutschen Psy- Vorbestellungen werden dringend emp- USA gibt es für alle Leseratten selbst- chothrillers SPIELTRIEB, zu dem der fohlen! Mehr dazu auf Seite 4. verständlich wieder Annas Kolumne, Regisseur mit seinen beiden Hauptdar- Wolframs Filmblog sowie eine Nachlese stellern nach Stuttgart anreiste. Surfen Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim der von uns gesichteten Filme auf dem Sie einfach mal auf unseren Kanal. -

Headshot/Resume 1/1/16
! Jeri Habberstad a.k.a. Jeri Kalvan Cell (661) 713-3141 Stunt Phone (818) 769-1777 Height: 5’ 4” Weight: 112 lbs Hair: Blonde Eyes: Blue Shoe 7 1/2 Shirt Small/Med Pants 1-3 Waist 27 Chest 33 Inseam 31 Hips 34 Sleeve 29 Hat 7 SKILLS /TRAINING: All-Around Gymnast, Sports Acrobatics, Equestrian, Aerial Circus Arts, Stunt Driving, Wire Work, Fights, High Falls, Rock Climbing, Strong Swimmer, Mountain Biking, Juggler, Water/Snow Skier, SCUBA Certified, Stuart K. Robinson Commercial Acting. Film/T.V. Director/Stunt Coordinator Agent Carter Stunt double - Lotte Verbeek Casey O'Neill Henry Danger multiple characters and stunts Vince Deadrick Trumbo Diane Lane double 100 Things...Before High School Kid Stunt Stunt and Juggling Double Vince Deadrick Sam and Cat Stunt Actor-old lady* Vince Deadrick Victorious Breakaway highfall stunts Vince Deadrick Kickin’ it Stunt Actor-old lady* Mitch Gould Transformers 3 Stunt Double-Frances McDormand Troy Robinson/Kenny Bates The Conan Show ND Stunts Tony Angelotti The Tonight Show Stunt Double-Helen Mirren Erik Solky The Tonight Show Stunt Double-The Queen of England Erik Solky Water for Elephants Acrobat, Juggler Francis Lawrence C.S.I. Stunt Double-Marg Helgenberger Jon Epstein In Treatment Gymnast Double-Mia Wasikowska Johnny Martin Brothers and Sisters Stunt Double-Calista Flockhart Shauna Duggins/Mike Gunther Wizards of Waverly Place Unicycle Stunts (double Jake Austin) Mike Cassidy MasterCard Commercial Mountain Biking Stunts Speck/Gordon/Eliza Coleman The Sarah Connor Chronicles Stunt Actor Joel Kramer -

Jeri Habberstad
Jeri Habberstad Gender: Female Mobile: 661-713-3141 Height: 5 ft. 4 in. E-mail: [email protected] Weight: 110 pounds Web Site: http://jakstunts.com... Eyes: Blue Hair Length: Long Waist: 28 inches Inseam: 32 Shoe Size: 7.5 Physique: Athletic Coat/Dress Size: small-medium Ethnicity: Caucasian / White Photos Film Credits Devil's Domain Stunts Social Nightmare Stunt Double Generated on 09/25/2021 11:09:06 am Page 1 of 4 Transformers: Dark of the Moon Stunt Double Frances McDormand Kenny Bates/Troy Robinson Water for Elephants Acrobat/Juggler Director Francis Lawrence Abandoned Stunt Double Brittany Murphy Stunt Coordinator Tony Snegoff Lady in the Water Stunt Double Bryce Howard Stunt Coordinator Jeff Habberstad Basement Jack Stunt Coordinator Director Michael Shelton Evilution Stunt Coordinator Director Chris Conlee Sweet Old World Stunt Coordinator Director David Zeiger Dust Factory Stunt Double Hayden Panettier Steve Buckley Confidential Report Stunt Double Adrienne Coppola Stunt Coordinator Merritt Yohnka Spider-man 2 Stunt Double Kirsten Dunst Stunt Coordinator Jeff Habberstad World of Tomorrow ND Stunts-wire work Tom DeWier Twisted Stunt Double Ashley Judd Bob Brown The Italian Job ND Stunts Kenny Bates/Kurt Bryant Sleepover Stunt Double Brie Larson Stunt Coordinator Charlie Croughwell Spider-man Stunt Double Kirsten Dunst Stunt Coordinator Jeff Habberstad The Village Stunt Double Bryce Howard Stunt Coordinator Jeff Habberstad Love is a 3 Ring Circus Stunt Coordinator Eric Yandoc/Circus Films Spider-man Far From Home Stunts Dan Brown Old World/Captain Marvel Stunts Jeff Habberstad/Hank Amos Trumbo Diane Lane stunt double Television Victorious High Fall Stunt Double Victoria Vince Deadrick Justice Victorious Stunt Double Victoria Justice Vince Deadrick C.S.I. -
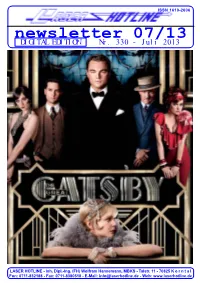
Newsletter 07/13 DIGITAL EDITION Nr
ISSN 1610-2606 ISSN 1610-2606 newsletter 07/13 DIGITAL EDITION Nr. 330 - Juli 2013 Michael J. Fox Christopher Lloyd LASER HOTLINE - Inh. Dipl.-Ing. (FH) Wolfram Hannemann, MBKS - Talstr. 11 - 70825 K o r n t a l Fon: 0711-832188 - Fax: 0711-8380518 - E-Mail: [email protected] - Web: www.laserhotline.de Newsletter 07/13 (Nr. 330) Juli 2013 editorial Hallo Laserdisc- und DVD-Fans, ben: die Videoproduktion. Da es sich ge zu verzeichnen. Da wäre zum Einen liebe Filmfreunde! dabei um eine extrem zeitaufwändige eine weitere Filmpremiere, die wir Angelegenheit handelt und der Tag videotechnisch festgehalten haben: Bestimmt ist es Ihnen als fleißigem Le- nach wie vor nur 24 Stunden hat, müs- EIN FREITAG IN BARCELONA. Zum ser unseres Newsletters schon längst sen wir mit der uns zur Verfügung ste- Anderen haben wir zwei Videos hoch- aufgefallen, dass wir ganz still und henden Zeit haushalten. Nachteile ent- geladen, die bereits 2011 während des heimlich dessen Erscheinungsfrequenz stehen Ihnen dadurch in keiner Weise. Widescreen Weekends in Bradford ent- geändert haben. Waren Sie es bislang Denn unseren Service in Bezug auf standen sind: TONY EARNSHAW IN gewohnt, alle 14 Tage eine neue Aus- DVDs und Blu-rays halten wir weiter- CONVERSATION WITH CLAIRE gabe in Händen zu halten oder auf Ih- hin mit höchster Priorität aufrecht. Da BLOOM und JOE DUNTON rem Bildschirm zu lesen, so passiert sich in den letzten Jahren nun doch INTRODUCING DANCE CRAZE IN dies seit diesem Jahr nunmehr erst alle einige Monatsmagazine in Deutschland 70MM. Zusätzlich haben wir noch eine vier Wochen. Aber keine Sorge: was etabliert haben, deren Hauptaugenmerk Kurzversion unseres BROKEN die enthaltenen Informationen angeht, den Heimmedien gilt und die an fast CIRCLE Videos erstellt, das weitere so hat sich daran nichts geändert. -

Ken Mok, Tyra Cast: Shannon Elizabeth
WILL & GRACE WB Production: NBC Universal levision Studios. Executive producers: David Kohan, Max Mutchnik, James Burrows, Tim Kaiser, Gary 7TH HEAVEN Janetti, Tracy Poust, Jon Kinally, Bill Wrubel, Greg Malins. Thursday Production: Spelling Television,Inc. Executive producers: Brenda 8:30 PM, 30 Min. Hampton, Aaron Spelling, E. Duke Vincent. Monday 8:00 PM, 60 Min. Cast: Eric McCormack, DebrMessing, Sean Hayes, Megan Mullally Cast: Stephen Collins, Catherine Hicks, David Gallagher, Beverly Mitchell, Mackenzie Rosman, George Stuffs, Tyler Hoechlin, Nikolas & UPN Lorenzo Brino, Haylie Duff, Sarah Thompson, Megan Henning. ALL OF US BLUE COLLAR TV Production: Warner Bros. Telvision. Executive producers: Will Smith, Production: Bahr/Small Productions, Parallel Entertainment, Riverside Jada Pinkett Smith, James ssiter, Betsy Borns. Monday 8:30 PM, Productions, Inc. Executive producers: Fax Bahr, Adam Small, Jeff 30 Min. Foxworthy, J.P. Williams. Sunday 9:00 & 9:30 PM, 30 Min. Cast: Duane Martin, LisarayMcCoy, Jhamani Griffin, Tony Rock. With: Jeff Foxworthy,Bill Engvall, Larry The Cable Guy, Brooke AMERICA'S NEXT TOP ODEL Dillman, Ashley Drane, Peter Oldring, Heath Hyche, Ayda Field, Gary Production: 10 By 10 Entertairent, Bankable Productions. Executive Anthony Williams. producers: Ken Mok, Tyra anks, Anthony Dominici. Tuesday & CHARMED Wednesday 8:00 PM, 60 Min Production: Spelling Television. Executive producers: Aaron Spelling, With: Tyra Banks, Twiggy, J.lexander, Nigel Barker, Jay Manuel. E. Duke Vincent, Brad Kern. Sunday 8:00 PM, 60 Min. CUTS Cast: Alyssa Milano, Rose McGowan, Holly Marie Combs, Brian Production: Paramount Netwrk Television, Executive Producers: Krause, Kaley Cuoco, Jason Lewis. Eunetta T. Boone, Bennie Ri burg. Thursday 9:00 PM, 30 Min. -

Y Business GOP Fund Raiser of (He Year, State NAACP Leader
20 - MANCHESTER HERALD. Tuesday. May 22, 1984 BUSINESS Here’s outdoor cooking Space support gear Is \Coventry citizens Don’t over-improve your home! You’ll lose with a Colonial flavor standard at Hamlltpn OK town budget ... page 13 ... page 21 ... page 19 We recently built un expensive addition toourhome homeowners stay within 10 percent to 15 percent of the Even if your home improvements take the form of in exurbiii. The chances that we ll recoup the cost — sales value of homes in their neighborhood if they are energy conservation measures that offer some tax much less make money on it — are next to zero. But making improvements. However, the longer you plan incentives, over-improvement remains a danger. the addition was my dream; 1 achieved it. 1 realize Your to stay in the house, the more easily you can disregard Active solar equipment, for instance, may not fit in that as a financial investment, it was ridiculous. In these suggested limits. Essentially, long-term owners with the neighborhood. Especially if you don’t plan to full knowledge of all the drawbacks, we built it. And I Money's will finance the use of the improvement and any stay long, you won’t recover enough in energy savings love every inch of the waste. appreciation in the value of your house will cover the to make it worthwhile. If you're remodeling, renovating, pushisng through Worth difference. Manchester, Conn. This IS a particularly timely topic now because Rain ending tonight; any major home-improvement project in this peak Sylvia Porter As an illustration, that $15,000 kitchen would pay for Wednesday. -

MR. BROOKS UK Release Date October 2007 MR
PRODUCTION NOTES MR. BROOKS UK Release Date October 2007 MR. BROOKS PRODUCTION NOTES UK Release October 2007 Date: Rating: tbc Running Time: 2 hours Page 1 of 38 FOR ALL PRESS ENQUIRIES, PLEASE CONTACT: 023 8084 3763 / [email protected] Press information and images available at www.vervepics.com PRODUCTION NOTES MR. BROOKS UK Release Date October 2007 ABOUT THE PRODUCTION “All human beings . are commingled out of good and evil.” -- Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde Consider Mr. Brooks: A successful businessman, generous philanthropist, loving husband and father, a true pillar of the community. Everyone says, he’s perfect. Nonetheless, Mr. Brooks harbors a sinister secret - he’s an insatiable serial killer, so lethally clever that no one has ever suspected him - until now. From Element Films and Relativity Media, in association with Eden Rock Media, comes a Tig Production distributed by MGM Distribution Co., the gripping suspense thriller MR. BROOKS, the story of an otherwise exceptional man divided in two by his unbearable need to kill. Academy Award Winner® Kevin Costner stars as the charming, widely admired Mr. Brooks, whose shocking private life is about to unravel. Demi Moore, Dane Cook, Academy Award Winner® William Hurt, Marg Helgenberger, Ruben Santiago-Hudson, and Danielle Panabaker also star. Earl Brooks (Costner) has it all: a loving wife (Marg Helgenberger) and devoted daughter (Danielle Panabaker), community standing, and his own thriving business. Mr. Brooks, however, lives another life, unknown to anyone else. He is also the notorious serial murderer branded as The Thumbprint Killer. Though recently inactive, his pathological compulsion is inflamed once again by his cunning, wicked alter ego (Academy Award® winner William Hurt), whom Mr. -
Settlement Predicted in Shipyard Strike GDANSK, Poland (UPI) - the President Leonid Brezhnev Himself
iUanrhpfitpr Priseweek Puzzle The person who correctly solves The Herald’s Prizeweek Puzzle in today’s paper will be awarded $50. The amount of the award will increase each week the puzzle is not solved. The puzzle is on Page 4. I Vol. XCIX, No. 283 — Manchester, Conn., Saturday. August 30, 19io~ • Since 1881 • 2d« Settlement predicted in shipyard strike GDANSK, Poland (UPI) - The President Leonid Brezhnev himself. with the national armies” of the War leader of the strikes engulfing most It also coincided with the arrival in saw Pact nations. of Poland, from the Baltic Coast to East Germany of Polish troops to Word of the coalfield strikes first the coalmining heartland, said take part in Warsaw Pact maneuvers came from a delegate from Lubin, a Friday a key dispute over free trade near the Polish border — and the southern Polish town near Wroclaw, unions was nearly settled and "we Baltic coast. who went to the Baltic coast port of see the finish.” Whether just one side or both felt Gdansk to confer with the leaders of The conference hall at the Lenin the pressure was not immediately a 16-day-old shipyard strike. shipyards in Gdansk, the Baltic port clear. Details of the reported settle It was the Gdansk walkout that where the strikes began 16 days ago, ment were not announced. touched off the labor unrest that has erupted into an uproar of cheers and Walesa cautioned the government mushroomed into a general strike applause as strike leader Lech may yet raise last-minute objections, affecting most of Poland and posing Walesa told delegates from 500 fac or renege on the terms later. -

KRIS EVANS Make-Up Artist IATSE 798 and 706 Toronto IATSE 873
KRIS EVANS Make-Up Artist IATSE 798 and 706 Toronto IATSE 873 FILM THE PERFECT GUY Assistant Department Head Screen Gems Productions Director: David M. Rosenthal THE HUNGER GAMES: Background Make-Up Supervisor MOCKINGJAY – PART 1 Director: Francis Lawrence Lionsgate THE FACE OF LOVE Assistant Department Head Mockingbird Pictures Director: Arie Posen Cast: Ed Harris THE HUNGER GAMES: CATCHING FIRE Background Make-Up Supervisor Lionsgate Director: Francis Lawrence THE RELUCTANT FUNDAMENTALIST Department Head Cine Mosaic Director: Mira Nair Cast: Kate Hudson, Riz Ahmed, Liev Schreiber, Kiefer Sutherland THE HUNGER GAMES Background Make-Up Supervisor Lionsgate Director: Gary Ross THE RUM DIARY Assistant Make-Up Department Head Warner Independent Pictures Director: Bruce Robinson Cast: Amber Heard, Giovanni Ribisi, Amaury Nolasco, Richard Jenkins, Marshall Bell, Bruno Irizarry SEX AND THE CITY Department Head – Los Angeles New Line Cinema Director: Michael Patrick King Cast: Jason Lewis, Gilles Marni PIRATES OF THE CARIBBEAN: Make-Up Artist and Special Make-Up Effects AT WORLD’S END Director: Gore Verbinski Buena Vista Pictures Cast: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, John Davenport, Naomi Harris X-MEN 3: THE LAST STAND Department Head 20th Century Fox Director: Brett Ratner Cast: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Famke Janssen, Sir Ian McKellen Hollywood Film Festival Award for Best Make-Up of the Year THE MILTON AGENCY Kris Evans 6715 Hollywood Blvd #206, Los Angeles, CA 90028 Make-Up Telephone: 323.466.4441 Facsimile: 323.460.4442 IATSE 798 and 706 [email protected] www.miltonagency.com Page 1 of 4 PIRATES OF THE CARIBBEAN: Make-Up Artist and Special Make-Up Effects DEAD MAN’S CHEST Director: Gore Verbinski Buena Vista Pictures Cast: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, John Davenport, Naomi Harris SPANGLISH Co-Department Head Columbia Pictures Director: James L.