These Page Titre Thèse Parisiii
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

American Road Movies of the 1960S, 1970S, and 1990S
Identity and Marginality on the Road: American Road Movies of the 1960s, 1970s, and 1990s Alan Hui-Bon-Hoa Art History and Communication Studies McGill University, Montreal March 2012 A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Master of Arts in Communication Studies. © Alan Hui-Bon-Hoa 2012 Table of Contents Abstract ………………………………………………………………………………………….. 3 Abrégé …………………………………………………………………………………………… 4 Acknowledgements …..………………………………………………………………………….. 5 Introduction ……………………………………………………………………………………… 6 Chapter One: The Founding of the Contemporary Road Rebel …...………………………...… 23 Chapter Two: Cynicism on the Road …………………………………………………………... 41 Chapter Three: The Minority Road Movie …………………………………………………….. 62 Chapter Four: New Directions …………………………………………………………………. 84 Works Cited …………………………………………………………………………………..... 90 Filmography ……………………………………………………………………………………. 93 2 Abstract This thesis examines two key periods in the American road movie genre with a particular emphasis on formations of identity as they are articulated through themes of marginality, freedom, and rebellion. The first period, what I term the "founding" period of the road movie genre, includes six films of the 1960s and 1970s: Arthur Penn's Bonnie and Clyde (1967), Dennis Hopper's Easy Rider (1969), Francis Ford Coppola's The Rain People (1969), Monte Hellman's Two-Lane Blacktop (1971), Richard Sarafian's Vanishing Point (1971), and Joseph Strick's Road Movie (1974). The second period of the genre, what I identify as that -

Diciembreenlace Externo, Se Abre En
F I L M O T E C A E S P A Ñ O L A Sede: Cine Doré C/ Magdalena nº 10 c/ Santa Isabel, 3 28012 Madrid 28012 Madrid Telf.: 91 4672600 Telf.: 91 3691125 Fax: 91 4672611 (taquilla) [email protected] 91 369 2118 http://www.mcu.es/cine/MC/FE/index.html (gerencia) Fax: 91 3691250 MINISTERIO DE CULTURA Precio: Normal: 2,50€ por sesión y sala 20,00€ abono de 10 PROGRAMACIÓN sesiones. Estudiante: 2,00€ por sesión y sala diciembre 15,00€ abono de 10 sesiones. 2009 Horario de taquilla: 16.15 h. hasta 15 minutos después del comienzo de la última sesión. Venta anticipada: 21.00 h. hasta cierre de la taquilla para las sesiones del día siguiente hasta un tercio del aforo. Horario de cafetería: 16.45 - 00.00 h. Tel.: 91 369 49 23 Horario de librería: 17.00 - 22.00 h. Tel.: 91 369 46 73 Lunes cerrado (*) Subtitulaje electrónico DICIEMBRE 2009 Monte Hellman Dario Argento Cine para todos - Especial Navidad Charles Chaplin (I) El nuevo documental iberoamericano 2000-2008 (I) La comedia cinematográfica española (II) Premios Goya (y V) El Goethe-Institut Madrid presenta: Ulrike Ottinger Buzón de sugerencias Muestra de cortometrajes de la PNR Las sesiones anunciadas pueden sufrir cambios debido a la diversidad de la procedencia de las películas programadas. Las copias que se exhiben son las de mejor calidad disponibles. Las duraciones que figuran en el programa son aproximadas. Los títulos originales de las películas y los de su distribución en España figuran en negrita. -

30 MENTAL FLOSS • HOW ROGER CORMAN REVOLUTIONIZED Cl EMA by IAN LENDLER
30 MENTAL_FLOSS • HOW ROGER CORMAN REVOLUTIONIZED Cl EMA BY IAN LENDLER MENTALFLOSS.COM 31 the Golden Age of Hollywood, big-budget movies were classy affairs, full of artful scripts and classically trained actors. And boy, were they dull. Then came Roger Corman, the King of the B-Movies. With Corman behind the camera, motorcycle gangs and mutant sea creatures .filled the silver screen. And just like that, movies became a lot more fun. .,_ Escape from Detroit For someone who devoted his entire life to creating lurid films, you'd expect Roger Corman's biography to be the stuff of tab loid legend. But in reality, he was a straight-laced workaholic. Having produced more than 300 films and directed more than 50, Corman's mantra was simple: Make it fast and make it cheap. And certainly, his dizzying pace and eye for the bottom line paid off. Today, Corman is hailed as one of the world's most prolific and successful filmmakers. But Roger Corman didn't always want to be a director. Growing up in Detroit in the 1920s, he aspired to become an engineer like his father. Then, at age 14, his ambitions took a turn when his family moved to Los Angeles. Corman began attending Beverly Hills High, where Hollywood gossip was a natural part of the lunchroom chatter. Although the film world piqued his interest Corman stuck to his plan. He dutifully went to Stanford and earned a degree in engineering, which he didn't particularly want. Then he dutifully entered the Navy for three years, which he didn't particularly enjoy. -

American Auteur Cinema: the Last – Or First – Great Picture Show 37 Thomas Elsaesser
For many lovers of film, American cinema of the late 1960s and early 1970s – dubbed the New Hollywood – has remained a Golden Age. AND KING HORWATH PICTURE SHOW ELSAESSER, AMERICAN GREAT THE LAST As the old studio system gave way to a new gen- FILMFILM FFILMILM eration of American auteurs, directors such as Monte Hellman, Peter Bogdanovich, Bob Rafel- CULTURE CULTURE son, Martin Scorsese, but also Robert Altman, IN TRANSITION IN TRANSITION James Toback, Terrence Malick and Barbara Loden helped create an independent cinema that gave America a different voice in the world and a dif- ferent vision to itself. The protests against the Vietnam War, the Civil Rights movement and feminism saw the emergence of an entirely dif- ferent political culture, reflected in movies that may not always have been successful with the mass public, but were soon recognized as audacious, creative and off-beat by the critics. Many of the films TheThe have subsequently become classics. The Last Great Picture Show brings together essays by scholars and writers who chart the changing evaluations of this American cinema of the 1970s, some- LaLastst Great Great times referred to as the decade of the lost generation, but now more and more also recognised as the first of several ‘New Hollywoods’, without which the cin- American ema of Francis Coppola, Steven Spiel- American berg, Robert Zemeckis, Tim Burton or Quentin Tarantino could not have come into being. PPictureicture NEWNEW HOLLYWOODHOLLYWOOD ISBN 90-5356-631-7 CINEMACINEMA ININ ShowShow EDITEDEDITED BY BY THETHE -

Join Us. 100% Sirena Quality Taste 100% Pole & Line
melbourne february 8–22 march 1–15 playing with cinémathèque marcello contradiction: the indomitable MELBOURNE CINÉMATHÈQUE 2017 SCREENINGS mastroianni, isabelle huppert Wednesdays from 7pm at ACMI Federation Square, Melbourne screenings 20th-century February 8 February 15 February 22 March 1 March 8 March 15 7:00pm 7:00pm 7:00pm 7:00pm 7:00pm 7:00pm Presented by the Melbourne Cinémathèque man WHITE NIGHTS DIVORCE ITALIAN STYLE A SPECIAL DAY LOULOU THE LACEMAKER EVERY MAN FOR HIMSELF and the Australian Centre for the Moving Image. Luchino Visconti (1957) Pietro Germi (1961) Ettore Scola (1977) Maurice Pialat (1980) Claude Goretta (1977) Jean-Luc Godard (1980) Curated by the Melbourne Cinémathèque. 97 mins Unclassified 15+ 105 mins Unclassified 15+* 106 mins M 101 mins M 107 mins M 87 mins Unclassified 18+ Supported by Screen Australia and Film Victoria. Across a five-decade career, Marcello Visconti’s neo-realist influences are The New York Times hailed Germi Scola’s sepia-toned masterwork “For an actress there is no greater gift This work of fearless, self-exculpating Ostensibly a love story, but also a Hailed as his “second first film” after MINI MEMBERSHIP Mastroianni (1924–1996) maintained combined with a dreamlike visual as a master of farce for this tale remains one of the few Italian films than having a camera in front of you.” semi-autobiography is one of Pialat’s character study focusing on behaviour a series of collaborative video works Admission to 3 consecutive nights: a position as one of European cinema’s poetry in this poignant tale of longing of an elegant Sicilian nobleman to truly reckon with pre-World War Isabelle Huppert (1953–) is one of the most painful and revealing films. -

Index Des Revues Des Cahiers Du Cinéma, Óþóõ
Index des revues des Cahiers du Cinéma, óþóÕ Les ó Alfred de Bruno Podalydès . ßßó Ch. G. ¢þ–¢Õ Le Õ¢ h Õß pour Paris deClintEastwood ........................... ßߦ M. M. ß–ßÉ Õ¦ì rue du désert d’Hassen Ferhani . ßßß M. M. Õ¦–Õ¢, C. A. Õ¢–Õä óþþ mètres d’AmeenNayfeh ........................................ ßßß M. M. ì¦ À l’abordage de Guillaume Brac . ßßä O. C.-H. ó¦–ó¢, C. A., E. M. óä–óÉ, C. A., E. M. ìþ–ìó, M. U. ìì–ì¢, P.F. ìä–ìß À nos amours de Maurice Pialat . ßß P.B. Õìó–Õì¢ L’Aaire collective d’Alexander Nanau . ßßÉ R. P. ì Aer Love d’AleemKhan ............................................ ßßÉ L. S. ¦¦ L’Amour existe de Maurice Pialat . ßß M. U. ÕÕß–ÕÕ Les Amours d’Anaïs de Charline Bourgeois-Tacquet . ßßÉ O. C.-H. ìä e Amusement Park deGeorgeA.Romero ............................ ßßß É. L. ìþ Annette de Leos Carax . ßß M. U. Õó–Õ¦, P.F., M. U. Õä–Õß, Ch. G., M. U. Õ–óì, E. K. ó¦, É. T. óä El año del descubrimiento de Luis López Carrasco . ßßó É. T. ¦ä Army of the Dead de Zack Snyder . ßßß Y.S. ¦ì–¦¦ Autour de Jeanne Dielman de Sami Frey . ßßì P.L. äþ–äÕ Aya et la sorcière de Goro Miyazaki . ßß M. M. ¢¦ Bac Nord de Cédric Jimenez . ßß O. C.-H. ¢¦ Back Door to Hell deMonteHellman ............................... ßßß Y.S. –É La Bataille du rail de Jean-Charles Paugam . ßß R. N. ¢¦ Beast from Haunted Cave deMonteHellman ........................ ßßß J.-M. S. Beef House d’Eric Wareheim et Tim Heidecker . -

Two-Lane Blacktop by Sam Adams “The B List: the National Society of Film Critics on the Low-Budget Beauties, Genre-Bending Mavericks, and Cult Clas- Sics We Love”
Courtesy Library of Congress Two-Lane Blacktop By Sam Adams “The B List: The National Society of Film Critics on the Low-Budget Beauties, Genre-Bending Mavericks, and Cult Clas- sics We Love” Reprinted by permission of the author Racing flat-out on the road to no- where, the scrawny speed demons of “Two-Lane Blacktop” are caught be- tween a past they’ve never known and a future they’ll never see. The Driver (James Taylor) and the Me- chanic (Dennis Wilson) act the part of rebels from a ‘50s exploitation movie, but their sallow skin and sunken eyes reveal the gnawing uncertainty of a Laurie Bird, James Taylor and Dennis Wilson strike a pose with another of the film’s stars: disillusioned age, a longing for a the Chevy. Courtesy Library of Congress sense of purpose that exists only in the seconds between starting flag and finish line. Oates), whose slick patter spills out in bewildering chunks. (the credits call him “G.T.O.” although the char- Universal, which handed director Monte Hellman nine acters never address each other by name.) The route hundred thousand dollars to make his first (and, as it (Arizona to DC) is set, the stakes (pink slips) agreed upon, turned out, only) studio movie, must have hoped for a and the cars peel out, intending to drive straight through. youth-culture paean in the “Easy Rider” mode. Although neither of the movie’s leads had acted before, both were But a series of pit stops and small-town diversions turns stars in their own right” Wilson was the Beach Boys’ their breakneck dash into a roadside odyssey, a trave- drummer and Taylor was a budding soft-rock superstar. -

On Tour (Aug – Oct 2021)
On Tour (Aug – Oct 2021) Cinema Rediscovered is back for its 5th Edition (28 July – 1 August 2021) celebrating the return to cinemas with a selection of restorations and rediscoveries. Full Festival line-up: watershed.co.uk/cinema-rediscovered Book any of the titles below under the Cinema Rediscovered on Tour banner and access: - Assets (copy, images, trailers, bespoke content such as pre-recorded screening intros) - National PR campaign (Sarah Harvey PR) and MUBI cross promotion* - Invitation to Cinema Rediscovered ‘s Reframing Film industry strand (29 – 30 July) and access to a 50% partner discount to festival tickets. *Optional: audiences for CR tour bookings can receive a free one month trial from MUBI, the global streaming service, production company and film distributor. Note that access to guest speakers and other titles from the festival line-up can be looked into on request. Contact: [email protected] See Credit Lines / Logos below. Also note that a high res DCP slide will be supplied for the cinema for the start of your screening. TOUR IMAGES & TRAILERS: Download folder TOUR TITLES – QUICK LINKS THE STORY OF A THREE DAY PASS 2 1971: THE YEAR HOLLYWOOD WENT INDEPENDENT 3 TWO-LANE BLACKTOP 4 KLUTE 5 MCCABE & MRS MILLER 5 THE LAST PICTURE SHOW 5 FIVE EASY PIECES 6 TWELVE 30 COLLECTIVE PRESENT: NO PLACE LIKE HOME 6 THE STORY OF A THREE DAY PASS 4K Restoration Rec Cert: 15 Dir: Melvin Van Peeble USA 1967 87mins Cast: Harry Baird, Nicole Berger, Pierre Doris Source: Cinema Rediscovered / Janus Films Book: [email protected] Terms: £80 MG vs 35% (+ UK Transport or download costs) Format: DCP or Eclairplay Trailer: watch & download A New 4K restoration by IndieCollect in consultation with Mario Van Peebles, with support from the Hollywood Foreign Press Association. -

Notes Toward a History of the Edinburgh International Film Festival, 1969-77
Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Stanfield, Peter (2008) Notes Toward a History of the Edinburgh International Film Festival, 1969-77. Film International, 6 (4). pp. 62-71. ISSN 1651-6826. DOI Link to record in KAR http://kar.kent.ac.uk/12945/ Document Version Publisher pdf Copyright & reuse Content in the Kent Academic Repository is made available for research purposes. Unless otherwise stated all content is protected by copyright and in the absence of an open licence (eg Creative Commons), permissions for further reuse of content should be sought from the publisher, author or other copyright holder. Versions of research The version in the Kent Academic Repository may differ from the final published version. Users are advised to check http://kar.kent.ac.uk for the status of the paper. Users should always cite the published version of record. Enquiries For any further enquiries regarding the licence status of this document, please contact: [email protected] If you believe this document infringes copyright then please contact the KAR admin team with the take-down information provided at http://kar.kent.ac.uk/contact.html Below Poster for Jacques Articles Edinburgh International Film Festival Tourneur’s Anne of the Indies 62 | ilm international issue 34 Articles Edinburgh International Film Festival Below Douglas Sirk Notes Toward a History of the Edinburgh International Film Festival, 1969–77 By Peter Stanield Keywords: Edinburgh International Film Festival (EIFF), ilm theory, ilm studies, auteurism, Lynda Miles, Peter Wollen, Claire Johnston, Paul Willemen Looking back over developments in British ilm culture since the late 1960s, one of the principal organizers of the Edinburgh International Film Festival (EIFF), David Will, wrote that the Festival ‘arrived as an institution of oppositional culture in 1969’ (Will 1982: 20). -

Road to Nowhere
ROAD TO NOWHERE A picture by Monte Hellman Starring Shannyn Sossamon, Tygh Runyan, Dominique Swain, Cliff De Young, Waylon Payne, John Diehl, Fabio Testi (Press Kit from Venice Film Festival) ROAD TO NOWHERE CAST (in order of appearance) Mitchell Haven Tygh Runyan Nathalie Post Dominique Swain Laurel Graham/Velma Duran Shannyn Sossamon Bobby Billings John Diehl Cary Stewart/Rafe Tachen Cliff de Young Bruno Brotherton Waylon Payne Steve Gates Robert Kolar Jermey Laidlaw Nic Paul Nestor Duran Fabio Testi Desk Clerk Fabio Tricamo Moxie Herself Peter Bart Himself El Cholo Bartender Pete Manos Mallory Mallory Culbert Doc Holliday Bartender Beck Lattimore Man in Bar Thomas Nelson Bonnie Pointer Herself Airplane Coordinator Jim Galan Airplane Pilot Jim Rowell Greg Gregory Rentis Larry Larry Lerner Erik Lathan McKay Joe Watts Michael Bigham Araceli Araceli Lemos Sarah Sarah Dorsey Female Cadaver Mandy Hughes Morgue Technician Cathy Parker Male Cadaver Brett Mann Room Service Waitress Vanessa Golden Cop Voices Dean Person Jared Hellman Jones Clark Guard Mitchell Allen Jenkin PRODUCTION Directed and Produced by Monte Hellman Written and Produced by Steven Gaydos Produced by Melissa Hellman Executive Producers Thomas Nelson, June Nelson Director of Photography Joseph M Civit Edited by Celine Ameslon Production Designed by Laurie Post Music by Tom Russell Co-Producers Peter R J Deyell, Jared Hellman Associate Producers Lea-Beth Shapiro, Robin-John Gibb Costumes Designed by Chelsea Staebell Production Sound by Rich Gavin Visual Effects Supervisor Robert Skotak First Assistant Director Larry Lerner Second Assistant Director Noreen Perez Supervising Sound Editors Ayne O Joujon-Roche, Kelly Cabral Re-Recording Mixers Scott Sanders, Perry Robertson First Assistant Editors Gregory Rentis, Harold Hyde Producers Representative Jonathan Dana Worldwide Sales E1 Entertainment ROAD TO NOWHERE "Well the ditches are on fire, And there ainʼt no higher ground. -

Films Begin at 8Pm £6 / £5 Conc
A young Parisian postman, Jules (Frederic Andrei), is obsessed with classical music and becomes entranced with the voice of American diva Cynthia Hawkins (Wilhelmenia Wiggins Fernandez). She doesn't believe in being recorded, but Jules secretly records one of her performances. His recording gets mixed up with another tape that has the recorded testimony of a prostitute, Nadia, which reveals Dir: Jean- Jacques Beineix, 1981, France, 12 that an important public figure is also the boss of a drug trafficking and prostitution racket. Jules is now in danger from underworld enforcers and is also being sought by two Taiwanese men (who want the Hawkins tape). Somehow he must find a way to get himself out of the situation alive. 2 hr 3 min, 12. Subtitles. Stars: Wilhelmenia Fernandez, Frédéric Andréi, Richard Bohringer After being fired from his boring job as a supermarket stock clerk in Los Angeles, a young punk rocker called Otto (Emilio Estevez) lands a job working for an eccentric automobile repossession agent named Bud (Harry Dean Stanton). Otto is reluctant at first but he soon grows to love his fast-paced work at the Helping Hand Acceptance Corporation, which involves hot-wiring cars, chases and good pay. After learning of a Chevy Malibu that has been Dir: Alex Cox, 1984, USA, 18 given a $20,000 repossession price tag, Otto embarks on a quest to find the car with the beautiful Leila (Olivia Barash), who claims that its trunk contains something otherworldly. 1 hr 35 min. 18. Stars: Harry Dean Stanton, Emilio Estevez, Tracey Walter After the death of his Nobel Prize-winning father, billionaire physicist Jerry Cornelius (Jon Finch) becomes embroiled in the search for the mysterious "Final Programme" that his father had been working on. -
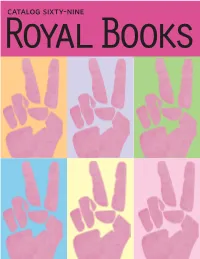
Catalog Sixty-Nine Royalbooks C Atalog Sixty-Nine Royal Books the CELLULOID PAPER TRAIL
catalog catalog sixty-nine royal books Royalc Booksatalog sixty-nine THE CELLULOID PAPER TRAIL Oak Knoll Press is pleased to announce the publication of Terms and Conditions Kevin R. Johnson’s The Celluloid All books are first editions unless indicated otherwise. Paper Trail. The first book All items in wrappers or without dust jackets advertised have glassine covers, and all dust jackets are protected ever published on film script by new archival covers. Single, unframed photographs identification and description, housed in new, archival mats. lavishly illustrated and detailed. In many cases, more detailed physical descriptions for archives, manuscripts, film scripts, and other ephemeral Designed for any book scholar, items can be found on our website. including collectors, archivists, Any item is returnable within 30 days for a full refund. librarians, and dealers. Books may be reserved by telephone, or email, and are subject to prior sale. Payment can be made by credit card Available now at royalbooks.com or, if preferred, by check or money order with an invoice. or by calling 410.366.7329. Libraries and institutions may be billed according to preference. Reciprocal courtesies extended to dealers. Please feel free to let us know if you would like your copy signed or inscribed by the author. We accept credit card payments by VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, and PAYPAL. Shipments are made via USPS priority mail or Fedex Ground unless other arrangements are requested. All shipments are fully insured. Shipping is free within the United States. For international destinations, shipping is $60 for the first book and $10 for each thereafter.