Libre Accès Et Recherche Scientifique Vers De Nouvelles Valeurs
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Violence and Social Orders
This page intentionally left blank VIOLENCE AND SOCIAL ORDERS All societies must deal with the possibility of violence, and they do so in different ways. This book integrates the problem of violence into a larger social science and historical framework, showing how economic and political behavior are closely linked. Most societies, which we call natural states, limit violence by political manipulation of the economy to create privileged interests. These privileges limit the use of violence by powerful individuals, but doing so hinders both economic and political development. In contrast, modern societies create open access to economic and political organizations, fostering political and economic competition. The book provides a framework for understanding the two types of social orders, why open access societies are both politically and economically more developed, and how some twenty- five countries have made the transition between the two types. Douglass C. North is co-recipient of the 1993 Nobel Memorial Prize in Economic Sci- ence. He is the Spencer T. Olin Professor in Arts and Sciences at Washington University in St. Louis, where he served as director of the Center for Political Economy from 1984 to 1990, and is the Bartlett Burnap Senior Fellow at the Hoover Institution at Stanford University. A member of the American Academy of Arts and Sciences and a former member of the Board of Directors of the National Bureau of Economic Research for twenty years, Professor North received the John R. Commons Award in 1992. The author of ten books, including Institutions, Institutional Change, and Economic Performance (Cambridge University Press, 1990) and Understanding the Process of Economic Change (2005), Professor North has research interests in property rights, economic organization in history, and the formation of political and economic institutions and their consequences through time. -

How Long Before Open Access in French Social Sciences and Humanities Journals? Maya Bacache-Beauvallet, Françoise Benhamou, Marc Bourreau
How long before open access in French social sciences and humanities journals? Maya Bacache-Beauvallet, Françoise Benhamou, Marc Bourreau To cite this version: Maya Bacache-Beauvallet, Françoise Benhamou, Marc Bourreau. How long before open access in French social sciences and humanities journals?. 2015. halshs-02523132 HAL Id: halshs-02523132 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02523132 Submitted on 28 Mar 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. HOW LONG TILL WE HAVE FREE ACCESS TO HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE JOURNALS IN FRANCE? Summary IPP Note The aim of this study is to evaluate the merits of the introduction of the principle of open access to research in the humanities and social sciences (HSS) in France, using a study of its effects on the consultation of articles. We want to know if a free access policy improves the visibility of research, and if so, to what extent. The study shines n°19 important light on decision making about the dissemination of research results and on the effect of restricted access (for both researchers and the broader public) to research results. At stake in this debate are the choice of duration of the open-access embargo period, that is, the delay between time of publication and when the journal July 2015 makes it freely available (delayed access journals), and the length of the self-archiving embargo, that is, the minimum time before the journal allows authors to self-archive their articles on the web (open access mandate). -

Gaulish Galo
palaeoeuropeanpalaeoeuropean languages & epigraphieslanguages & | epigraphiesHispania & Gaul PALAEOHISPANICA 2020 | I.S.S.N. 1578-5386 revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua DOI: 10.36707/palaeohispanica.v0i20.383 Gaulish Galo Alex Mullen University of Nottingham [email protected] Coline Ruiz Darasse Université Bordeaux Montaigne, Institut Ausonius / UMR 5607 CNRS [email protected] Abstract: Gaulish is a language in the Celtic language family, documented in Gaul (France and surrounding territories) from around the 2nd century BC and through the Roman period. It is transmitted primarily in Greek (Gallo-Greek) and Latin (Gallo-Latin) script, with a small number of Gaulish texts also attested in the Etruscan alphabet in Italy (Gallo-Etruscan) and with Gaulish names found in Iberian script. In this article we detail current knowledge of the linguistic content, context and classification of Gaulish, and consider the epigraphic corpus, naming practices, writing systems and the cultural interactions that shape this material. Finally, we discuss the future challenges for the study of Gaulish and some of the work that is underway which will drive our research in the 21st century. Keywords: Continental Celtic. Cultural contacts. Epigraphy. Gaul. Gaulish. Gallo-Greek. Gallo-Latin. Onomastics. Writing systems. Resumen: El galo es una lengua perteneciente a la familia celta, que está documentada en la Galia (Francia y los territorios adyacentes) desde aproximadamente el siglo II a. C. y a lo largo del período romano. Esta lengua se escribió principalmente en alfabeto griego (galo-griego) y latino (galo-latín), aunque también se cuenta con un pequeño número de textos en alfabeto etrusco en Italia (galo-etrusco) y de nombres galos en escritura ibérica. -

Owning the Right to Open up Access to Scientific Publications Guibault, L
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Owning the right to open up access to scientific publications Guibault, L. Published in: Open content licensing: from theory to practice DOI: 10.5117/9789089643070 Link to publication Citation for published version (APA): Guibault, L. (2011). Owning the right to open up access to scientific publications. In L. Guibault, & C. Angelopoulos (Eds.), Open content licensing: from theory to practice (pp. 137-167). Amsterdam: Amsterdam University Press. DOI: 10.5117/9789089643070 General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: http://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl) Download date: 15 Dec 2018 Open Content Licensing From Theory to Practice Edited by Lucie Guibault & Christina Angelopoulos Amsterdam University Press Cover design: Kok Korpershoek bno, Amsterdam Lay-out: JAPES, Amsterdam ISBN 978 90 8964 307 0 e-ISBN 978 90 4851 408 3 NUR 820 Creative Commons License CC BY NC (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) L. -

Jussieu Reflects Our Social, Technical and Political Landscape Laurent Romary, Directeur De Recherche - Inria
Open Access in France: how the call of Jussieu reflects our social, technical and political landscape Laurent Romary, Directeur de Recherche - Inria OA Tage - Graz, 24 September 2018 Jussieu: why and how… • The gist of Jussieu – We could not accept the (APC-based) golden rush… – First meeting in Jussieu campus on 20 May 2016 • A favourable landscape – Jussieu is just the tip of the French iceberg – The clue: a combination of centralism and consensus building • Infrastructures – HAL, but not only… • A strong political support • A not so typical example: Inria Why are we here today? • Appel de Jussieu: http://jussieucall.org – “This Call is aimed at scientific communities, professional associations and research institutions to promote a scientific publishing open-access model fostering bibliodiversity and innovation without involving the exclusive transfer of journal subscription monies to APC payments.” • What it is about: – Writing practices, peer-review procedures, editorial services on content, additional services (TDM...), business models Concrete measures to re-use saved Springer budget at Université de Lorraine: • SSH: Subscription to open and public platforms (OpenEdition,France; Erudit, Canada, Open Library of Humanities, UK) • STM: Sci-Post (physics), EDP Sciences (France), Epiga (overlay journal on Episciences.org) • Joining the Fair Open Access Alliance • Support to Directory of Open Access Journals – DOAJ, Coalition of Open Access Repositories – COAR, Sparc Europe • Note: favouring free for authors-free for readers approaches -
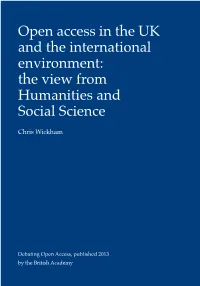
Open Access in the UK and the International Environment: the View from Humanities and Social Science
42 Chris Wickham Open access in the UK and the international environment: the view from Humanities and Social Science Chris Wickham Debating Open Access, published 2013 by the British Academy Open access in the UK and the international environment: the view from Humanities and Social Science 43 • Since HSS disciplines receive only a small percentage of RCUK funds, HEFCE’s policy on the admissibility of work for future REFs will be the most important determining factor. • Other countries do not have RAE/REF equivalents to drive them down the Gold route; hence they are more likely to stay with Green and with longer embargo periods. • Some leading international journals, particularly in the Humanities, have set their face against Gold OA and the introduction of APCs. • UK scholars in HSS thus face a dilemma. If they publish in non- compliant international journals their work risks being ineligible for future REFs; if they don’t publish in these venues they risk falling off the international pace. • A particularly intense variant of this dilemma threatens those whose professional community does not operate in English. • Future REF criteria will need to reflect these discipline-specific circumstances. I strongly share the desire for open access as an aspiration for the future availability of research; who wouldn’t? But I am very concerned about its practicalities, and about the unintended dangers which imposing some forms of open access on the academic community will have on the research landscape as a whole. There are many concerns, all of which I cannot deal with here. In this article I will concentrate on the effect current proposals in the UK risk having on the standing of the country’s research in the world, particularly in Humanities and Social Science. -

The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity
The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Wilkinson, Ryan Hayes. 2015. The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity. Doctoral dissertation, Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:17467211 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity A dissertation presented by Ryan Hayes Wilkinson to The Department of History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of History Harvard University Cambridge, Massachusetts May 2015 © 2015 Ryan Hayes Wilkinson All rights reserved. Dissertation Advisor: Professor Michael McCormick Ryan Hayes Wilkinson The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity Abstract In the fifth and sixth centuries CE, the Roman Empire fragmented, along with its network of political, cultural, and socio-economic connections. How did that network’s collapse reshape the social and mental horizons of communities in one part of the Roman world, now eastern France? Did new political frontiers between barbarian kingdoms redirect those communities’ external connections, and if so, how? To address these questions, this dissertation focuses on the cities of two Gallo-Roman tribal groups. -

Report on the Medoanet European Conference • Athens, 17 and 18 October 2013 2/28
REPORT MedOANet Final Open Access Conference Athens, October 17 and 18, 2013 Organiser: EKT/NHRF Report prepared by: EKT/NHRF Funded by the Seventh Framework Programme for Research and Development (FP7) Grant Agreement number: 288945 Project acronym: MEDOANET Project title: Mediterranean Open Access Network Funding Scheme: Coordination Support Action Project co-ordinator Organisation: EKT/NHRF Project website address: www.medoanet.eu Deliverable No. 4.3 Deliverable Name Report on the European conference Lead Beneficiary EKT/NHRF Dissemination Level PU © 2014 MEDOANET This report is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License MEDOANET is an FP7 project funded by the EUROPEAN COMMISSION This publication reflects only the author’s views – the Community is not liable for any use that may be made of the information contained therein. Report on the MedOANet European Conference • Athens, 17 and 18 October 2013 2/28 Index Introduction: MedOANet and the Final Project Conference 4 Executive Summary 6 MedOANet in Context: Project Accomplishments 10 Implementing National Policies for Open Access to Scientific Information: the National Perspectives 14 Implementing Open Access Policies for Research Funding Organisations 17 Building Capacity for Open Access in Europe: e-Infrastructures, Policies and People 20 Open Access and the European Research Area 23 Implementing Open Access Policies among Research Performing Institutions 26 Report on the MedOANet European Conference • Athens, 17 and 18 October 2013 3/28 Introduction: MedOANet and the Final Project Conference The Mediterranean Open Access Network is a project funded by the European Commission’s 7th Framework Programme. It run for 24 months and concluded in the end of 2013. -
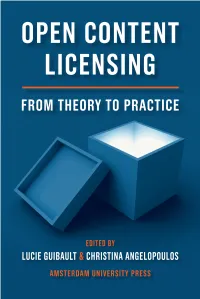
Open Content Licensing
Open Content Licensing Open Content Licensing From Theory to Practice Edited by Lucie Guibault & Christina Angelopoulos Amsterdam University Press Cover design: Kok Korpershoek bno, Amsterdam Lay-out: JAPES, Amsterdam ISBN 978 90 8964 307 0 e-ISBN 978 90 4851 408 3 NUR 820 Creative Commons License CC BY NC (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) L. Guibault & C. Angelopoulos / Amsterdam University Press, Amsterdam, 2011 Some rights reversed. Without limiting the rights under copyright reserved above, any part of this book may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise). Contents 1. Open Content Licensing: From Theory to Practice – An Introduction 7 Lucie Guibault, Institute for Information Law, University of Amsterdam 2. Towards a New Social Contract: Free-Licensing into the Knowledge Commons 21 Volker Grassmuck, Humboldt University Berlin and University of Sao Paulo 3. Is Open Content a Victim of its Own Success? Some Economic Thoughts on the Standardization of Licenses 51 Gerald Spindler and Philipp Zimbehl, University of Göttingen 4. (Re)introducing Formalities in Copyright as a Strategy for the Public Domain 75 Séverine Dusollier, Centre de Recherche Informatique et Droit, Université Notre- Dame de la Paix (Namur) 5. User-Related Assets and Drawbacks of Open Content Licensing 107 Till Kreutzer, Institute for legal questions on Free and Open Source Software (ifrOSS) 6. Owning the Right to Open Up Access to Scientific Publications 137 Lucie Guibault, Institute for Information Law, University of Amsterdam 7. Friends or Foes? Creative Commons, Freedom of Information Law and the European Union Framework for Reuse of Public Sector Information 169 Mireille van Eechoud, Institute for Information Law, University of Amsterdam 8. -

Violence and Social Orders
This page intentionally left blank VIOLENCE AND SOCIAL ORDERS All societies must deal with the possibility of violence, and they do so in different ways. This book integrates the problem of violence into a larger social science and historical framework, showing how economic and political behavior are closely linked. Most societies, which we call natural states, limit violence by political manipulation of the economy to create privileged interests. These privileges limit the use of violence by powerful individuals, but doing so hinders both economic and political development. In contrast, modern societies create open access to economic and political organizations, fostering political and economic competition. The book provides a framework for understanding the two types of social orders, why open access societies are both politically and economically more developed, and how some twenty- five countries have made the transition between the two types. Douglass C. North is co-recipient of the 1993 Nobel Memorial Prize in Economic Sci- ence. He is the Spencer T. Olin Professor in Arts and Sciences at Washington University in St. Louis, where he served as director of the Center for Political Economy from 1984 to 1990, and is the Bartlett Burnap Senior Fellow at the Hoover Institution at Stanford University. A member of the American Academy of Arts and Sciences and a former member of the Board of Directors of the National Bureau of Economic Research for twenty years, Professor North received the John R. Commons Award in 1992. The author of ten books, including Institutions, Institutional Change, and Economic Performance (Cambridge University Press, 1990) and Understanding the Process of Economic Change (2005), Professor North has research interests in property rights, economic organization in history, and the formation of political and economic institutions and their consequences through time. -
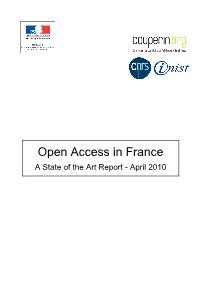
Open Access in France
Open Access in France A State of the Art Report - April 2010 Table of content Introduction ........................................................................................................... 3 Part 1. Institutional background .......................................................................... 4 Part 2. Historical background .............................................................................. 8 Part 3. Open Access journals in France ............................................................ 11 Part 4. Open Archives in France ........................................................................ 23 Part 5. Large digitisation programs ................................................................... 32 Conclusions ........................................................................................................ 34 Open Access in France: a state of the art report – April 2010 page 2 Introduction This report has been collaboratively produced by representatives of several bodies: the scientific and technical information and libraries network Unit of the Ministry of Higher Education and Research (Francis ANDRE, Rachel CREPPY) the academic consortium Couperin (Emilie BARTHET, Jean-François LUTZ, Mariette NAUD), the Institute for scientific and technical information INIST-CNRS (Anne-Marie BADOLATO, Jean-François NOMINE, Christine WEIL-MIKO). It is the wish of the SELL consortium (Southern European Libraries Link) to produce a state of the art of Open Access in the participating countries. It will serve as -

Dare to Share
Advisory council for science, technology and innovation Advisory council for science, technology and innovation DARE TO SHARE OPEN ACCESS AND DATA SHARING IN SCIENCE DARE TO SHARE Advisory council for science, technology and innovation Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie The Advisory council for science, technology and innovation (AWTI) advises the Dutch government and parliament on policy in the areas of scientifi c research, technological development and innovation. The AWTI provides advice when it is applied for or when the council deems it necessary. It enjoys an independent position towards the Ministers and their Departments, as well as towards other parties involved. The advisory council consists of a maximum of 10 members, each originating from different sectors of society, such as research institutes and trade and industry. The members do not represent any special interests. The Advisory council on science, technology and innovation consists of the following members: prof. dr. U. Rosenthal (voorzitter) prof. dr. ing. D.H.A. Blank mrs. ing. T.E. Bodewes mrs. prof. dr. R. Cools mrs. prof. dr. V.A. Frissen prof.dr. ir. T.H.J.J. van der Hagen prof. dr. E.M. Meijer dr. ir. A.J.H.M. Peels prof.dr. ir. M.F.H. Schuurmans prof. dr. L.L.G. Soete mrs. dr. D.J.M. Corbey (secretaris) The offi ce is located in The Hague, the Netherlands: Javastraat 42 2585 AP The Hague The Netherlands t. +31(0)70 31 10 920 e. [email protected] w. www.awti.nl ISBN: 9789077005743 Dare to share Open access and data sharing in science January 2016 Photography Shutterstock.com Design 2D3D Design, The Hague January 2016 All publications may be downloaded free of charge from www.awti.nl.