Le Viaduc De Jaulny
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

From Civilian Life to Army Life: Fred Pickering's World War I Narrative
Nebraska History posts materials online for your personal use. Please remember that the contents of Nebraska History are copyrighted by the Nebraska State Historical Society (except for materials credited to other institutions). The NSHS retains its copyrights even to materials it posts on the web. For permission to re-use materials or for photo ordering information, please see: http://www.nebraskahistory.org/magazine/permission.htm Nebraska State Historical Society members receive four issues of Nebraska History and four issues of Nebraska History News annually. For membership information, see: http://nebraskahistory.org/admin/members/index.htm Article Title: From Civilian Life to Army Life: Fred Pickering’s World War I Narrative Full Citation: Jeff Patrick, ed., “From Civilian Life to Army Life: Fred Pickering’s World War I Narrative,” Nebraska History 90 (2009): 132-161 URL of article: http://www.nebraskahistory.org/publish/publicat/history/full-text/NH2009FPickering.pdf Date: 2/03/2015 Article Summary: Though many Nebraskans served in the Great War, we have few war narratives written by them. Fred Pickering was a farmer from Ulysses, Nebraska, who wrote a lively account of army life for the folks back home. Cataloging Information: Names: Fred Pickering, John J Pershing Place Names: Ulysses, Nebraska; Camp Funston, Kansas; Camp Dodge, Iowa; Les Laumes, Villiers, Dannemarie, Metz, Wolfersdorf and Gondrecourt, France Keywords: Company E, 313th Engineers, 88th Division; American Expeditionary Forces (AEF), Meuse-Argonne offensive, Red -

American Armies and Battlefields in Europe 533
Chapter xv MISCELLANEOUS HE American Battle Monuments The size or type of the map illustrating Commission was created by Con- any particular operation in no way indi- Tgress in 1923. In carrying out its cates the importance of the operation; task of commeroorating the services of the clearness was the only governing factor. American forces in Europe during the The 1, 200,000 maps at the ends of W or ld W ar the Commission erected a ppro- Chapters II, III, IV and V have been priate memorials abroad, improved the placed there with the idea that while the eight military cemeteries there and in this tourist is reading the text or following the volume records the vital part American tour of a chapter he will keep the map at soldiers and sailors played in bringing the the end unfolded, available for reference. war to an early and successful conclusion. As a general rule, only the locations of Ail dates which appear in this book are headquarters of corps and divisions from inclusive. For instance, when a period which active operations were directed is stated as November 7-9 it includes more than three days are mentioned in ail three days, i. e., November 7, 8 and 9. the text. Those who desire more com- The date giYen for the relief in the plete information on the subject can find front Jine of one division by another is it in the two volumes published officially that when the command of the sector by the Historical Section, Army W ar passed to the division entering the line. -

VU Le Code Général Des Collectivités Territoriales Et Notamment Les Articles L5211-1 Et Suivants Et L5214-1 Et Suivants;
Liberté • Égalité • Ft•attrnité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE Préfecture Direction de l'action focale Bureau du contrôle de légalité, de l'intercommunalité et du conseil aux collectivités LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE LE PRÉFET DE LA MOSELLE Officier de la légion d'honneur Officier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur Officier dans l'Ordre National du Mérite VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-1 et suivants et L5214-1 et suivants; VU la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, notamment son article 35 Ill ; VU le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2003 autorisant la création de la communauté de communes du Val de Moselle ; VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2010 autorisant la création de la communauté de communes du Chardon Lorrain ; VU l'arrêté préfectoral du 22 avril 2013 complété par l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2013 autorisant, à compter du 1er janvier 2014, la création d'une communauté de communes issue de la fusion de la communauté de communes du Toulois et de la communauté de communes des côtes en Haye sans la commune de Martincourt qui porte le nom de« Communauté de communes du Toulois » ; VU l'arrêté préfectoral du 14 juin 2016 fixant le projet de périmètre de la communauté de communes issue de la fusion de la communauté de communes du Chardon lorrain et de la communauté de communes du Val de Moselle (57) intégrant la commune d'Hamonville issue de la communauté de communes du Toulois. -

Pelouses Et Vallons Forestiers De La Vallee Du Rupt De Mad Fr4100161
PREFECTURE DE LA MEURTHE ET MOSELLE PELOUSES ET VALLONS FORESTIERS DE LA VALLEE DU RUPT DE MAD FR4100161 Document d’objectifs 1. SYNTHESE Juin 2001 PREFECTURE DE LA MEURTHE ET MOSELLE Site Natura 2000 « Pelouses et vallons forestiers de la vallée du Rupt de Mad » Documents d’objectifs 1. SYNTHESE Synthèse et rédaction Stéphanie HARRAULT Jérôme DAO Juin 2001 SOMMAIRE INTRODUCTION 3 A CARACTERISTIQUES DU SITE 4 A.1 Le périmètre « Pelouses et Vallons Forestiers de la vallée du Rupt de Mad » en quelques mots 4 A.2 Caractéristiques physiques 6 A.2.1 Topographie et hydrographie 6 A.2.2 Géologie et pédologie 6 A.2.3 Climat 7 A.3 Contexte socio-économique 7 A.3.1 Population 8 A.3.2 Utilisation du sol 8 A.3.3 Principales activités humaines 9 A.3.4 Cadre de vie 14 A.4 Considérations relatives à la biodiversité sur le site 16 A.4.1 Quelques constats d’évolution et leurs facteurs explicatifs 16 A.4.2 Actions de conservation déjà engagées sur le site 17 A.4.3 La vallée du Rupt de Mad, un corridor pour la faune et la flore 18 B HABITATS ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 20 B.1 Inventaires et cartographie 20 B.1.1 Méthodologie suivie 20 B.1.2 Habitats naturels inscrits à l’annexe I de la Directive recensés sur le site 21 B.1.3 Espèces inscrites aux annexes II et IV de la Directive recensées sur le site 25 B.1.4 Inventaires complémentaires nécessaires 27 B.2 Analyse écologique 28 B.2.1 Exigences écologiques 28 B.2.2 Facteurs naturels ou humains qui modifient ou maintiennent leur état de conservation 28 B.2.3 Etat de conservation initial des habitats -

Plus Que Jamais Proches Et Solidaires Envie D’Aller Plus Loin ? Meurthe-Et-Moselle.Fr/Mag77
#77-janvier 2021 le magazine du département 2021 plus que jamais proches et solidaires envie d’aller plus loin ? meurthe-et-moselle.fr/mag77 S U T R E contenu augmenté visionner une vidéo sur le sujet INTERN le magazine du département VU : l’info du département en bref p4 Belles images du Département p6 Transition écologique : un prix au Département Trophée de l’encouragement à Le Vert t’y Go Meurthe-et-Moselle solidaire p7 La médiathèque départementale et les tout-petits Partenariat avec la profession agricole Nouveau giratoire à Pont-à-Mousson p8 L’aide alimentaire pendant la crise Pass Jeunes 54 : essentiel pour les 6 - 16 ans La carte de vœux du Département a été réalisée à partir d’une œuvre créée Statues restaurées au château de Lunéville e pour la 15 édition de Jardin extraordinaire, par 5 jeunes - Dan, Florian, Jessy, p9 Le Département et la crise sanitaire Quentin et Thibaut - dans le cadre du dispositif Prév’en Scène porté Devoir de mémoire par l’association Jeunes et Cité en partenariat avec le conseil départemental Zoom sur l’agro-écologie et le CAUE 54. Ils ont été accompagnés par 3 éducateurs spécialisés et une Bornes de recharge électrique intervenante artistique, Loriane Blondiaux. L’expérimentation Prév’en Scène p10 Du RSA vers l’aide à domicile s’inscrit dans la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté. Elle accueille p12 Médecin en protection maternelle et infantile p13 et remobilise chaque année une centaine de jeunes ni en études, ni en Nouveau collège à Homécourt Un label pour nos paysages formation, ni en emploi, par le biais, notamment, d’ateliers artistiques. -

Famille De Produits Exploitation NOM MILLARD Rucher Des Six Reines
Famille de produits Exploitation NOM MILLARD Rucher des Six Reines Luc et Françoise BARTHELEMY Miel Professionnels Michel PERRIN Robert GENEVAUX Le rucher de Gorze DEGLI ESPOSI Le moulin à miel LEMAIRE Etablissement LAMBINET LAMBINET La Ferme des Crêtes BERCHE Volailles BELLO et Oeufs Ferme de Belleville La Ferme du Grand Pré TRIVEILLOT PIERON Chèvrerie Les Tournesols Produits laitiers et fromage GIROUX La chèvrerie de Lorry EARL du Vieux Poirier WAHU Les pains vagabonds MOREAU Farines et Huiles Farines Micro entreprise - Pas de nom commercialMOYEN et Huiles EARL La Gloriette NAUT EARL Jadinot HOUIN GORSKI Domaines des Coteaux de Dornot BERT La tomate rouge et noire MALMANCHE VOIR LISTING CMA 54 LANG Les Jardins d'Arnaville LEFEBVRE La cave aux pommes AUBRIOT Les Jardins Ecotones OLRY MOMBELLI Fruits SCEA de Mandrise et ou MILLARD Légumes SCEA des Mirabellières FERVILLE EARL de l'Hatto BRIER Domaine de la Grange en Haye EARL La grange aux fruits d'or Fruits et Légumes Prunelles MANSARD SCHIVRE Elevage Michel Besançon BESANCON PHILIPPE La Porcinière NICOLAS-BOSCH Viandes Ferme de la Souleuvre NOEL EARL de Tantelainville CHONE EARL du Cytise EARL de Champagne RAUX Brasserie de l'Epitaphe MARCHAL Brasserie l'Abeille Noire LORRAIN Alcools Domaine les Béliers MAURICE Domaine Buzea BUZEA Alcools Domaine des Coteaux de Dornot BERT Domaine Oury-Schreiber OURY Association « La Côte des Caures» BATTAGLIA Domaine de la Joyeuse STAPUREWICZ L'herbe folle GALANO GOETGHEBER AMAP PERRIN Le Charpagne LUDWIG Graine d'Ortie ROLIN EARL du Pré Labarre SENERS -

Meurthe Et Moselle Meuse
Genre NomPrénom Titre Maires Adresse CP Ville MEURTHE ET MOSELLE Monsieur TARDY Yvan Maire de ANDILLY Mairie-Place de l'Eglise 54200 ANDILLY Monsieur COLLET Thierry Maire de ANSAUVILLE Mairie-2 rue de l'Eglise 54470 ANSAUVILLE Monsieur CAILLOUX René Maire de ARNAVILLE Mairie-98 Grande Rue 54530 ARNAVILLE Madame ROCH Marie-Line Maire de BAYONVILLE SUR MAD Mairie-1 rue de Biard 54890 BAYONVILLE SUR MAD Monsieur CIOLLI Christophe Maire de BEAUMONT Mairie-8 Grande rue 54470 BEAUMONT Monsieur LAURENT Serge Maire de BELLEVILLE Mairie-Rue de la Mairie 54940 BELLEVILLE Monsieur BUVET Daniel Maire de BERNECOURT Mairie-12 Grande Rue 54470 BERNECOURT Monsieur LIOUVILLE Gérald Maire de BOUCQ Mairie-1 place du Souvenir 54200 BOUCQ Monsieur RENOUARD Gérard Maire de BOUILLONVILLE Mairie-9 rue Sur l'Eau 54470 BOUILLONVILLE Monsieur MANET Claude Maire de BRULEY Mairie- 36 rue Victor Hugo 54200 BRULEY Monsieur MANGIN Michel Maire de BRUVILLE Mairie-1Bis rue de l'Ecole 54800 BRUVILLE Madame ROSELEUR Lise Maire de CHAMBLEY BUSSIERES Mairie-12 rue de l'Eglise 54890 CHAMBLEY BUSSIERES Monsieur LARA Lionel Maire de CHAREY Mairie-10 rue Edmond Henry 54470 CHAREY Monsieur ARGAST Michel Maire de DAMPVITOUX 19 rue de la Mairie 54470 DAMPVITOUX Monsieur POIRSON Henri Maire de DIEULOUARD Mairie-8 rue Saint Laurent-BP 13 54380 DIEULOUARD Monsieur SEGAULT Jean-François Maire de DOMEVRE-EN-HAYE Mairie-2 place de l'Eglise 54385 DOMEVRE EN HAYE Monsieur PETIT Denis Maire de DOMMARTIN LA CHAUSSEE Mairie-3 rue de l'Eglise 54470 DOMMARTIN LA CHAUSSEE Monsieur SILLAIRE Roger -

DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 1Ère Circonscription
DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 1ère circonscription CUSTINES BRIN-SUR-SEILLE BOUXIERES-AUX-CHENES BRIN-SUR-SEILLE MONCEL-SUR-SEILLE BOUXIERES-AUX-CHENES MAZERULLES BOUXIERES-AUX-DAMES BOUXIERES-AUX-DAMES AMANCE AMANCE MAZERULLES LLAY--SAIINT--CHRIISTOPHE EULMONT SORNEVILLE EULMONT LAITRE-SOUS-AMANCE SORNEVILLE LAITRE-SOUS-AMANCE CHAMPENOUX DOMMARTIN- CHAMPENOUX DOMMSOAURST-IANM-SAONUCSE-AMANCE AGINCOURT LANEUVELOTTE AGINCOURT MALZEVILLE LANEUVELOTTE DOMMARTEMONT SEICHAMPS SEICHAMPS VELAINE-SOUS-AMANCE ESSEY-LES-NANCY ESSEY-LES-NANCY SAINT-MAX PULNOY NANCY-2 PULNOY SAULXURES-LES-NANCY NANCY SAULXURES-LES-NANCY NANCY-3 Légende Couleur : Canton Entre Seille et Meurthe Grand Couronné Saint-Max Nancy-3 Nancy-2 SICOM 54 06/12/2016 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 2ème circonscription NANCY-1 LAXOU JARVILLE- LA-MALGRANGE VILLERS-LES-NANCY VANDOEUVRE-LES-NANCY HEILLECOURT HOUDEMONT LUDRES Légende Couleur : Canton Laxou Vandoeuvre-lès-Nancy Jarville-la-Malgrange Nancy-1 SICOM 54 06/12/2016 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 3ème circonscription MONT-SAINT-MARTIN VILLE-HOUDLEMONT MONT-SAINT-MARTIN GORCY LONGLAVILLE SAULNES GORCY LONGLAVILLE VILLE-HOUDLEMONT SAINT-PANCRE SAULNES COSNES-ET-ROMAIN HERSERANGE COSNES-ET-ROMAIN LONGW Y LONGW Y SAINT-PANCRE HERSERANGE TELLANCOURT LEXY MEXY VILLERS-LA-CHEVRE MEXY ALLONDRELLE-LA-MALMAISON TELLANCOURT LEXY ALLONDRELLE-LA-MALMAISON VILLERS-LA-CHEVRE HAUCOURT-MOULAINE FRESNOIS-LA-MONTAGNE REHON HUSSIGNY-GODBRANGE EPIEZ-SUR-CHIERS FRESNOIS-LA-MONTAGNE HAUCOURT HUSSIGNY-GODBRANGE -MOULAINE EPIEZ-SUR-CHIERS -

Lettre Circulaire 2019-14
LETTRE CIRCULAIRE n° 2019-0000014 Montreuil, le 05/06/2019 DRCPM OBJET Sous-direction production, Instauration du versement transport (art. L. 2333-64 et s. du Code gestion des comptes, Général des Collectivités Territoriales) fiabilisation VLU-grands comptes et VT Par un arrêté du 12 décembre 2016, la Préfecture de Meurthe et Moselle a autorisé la création au 1er janvier 2017 de la Communauté de Communes Affaire suivie par : Mad et Moselle par fusion de la Communauté de Communes du Chardon ANGUELOV Nathalie, Lorrain et de la Communauté de Communes du Val de Moselle et avec BLAYE DUBOIS Nadine, intégration de la commune d’Hamonville (54248) issue de la de la WINTGENS Claire Communauté de Communes du Toulois. Par une délibération du 9 avril 2019, la Communauté de Communes Mad et Moselle a décidé de créer un taux de versement transport de 0,55 % sur le territoire de toutes les communes comprises dans son ressort territorial. La délibération prend effet au 1er juillet 2019. La délibération entraine la création de l’identifiant 9305414 au 1er juillet 2019 Par un arrêté du 12 décembre 2016, la Préfecture de Meurthe et Moselle a autorisé la création au 1er janvier 2017 de la Communauté de Communes Mad et Moselle par fusion de la Communauté de Communes du Chardon Lorrain et de la Communauté de Communes du Val de Moselle et avec intégration de la commune d’Hamonville (54248) issue de la Communauté de Communes du Toulois. Par une délibération du 9 avril 2019, la Communauté de Communes Mad et Moselle a décidé de créer un taux de versement transport de 0,55 % sur le territoire de toutes les communes comprises dans son ressort territorial. -
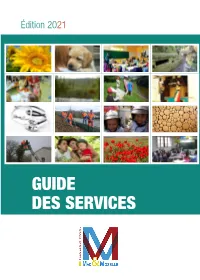
Guide Des Services
Édition 2021 GUIDE DES SERVICES ASSOCIATIONS Menuiserie - Ebénisterie - Scierie Sommaire Associations sportives Métallerie - Serrurerie - Travaux de soudure Associations caritatives Peinture - Sols - Carrelage Associations de cultes Sécurité CARTE INTERACTIVE SANTÉ Associations des écoles Terrassement - Travaux Publics LA COMMUNAUTE DE COMMUNES EN BREF Organismes Traitement - Dépollution Les hôpitaux de proximité Associations des Sapeurs Pompiers LES URGENCES Les autres services de proximité Associations environnementales Associations patriotiques Café - Restaurant - Hébergement LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES Café - Bar - Club DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI Associations socio-culturelles État Associations de santé Camping Région Les organismes d’État Gîtes - Chambres d’hôtes Les chambres consulaires Département TOURISME ET PATRIMOINE Hôtels Communauté de Communes Appui et conseil de proximité Restaurants Accueil - Informations Mairies Accompagnement à la création et au dévelop- Traiteurs pement d’entreprises Patrimoine naturel VIE QUOTIDIENNE Hébergement d’entreprises ENTREPRISES Commerce de proximité Enseignement- Formation Activités spécialisées HABITAT ET LOGEMENT Agriculture Les organismes Ameublement - Equipement de la Activités de soutien Les établissements scolaires : Conseils maison Culture - Elevage } Écoles maternelles et primaires Les aides : OPAH - RR Boucherie -Charcuterie Fruits - Légumes } Collèges Boulangerie - Patisserie TRANSPORT Produits du terroir Les services postaux Commerce ambulant Viticulture Trésor public et -

Brief Histories of Divisions, U.S. Army 1917-1918
BRIEF HISTORIES OF DIVISIONS, U.S* AFRMY 1917-1918 Prepared in the -Historical Branch, War Plans Division, General Staff* Junew 1921* *^ 0000000000-- Branch, Note:- Authorities for statemonts of fact are on file ia the Historical Comment, with a view to correction of any error discovered, is invited. Form Approved Report Documentation Page OMB No. 0704-0188 Public reporting burden for the collection of information is estimated to average 1 hour per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to Washington Headquarters Services, Directorate for Information Operations and Reports, 1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington VA 22202-4302. Respondents should be aware that notwithstanding any other provision of law, no person shall be subject to a penalty for failing to comply with a collection of information if it does not display a currently valid OMB control number. 1. REPORT DATE 3. DATES COVERED 2. REPORT TYPE 1921 - 4. TITLE AND SUBTITLE 5a. CONTRACT NUMBER Brief Histories of Divisions, U.S. Army 1917- 1918. 5b. GRANT NUMBER 5c. PROGRAM ELEMENT NUMBER 6. AUTHOR(S) 5d. PROJECT NUMBER 5e. TASK NUMBER 5f. WORK UNIT NUMBER 7. PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES) 8. PERFORMING ORGANIZATION Army Command & General Staff College,Combined Arms Research REPORT NUMBER Library ,250 Gibbon Avenue,Fort Leavenworth,KS,66027-2314 9. SPONSORING/MONITORING AGENCY NAME(S) AND ADDRESS(ES) 10. -

1104934 Dreal Lorraine Natura 2000 Les Sites Vol
1 La vallée du Rupt de Mad depuis le Rudemont à Arnaville © FRANÇOIS SCHWAAB 2 Le Rupt de Mad © FRANÇOIS SCHWAAB 1 2 156 Les milieux humides FR4100161 79 Pelouses et vallons forestiers du Rupt de Mad Superficie :1 702 ha Département : Meurthe-et-Moselle (et Moselle) Maître d’ouvrage : PNRL Opérateur : PNRL Le Rupt de Mad, un corridor entre Meuse et Moselle Le site « Pelouses et vallons forestiers du Rupt de Mad » occupe une grande partie de la vallée encaissée formant une rupture topographique orientée Sud-Ouest / Nord-Est dans le revers des Côtes de Moselle. Le Rupt de Mad a tout d’abord été un affluent de la Meuse avant d’être capturé par la Moselle, suite à un engorgement périglaciaire* ; sa vallée a ainsi pu servir de relais pour la circulation de la faune et de la flore entre les grandes vallées de la Meuse et de la Moselle. Plusieurs vallées secondaires* étroites se raccordent à la vallée principale. Il en résulte une grande variété de reliefs et d’expositions générant un puzzle de milieux naturels plus ou moins façonnés par l’Homme. Cette hétérogénéité est à l’origine de cortèges faunistiques et floristiques très diversifiés. Avec douze habitats et quatorze espèces d’intérêt communautaire, le site « Pelouses et vallons forestiers du Rupt de Mad » offre un très grand intérêt écologique : − Le cours d’eau présente un fonctionnement tout à fait particulier. Le Rupt de Mad traverse d’abord la plaine de la Woëvre, coulant sur un secteur de faible pente et au substrat* argileux, zone sur laquelle il a subi de nombreuses opérations d’aménagements hydrauliques qui ont largement banalisé ses formes.