Agrobiodiversité Et Territoires Recherches, Expériences, Projets
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Right to Seeds and Biological Diversity
FIAN INTERNATIONAL BRIEFING MARCH 2016 By Sofía Monsalve Suárez1 The right to seeds and biological diversity IN THE UN DECLARATION ON THE RIGHTS OF PEASANTS AND OTHER PEOPLE WORKING IN RURAL AREAS This briefing note on the right to seeds and biological diversity is part of a series of brief- ings published by FIAN International to feed into the negotiations on the draft UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas. The series of briefings covers the following topics: states’ obligations, the rights to sovereignty over natural resources, development and food sovereignty, rural women’s rights, the right to food, the right to a decent income and livelihood, the right to land and other natural resources, the right to seeds and the right to biological diversity, and the right to water. All briefings are available on our website http://www.fian.org/ 1 Sofía Monsalve Suárez is Secretary General of FIAN International. The author would like to thank Guy Kastler, Antonio Onorati, Christine Frison, Marc Edelman, Maryam Rahmanian and Karine Peschard, for their guidance and review of this briefing. Agricultural biodiversity, a highly threatened component 1. WHAT ARE THE RIGHT of biodiversity, is a fundamental requirement for the reali- zation of the right to adequate food, the right to health and TO SEEDS AND THE the right to an adequate standard of living. RIGHT TO BIOLOGICAL As defined by FAO and the Secretariat of the Convention on Biological Diversity (CBD): DIVERSITY ? “Agricultural biodiversity refers to the variety and vari- ability of animals, plants, and micro-organisms on earth that are important to food and agriculture which result from the interaction between the environment, genetic resources and the management systems and practices used by people. -

REPORT of the REGIONAL SYMPOSIUM on AGROECOLOGY for SUSTAINABLE AGRICULTURE and FOOD SYSTEMS for Europe and Central Asia
REPORT OF THE REGIONAL SYMPOSIUM ON AGROECOLOGY FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FOOD SYSTEMS for Europe and Central Asia Budapest, Hungary, 23–25 November 2016 REPORT OF THE REGIONAL SYMPOSIUM ON AGROECOLOGY FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FOOD SYSTEMS for Europe and Central Asia Budapest, Hungary, 23–25 November 2016 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome, 2017 The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The mention of specific companies or products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have been endorsed or recommended by FAO in preference to others of a similar nature that are not mentioned. The views expressed in this information product are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views or policies of FAO. ISBN 978-92-5-109851-6 © FAO, 2017 FAO encourages the use, reproduction and dissemination of material in this information product. Except where otherwise indicated, material may be copied, downloaded and printed for private study, research and teaching purposes, or for use in non-commercial products or services, provided that appropriate acknowledgement of FAO as the source and copyright holder is given and that FAO’s endorsement of users’ views, products or services is not implied in any way. -
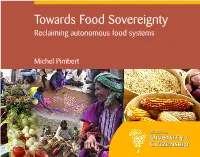
Towards Food Sovereignty Reclaiming Autonomous Food Systems
Towards Food Sovereignty Reclaiming autonomous food systems Michel Pimbert Reclaiming Diversi TY & CiTizensHip Towards Food Sovereignty Reclaiming autonomous food systems Michel Pimbert Table of Contents Chapter 7. Transforming knowledge and ways of knowing ........................................................................................................................3 7.1. Introduction...............................................................................................................................................................................................3 7.2. Transforming knowledge..........................................................................................................................................................................6 7.2.1. Beyond reductionism and the neglect of dynamic complexity ..........................................................................................6 7.2.2. Overcoming myths about people and environment relations .........................................................................................10 7.2.3. Decolonising economics......................................................................................................................................................17 7.3. Transforming ways of knowing..............................................................................................................................................................22 7.3.1. Inventing more democratic ways of knowing...................................................................................................................22 -

SILENCE N°320 2 Février 2005 LE MOIS DE LASSERPE Editorial
e c n e l ! S N°320 Février 2005 4 € 6 FS EEccoollooggiiee eett ccuullttuurreess n e l h a M aalltteerrnnaattiivveess Décroissance Finances Energies Pétrole Imaginer Bureautique et géologie une banque et économies politique transparente d’énergie Sommaire Ecologie et de l’intérieur... cultures alternatives de Vincent Peyret et Mimmo Pucciarelli VU Index de la revue Nord-Pas-de-Calais r La culture comme L'index des articles et brèves parus Le prochain numéro régional sera consa - des chaussures en 2004 est disponible contre 2 euros. cré au Nord-Pas-de-Calais. Si vous dési - e i de Matt Mahlen Les index des années précédentes rez nous aider à concevoir ce numéro, sont également disponibles à ce prix nous pouvons vous envoyer un courrier s Culture où est-tu ? (depuis 1994). avec les explications pour la recherche s Pour ceux qui le désirent, nous disposons des reportages. Ecrivez-nous ou télépho - de Madeleine Nutchey d'une compilation portant sur la fusion nez-nous (de préférence le mercredi o des index de 1994 à 2002. Il peut vous au 04 78 39 55 33). Culture ou barbarie être communiqué par courriel en le demandant à D de Jean-Claude Besson-Girard [email protected] . Primevère 2005 Nous cherchons des volontaires pour Décroissance tenir le stand de Silence au salon Assemblée Primevère, à Eurexpo, les 25, 26 et 27 Pétrole et février. Si vous pouvez donner au moins générale deux heures, vous pouvez prendre géologie po2litiq3 ue contact dès maintenant avec Dorothée de Silence Fessler en téléphonant à Silence le ven - d’ Yves Cochet Finances Notez déjà la date. -

Evénements 2010 En Archive
Evénements 2010 en archive Extrait du Site de l'Association Adéquations http://www.adequations.org/spip.php?article1411 Evénements 2010 en archive - Le suivi de l'actualité sur le site d'Adéquations - Carnet - Date de mise en ligne : 2010 Site de l'Association Adéquations Copyright © Site de l'Association Adéquations Page 1/143 Evénements 2010 en archive º 2010, anné internationale de la biodiversité º 2010, anné internationale du rapprochement des cultures | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 18 DECEMBRE 2010 / PARIS Rencontre débat Contre-pouvoirs & décroissance ’ Organisation : revue Entropia ’ « Ouverture par Jean-Claude Besson-Girard, directeur d'Entropia ’ "La notion de contre-pouvoir, animation" : Yves Cochet, député de Paris / "Expériences vécues d'Europe et d'Amérique latine", animation : Alain Gras, professeur de philosophie des techniques. » / Débats 16 DECEMBRE 2010 / PARIS Dialogue lecteurs - auteurs : rencontre avec Jean-Guy Henckel ’ « Pour ces premiers échanges lecteurs - auteurs, l'Atelier et la maison d'édition Rue de l'Echiquier vous proposent de rencontrer Jean-Guy Henckel, fondateur des Réseaux de Cocagne, et d'échanger sur l'insertion et le maraichage biologique. » 16 DECEMBRE 2010 / PANTIN (93) Conférence Le Grand Paris dans la mondialisation financière ’ « La mondialisation financière a changé les structures urbaines de la région Ile-de-France ces 20 dernières années. La désindustrialisation, le chômage, la ségrégation spatiale et l'étalement urbain sont les conséquences de cette mutation économique. Outre les déséquilibres spatiaux du projet du Grans Paris, l'Est Parisien et en particulier la Seine-Saint-Denis, est totalement négligé. Il apparaît pourtant que l'Arc express ne fait pas forcément mieux sur ce sujet. -

Peasant Seed’ Movements Facing Opening-Up Institutions and Policies Elise Demeulenaere, Yvonne Piersante
In or out? Organisational dynamics within European ‘peasant seed’ movements facing opening-up institutions and policies Elise Demeulenaere, Yvonne Piersante To cite this version: Elise Demeulenaere, Yvonne Piersante. In or out? Organisational dynamics within Euro- pean ‘peasant seed’ movements facing opening-up institutions and policies. Journal of Peas- ant Studies, Taylor & Francis (Routledge), 2020, Forum on Seed activism, 47 (4), pp.767-791. 10.1080/03066150.2020.1753704. hal-03005880 HAL Id: hal-03005880 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03005880 Submitted on 19 Jun 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. The Journal of Peasant Studies ISSN: 0306-6150 (Print) 1743-9361 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/fjps20 In or out? Organisational dynamics within European ‘peasant seed’ movements facing opening-up institutions and policies Elise Demeulenaere & Yvonne Piersante To cite this article: Elise Demeulenaere & Yvonne Piersante (2020): In or out? Organisational dynamics within European ‘peasant seed’ movements facing opening-up institutions and policies, The Journal of Peasant Studies, DOI: 10.1080/03066150.2020.1753704 To link to this article: https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1753704 Published online: 13 May 2020. -

Farmseedopportunities Deliverable D2.4
FarmSeedOpportunities – Deliverable D2.3 FarmSeedOpportunities Opportunities for farm seed conservation, breeding and production Project number: 044345 Specific Targeted Research project Sixth Framework Programme Thematic Priority 8.1 Specific Support to Policies Deliverable D2.4 Title: Innovative approaches in participatory research, on-farm conservation and the management of agricultural biodiversity in Europe Due date of deliverable: M36 Actual submission date: work version for the partners Start date of the project: January 1st, 2007 Duration: 36 months Organisation name of lead contractor: INRA Project co-funded by the European Commission within the Sixth Framework Programme (2002-2006) Dissemination Level PU Public X PP Restricted to other programme participants (including the Commission Services) RE Restricted to a group specified by the consortium (including the Commission Services) CO Confidential, only for members of the consortium (including the Commission Services) Page 1 of 31 FarmSeedOpportunities – Deliverable D2.3 Report on Innovative approaches in participatory research, on-farm conservation and the management of agricultural biodiversity in Europe WP2 Leader: Isabelle Goldringer, INRA Task2.3 Leader: Michel Pimbert, IIED Partners: IIED, INRA, DLO, RSP, LBI Authors Michel Pimbert with comments incorporated from Julie Dawson, Isabelle Goldringer Patrick de Kochko, Guy Kastler & RSP farmers 20 April 2010 Page 2 of 31 FarmSeedOpportunities – Deliverable D2.3 Contents 1 SUMMARY .................................................................................................................................................. -

Green Week Daily Is Published Revenue for Many Regional Enterprises
ISSUE 4 2 JUNE 2006 <G::CL::@96>AN 8=6C<>C<DJG7:=6K>DJG EDITORIAL Change is in the air... Countdown 2010: the way forward and in the plants, animals and birds Only four years to go to 2010, to meet the UN Convention on Bio- Climate change has a very real impact on the environment and biodiversity and action must be taken to logical Diversity (CBD) goal of sig- mitigate its effects and to help ecosystems to adapt to new conditions, delegates heard on Thursday morning. nifi cantly reducing the rate of bio- diversity loss worldwide, as well The fi rst two speakers, Robert very serious consequences for bio- demonstrate that rising global tem- Hungary for as the EU’s own target of bringing Wilson of the University Rey Juan diversity,” Wilson said. “Climate peratures in recent decades have a better future it to a total halt in Europe. What is Carlos in Spain and Rik Leemans change does not impact ecosystems been accompanied by latitudinal the next step? of Wageningen University in the directly but affects the species living shifts north and altitudinal shifts to Gabor Vida of the Hungarian Acad- Netherlands, examined the scien- in them, which then affects the eco- higher ground by many species. emy of Sciences brought a na- There is clearly some progress. tifi c evidence on links between cli- system at large,” Leemans qualifi ed. tional perspective to the debate. The Natura 2000 network now mate change and shifts in ecosys- In addition, seasons have moved In Hungary, the climate is growing comprises over 20,000 sites across tems and biodiversity. -

Transformative Agroecology Learning in Europe: Building Consciousness, Skills and Collective Capacity for Food Sovereignty
Agriculture and Human Values https://doi.org/10.1007/s10460-018-9894-0 SYMPOSIUM/SPECIAL ISSUE Transformative agroecology learning in Europe: building consciousness, skills and collective capacity for food sovereignty Colin R. Anderson1 · Chris Maughan1 · Michel P. Pimbert1 Accepted: 19 October 2018 © The Author(s) 2018 Abstract Agroecology has been proposed as a key building block for food sovereignty. This article examines the meaning, practices and potentials of ‘transformative agroecology learning’ as a collective strategy for food system transformation. Our study is based on our qualitative and action research with the European Coordination of Via Campesina to develop the European Agroecology Knowledge Exchange Network (EAKEN). This network is linked to the global network of La Via Campesina and builds on the strong experiences and traditions of popular education in Latin American peasant movements. Rather than focusing on agroecology education as a process of individual learning, we analyse how a transformative agroecology education can be strengthened as a critical repertoire of action used by social movements to advance food sovereignty. Our analysis contributes a new theory of transformative agroecology learning based on four key characteristics or qualities: horizontalism; diálogo de saberes (wisdom dialogues); combining practical and political knowledge; and building social movement networks. While these different elements of transformative agroecology learning were present across EAKEN, they were unevenly developed and, in many cases, not systematized. The framework can help to strategically and reflexively systematize and strengthen a transformative agroecology learning approach as a key building block for food sovereignty. Keywords Agroecology · Pedagogy · Learning · Sustainable agriculture · Food sovereignty · Europe · Popular education Introduction dominant modes of agriculture through learning processes that force ruptures in conventional thinking and practice. -

Symposium on the Benefits of Plant Variety Protection for Farmers and Growers
SYMPOSIUM ON THE BENEFITS OF PLANT VARIETY PROTECTION FOR FARMERS AND GROWERS November 2, 2012 Geneva, Switzerland SYMPOSIUM ON THE BENEFITS OF PLANT VARIETY PROTECTION AND FOR GROWERS FARMERS SYMPOSIUM ON THE BENEFITS OF PLANT VARIETY PROTECTION FOR FARMERS AND GROWERS Table of Contents Program 2 Keynote Speech The importance of new plant varieties for farmers and growers Mr. Thor Gunnar Kofoed (Committee of Professional Agricultural Organisations (COPA) General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union (COGEPA)) (Denmark) 3 SESSION I: The Role of PVP in Improving Incomes for Farmers and Growers Introduction Mr. Peter Button, Vice Secretary-General, UPOV 10 The Experience of Smallholder Flower Growers in Kenya Mr. Stephen Mbithi, Fresh Produce Exporters Association of Kenya (FPEAK) 20 The use of Plant Variety Protection to add Value for Fruit Growers Mr. Philippe Toulemonde, President of Star Fruits (France) 23 Investing to Deliver the Varieties that Farmers and Growers Need Mr. Stephen Smith, Pioneer Hi-Bred International Inc. (United States of America) 28 Adding Value for Grower Cooperatives Mr. Eduardo Baamonde, Director General, Cooperativas Agroalimentarias (Spain) 32 The use of Plant variety Protection to add Value for Farmers in Brazil Mr. Oscar Stroschon, Sementes Produtiva (Brazil) 35 Delivering High Performance Varieties To Subsistence/Smallholder Farmers Mr. Vuyisile Phehane, Agricultural Research Council (South Africa) 38 SESSION II: The Role of PVP in Enabling Farmers and Growers to Become Breeders Encouraging the development of new varieties of plants Mr. Peter Button, Vice Secretary-General, UPOV 49 A farmer-breeder experience in the Republic of Korea Mr. Young-Hae Kim (Republic of Korea) 54 The role of plant variety protection in supporting the development of improved varieties Mr. -

The United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas
The Journal of Peasant Studies ISSN: 0306-6150 (Print) 1743-9361 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/fjps20 The United Nations Declaration on the rights of peasants and other people working in rural areas Priscilla Claeys & Marc Edelman To cite this article: Priscilla Claeys & Marc Edelman (2019): The United Nations Declaration on the rights of peasants and other people working in rural areas, The Journal of Peasant Studies, DOI: 10.1080/03066150.2019.1672665 To link to this article: https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1672665 Published online: 24 Oct 2019. Submit your article to this journal Article views: 39 View related articles View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=fjps20 THE JOURNAL OF PEASANT STUDIES https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1672665 GRASSROOTS VOICES The United Nations Declaration on the rights of peasants and other people working in rural areas Priscilla Claeys and Marc Edelman* Guest Editors Editors’ introduction Seventeen years of struggle. That’s what it took for the United Nations to adopt – on 17 December 2018 – the Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP 2018). UNDROP recognises the dignity of the world’s rural popu- lations, their contributions to global food production, and the ‘special relationship’ they have to land, water and nature, as well as their vulnerabilities to eviction, hazardous working conditions and political repression. It reiterates human rights protected in other instruments and sets new standards for individual and collective rights to land and natural resources, seeds, biodiversity and food sovereignty. -

Summaries of Presentations: Opening Plenary Session and Parallel Sessions
February 18, 2016 Summaries of presentations: Opening plenary session and parallel sessions FAO International Symposium on “The Role of Agricultural Biotechnologies in Sustainable Food Systems and Nutrition” 15- 17 February, 2016 The international symposium will explore how the application of science and technology, particularly agricultural biotechnologies, can benefit smallholders in developing sustainable food systems and improving nutrition in the context of climate change. The symposium takes a multisectoral approach, covering the crop, livestock, forestry and fishery sectors. It also aims to cover the wide spectrum of available biotechnologies, including microbial food fermentation, tissue culture in plants, reproductive technologies in livestock, use of molecular markers, genetic modification and other technologies. The symposium takes place over two and a half days, with keynote speakers addressing the opening plenary session on 15 February. A high-level ministerial segment will take place on 16 February. Three parallel sessions will also be held each day and the symposium will close on 17 February 2016 with a final plenary session where outcomes from the parallel sessions will be reported. All parallel session speakers and opening plenary speakers have been asked to provide a 2 page summary (1000 words) of their presentation. This document provides these summaries. The agenda for the keynote speeches and parallel sessions is provided below with hyperlinks to each speaker’s summary. If a summary is available, the name of the speaker will be in blue text. CTRL+ Click on the author’s name to go directly to their summary. At the end of each summary there is another hyperlink to return to the top of the document.