Rôles, Impacts Et Services De L'élevage Européen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Università Degli Studi Di Padova Functional Meat And
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI RISORSE NATURALI E AMBIENTE - DAFNAE SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE ANIMALI E AGROALIMENTARI INDIRIZZO SCIENZE ANIMALI CICLO XXVI FUNCTIONAL MEAT AND MEAT PRODUCTS FROM UNCONVENTIONAL MEAT SPECIES Direttore della Scuola : Ch.mo Prof. Martino Cassandro Coordinatore d’indirizzo: Ch.mo Prof. Roberto Mantovani Supervisore: Ch.ma Prof.ssa Antonella Dalle Zotte Dottorando : Marco Cullere 2 Alla mia famiglia e a Mara… 3 4 TABLE OF CONTENTS The outline of the thesis 6 Abstract 8 Riassunto 10 Chapter 1 General introduction 12 Chapter 2 General aims 66 Chapter 3 Effects of Dietary supplementation of Spirulina (Arthrospira platensis) and Thyme (Thymus vulgaris) to growing rabbits on: a) Apparent digestibility and productive performances of growing rabbits 68 b) Carcass composition, meat physical traits, and vitamin B12 content on growing rabbits 85 c) Rabbit meat appearance, oxidative stability and fatty acid profile during retail display 104 d) Raw and cooked meat quality, nutrient true retention and oxidative stability 123 Chapter 4 Oregano, Rosemary, Vitamin E and Saccaromyces cerevisiae dietary supplementation to growing rabbits: Effect on growth performance, carcass traits, bone development and meat chemical composition 155 Chapter 5 First evaluation of unfermented and fermented rooibos (Aspalathus linearis) in preventing lipid oxidation in ostrich meat products 173 Chapter 6 Two different fat inclusion levels, NaCl contents and two LAB starter cultures in the manufacturing of Italian-type ostrich salami ripened for 10 and 20 weeks: Part 1. Weight loss, proximate composition and cholesterol content 193 Chapter 7 General conclusions 216 List of publications 218 5 6 THE OUTLINE OF THE THESIS In the first part, some topics to understand and contextualize the research of the present PhD thesis are presented (Chapter 1). -

Insights Into the European Rabbit (Oryctolagus Cuniculus) Innate
Abrantes et al. BMC Genetics 2013, 14:73 http://www.biomedcentral.com/1471-2156/14/73 RESEARCH ARTICLE Open Access Insights into the European rabbit (Oryctolagus cuniculus) innate immune system: genetic diversity of the toll-like receptor 3 (TLR3) in wild populations and domestic breeds Joana Abrantes1,3, Helena Areal1,2 and Pedro J Esteves1,4* Abstract Background: Toll-like receptors (TLRs) belong to the innate immune system and are a major class of pattern recognition receptors representing the first line of the innate immune response. The TLR molecule is structurally composed by an ectodomain that contains leucine rich repeats (LRRs) that interact with pathogen associated molecular patterns (PAMPs), a transmembrane domain and a conserved cytoplasmic domain designated TIR (Toll-IL1 receptor) that is responsible for the intracellular signaling. TLR3 has been associated with the direct recognition of double-stranded viral RNA resulting from viral replication, while TLR7 and TLR8 target single-stranded viral RNA. In the European rabbit (Oryctolagus cuniculus), TLR7 and TLR8 were reported to be absent and pseudogenised, respectively, making TLR3 the only available TLR for the recognition of viral RNA. Thus, the levels of diversity of TLR3 were evaluated in the European rabbit by analysing different genetic backgrounds and exposure to pathogen pressures. Results: We detected 41 single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the coding sequence of TLR3. The highest diversity was observed in the wild populations of Iberian Peninsula, between 22–33 polymorphic positions. In the French population, 18 SNPs were observed and only 4 polymorphic positions were detected in the domestic breeds. 14 non-synonymous substitutions were observed, most of them in the LRR molecules. -

The Genetic Structure of Domestic Rabbits Research Article
The Genetic Structure of Domestic Rabbits Miguel Carneiro,*,1,2,3 Sandra Afonso,1 Armando Geraldes,4 Herve´ Garreau,5 Gerard Bolet,5 Samuel Boucher,6 Aure´lie Tircazes,5 Guillaume Queney,7 Michael W. Nachman,3 and Nuno Ferrand1,2 1CIBIO, Centro de Investigacxa˜o em Biodiversidade e Recursos Gene´ticos, Campus Agra´rio de Vaira˜o, Vaira˜o 2Departamento de Biologia da Faculdade de Cieˆncias, Universidade do Porto, Porto, Portugal 3Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Arizona 4Department of Botany, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada 5Institut national de la recherche agronomique, UR 631 Station d’ame´lioration ge´ne´tique des animaux, Castanet-Tolosan Cedex, France 6Labovet Conseil, re´seau Cristal, Les Herbiers, France 7Antagene, Wildlife Genetics Laboratory, Limonest, Lyon, France *Corresponding author: E-mail: [email protected]. Research article Associate editor: Naoko Takezaki Abstract Understanding the genetic structure of domestic species provides a window into the process of domestication and motivates the design of studies aimed at making links between genotype and phenotype. Rabbits exhibit exceptional phenotypic diversity, are of great commercial value, and serve as important animal models in biomedical research. Here, we provide the first comprehensive survey of nucleotide polymorphism and linkage disequilibrium (LD) within and among rabbit breeds. We resequenced 16 genomic regions in population samples of both wild and domestic rabbits and additional 35 fragments in 150 rabbits representing six commonly used breeds. Patterns of genetic variation suggest a single origin of domestication in wild populations from France, supporting historical records that place rabbit domestication in French monasteries. -

Consumers' Attitude to Consumption of Rabbit Meat in Eight Countries
foods Article Consumers’ Attitude to Consumption of Rabbit Meat in Eight Countries Depending on the Production Method and Its Purchase Form Katalin Szendr˝o* , Eszter Szabó-Szentgróti and Orsolya Szigeti Institute of Marketing and Management, Kaposvár University, H-7400 Kaposvár, Hungary; [email protected] (E.S.-S.); [email protected] (O.S.) * Correspondence: [email protected] Received: 17 April 2020; Accepted: 14 May 2020; Published: 19 May 2020 Simple Summary: The aim of the study was to investigate the consumers’ attitude to their preference of rabbit meat in eight countries depending on the production method and its purchase form. Consumers’ attitude was evaluated in Spain, Italy, France, Poland, Hungary, China, Brazil and Mexico based on the respondents’ opinion regarding origin, production conditions, slaughtering methods and breed. Results revealed that breed was an inessential factor. The origin of rabbits was the most important in Italy, France, Hungary and Brazil (in the latter country the slaughtering method and the level of processing were also highly valued), feeding of animals received the highest scores in Spain, Poland and Mexico (in the latter also the slaughtering method), while the level of processing was the foremost factor in China. The preference of fresh meat was the highest in Spain, France and Mexico, and that of frozen in Brazil and Mexico. The highest preference of a whole carcass was found in France and Mexico. The thigh was mostly favored in France and that of the loin in Mexico. The prepared meat products (roasted, smoked and semi-finished) were the most popular in Mexico. -
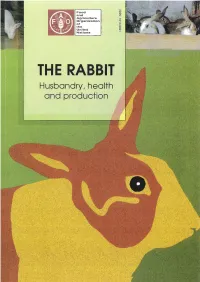
The Rabbit: Husbandry, Health and Production (New Revised Version) ISBN 92-5-103441-9
Food E5 and zco Agriculture Organization of the United Nations THE RABBIT Husbandry, health and production Rabbits reared with techniques adapted to specific environments can do much to improve the family diet of many of the neediest rural families, at the same time supplying a regular source of income. The purpose of this work is to bring to- gether as fully and objectively as possible all the available data on rabbit husbandry, health and production. It is also intended as a contribution to the preparation and execution of rabbit development pro- grammes, particularly in developing countries. A team of scientists from the French National Institute for Agricultural Research (INRA), a world-renowned rabbit author- ity, was marshalled to cover the many and varied aspects of rabbit production. FAO Animal Production and Health Series No. 21 ISSN 1010-9021 THE RABBIT Husbandry, health and production (new revised version) by F. Lebas Agricultural Engineer P. Coudert Veterinary Surgeon H. de Rochambeau Agricultural Engineer R.G. Thébault Engineer (INRA) FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome, 1997 The designations employed and the presentation of material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. David Lubin Memorial Library Cataloguing in Publication Data Lebas, F. The rabbit: husbandry, health and production (new revised version) ISBN 92-5-103441-9 (FAO Animal Production and Health Series, no. -

Rabbit-Nutrition-With-Emphasis-On
REFLECTIONS ON RABBIT NUTRITION WITH A SPECIAL EMPHASIS ON FEED INGREDIENTS UTILIZATION LEBAS F. Cuniculture, 87a Chemin de Lassère, 31450 Corronsac, France [email protected] ABSTRACT In this invited communication the author proposes a list of nutritional recommendations for rabbits of different categories: growing from 18 to 42 days, from 42 to 80 days, for breeding does according to productivity (40-50 kits weaned per doe/year or more than 50) and for a single diet suitable for all rabbits. Recommendations taking account the last published data, are divided in 2 groups. The first corresponds to nutrients which contribute mainly to feed efficiency: digestible energy, crude and digestible protein, amino acids, minerals, and fat-soluble vitamins. The second group corresponds to nutrients which contribute mainly to nutritive security and digestive health: different fibre components (lignins, cellulose, hemicelluloses) and their equilibrium, starch and water soluble vitamins. In a second part, 387 papers published during the last 30 years on raw material utilisation in rabbit feeding were analysed. In a total of 14 tables, the 542 corresponding experiments were summarised each by the identification of the raw material, by the highest level of incorporation used in the experiment, by the highest acceptable level, by the main ingredient(s) replaced by the raw material studied, and finally by the authors reference. Raw materials studied were those used in temperate as well as in tropical countries. The raw material were grouped according -

(MRSA) in Purulent Subcutaneous Lesions of Farm Rabbits
foods Article Livestock-Associated Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Purulent Subcutaneous Lesions of Farm Rabbits 1,2,3,4, 1,2,3, 5 1,2,3 Vanessa Silva y , Telma de Sousa y , Paula Gómez , Carolina Sabença , Madalena Vieira-Pinto 6,7 , Rosa Capita 8,9 , Carlos Alonso-Calleja 8,9 , Carmen Torres 5 , José L. Capelo 10,11, Gilberto Igrejas 1,2,4 and Patrícia Poeta 3,4,* 1 Functional Genomics and Proteomics Unit, University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD), 5000-801 Vila Real, Portugal; [email protected] (V.S.); [email protected] (T.d.S.); [email protected] (C.S.); [email protected] (G.I.) 2 Department of Genetics and Biotechnology, University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD), 5000-801 Vila Real, Portugal 3 Microbiology and Antibiotic Resistance Team (MicroART), Department of Veterinary Sciences, University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD), 5000-801 Vila Real, Portugal 4 Associate Laboratory for Green Chemistry-LAQV, Chemistry Department, Faculty of Science and Technology, University Nova of Lisbon, 2829-516 Lisbon, Portugal 5 Area of Biochemistry and Molecular Biology, University of La Rioja, 26006 Logroño, Spain; [email protected] (P.G.); [email protected] (C.T.) 6 Veterinary and Animal Science Research Center (CECAV), University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD), 5000-801 Vila Real, Portugal; [email protected] 7 Department of Veterinary Sciences, University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD), 5000-801 Vila Real, Portugal 8 Department of Food Hygiene and -

Rabbits Behavioural Response to Climatic and Managerial Conditions – a Review
Arch. Tierz. Dummerstorf 47 (2004) 5, 469-482 1 Department of Animal Production, Faculty of Agriculture, Zagazig University, Zagazig, Egypt 2 Department of Animal Wealth, Institute of Efficient Productivity, Zagazig University, Egypt IBRAHIM FAYEZ M. MARAI 1 and ALI A. RASHWAN 2 Rabbits behavioural response to climatic and managerial conditions – a review Abstract The domestic rabbit is deprived of the protection of burrows and of a social hierarchy and live in a limited space which is a fraction of a metre of a hard sanitized space, removed from odours, markers and social interaction. Hot climate was the main cause for abnormal maternal and sexual behaviour. Exposure to high ambient temperature induces rabbits to try to balance their excessive heat load by using different means. The doe that was capable to produce 10 litters a year may give only 4 to 5 litters in hot climate Noise in rabitries causes adverse effects including nervous and behavioural abnormalities and can cause a startled response and traumatic injuries to limbs and back. Particularly, most concern about noise effects has traditionally focused on impairment of reproductive and maternal behaviours, although few controlled studies have been done to support the observations of animal caretakers that noise inhibits production. Moon phases are one of the main causes of abnormal sexual behaviour in females. Crowdness causes that rabbits become aggressive and bite one another during the first few days of nest sharing, while successive litters live together. Keeping rabbits singly in cages is not compatible with the demand of housing with respect to animal welfare, since the singly caged rabbit is exposed to natural external stimulus, has no social contact and has no conditions for suitable locomotion. -

The Welfare of Farmed Rabbits in Commercial Production Systems
The Welfare of Farmed Rabbits in Commercial Production Systems A scientific review Jo Dorning BSc PhD Stephen Harris BSc PhD DSc March 2017 Page Executive summary 3 Purpose 5 Assessing animal welfare 5 World rabbit production 5 Domestication 6 Rabbit farming systems 7 Breeding does 7 Fattening rabbits 9 What science shows us rabbits need from their environment 10 Contents Social housing 10 Breeding does 11 Aggression 12 Pseudopregnancy 12 Double littering 12 Semi-group housing 13 Management of breeding does 13 Fattening rabbits 14 Breeding bucks 14 Reproduction 15 Breeding intensity 15 Biostimulation 16 Weaning age 16 Semen collection 16 Maternal behaviour 16 Climate 17 Space 17 Floor area 18 Vertical space 18 Outside space 18 Substrate 18 Wire 19 Plastic 19 Bedding 19 Enrichment 19 Gnawing sticks 19 Platforms 20 Hiding places 20 Nutrition 20 Handling, transport and slaughter 21 Loading 21 Transport 21 Fasting 22 Lairage 22 Slaughter 22 Standards for commercial rabbit farms in the EU 22 Concluding remarks 23 References 24 THE WELFARE OF FARMED RABBITS IN COMMERCIAL PRODUCTION SYSTEMS scale. Enriched pens or parks provide more space and Executive summary enable group housing of breeding does and fatteners, but Rabbits are the second most frequently farmed species in require more work to clean and manage. Free-range and the EU but are not protected by species-specific legislation. organic systems remain a small sector, but usually enable Global rabbit meat production is increasing year on year grazing and provide access to more space and natural and reached 1.6 million tonnes in 2014, equivalent to 1.07 light than is possible in indoor systems. -
Redalyc.HOW CAN RABBIT RESEARCH in the LABORATORY
Tropical and Subtropical Agroecosystems E-ISSN: 1870-0462 [email protected] Universidad Autónoma de Yucatán México González-Mariscal, Gabriela HOW CAN RABBIT RESEARCH IN THE LABORATORY CONTRIBUTE TO CUNICULTURE ON THE FARM? Tropical and Subtropical Agroecosystems, vol. 15, núm. 1, 2012, pp. S71-S78 Universidad Autónoma de Yucatán Mérida, Yucatán, México Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93924484006 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative Tropical and Subtropical Agroecosystems, 15 (2012) SUP 1: S71 – S78 REVIEW [REVISIÓN] HOW CAN RABBIT RESEARCH IN THE LABORATORY CONTRIBUTE TO CUNICULTURE ON THE FARM? [¿CÓMO PUEDE LA INVESTIGACIÓN SOBRE CONEJOS, REALIZADA EN EL LABORATORIO, CONTRIBUIR A LA CUNICULTURA EN LA GRANJA?] Gabriela González-Mariscal Centro de Investigación en Reproducción Animal, CINVESTAV-Universidad Autónoma de Tlaxcala, Apdo. Postal 62, Tlaxcala Tlax 90000, México. Tel: 52-248- 48-16020; Fax: 52-248-48-15476 E-mail: [email protected] * Corresponding author SUMMARY RESUMEN Rabbit research coming from the laboratory can have a La investigación sobre el conejo, generada en el profound impact on Cuniculture, performed on the laboratorio, puede tener un impacto profundo sobre la farm, and vice versa. This bi-directional Cunicultura, realizada en la granja. Esta comunicación communication is scarce at present but, by finding bi-direccional es escasa actualmente pero, issues of common interest, an effective interaction identificando tópicos de interés común, puede between these two niches can be promoted. -

Rabbit Production in the World, with a Special Reference to Western Europe Quantitative Estimation and Methods of Production
Conference for promotion of rabbit production in Russia, Kazan, 30 October 2009 An initiative of the WRSA Russian Branch Rabbit production in the World, with a special reference to Western Europe Quantitative estimation and Methods of production François LEBAS President of the French Association CUNICULTURE Former General Secretary of the World Rabbit Science Association (1988 – 2008) Web site : http://www.cuniculture.info GeneralGeneral planplan ofof thethe lecturelecture 1 – Quantitative production in the different countries - Difficulty of the estimation: official and real situation, carcasses presentation, … - Range of estimation of the world production - the 4 main countries : China, Italy, Spain and France 2 – Worldwide overview of the methods of production - Asia : China, Indonesia, Vietnam, … - North America : USA, Canada, Mexico - Central and South America : Cuba, Brazil, Argentina, - Africa : North and South of Sahara - Europe : traditional and intensive commercial production 3 – Description of the production techniques used in Western Europe - Cages and buildings - Genetic resources - Reproduction & Insemination - Nutrition and Feeding - Rabbitries management - Slaughter and commercialization World Rabbit meat production according to FAO in 2007 Production BUT Rank Countries tonnes Nothing for 1 CHINA 597 000 2 VENEZUELA 277 000 ???? - Belgium 20 000 t 3 ITALY 230 000 - Portugal 20 000 t 4 North KOREA 91 000 ???? - USA 35 000 t 5 SPAIN 71 000 - Morocco 20 000 t 6 EGYPT 70 000 -etc… 7 FRANCE 55 000 8 GERMANY 32 000 9 UKRAINE 12 000 Crazy overestimation for 10 RUSSIA 10 000 - Venezuela 6 000 t 11 HUNGARY 9 500 - North Korea 1 000 t 12 GREECE 8 000 13 ARGENTINA 7 000 Clear underestimation for 14 ALGERIA 7 000 - France 80 000 t 15 KAZAKHSTAN 6 500 - Spain 100 000 t 16 POLAND 5 000 - Poland 25 000 t 17 MEXICO 4 000 etc …. -

Abstracts of the 44Th Symposium on Cuniculture, Asescu
W orld World Rabbit Sci. 2019, 27: 101-108 R abbit doi:10.4995/wrs.2019.11963 Science © WRSA, UPV, 2003 ABSTRACTS OF THE 44TH SYMPOSIUM ON CUNICULTURE, ASESCU ARANDA DE DUERO, SPAIN, 5TH-6TH JUNE, 2019. The 44th Congress of the Spanish Association of Cuniculture (ASESCU) was held in Aranda de Duero (Burgos province, Castile and Leon region, Spain) from 5th to 6th June 2019, hosted by the trade union ‘Unión de Campesinos de Burgos’. The six main talks largely focused on the reasons behind rabbit meat consumption and how to promote it. The first explained the evolution of meat consumption by humans, the second analysed the environmental impact of livestock and the third showed efficient advertising strategies. Another talk explained the strategic approach of the rabbit meat promotion campaigns carried out in Spain in recent years. Finally, the Director of the Rabbit Meat Marketing Board (INTERCUN) spoke about the need for research, development and innovation in rabbit farming. The closing speech proposed what to do to achieve better rabbit meat sales based on current food market trends. Moreover, a total of 22 communications were presented in working sessions with oral communications and posters (nutrition, pathology, housing and welfare, and reproduction and genetics). The meeting was attended by around 170 participants from several European, American and African countries. Abstracts of the contributions submitted are reported below. MAIN PAPER NUTRITION WHAT DO WE HAVE TO DO TO SELL OUR PRODUCT DIETARY PROTEIN OPTIMISATION USING A RABBIT BETTER? REVIEW OF CURRENT FOOD MARKET MODEL: TOWARDS A MORE SUSTAINABLE TRENDS AS A BASIS FOR THE GENERATION OF PRODUCTION IN NITROGEN CONTAMINATION OPPORTUNITIES IN THE COMMERCIALISATION OF MARÍN-GARCÍA P.J., LÓPEZ M.C., RÓDENAS L., MARTÍNEZ- RABBIT MEAT PAREDES E., BLAS E., PASCUAL J.J.