50 Documents Pour Une Histoire De La Corse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sentiers De L'alta Rocca
SENTIERS DE L’ALTA ROCCA MAPS : 4254OT et/ou 4253OT - Top 25 San Gavinu di Carbini / Carabona / Zonza / Quenza / Zonza GPSZonza : N 41° / 43’San 10.9446’’ Gavinu - E 9° di 8’ 46.7262’’Carbini GPS : N 41° 44’ 42.2988’’ - E 9° 10’ 3.4788’’ Sera di Scopamena / Aulene GPS :/ N 41°Sera 45’ 13.9068’’ di Scopamena - E 9° 6’ 2.8836’’ 6H00 BALISAGE DIFFICULTÉ 4H15 BALISAGE DIFFICULTÉ aller/retour orange facile aller/retour orange facile 3H30 BALISAGE DIFFICULTÉ Départ : à 650 mètres du village de San Gavino di Carbini, Départ : en venant de Levie, à 50 m à gauche de l’hôtel le aller/retour orange facile sur la route de Sàpara Maiò. « Mouflon d’or ». Intérêt : beaux passages ombragés, forêts de chênes et Panneaux de départ en bois. de pins, châtaigneraies. Curiosités patrimoniales : église Intérêt : agréables passages au fil de l’eau (sites de bai- RANDOS Départ : centre du village de Serra di Sco- à Gualdaricciu, église à Carabona, four à pain à Giglio, gnades). Forêt de chênes. HIKES / GITE pamena. moulin à Pian di Santu. Intérêt : panorama sur la région. Possibilité d’accéder à la Punta di Cucciurpula (1164 m). Compter 1h00 de plus pour le trajet aller-retour à partir de Col d’Arghja La Foce. Carte IGN TOP 25 Petreto-Bicchisano-Zicavo. Les conseils de sécurité et de LesFusée rouge, signes 6 éclats d’unede lampesecours ou d’un miroir, en ou montagne6 appels sonores à la: minute signifient : nous avons besoin d’aide ÉTUDIEZbone VOTRE conduite ITINÉRAIRE ! Prenez du conseil randoneurauprès des organismes compé- tents sur les conditions locales. -

Randonnée En Corse, Rando Corse Du Sud À Partir De Porto Vecchio 2021
LA CORSE Mare a Mare sud A partir de Porto-Vecchio e Mare a Mare sud est une randonnée incontournable, une grande traversée d’Est en Ouest. Au départ de Porto-Vecchio, la cité du sel et du liège, L l’itinéraire emprunte les grandes routes de la transhumance. Des chemins usités pendant des siècles par les bergers et leurs troupeaux, ponctués de magnifiques églises romanes et villages de granit, plongés dans une végétation luxuriante. Votre séjour se déroule en moyenne montagne à une altitude moyenne de 800 m. Vous marchez à l’ombre des chênes, arbousiers et autres essences qui composent le maquis. Vous sillonnez les villages de pierre à la rencontre d’une culture authentique. › PROGRAMME FL299 7 jours - 5 nuits - 5 jours de randonnée Jour 1 : Porto-Vecchio Rendez-vous à votre hébergement à Porto-Vecchio. Installation à votre en hôtel, en centre-ville. Dîner libre. Jour 2 : Porto-Vecchio - Cartalavonu C’est par la route que vous quittez la ville, pour rejoindre le petit hameau d’Alzu Gallina. Le sentier s’enfonce entre les chênes-lièges, puis monte progressivement vers de beaux panoramas sur la côte et la Sardaigne, avant de rejoindre le village de l’Ospédale, qui domine toute la côte. Dernière traversée en forêt de pins pour arriver sur le plateau de Cartalavonu et votre hébergement. Distance : 15km, durée : 5h00, dénivelé plus : +1030 LA PELERINE Randonnées et Voyages à pied 32 Place Limozin 43170 SAUGUES Tèl : +33 (0)4 71 74 47 40 \ [email protected] \ www.lapelerine.com Jour 3 : Cartalavonu - Levie Au départ du plateau le sentier s’élève et franchit plusieurs cols, offrant de magnifiques points de vue. -
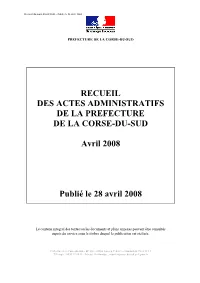
RAA Avril2008 Cle06cc69.Pdf
Recueil du mois d'avril 2008 - Publié le 28 avril 2008 PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD Avril 2008 Publié le 28 avril 2008 Le contenu intégral des textes/ou les documents et plans annexés peuvent être consultés auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée. Préfecture de la Corse-du-Sud – BP 401 – 20188 Ajaccio Cedex 1 – Standard 04 95 11 12 13 Télécopie : 04 95 11 10 28 - Adresse électronique : [email protected] Recueil du mois d'avril 2008 - Publié le 28 avril 2008 SOMMAIRE PAGES CABINET 6 - Arrêté N° 2008-0353 du 07 avril 2008 portant autorisation d’installation d’un 7 système de vidéosurveillance……………………………………………………. DIRECTION DU PUBLIC ET DES COLLECTIVITES LOCALES 9 - Arrêté N° 2008-0331 du 03 avril 2008 autorisant l'organisation du raid 10 d'endurance équestre de Coti-Chiavari le 13 avril 2008………………………… - Arrêté N° 2008–0388 du 21 avril 2008 portant répartition des sièges au Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 13 département de la Corse-du-Sud………………………………………………... - Arrêté N° 2008-0401 du 22 avril 2008 autorisant l’organisation du 2ème Rallye 15 de Corse – Championnat de France Rallye Routier les 26 et 27 avril 2008……. - Arrêté N° 2008-0403 du 24 avril 2008 modifiant l’arrêté 07-0301 du 8 mars 2007 fixant la composition de la commission départementale de la sécurité 20 routière………………………………………………………………………….. - Arrêté N° 2008-0404 du 24 avril 2008 modifiant l’arrêté 07-0302 du 8 mars 2007 fixant la composition des sections spécialisées de la commission 22 départementale de la sécurité routière…………………………………………. -

17 Décembre 2019 Page 1 CONVENTION QUINQUENNALE 2020-2024 PREAMBULE La Révision De La Charte Du SM/PNRC : D'une Période D
CONVENTION QUINQUENNALE 2020-2024 RELATIVE A LA DEFINITION ET A LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CORSE - PARCU DI CORSICA SUR SON TERRITOIRE PREAMBULE La révision de la Charte du SM/PNRC : d’une période d’incertitude à une concertation élargie et déterminante : Le classement du Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) avait été renouvelé pour 10 ans par décret du 9 juin 1999 sur un territoire de 145 communes, étendu à deux communes supplémentaires par décret du 12 avril 2007. Une première révision de la charte du Parc Naturel Régional de Corse, avait été prescrite par délibération de l’Assemblée de Corse en date du 30 mars 2007. Elle était initialement envisagée sur un périmètre d’étude identique à celui du périmètre classé en Parc naturel régional. Un débat s’est ensuite instauré sur l’opportunité d’étendre ce périmètre, certains élus considérant que la valeur patrimoniale de la Corse justifiait l’inscription de l’ensemble de l’île en Parc naturel régional. Le diagnostic territorial réalisé en 2011 à la demande de la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) a permis d’analyser les possibilités d’extensions pertinentes au regard des critères de classement d’un Parc naturel régional, tels qu’ils sont définis par le code de l’environnement. Le classement du Parc a été prolongé par décret du 2 juin 2009 jusqu’au 9 juin 2011. Depuis cette date, le Parc Naturel Régional de Corse n’était plus classé. La révision de la Charte a par la suite été relancée en juillet 2013, selon un processus concerté avec l’Office de l’Environnement de la Corse, la fédération des parcs naturels régionaux de France et en relation étroite avec l’Etat. -

OLIVERAIES D'olmeto-SANTA MARIA FIGANIELLA (Identifiant National : 940004161)
Date d'édition : 06/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004161 OLIVERAIES D'OLMETO-SANTA MARIA FIGANIELLA (Identifiant national : 940004161) (ZNIEFF Continentale de type 2) (Identifiant régional : 0174) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Corse, .- 940004161, OLIVERAIES D'OLMETO-SANTA MARIA FIGANIELLA. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004161.pdf Région en charge de la zone : Corse Rédacteur(s) :DREAL Corse Centroïde calculé : 1148207°-1661509° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 24/04/2013 Date actuelle d'avis CSRPN : 24/04/2013 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 3 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 3 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 4 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 4 7. ESPECES ...................................................................................................................................... -

Avis De La Mission Régionale D'autorité Environnementale De
Corse Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Corse sur l’élaboration du plan local d’urbanisme de VICO (Corse-du-Sud) n°MRAe 2018-02 1 AVIS DÉLIBÉRÉ N° 2018-02 adopté lors de la séance du 11 juin 2018 par La mission régionale d’autorité environnementale de Corse Préambule La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Corse s’est réunie téléphoniquement le XXXXX 2018. L’ordre du jour comportait notamment, l’avis sur l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vico. Étaient présents et ont délibéré : Fabienne Allag-Dhuisme présidente, Jet en tant que membres associés, Marie Livia Leoni et Louis Olivier ; Etait excusé : Jean-Pierre Viguier, membre permanent titulaire. Était présent sans voix délibérative : Jean-Marie Seité membre associé suppléant. En application de l’article 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci- dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis. L’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004, portant transposition de la directive 2001/42/CE du parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, a introduit la notion d’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Le décret n°2005-608 du 27 mai 2005 a complété le code de l’urbanisme par les articles désormais codifiés R. 104-1 et suivants. La procédure d’évaluation environnementale, diligentée au stade de la planification, en amont des projets opérationnels, vise à repérer de façon préventive les impacts potentiels des grandes orientations du document d’urbanisme sur l’environnement, à un stade où les infléchissements sont plus aisés à mettre en œuvre. -

Juillet2009-Tome1 Cle2d9815.Pdf
Recueil du mois de Juillet 2009 – Tome 1 - Publié le 30 juillet 2009 PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD Mois de Juillet 2009 Tome 1 Publié le 30 juillet 2009 Le contenu intégral des textes/ou les documents et plans annexés peuvent être consultés auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée. Préfecture de la Corse-du-Sud – BP 401 – 20188 Ajaccio Cedex 1 – Standard 04 95 11 12 13 Télécopie : 04 95 11 10 28 - Adresse électronique : [email protected] Recueil du mois de Juillet 2009 – Tome 1 - Publié le 30 juillet 2009 SOMMAIRE PAGES CABINET 5 - Arrêté N° 2009-0772 du 15 juillet 2009 portant attribution de la médaille 6 d'honneur du travail - promotion du 14 juillet 2009…………………………… - Arrêté N°09-0818 du 27 juillet 2009 portant sur l’interdiction des activités de 10 plein air, de loisirs et de randonnées dans le département de la Corse du Sud… - Arrêté préfectoral N° 09 – 0819 du 27 juillet 2009 modifiant l’arrêté n° 07 - 719 en date du 01 juin 2007 relatif aux mesures de police applicables sur l’aérodrome d’Ajaccio et sur l’emprise des installations extérieures rattachées (l'annexe est 12 consultable dans les bureaux de la Délégation de la direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est)…………………………………………. DIRECTION DU PUBLIC ET DES COLLECTIVITES LOCALES 14 - Arrêté N° 2009-748 du 8 juillet 2009 Renouvelant l’arrêté préfectoral 07-1115 agréant la société Kaléïdopsy en qualité d’organisme chargé de faire subir des 15 tests psychotechniques aux conducteurs dont le permis de conduire a été annulé. -

Ferrara Xavier Lacombe Suppléant
jean jacques ferrara xavier lacombe suppléant AFA AJACCIO ALATA AMBIEGNA De résultat en rendez-vous inédits cette année affirme l’évolution de notre APPIETTO ARBORI ARRO société. Les dimanches 11 et 18 juin prochains c’est votre député de AZZANA BASTELICACCIA circonscription que vous élirez. Pour la première fois, les électeurs vont élire un BALOGNA BOCOGNANO représentant à l’Assemblée nationale dont la fonction politique sera unique. CALCATOGGIO CANNELLE CARBUCCIA CARGESE Engagé par réelle conviction, ceux au service de l’intérêt général et du CASAGLIONE COGGIA qui me côtoient sauront reconnaître progrès collectif pour notre île. Les CRISTINACCE CUTTOLI que la volonté d’agir pour l’intérêt évènements des dernières années, CORTICCHIATO EVISA GUAGNO général est dans ma nature! Chacun le contexte de crise mondiale, me LOPIGNA LETIA MARIGNANA de mes engagements, autant dans poussent à avoir une lecture réaliste ma vie personnelle, que MURZO OSANI ORTO OTAPORTO du monde qui nous entoure. professionnelle ou politique ont PARTINELLO PASTRICCIOLA Ce mandat de député que je brigue toujours été pris en tant qu’homme PERI PIANA POGGIOLO RENNO aujourd’hui, je l’envisage comme libre et soucieux du respect de tous. REZZA ROSAZIA SALICE une mission d’engagements et SANT’ANDREA D’ORCINO SARI d’actions, sur notre territoire comme Cette élection est complexe dans un D’ORCINO SARROLA CARCOPINO contexte politique mondial mouvant à Paris. Je sais le désaroi de nos SERRIERA SOCCIA TAVACO dans lequel notre famille politique populations face à la chose TAVERA UCCIANI VALLE DI doit assumer les réalités et défendre politique, nos électeurs sont MEZZANA VERO VICO nos enjeux. -

Livret III - Schéma D'aménagement Territorial
P L A N D ’AMÉNAGEMENT ET DE D ÉVELOPPEMENT D URABLE D E L A C ORSE Livret III - Schéma d'Aménagement Territorial Approuvé par l’Assemblée de Corse le 2 octobre 2015 Modifié par l’Assemblée de Corse le APPROUVÉ LE 2 OCTOBRE 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION ................................................................................................ 3 I. SPATIALISATION DES ENJEUX IDENTIFIÉS PAR LE PADD ............................. 5 A. ENJEUX URBAINS & ÉCONOMIQUES ............................................................................ 7 1. LE CONTEXTE DE L’URBANISATION .................................................................................... 8 2. LES ENJEUX URBAINS ..................................................................................................... 8 3. L’ARMATURE URBAINE ................................................................................................. 10 4. LES SECTEURS D’ENJEUX RÉGIONAUX (SER) .................................................................... 13 B. ENJEUX AGRICOLES ET FORESTIERS ........................................................................... 63 1. LES POTENTIELS AGRICOLES ET SYLVICOLES ....................................................................... 64 2. LES PRESSIONS ........................................................................................................... 65 3. LES ENJEUX ET LES ESPACES STRATÉGIQUES AGRICOLES ....................................................... 66 C. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ................................................................................ -

Mois De Mars 2007 TOME 1 SOMMAIRE
PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Mois de Mars 2007 TOME 1 SOMMAIRE PAGES CABINET 3 - Arrêté N° 07-0288 du 02 mars 2007 relatif à la modification de la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialistes en 4 secours subaquatiques……………………………………………………………... DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DE LA 6 REGLEMENTATION ET DE L’ACCUEIL - Arrêté N° 07-0282 du 1er mars 2007 portantp renouvellement de la composition de 7 la Commission Départementale de l’Action Touristique de la Corse du Sud…….. - Arrêté N° 07-0300 du 7 mars 2007 autorisant la Société Civile Agricole Ferme Marine de Santa Manza à exploiter une pisciculture d’eau de mer, en mer, sur le 15 territoire de la commune de Bonifacio……………………………………………. - Arrêté N° 07-0301 du 8 mars 2007 fixant la composition de la commission 44 départementale de la sécurité routière…………………………………………….. - Arrêté N° 07-0302 du 8 mars 2007 fixant la composition des sections spécialisées 47 de la commission départementale de la sécurité routière…………………………. - Arrêté N° 07 0310 du 9 mars 2007 prorogeant le délai réglementaire d’instruction de la procédure relative à la demande de renouvellement d’autorisation 50 d’exploiter, avec augmentation de la production maximale, une carrière de granit à ciel ouvert sur le territoire de la commune de SARTENE………………………. - Arrêté N° 07-0334 du 15 mars 2007 complémentaire modifiant les prescriptions 52 de l’arrêté préfectoral d’autorisation n°04-2013 du 25 novembre 2004…………... - Arrêté N °07-0354 du 16 -

Sartene Propriano
Territoire du Les Incontournables Sartenais Valinco Taravo Les sites préhistoriques : La Corse compte actuellement plus Légendes de 900 menhirs situés principalement en Corse du Sud et plus particulièrement Édifices classés sur notre territoire. - Filitosa : ce site classé monument his- Site préhistorique torique est l’une des aventures archéolo- giques les plus riches de Corse. Tour Génoise - Cauria : sur ce site se situent l’aligne- Palneca ment I Stantari, l’alignement de Rinaiu Site préhistorique et le dolmen de Funtanaccia. aménagé - Paddaghu est la concentration de 258 Bastelica Point de vue D69 monolithes regroupés en 7 alignements. Ciamannacce construites entre le XVIe et le début du Bains d'eau chaude Les tours génoises : XVIIe siècle pour freiner les incursions barbaresques Sampolo Cozzano Site protégé - La Tour de Campomoro, la plus massive de Corse, entourée Conservatoire Tasso du Littoral d’un rempart en étoile, est ouverte au public d’ Avril à début Territoire D757 du Sartenais Octobre ( entrée 3.50€) Valinco Taravo D69 - La Tour de Roccapina - 8 m de haut Zicavo - partiellement en ruine, surplombe la Plages plage de Roccapina et n’est visible que D757a Sentiers de balades Guitera-les-bains du point de vue, sur la RN 196. schématisés - La tour de Capanella, renovée en 2010. (Consultation d'une carte I.G.N. conseillée) Accès à pied au départ de Porto Pollo. - Les tours de Micalona et de la Calanca Domaines viticoles D83 Corrano sont privées. Office de Tourisme - La tour de Senetosa - 11 m de haut - Zévaco est accessible à pied par le sentier du D27 littoral entre Tizzano et Campomoro, ou par la mer à partir de la Cala di Conca ( 1h de marche). -

Bulletin Juin 06
R M T h o o 1 @ h m en JUIN 06 h t t p : / / 2 a . s n u i p p . f r Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et PEGC, section Corse du Sud Sommaire : • Mouvement principal. • Résultats des différentes CAPD. • Calendrier du mouvement Tous les complémentaire. • Supplément des syndiqués. résultats ROUTAGE 206—Dispensé de tim- brage—AJACCIO Salines 1– du SNUipp 2A Rés. Kennedy 20090 AJACCIO Directeur de la publication: mouvement Dominique PELLEGRIN Rédacteur en chef: Maryse LAFFITE Réunion d’inform ation syndicale: le samedi 10 juin à 9h à l’école élémentaire de SARTENE Page 2 SNU2A info Mouvement principal 2006 Vos délégués présents à la CAPD Vos représentants SNUipp élus à la CAPD vous ont renseignés et aidés pendant le P ELLEGRI N mouvement. D o m i n i qu e Ils ont vérifiés avec vous: barèmes, ancien- P ELLEGRI N I neté et points de bonifications. Gé r a r d Ils ont veillés au bon respect des règles dé- partementales lors de la CAPD du vendredi 2 BEN ETTI juin consacrée au mouvement principal. Fr é d é r i c LA FFI TTE Ma r ys e Nous publions le mouvement à titre définitif présenté à la CAPD du 2 juin. Cette publication tradi- tionnelle du SNUipp permet à tous de consulter l’ensemble des résultats. L’information à tous garantit la transparence des opérations de mutations. Des dizaines de collègues nous ont contacté par courrier, par mail ou par téléphone pour deman- der des informations, signaler une erreur.