Premier Spiritain Camerounais Jean Criaud
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MINMAP Région Du Centre SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX
MINMAP Région du Centre SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX N° Désignation des MO/MOD Nbre de Marchés Montant des Marchés N° page 1 Services déconcentrés Régionaux 19 2 278 252 000 4 Département de la Haute Sanaga 2 Services déconcentrés départementaux 6 291 434 000 7 3 COMMUNE DE BIBEY 2 77 000 000 8 4 COMMUNE DE LEMBE YEZOUM 8 119 000 000 8 5 COMMUNE DE MBANDJOCK 3 50 000 000 10 6 COMMUNE DE MINTA 5 152 500 000 10 7 COMMUNE DE NANGA-EBOKO 12 139 500 000 11 8 COMMUNE DE NKOTENG 5 76 000 000 13 9 COMMUNE DE NSEM 1 27 000 000 13 TOTAL 42 932 434 000 Département de la Lekié 10 Services déconcentrés départementaux 8 268 357 000 14 11 COMMUNE DE BATCHENGA 2 35 000 000 15 12 COMMUNE DE LOBO 8 247 000 000 15 13 COMMUNE DE MONATELE 11 171 500 000 16 14 COMMUNE DE SA'A 16 384 357 000 18 15 COMMUNE D'ELIG-MFOMO 7 125 000 000 20 16 COMMUNE D'EVODOULA 9 166 250 000 21 17 COMMUNE D'OBALA 14 223 500 000 22 18 COMMUNE D'OKOLA 22 752 956 000 24 19 COMMUNE D’EBEBDA 6 93 000 000 27 TOTAL 103 2 466 920 000 Département du Mbam et Inoubou 20 Services déconcentrés départementaux 4 86 000 000 28 21 COMMUNE DE BAFIA 5 75 500 000 28 22 COMMUNE DE BOKITO 12 213 000 000 29 23 COMMUNE DE KIIKI 4 134 000 000 31 24 COMMUNE DE KONYAMBETA 6 155 000 000 32 25 COMMUNE DE DEUK 2 77 000 000 33 26 COMMUNE DE MAKENENE 3 17 000 000 33 27 COMMUNE DE NDIKINIMEKI 4 84 000 000 34 28 COMMUNE D'OMBESSA 5 91 000 000 34 29 COMMUNE DE NITOUKOU 6 83 000 000 35 TOTAL 51 1 015 500 000 MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 1 de 88 N° Désignation -

Ngomedzap Council
République RE =è_ du Cameroun Republic of Cameroon Paix – Travail – Patrie Peace – Work – Fatherland ----------- ----------- Région du Centre Center Region ----------- ----------- Département du Nyong et So’o Nyong and So’o Division ----------- ----------- Commune de Ngomedzap Ngomedzap Council PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE NGOM EDZAP TOME I Réalisé avec l’Appui du PNDP Accompagné par l’Association Camerounaise des Femmes Ingénieurs en Agriculture (ACAFIA) B.P. Tel : 22 66 35 93 Siège Social Yaoundé Juin 2011 1 TABLE DE MATIERES TABLE DE MATIERES ............................................................................................................ 2 LISTE D’ABBREVIATIONS .................................................................................................... 5 LISTE DES TABLEAUX, PHOTOS ET FIGURES ................................................................. 7 RESUME .................................................................................................................................... 8 I. INTRODUCTION ................................................................................................................ 10 1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION ............................................................................... 10 1.2 OBJECTIFS DE LA PLANIFICATION ....................................................................... 10 1.3. STRUCTURE DU DOCUMENT ................................................................................. 11 II. METHODOLOGIE ............................................................................................................ -

Joshua Osih President
Joshua Osih President THE STRENGTH OF OUR DIVERSITY PRESIDENTIAL ELECTION 2018 JOSHUA OSIH | THE STRENGTH OF OUR DIVERSITY | P . 1 MY CONTRACT WITH THE NATION Build a new Cameroon through determination, duty to act and innovation! I decided to run in the presidential election of October 7th to give the youth, who constitute the vast majority of our population, the opportunity to escape the despair that has gripped them for more than three decades now, to finally assume responsibility for the future direction of our highly endowed nation. The time has come for our youth to rise in their numbers in unison and take control of their destiny and stop the I have decided to run in the presidential nation’s descent into the abyss. They election on October 7th. This decision, must and can put Cameroon back on taken after a great deal of thought, the tracks of progress. Thirty-six years arose from several challenges we of selfish rule by an irresponsible have all faced. These crystalized into and corrupt regime have brought an a single resolution: We must redeem otherwise prosperous Cameroonian Cameroon from the abyss of thirty-six nation to its knees. The very basic years of low performance, curb the elements of statecraft have all but negative instinct of conserving power disappeared and the citizenry is at all cost and save the collapsing caught in a maelstrom. As a nation, system from further degradation. I we can no longer afford adequate have therefore been moved to run medical treatment, nor can we provide for in the presidential election of quality education for our children. -

Programmation De La Passation Et De L'exécution Des Marchés Publics
PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS EXERCICE 2021 JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES RÉGION DU CENTRE EXERCICE 2021 SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES N° Désignation des MO/MOD Nbre de Marchés Montant des Marchés N°Page 1 Services déconcentrés Régionaux 17 736 645 000 3 2 Communauté Urbaine de Yaoundé 62 10 459 000 000 5 Département de la Haute Sanaga 3 Services déconcentrés départementaux 2 24 000 000 10 4 Commune de Bibey 12 389 810 000 10 5 Commune de Lembe Yezoum 17 397 610 000 11 6 Commune de Mbandjock 12 214 000 000 12 7 Commune de Minta 8 184 500 000 12 8 Commune de Nanga Ebogo 21 372 860 000 13 9 Commune de Nkoteng 12 281 550 000 14 10 Commune de Nsem 5 158 050 000 15 TOTAL 89 2 022 380 000 Département de la Lekié 11 Services déconcentrés départementaux 9 427 000 000 16 12 Commune de Batchenga 8 194 000 000 17 13 Commune d'Ebebda 10 218 150 000 18 14 Commune d'Elig-Mfomo 8 174 000 000 19 15 Commune d'Evodoula 10 242 531 952 20 16 Commune de Lobo 11 512 809 000 21 17 Commune de Monatélé 12 288 500 000 22 18 commune d'Obala 11 147 000 000 23 19 commune d'Okola 14 363 657 000 24 20 commune de Sa'a 17 319 500 000 25 TOTAL 110 2 887 147 952 Département du Mbam et Inoubou 21 Services déconcentrés départementaux 6 144 385 000 27 22 Commune Bafia 13 213 500 000 27 23 Commune de Bokito 9 167 500 000 28 24 Commune de DEUK 17 379 500 000 29 25 Commune Kiiki 10 285 000 000 30 26 Commune Konyambeta 12 295 -

Land Use and Land Cover Changes in the Centre Region of Cameroon
Preprints (www.preprints.org) | NOT PEER-REVIEWED | Posted: 18 February 2020 Land Use and Land Cover changes in the Centre Region of Cameroon Tchindjang Mesmin; Saha Frédéric, Voundi Eric, Mbevo Fendoung Philippes, Ngo Makak Rose, Issan Ismaël and Tchoumbou Frédéric Sédric * Correspondence: Tchindjang Mesmin, Lecturer, University of Yaoundé 1 and scientific Coordinator of Global Mapping and Environmental Monitoring [email protected] Saha Frédéric, PhD student of the University of Yaoundé 1 and project manager of Global Mapping and Environmental Monitoring [email protected] Voundi Eric, PhD student of the University of Yaoundé 1 and technical manager of Global Mapping and Environmental Monitoring [email protected] Mbevo Fendoung Philippes PhD student of the University of Yaoundé 1 and internship at University of Liège Belgium; [email protected] Ngo Makak Rose, MSC, GIS and remote sensing specialist at Global Mapping and Environmental Monitoring; [email protected] Issan Ismaël, MSC and GIS specialist, [email protected] Tchoumbou Kemeni Frédéric Sédric MSC, database specialist, [email protected] Abstract: Cameroon territory is experiencing significant land use and land cover (LULC) changes since its independence in 1960. But the main relevant impacts are recorded since 1990 due to intensification of agricultural activities and urbanization. LULC effects and dynamics vary from one region to another according to the type of vegetation cover and activities. Using remote sensing, GIS and subsidiary data, this paper attempted to model the land use and land cover (LULC) change in the Centre Region of Cameroon that host Yaoundé metropolis. The rapid expansion of the city of Yaoundé drives to the land conversion with farmland intensification and forest depletion accelerating the rate at which land use and land cover (LULC) transformations take place. -
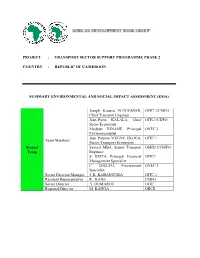
Project : Transport Sector Support Programme Phase 2
PROJECT : TRANSPORT SECTOR SUPPORT PROGRAMME PHASE 2 COUNTRY : REPUBLIC OF CAMEROON SUMMARY ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) Joseph Kouassi N’GUESSAN, OITC.1/CMFO Chief Transport Engineer Jean-Pierre KALALA, Chief OITC1/CDFO Socio-Economist Modeste KINANE, Principal ONEC.3 Environmentalist Jean Paterne MEGNE EKOGA, OITC.1 Team Members Senior Transport Economist Project Samuel MBA, Senior Transport OSHD.2/CMFO Team Engineer S. KEITA, Principal Financial OITC1 Management Specialist C. DJEUFO, Procurement ONEC.3 Specialist Sector Division Manager J. K. KABANGUKA OITC.1 Resident Representative R. KANE CMFO Sector Director A. OUMAROU OITC Regional Director M. KANGA ORCE SUMMARY ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) Programme Name : Transport Sector Support Programme Phase 2 SAP Code: P-CM-DB0-015 Country : Cameroon Department : OITC Division : OITC-1 1. INTRODUCTION This document is a summary of the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) of the Transport Sector Support Programme Phase 2 which involves the execution of works on the Yaounde-Bafoussam-Bamenda road. The impact assessment of the project was conducted in 2012. This assessment seeks to harmonize and update the previous one conducted in 2012. According to national regulations, the Yaounde-Bafoussam-Babadjou road section rehabilitation project is one of the activities that require the conduct of a full environmental and social impact assessment. This project has been classified under Environmental Category 1 in accordance with the African Development Bank’s Integrated Safeguards System (ISS) of July 2014. This summary has been prepared in accordance with AfDB’s environmental and social impact assessment guidelines and procedures for Category 1 projects. -

Proceedingsnord of the GENERAL CONFERENCE of LOCAL COUNCILS
REPUBLIC OF CAMEROON REPUBLIQUE DU CAMEROUN Peace - Work - Fatherland Paix - Travail - Patrie ------------------------- ------------------------- MINISTRY OF DECENTRALIZATION MINISTERE DE LA DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL Extrême PROCEEDINGSNord OF THE GENERAL CONFERENCE OF LOCAL COUNCILS Nord Theme: Deepening Decentralization: A New Face for Local Councils in Cameroon Adamaoua Nord-Ouest Yaounde Conference Centre, 6 and 7 February 2019 Sud- Ouest Ouest Centre Littoral Est Sud Published in July 2019 For any information on the General Conference on Local Councils - 2019 edition - or to obtain copies of this publication, please contact: Ministry of Decentralization and Local Development (MINDDEVEL) Website: www.minddevel.gov.cm Facebook: Ministère-de-la-Décentralisation-et-du-Développement-Local Twitter: @minddevelcamer.1 Reviewed by: MINDDEVEL/PRADEC-GIZ These proceedings have been published with the assistance of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) through the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in the framework of the Support programme for municipal development (PROMUD). GIZ does not necessarily share the opinions expressed in this publication. The Ministry of Decentralisation and Local Development (MINDDEVEL) is fully responsible for this content. Contents Contents Foreword ..............................................................................................................................................................................5 -
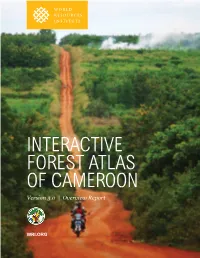
INTERACTIVE FOREST ATLAS of CAMEROON Version 3.0 | Overview Report
INTERACTIVE FOREST ATLAS OF CAMEROON Version 3.0 | Overview Report WRI.ORG Interactive Forest Atlas of Cameroon - Version 3.0 a Design and layout by: Nick Price [email protected] Edited by: Alex Martin TABLE OF CONTENTS 3 Foreword 4 About This Publication 5 Abbreviations and Acronyms 7 Major Findings 9 What’s New In Atlas Version 3.0? 11 The National Forest Estate in 2011 12 Land Use Allocation Evolution 20 Production Forests 22 Other Production Forests 32 Protected Areas 32 Land Use Allocation versus Land Cover 33 Road Network 35 Land Use Outside of the National Forest Estate 36 Mining Concessions 37 Industrial Agriculture Plantations 41 Perspectives 42 Emerging Themes 44 Appendixes 59 Endnotes 60 References 2 WRI.org F OREWORD The forests of Cameroon are a resource of local, Ten years after WRI, the Ministry of Forestry and regional, and global significance. Their productive Wildlife (MINFOF), and a network of civil society ecosystems provide services and sustenance either organizations began work on the Interactive Forest directly or indirectly to millions of people. Interac- Atlas of Cameroon, there has been measureable tions between these forests and the atmosphere change on the ground. One of the more prominent help stabilize climate patterns both within the developments is that previously inaccessible forest Congo Basin and worldwide. Extraction of both information can now be readily accessed. This has timber and non-timber forest products contributes facilitated greater coordination and accountability significantly to the national and local economy. among forest sector actors. In terms of land use Managed sustainably, Cameroon’s forests consti- allocation, there have been significant increases tute a renewable reservoir of wealth and resilience. -

Cameroon's Forest Investment Plan
Cameroon's Forest Investment Plan FOREST INVESTMENT PLAN (CAMEROON) MINISTRY OF Lead MDB Support MDB ENVIRONMENT, PROTECTION OF NATURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT FINAL REPORT 11 November 2017 1 Cameroon's Forest Investment Plan TABLE OF CONTENTS LIST OF TABLES.................................................................................................................................4 LIST OF ABBREVIATIONS ...............................................................................................................5 1. NATIONAL CONTEXT AND THE FOREST SECTOR........................................................20 1.1. Country Profile....................................................................................................................20 1.1.1. Geography and Climate...............................................................................................20 1.1.2. Agro-Ecological zones..................................................................................................20 1.1.3. Population.....................................................................................................................23 1.1.4. National Economy........................................................................................................24 1.2. The forest Sector .................................................................................................................25 1.2.1. The forest sector economic and political context ......................................................26 1.2.2. Key Drivers of -

Est Centre Sud Littoral Ouest Est
Bazou IBRD 32132 5˚ 5˚ NDE NOUN 11˚ 12˚ 13˚ CAMEROON Tonga Nkongsamba OUEST PETROLEUMHAUT- DEVELOPMENT Bélabo AND PIPELINE PROJECT NKAM Nkongjok LOM-ET- Nginda Sanaga Towns and Villages Mentioned in Request Bafia DJEREM Ndikiniméki Mougué Rivers Mentioned in Request Pipeline Route Nanga Eboko Bakola Territory Nginda Ombessa MBAM Bakola Camps (1983 study, LOUNG, 1996) Ngamba Minta Bokito Rivers Wouri Yingui HAUTE-SANAGA YabassiMajor Rivers Nkoteng Paved Roads Ntuj All-Weather Roads Mbandjok Dim NKAM Ndom Nguélémendouka Unsurfaced Roads Saa Tracks/Trails Doume Railroads LITTORAL Monatélé Selected Towns/Villages Ngambé Department Capitals Obala Province Capital Nkon Ngok CENTRE National Capital LEKIE Essé Evodoula Abong Department Boundaries Sanaga Okola Mbang 4˚ 4˚ Province Boundaries Bot Makak Ngog Mapubi MEFOU Awaé NYONG-ET MFOUMOU Ayos 10˚ EST Pouma YAOUNDÉ Edéa Matomb Mbankomo Akonolinga Dzeng HAUT-NYONG SANAGA-MARITIME NYONG-ET-KELLE Mfou Messaména Messondo MFOUNDI Eséka Bikok Ngoumou Makak Nkongzok 1 Akono Mbalmayo Nyong Endom 10° 12° Lake 16° Elogbatindi Bengbis Chad ° 12 12° Nkoala'a CHAD CHAD Mvengué CAMEROON NYONG-ET-SO 10° 10° Ngovayang 2 Ngomedzap Bakola or Saballi Zoétélé Fifinda Bagyeli Bili-bi- Tchop Lolodorf Mbikiliki 8° 8° Bidjouka NIGERIA Lokoundjé Mougué Bikoui Gulf of Kouambo DJA-ET-LOBO CAMEROON Guinea Bandevouri Bipindi Ngoulemakong CENTRAL 6° Makouré 1 AFRICAN Dja 3˚ REPUBLIC 3˚ Kour Loundabele Tchangué Kribi Mintoum Sangmélima Area of Map Nkaga Zalé Ebolowa 4° 4° This map was produced by the YAOUNDE Mpango 0204060 80 100 Map Design Unit of The World Bank. OCEAN SUD The boundaries, colors, denominations Ebomé Kienké and any other information shown on this map do not imply, on the part of ATLANTIC For Detail, see Pembo River/swamp KILOMETERS The World Bank Group, any judgment OCEAN 10˚ Akom II 11˚ 12˚ on the legal status of any territory, or 13˚ IBRD 32148 any endorsement or acceptance of 2° NTEM such boundaries. -

CAC Au Niveau Communal Exercice 2003
REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie Source: FEICOM Yaoundé; le 05/09/2008 CAC au Niveau Communal Exercice 2003 - 2007 en francs CFA Commune 2003 2004 2005 2006 2007 Total BABESSI 71111420 73201803 52839330 78037678 82768880 357959111 BAFANG 61760230 63575727 45890930 67482231 71884728 310593846 BANKIM 0 0 0 0 0 0 BIBEY 6765501 6964379 5027105 7248353 7874585 33879923 BOKITO 64559463 66457245 47970899 70858006 75142845 324988458 DEUK 16553708 17040319 12300230 18042230 19267397 83203884 DOUALA 1240829221 1639118161 1438080202 2305592049 2523691305 9147310938 DOUALA 5 EME 0 0 0 0 0 0 DOUALA 3 EME 0 0 0 0 0 0 DOUALA 4 EME 0 0 0 0 0 0 ELIG-MFOMO 39728901 40896766 29520554 43767102 46241750 200155073 LEMBE 12415282 12780239 9225172 13585920 14450547 62457160 MBANDJOCK 27406319 67851363 59934264 95904105 130162475 381258526 MFOU 47912880 49599257 35802281 53029037 56081610 242425065 MINTA 16386455 16868211 12175998 17993653 19072796 82497113 NIETE 28141305 108247365 62400084 97220744 131017946 427027444 NKOLMETET 33107416 34080639 24600462 36472585 38534791 166795893 SANGMELIMA 38505581 39637486 28611567 41952802 53638511 202345947 TIBATI 77079032 79344838 57273564 84570425 89714776 387982635 YAOUNDE 755180462 1022432633 897031197 1429940622 1569420934 5674005848 YAOUNDE 1 ER 0 0 0 0 0 0 YAOUNDE 4 EME 0 0 0 0 0 0 YAOUNDE 7 EME 0 0 0 0 0 0 ABONG-MBANG 41384271 42600798 30750577 44977207 48168490 207881343 AFANLOUM 4068902 4188500 3023397 4482480 4735926 20499205 AKO 57010971 58686860 42361995 62612861 66356912 287029599 AKOEMAN 14898338 -

Aspects of Poverty and Inequality in Cameroon
GÖTTINGER STUDIEN ZUR ENTWICKLUNGSÖKONOMIK / GÖTTINGEN STUDIES IN DEVELOPMENT ECONOMICS Wokia-azi Ndangle Kumase Aspects of Poverty and Inequality in Cameroon Wokia-azi Ndangle Kumase - 978-3-631-75351-4 Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 06:02:02AM via free access GÖTTINGER STUDIEN ZUR ENTWICKLUNGSÖKONOMIK / GÖTTINGEN STUDIES IN DEVELOPMENT ECONOMICS Wokia-azi Ndangle Kumase Aspects of Poverty and Inequality in Cameroon Poverty and inequality remain extremely high for Cameroon despite improvements in poverty figures between 1996 and 2001. To understand the dynamics of poverty and inequality between 1996 and 2001, this book develops a poverty and inequality profile, investigates the sources of inequality along spatial lines and simulates some policies which could be used in the reduction of poverty and inequality. The book also addresses two major sectors of the Cameroonian economy with a special focus on gender bias in agriculture and linkages between the formal and informal sector. The empirical analyses show that there are large spatial differences in poverty in Cameroon and that sources of inequality vary by location. Regardless of the definition used, the informal sector in Cameroon is extremely large but closely linked to the formal sector. The gender bias experienced by women in access to productive assets in agriculture reduces the efficiency of agricultural production. Wokia-azi Ndangle Kumase was born in Cameroon and graduated from the University of Buea in Cameroon with a Bsc. in banking and finance. He obtained a Masters degree in international economics and a PhD in development economics from the University of Göttingen. The author worked as a research assistant at the chair for development economics and consultant for the GTZ.