Kourou, Saint-Laurent, Sinnamary
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ariane-5 Completes Flawless Third Test Flight
r bulletin 96 — november 1998 Ariane-5 Completes Flawless Third Test Flight A launch-readiness review conducted on Friday engine shut down and Maqsat-3 was 16 and Monday 19 October had given the go- successfully injected into GTO. The orbital ahead for the final countdown for a launch just parameters at that point were: two days later within a 90-minute launch Perigee: 1027 km, compared with the window between 13:00 to 14:30 Kourou time. 1028 ± 3 km predicted The launcher’s roll-out from the Final Assembly Apogee: 35 863 km, compared with the Building to the Launch Zone was therefore 35 898 ± 200 km predicted scheduled for Tuesday 20 October at 09:30 Inclination: 6.999 deg, compared with the Kourou time. 6.998 ± 0.05 deg predicted. On 21 October, Europe reconfirmed its lead in providing space Speaking in Kourou immediately after the flight, transportation systems for the 21st Century. Ariane-5, on its third Fredrik Engström, ESA’s Director of Launchers qualification flight, left no doubts as to its ability to deliver payloads and the Ariane-503 Flight Director, confirmed reliably and accurately to Geostationary Transfer Orbit (GTO). The new that: “The third Ariane-5 flight has been a heavy-lift launcher lifted off in glorious sunshine from the Guiana complete success. It qualifies Europe’s new Space Centre, Europe’s spaceport in Kourou, French Guiana, at heavy-lift launcher and vindicates the 13:37:21 local time (16:37:21 UT). technological options chosen by the European Space Agency.” This third Ariane-5 test flight was intended ESA’s Director -

Annual Report 2018
RAPPORT D'ACTIVITÉ ANNUAL REPORT 2018 Mission InSight-SEIS La France sur Mars InSight-SEIS mission France on Mars 4 ÉDITORIAL FOREWORD Avec ses coopérations sur tous les continents, le CNES est une référence incontournable 2018 a été Nous sommes aussi partis vers la steppe du Kazakhstan, au retour sur particulièrement Mercure avec le lancement de la sonde Terre de Thomas Pesquet, il avait eu BepiColombo le 26 octobre, sans oublier l’intuition de ce projet. réussie pour le CNES que le 3 octobre, l’atterrisseur Mascot Nous avons donc immédiatement s’était posé sur l’astéroïde Ryugu. avec des succès partagé cette idée avec nos Côté observation, nous avons bien partenaires du monde entier et le SCO majeurs : lancement terminé l’année avec le lancement des satellites CFOSat, de MetOp-C et auparavant, nous a été lancé par Frédérique Vidal, le MetOp-C, CSO-1 avions lancé avec la Chine, CFOSat 11 décembre 2017 lors de la première pour l’étude du vent et des vagues. édition du One Planet Summit et et de la sonde présenté à de nombreux Chefs d’État interplanétaire En matière de télécommunications, à New-York, le 26 septembre 2018. BepiColombo, l’année a aussi été intense avec le La signature de l’acte fondateur du succès planétaire de la constellation SCO sera l’un des temps forts de 2019 naissance du SCO Galileo et avec la décision de et rappellera que les satellites sont (le Space Climate développer le satellite Konnect pour incontournables dans la lutte contre Observatory), création que la totalité des habitants de le changement climatique. -

ARIANE 5 Data Relating to Flight 225
KOUROU August 2015 ARIANE 5 Data relating to Flight 225 EUTELSAT 8 West B Intelsat 34 Data relating to Flight 225 Flight 225 Ariane 5 Satellites: EUTELSAT 8 WEST B – INTELSAT 34 Content 1. Introduction .................................................................... 3 2. Launcher L579 ............................................................... 4 3. Mission V225 ............................................................... 10 4. Payloads ...................................................................... 19 5. Launch campaign ........................................................ 32 6. Launch window ............................................................ 35 7. Final countdown .......................................................... 36 8. Flight sequence ........................................................... 40 9. Airbus Defence and Space and the ARIANE programmes ........................................................................ 42 2 Data relating to Flight 225 1. Introduction Flight 225 is the 81st Ariane 5 launch and the fourth in 2015. It follows on from a series of 66 consecutive successful Ariane 5 launches. This is the 51st ARIANE 5 ECA (Cryogenic Evolution type A), the most powerful version in the ARIANE 5 range. Flight 225 is a commercial mission for Ariane 5. The L579 launcher is the twenty-fifth to be delivered by Airbus Defence and Space to Arianespace as part of the PB production batch. The PB production contract was signed in March 2009 to guarantee continuity of the launch service after completion -
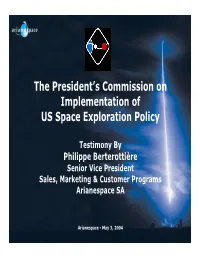
The President's Commission on Implementation of US Space Exploration Policy
The President’s Commission on Implementation of US Space Exploration Policy Testimony By Philippe Berterottière Senior Vice President Sales, Marketing & Customer Programs Arianespace SA Arianespace - May 3, 2004 Who We Are • Founded in 1980 • The world’s 1st commercial launch services provider • Signed over 250 contracts • Launched majority of commercial satellites in orbit • >50% of our business is with US manufacturers/operators • Privately held European company with 44 Shareholders from 13 European nations • Arianespace is the prime contractor to ESA for marketing, sales, integration and launch of Europe’s family of vehicles Arianespace - May 3, 2004 2 Family of Launch Vehicles • Serves European launch policy to optimize resources and address all market segments • A contract with ESA provides Arianespace with the rights to operate Europe’s family of launch vehicles • Arianespace operates 3 systems from French Guiana The heavy-lift Ariane 5 (operational) The medium-lift Soyuz ST (from 2006) The light-lift Vega (from 2006) • Arianespace is currently involved in Soyuz operations from Baikonur through our sister company Starsem Arianespace - May 3, 2004 3 Ariane 5 Current Configurations & Capabilities LEO GTO Moon (mt) (mt) (mt) Ariane 5 Generic 6.8 Ariane 5 ECA 10 7.5 Ariane 5 ES/V 21 ARIANE 5 Configuration Under Evaluation Ariane 5 ECB 23 12 9 With the two solid propellant boosters and the central core of Ariane 5, there is a tool kit to build a super-heavy vehicle, should the need arise Arianespace - May 3, 2004 Facilities • We launch -

Monitoring of Nesting Leatherback Turtles
142 CHELONIAN CONSERVATION AND BIOLOGY, Volume 6, Number 1 — 2007 Among the significant leatherback turtle nesting Chelonian Conservation and Biology, 2007, 6(1): 142–147 rookeries, the one within Suriname and French Guiana Ó 2007 Chelonian Research Foundation has long been considered as one of the largest in the world (Pritchard 1973). This species main nesting season (April– Monitoring of Nesting Leatherback Turtles August) has been monitored in French Guiana for more (Dermochelys coriacea): Contribution of than 3 decades (Fretey and Lescure 1998). Since the first Remote Sensing for Real-Time Assessment of monitoring efforts, the high coastal dynamic has repre- Beach Coverage in French Guiana sented a source of difficulties. The entire coastline of the Guianas’ shelf, from the 1 2 Amapa` (Brazil) to the Orinoco (Venezuela), is character- LAURENT KELLE ,NICOLAS GRATIOT , ized by alternate phases of erosion and accretion (Fig. 1), 3 4 ISABELLE NOLIBOS ,JOCELYN THE´ RE` SE , with mudbanks that migrate at a mean annual rate of about 5 RONALD WONGSOPAWIRO , AND 1–3 km/y (Augustinus 1978; Gardel and Gratiot 2005). 6 These mudbanks significantly modify the beach profiles at BENOIˆTDETHOISY pluri-annual timescales (Anthony and Dolique 2004), with severe consequences on marine turtles nesting possibilities 1WWF Guianas, 5 lot Katoury, 97300 Cayenne, French Guiana [[email protected]]; (Reichart and Fretey 1993; Hilterman et al. in press). In 2Laboratoire d’e´tude des Transferts en Hydrologie et addition, the high number of nesting females each night Environnement, BP 53, 38041 Grenoble Cedex 9, France and the logistical difficulties to monitor some remote [[email protected]]; nesting sites make the leatherback turtle census challeng- 3 Se´panguy Kourou, Rue des Palikas, BP 1, 97371 Kourou, ing in French Guiana. -

Quarterly Launch Report
Commercial Space Transportation QUARTERLY LAUNCH REPORT Featuring the launch results from the previous quarter and forecasts for the next two quarters. 4th Quarter 1996 U n i t e d S t a t e s D e p a r t m e n t o f T r a n s p o r t a t i o n • F e d e r a l A v i a t i o n A d m i n i s t r a t i o n A s s o c i a t e A d m i n i s t r a t o r f o r C o m m e r c i a l S p a c e T r a n s p o r t a t i o n QUARTERLY LAUNCH REPORT 1 4TH QUARTER REPORT Objectives This report summarizes recent and scheduled worldwide commercial, civil, and military orbital space launch events. Scheduled launches listed in this report are vehicle/payload combinations that have been identified in open sources, including industry references, company manifests, periodicals, and government documents. Note that such dates are subject to change. This report highlights commercial launch activities, classifying commercial launches as one or more of the following: • Internationally competed launch events (i.e., launch opportunities considered available in principle to competitors in the international launch services market), • Any launches licensed by the Office of the Associate Administrator for Commercial Space Transportation of the Federal Aviation Administration under U.S. -

Third Vega Launch from the Guiana Space Center
THIRD VEGA LAUNCH FROM THE GUIANA SPACE CENTER On the third Vega launch from the Guiana Space Center (CSG) in French Guiana, Arianespace will orbit Kazakhstan’s first Earth observation satellite, DZZ-HR. With Soyuz, Ariane 5 and now Vega all operating at the Guiana Space Center, Arianespace is the only launch services provider in the world capable of launching all types of payloads to all orbits, from the smallest to the largest geostationary satellites, along with clusters of satellites for constellations and missions to support the International Space Station (ISS). Vega is designed to launch payloads in the 1,500 kg class to an altitude of 700 km, giving Europe a launcher that can handle all of its scientific and government missions along with commercial payloads. Designed to launch small satellites into low Earth orbit (LEO) or Sun-synchronous orbit (SSO), Vega will quickly establish itself as the best launcher in its class, especially in the emerging market for Earth observation satellites. Vega is a European Space Agency (ESA) program financed by Italy, France, Germany, Spain, Belgium, the Netherlands, Switzerland and Sweden. The Italian company ELV, a joint venture of Avio (70%) and the Italian space agency (30%), is the launcher design authority and prime contractor, while Arianespace handles launch operations. For its third launch, Vega will orbit the DZZ-HR Earth observation satellite, the 51st of this type to be launched by Arianespace. DZZ-HR is an 830 kg satellite that is designed to provide a complete range of civilian applications for the Republic of Kazakhstan, including monitoring of natural and agricultural resources, provision of mapping data and suport for rescue operations during natural disasters. -

APSCC Monthly E-Newsletter
APSCC Monthly e‐Newsletter February 2018 The Asia‐Pacific Satellite Communications Council (APSCC) e‐Newsletter is produced on a monthly basis as part of APSCC’s information services for members and professionals in the satellite industry. Subscribe to the APSCC monthly newsletter and be updated with the latest satellite industry news as well as APSCC activities! To renew your subscription, please visit www.apscc.or.kr/sub4_5.asp. To unsubscribe, send an email to [email protected] with a title “Unsubscribe.” News in this issue has been collected from January 1 to January 31. INSIDE APSCC APSCC 2018 Satellite Conference & Exhibition, 2‐4 October, Jakarta, Indonesia The APSCC Satellite Conference and Exhibition is Asia’s must‐attend executive conference for the satellite and space industry, where business leaders come together to gain market insight, strike partnerships and conclude business deals. The APSCC 2018 Satellite Conference & Exhibition will incorporate industry veterans and new players into the program to reach out to a broader audience. Mark your calendar for the APSCC 2018 and expand your business network while hearing from a broad range of thought provoking panels and speakers representing visionary ideas and years of business experience in the industry. Contact [email protected] for general inquiries to the APSCC 2018. APSCC Supports Community Connect Initiative APSCC supports a new initiative (click here for full Community Connect Paper) aimed at facilitating global broadband with satellite’s role highlighted. The goals of -

Vega: the European Small-Launcher Programme
r bulletin 109 — february 2002 Vega: The European Small-Launcher Programme R. Barbera & S. Bianchi Vega Department, ESA Directorate of Launchers, ESRIN, Frascati, Italy Background The programme was adopted by ESA in June The origins of the Vega Programme go back to 1998, but the funding was limited to a Step 1, the early 1990s, when studies were performed with the aim of getting the full approval by the in several European countries to investigate the European Ministers meeting in Brussels in May possibility of complementing, in the lower 1999. This milestone was not met, however, payload class, the performance range offered because it was not possible to obtain a wide by the Ariane family of launchers. The Italian consensus from ESA’s Member States for Space Agency (ASI) and Italian industry, in participation in the programme. This gave rise to particular, were very active in developing a period of political uncertainty and to a series concepts and starting pre-development work of negotiations aimed at finding an agreeable based on established knowhow in solid compromise. It is important, on the other hand, propulsion. When the various configuration to record that during the same period the options began to converge and the technical technical definition work continued without feasibility was confirmed, the investigations major disruption, and development tests on the were extended to include a more detailed Zefiro motor were successfully conducted. definition in terms of a market analysis and related cost targets. The subsequent extension of the duration of Step 1 provided the opportunity to revisit and By the end of 2001, the development programme for Europe’s new update the market analysis, based on the small Vega launcher was well underway. -

Quarterly Launch Report
Commercial Space Transportation QUARTERLY LAUNCH REPORT Featuring the launch results from the previous quarter and forecasts for the next two quarters 1st Quarter 1998 U n i t e d S t a t e s D e p a r t m e n t o f T r a n s p o r t a t i o n • F e d e r a l A v i a t i o n A d m i n i s t r a t i o n A s s o c i a t e A d m i n i s t r a t o r f o r C o m m e r c i a l S p a c e T r a n s p o r t a t i o n QUARTERLY LAUNCH REPORT 1 1ST QUARTER 1998 REPORT Objectives This report summarizes recent and scheduled worldwide commercial, civil, and military orbital space launch events. Scheduled launches listed in this report are vehicle/payload combinations that have been identified in open sources, including industry references, company manifests, periodicals, and government documents. Note that such dates are subject to change. This report highlights commercial launch activities, classifying commercial launches as one or more of the following: • Internationally competed launch events (i.e., launch opportunities considered available in principle to competitors in the international launch services market), • Any launches licensed by the Office of the Associate Administrator for Commercial Space Transportation of the Federal Aviation Administration under U.S. -

Kourou Media Guide PDF / 419 KB
Kourou Media Guide Introduction Journalists visiting the Spaceport will be provided the support of Arianespace whenever possible. Modern press room facilities have been developed at the Spaceport's technical center, where reporters will be able to file stories and conduct interviews before and after launches. Accreditation Guiana Space Center press accreditation, valid for one year, will be issued by the Guiana Space Center (CSG), following submission by the press offices of the European Space Agency (ESA), the French space agency CNES, or Arianespace, whether for a launch or otherwise. Journalists All accreditation requests from journalists, photographers or other media technicians must be made in the following manner: • Fill out a single copy of the downloadable press registration form (available online here: http://www.arianespace.com/press/kourou-media-guide). • Include a photocopy of your press card, or failing that, a letter of accreditation from your editor-in-chief. • The form plus attached document is to be faxed, and then mailed, to the press office of the host organization, which will then send the documents to the CNES/CSG Information Department ([email protected]). • For press card holders who are nationals of the European Union and/or member countries of ESA, the form plus attached document must reach the CNES/CSG Information Department at least five working days prior to the arrival of the journalist. • For other nationals and non-press card holders, the form plus attached document must reach the CNES/CSG Information Department at least two weeks prior to your arrival. • You also need to include a recent passport-sized photograph. -

A Launch for Science
A launch for science For its second launch of the year, Arianespace will orbit two scientific satellites for the European Space Agency: the Herschel space telescope and the Planck scientific observatory. The two satellites are being launched towards the Lagrange Point (L2), once again demonstrating the operational capabilities of Ariane 5. This is the only launch vehicle on the commercial market today capable of launching two payloads simultaneously, and handling a complete array of missions, from commercial launches into geostationary orbit, to scientific missions into special orbits. ESA's selection of Ariane 5 also confirms Arianespace's position as the benchmark provider of launch Service & Solutions, guaranteeing independent access to space for everybody in the space industry, including national and international agencies, private and government operators. Herschel space telescope: A follow-on to the ISO (Infrared Space Observatory) program, the Herschel space telescope has two main objectives: observation of the “cold” Universe, in particular the formation of stars and galaxies; and studying the chemical composition of celestial bodies and the molecular chemistry of the Universe. Herschel's mirror, at 3.5 meters in diameter, will be the largest ever deployed in space. The spacecraft will weigh about 3,400 kg at launch. Planck scientific satellite: The Planck scientific observatory is designed to analyze the remnants of the radiation that filled the Universe immediately after the Big Bang, which we observe today as the cosmic microwave background. Planck will provide vital information concerning the creation of the Universe and the origins of the cosmic structure. It will weigh 1,920 kg at launch.