Notice Biographique Sur L'abbé A. Angot
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Saint Loup Du Dorat Rondes Et Rectangulaires, Commodes, Lits, Horloges, 06.03.66.92.59 Tables De Nuit Et De Toilette, Malles
ULLETIN B MUNICIPAL DE LA VILLE 2018 Saint Loup du Dorat www.saintloupdudorat.fr P a g e | 2 Antiquités - Brocante Sylvie GILLET Monsieur LARDEUX Coiffeuse à domicile ACHÈTE A DOMICILE. Contact au 06.73.25.06.07 Les Allais Tous meubles anciens : buffets, armoires, tables 53290 Saint Loup du Dorat rondes et rectangulaires, commodes, lits, horloges, 06.03.66.92.59 tables de nuit et de toilette, malles. DÉBARRAS CAVES, GRENIERS ET MAISONS APRÈS SUCCESSION OU DÉMÉNAGEMENT Paiement comptant - discrétion assurée Jérôme LAMBERT Entreprise de maçonnerie Les Angevinières 53290 Saint Loup du Dorat Tél. : 06.17.62.44.01 AGRIDUO Au service des éleveurs agriculteurs AGRIDUO vous propose des produits pour vos animaux et vos cultures. Groupe AGRI-NEGOCE AGRIDUO - Rue des Chênes 53290 Saint Loup du Dorat CAP’PAYSAGE Tél : 02.43.07.54.14 Entreprise de conseils et réalisations d’aménagement et d’entretien dans le domaine du paysage. Olivier CLÉMENT Lieu-dit La Foupraie SAINT LOUP DU DORAT 02 53 68 00 60 Les écuries du Loup PONEY CLUB - CENTRE EQUESTRE - PENSIONS - BALLADES Gaëlle BONNAUDET La Bouchardière Eric ESNAULT 53290 Saint Loup du dorat Entreprise de ravalement de façade Tél : 02.43.06.10.51 11, rue Principale Mobile : 06.42.05.90.92 53290 Saint Loup du Dorat Site : http://www.ecuriesduloup.fr 02.43.07.69.58 P a g e | 3 LE ROND-POINT Restaurant ouvrier et routier, de cuisine traditionnelle propose une formule le midi et le soir avec buffet entrées, plat, fromage, dessert, café, 1/4 de vin ou de cidre. -
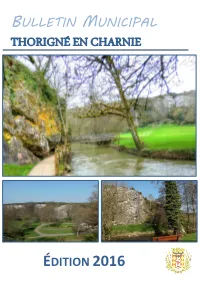
Thorignéencharnie
BULLETIN MUNICIPAL THORIGNÉ EN CHARNIE ÉDITION 2016 Le mot du Maire Nous voilà déjà au crépuscule de cette année 2017. 2016 s’achève avec son lot de bons et moins bons souvenirs. Dans les nouvelles les plus agréables, L’accord des subventions qui nous sont allouées pour la réalisation du projet salle multiculturelle avec adjonction d’une salle dite de cantine ; L’arrivée du haut-débit pour espérer voir les habitants mieux connectés. Dans le domaine des inquiétudes disons, Les réformes de la Loi NOTRe qui engagent des révisions importantes sur le mode de fonctionnement de nos collectivités. Beaucoup de dossiers seront administrés par les Communautés de Communes (ex : compétences urbanisme, eau, assainissement voire mutualisation du personnel). Beaucoup de maire se posent la question : « Quel sera le pouvoir décisionnel de nos conseils municipaux ? » Autres soucis, Notre modèle de RPI pourrait être remis en cause par l’inspection académique en raison de la faiblesse de nos effectifs, nous veillerons à défendre la valeur de l’enseignement à l’intérieur de notre territoire. En 2017, vous allez être sollicité pour choisir le renouvellement de la présidence de la République, suivra l’élection des membres de l’Assemblée Nationale, je vous encourage à participer à ce mouvement démocratique qui vous est offert. L’agriculture a vécu une année difficile. Tout d’abord par un climat peu favorable à la qualité et aux rendements. Les prix des céréales, du lait et de la viande bovine et porcine qui conduisent à des inquiétudes dans nos campagnes. Sommes-nous dans une crise structurelle, nous pouvons craindre une remise en cause du modèle de notre agriculture, faisons confiance à la profession pour s’adapter et ceci dans le respect de chacun. -

Bassins D'alimentation Des Captages Prioritaires Dans Le Département De La Mayenne
Bassins d'alimentation des captages prioritaires dans le département de la Mayenne MANCHE ORNE n. LIGNIERES o! r i La May ORGERES A ' L e RENNES-EN nne FOUGEROLLES GRENOUILLES !. LA PALLU LANDIVY DU-PLESSIS THUBOEUF L SAINT a SAINT NEUILLY F DESERTINES CALAIS-DU u JULIEN-DU SAINTE LE-VENDIN t LE HOUSSEAU COUPTRAIN DESERT a SOUCE TERROUX i MARIE e SAINT-AUBIN BRETIGNOLLES MADRE L SAINT PRE-EN LA DOREE a DU-BOIS VIEUVY FOSSE LESBOIS COUESMES AIGNAN-DE PAIL-SAINT " LOUVAIN V SAINT-MARS VAUCE a COUPTRAIN SAMSON re PONTMAIN SUR-LA n n n CHEVAIGNE CHAMPFREMONT o h FUTAIE e LASSAY-LES SAINT-CYR t SAINT SAINT LEVARE HERCE GORRON DU-MAINE RAVIGNY r . CHATEAUX a ! LE PAS AMBRIERES EN-PAIL S ELLIER-DU BERTHEVIN-LA BOULAY e LES-VALLEES JAVRON-LES L MAINE TANNIERE CHANTRIGNE LES-IFS CHARCHIGNE CHAPELLES COLOMBIERS BRECE CARELLES L SAINT VILLEPAIL MONTAUDIN DU-PLESSIS a SAINT-LOUP LE HORPS C MONTREUIL SAINT-PIERRE o MARS-SUR LA HAIE l DU-GAST ne m COLMONT POULAY 'Ais DES-NIDS " on TRAVERSAINE L LE RIBAY CRENNES-SUR t L SAINT LE HAM FRAUBEE ' LARCHAMP OISSEAU GESVRES Ornette DENIS-DE SAINT CHAMPEON GASTINES FRAIMBAULT L CHATILLON AVERTON ' E DE-PRIERES LOUPFOUGERES VILLAINES r SUR-COLMONT LA PELLERINE n HARDANGES é PARIGNE LA-JUHEL e Le M . MARCILLE erde ! SUR-BRAYE LA CHAPELLE rea ERNEE LA-VILLE u SAINT SAINT MAYENNE AU-RIBOUL SAINT-AUBIN VAUTORTE PIERRE-DES GEORGES ARON DU-DESERT BUTTAVENT ron COURCITE LANDES SAINT L'A SAINT MONTENAY BAUDELLE CHAMPGENETEUX LA BAZOGE GRAZAY MARS-DU MONTPINCON TRANS DESERT PLACE MOULAY CONTEST La Va udelle SAINT GERMAIN-DE -

Carte Des 17 PIAL De La Mayenne
Les 17 PIAL de la Mayenne Lignières- Orgères La Rennes-en- Fougerolles- Thuboeuf Pallu Landivy Grenouilles Neuilly- St-Calais- du-Plessis St-Julien- le-Vendin du-Désert du-Terroux Couptrain Désertines Le Housseau- Soucé Brétignolles Ste-Marie- Madré St-Aubin- La du-Bois St-Aignan- Fosse- Lesbois Pré-en-Pail- Pontmain Dorée Couesmes-Vaucé de-Couptrain Vieuvy Louva St-Samson St-Mars- Chevaigné- sur-la-Futaie Lassay- du-Maine Ravigny Gorron Ambrières- les-Châteaux St-Cyr- Levaré Hercé Le Pas les-Vallées Javron- en-Pail Boulay- St-Berthevin- St-Ellier- Chantrigné les-Chapelles les-Ifs Champfrémont la-Tannière du-Maine Charchigné Colombiers- Villepail Carelles Brecé Le du-Plessis St-Mars- St-Loup- Montaudin Montreuil- Horps Saint-Pierre- sur-Colmont du-Gast Le Poulay Crennes- des-Nids Ribay sur-Fraubée La Haie- Le Ham Gesvres Traversaine Larchamp St-Denis- Oisseau Champéon de-Gastines St-Fraimbault- Averton Châtillon- de-Prières Hardanges sur-Colmont La Pellerine Parigné- VILLAINES-LA- Loupfougères ERNEE sur-Braye Marcillé- la-Ville JUHEL St-Aubin- La Chapelle- St-Georges- Aron au-Riboul du-Désert Vautorte Courcité Saint-Pierre- Buttavent St- MAYENNE des-Landes Champgenéteux Baudelle Montenay Grazay St-Mars-du-Désert Trans La Bazoge- Placé Montpinçon St-Thomas- Contest Moulay de-Courceriers St-Germain- de-Coulamer Hambers Belgeard Bais Juvigné Jublains Chailland Alexain Commer St-Hilaire- St-Martin- La du-Maine St-Germain- de-Connée Bigottière Izé d'Anxure St-Pierre- La Croixille St-Germain- Martigné-sur- Ste-Gemmes- sur-Orthe le-Guillaume -

Portrait Environnement Du Territoire
PORTRAIT ENVIRONNEMENT DU TERRITOIRE Communauté de communes des Coëvrons (53) | 2018 Réalisation : CPIE Mayenne - Bas-Maine Pour l'Union régionale des CPIE des Pays de la Loire Rémi BOUTELOUP - sous la direction de David QUINTON Décembre 2018 Les partenaires et fournisseurs de données Sommaire Géographie administrative du territoire..................................................................................2 Localisation de la Communauté de communes en Pays de la Loire.…................2 Les communes qui composent la Communauté de communes.…......................4 Géographie physique du territoire...........................................................................................6 Le relief et les zones de pente..............................................................................6 Les unités paysagères ligériennes........................................................................8 Milieux naturels......................................................................................................................10 Les cours d'eau...................................................................................................10 Les zones humides.............................................................................................12 Les étangs...........................................................................................................14 Les mares...........................................................................................................16 Les boisements..................................................................................................18 -

Procès Verbal Conseil Du 26 Janvier 2021.Pdf
Procès-Verbal du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez Le mardi 26 janvier 2021 à 18h30 SALLE L’AMPHI - Pôle intercommunal Étaient présents : MAISONCELLES DU MAINE BOURGEAIS Michel Commune Nom Prénom MESLAY DU MAINE BOULAY Christian ARQUENAY BERTREL Jérémy MESLAY DU MAINE FORET Florence BANNES GASNIER Jérôme MESLAY DU MAINE SUREAU Gwénola BAZOUGERS LANDELLE Jérôme MESLAY DU MAINE CAUCHOIS Xavier BAZOUGERS LEVEILLE Emilie MESLAY DU MAINE JARDIN Véronique BAZOUGERS GAHERY Estelle MESLAY DU MAINE POULAIN Jean-Marc BOUERE CHAUVEAU Jacky MESLAY DU MAINE TAUNAIS Maryse BOUERE MAHIEU Céline PREAUX FOUCAULT Roland BOUERE LE GRAET Sylvain RUILLE FROID FONDS HELBERT Marie-Claude CHEMERE LE ROI LANDELLE Jean-Luc SAINT BRICE BOISSEAU André GREZ EN BOUERE BOULAY Didier GREZ EN BOUERE MOTTE Barbara SAINT CHARLES LA FORET ABAFOUR Michel LA BAZOUGE DE CHEMERE LEGEAY Franck SAINT DENIS DU MAINE HAMOND Yannick LA CROPTE LAMBERT Paul SAINT LOUP DU DORAT BREHIN Jean-Claude LE BIGNON DU MAINE BELLAY Jean-Louis VILLIERS CHARLEMAGNE SABIN Jacques LE BURET CATILLON Didier VILLIERS CHARLEMAGNE CORNILLE Alain Secrétaire de séance : Landelle Jérôme Étaient absents excusés : Mesdames et Messieurs : Seurin Eric - Foucher Stéphane - Brault Jacques - Boizard Bernard - Desnoë Stéphane - Lavoué Isabel - Frétigné Cécile Assistaient également à la séance : Jérôme Cribier - DST Vincent Bréhard - Directeur Culturel CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE MESLAY-GREZ – 15 DECEMBRE 2020 Page 1 sur 56 ORDRE DU JOUR 0 – Modification de la composition -

Une Architecture Rurale De La Renaissance En Mayenne ? L’Exemple Du Canton De Sainte-Suzanne
La Mayenne, Archéologie, Histoire, 2011 Publié avec le concours des Archives départementales du Conseil général de la Mayenne Une architecture rurale de la Renaissance en Mayenne ? L’exemple du canton de Sainte-Suzanne par Christian DAVY et Nicolas FOISNEAU Résumé Définir les caractéristiques de l’architecture rurale en Mayenne au 16e siècle se heurte à la simplicité et à la pérennité des formes de la maison paysanne jusqu’au 19e siècle, à l’insuffisance des études et à l’absence des sources. L’inventaire architectural mené dans le secteur de Sainte-Suzanne peut y contribuer, malgré l’important renouvellement du bâti opéré au 19e siècle, grâce aux apports de la dendrochronologie. Il fait apparaître le passage de la construction en bois à la construction en pierre, et l’emploi, dans un large 16e siècle, débordant sur le 15e et le 17e siècle, de deux types de charpentes, l’une présente surtout dans le nord de la zone et l’autre dans le sud. Mots-clés Mayenne - architecture rurale - architecture vernaculaire - ferme - hameau - 16e siècle - construction en bois - construction en pierre - charpente - dendrochronologie Peut-on parler d’une architecture rurale de la Renaissance ? Le terme de rural n’est peut-être pas le plus approprié pour désigner les bâtiments construits pour l’habitation et le travail des populations dispersées dans les fermes et les hameaux à l’époque moderne dans la France de l’Ouest, en particulier dans le Bas-Maine. En effet, la campagne est alors dominée par les seigneurs, qui y bâtissent des manoirs. La majorité du peuple rural est constituée de paysans : parler d’architecture paysanne est sans doute plus approprié. -

Dossier EA Ballée
LIGNE A GRANDE VITESSE BRETAGNE PAYS-DE-LOIRE – Département de LA MAYENNE ETUDE D'AMENAGEMENT FONCIER Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier de : BALLEE, PREAUX, LA CROPTE, CHEMERE-LE-ROI, SAULGES et EPINEUX LE SEGUIN - Economie des exploitations P.36 SOMMAIRE - Protection de l'environnement P.38 - Avenir et souhaits des exploitations impactées par la LGV P.39 - Synthèse générale P.42 1 – PRESENTATION P.04 3.1.3 – ORGANISATION FONCIERE DES EXPLOITATIONS P.42 1.1 - OBJET DE L’ETUDE P.05 - Analyse de la propriété foncière et agricole P.42 - Analyse de l'exploitation agricole P.43 1.2 – OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ETUDE P.06 - Drainage et irrigation P.44 Carte1.1 : Secteur d’étude et communes concernées P.07 3.1.4 – ESPACE FORESTIER P.44 Carte1.2 : Périmètres d'étude P.08 3.2 – PERSPECTIVES D'EVOLUTION DES EXPLOITATIONS P.44 2 – VOLET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE P.09 3.3 – ORGANISATION DE LA DESSERTE P.46 2.1 – SITUATION GEOGRAPHIQUE P.10 3.4 – IMPACTS DE LA LGV ET SYNTHESE DES ENJEUX P.47 2.1.1 – SITUATION PAR RAPPORT AUX AGGLOMERATIONS ENVIRON- 3.4.1 – IMPACT DE L'EMPRISE DE L'INFRASTRUCTURE P.47 NANTES DE PORTEE REGIONALE P.10 - Impact de l'emprise sur les exploitations agricoles P.47 2.1.2 – DESSERTE PAR LES RESEAUX ROUTIERS ET FERROVIERES P.10 - Répartition des surfaces P.47 - Impact sur les exploitations touchées ou divisées P.48 2.2 – INTERCOMMUNALITE P.10 - Parcelles sous emprise présentant les caractéristiques de terrains à bâtir P.50 2.3 – GEOGRAPHIE HUMAINE P.12 3.4.2 – IMPACT SUR LES CONDITIONS D'EXPLOITATIONS P.50 2.3.1 -

Bulletin Communal 2011 2E Semestre N° 2
Ce bulletin pourra être téléchargé par internet. Voir l'adresse du lien sur le site de la Mairie ou sur Facebook (rechercher "Le Ham" Communauté). Pour toutes remarques ou suggestions concernant le Bulletin Municipal, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la Mairie ou par messagerie électronique : [email protected] MAIRIE de LE HAM 5, rue de la grotte, 53 250 Le Ham (Entrée par le parking de la salle communale). Tél.: 02/43/03/97/07 - Fax : 02/43/03/97/23 - Site : www.leham.mairie53.fr Courriels : [email protected] LUNDI 9h - 12h fermée MARDI 9h – 12h (CV) 14h – 17h JEUDI 9h – 12h (CV) fermée VENDREDI 9h - 12h 14h – 16h30 (CV, DR) SAMEDI 9h - 12h (CV, MF, OT) fermée SOMMAIRE Page de Couverture : le Lavoir enfin rénové ! Informations Pratiques / Sommaire P2 Mot du Maire P2 VIE MUNICIPALE …………………………………………………………………………………… P3 (Extraits des séances du Conseil Municipal) VIE COMMUNALE …………………………………………………………………………………… P6 Vœux du Maire/cimetière/randonnée P6 Nouveaux habitants/état civil P7 Budget P8 Hamois à l'honneur P9 Photo-mystère/ALSH P10 Tarifs de la salle socioculturelle P11 VIE QUOTIDIENNE …………………………………………………………………………………… P12 Centre de ressources P12 SPANC P13 Elagage P15 VIE CULTURELLE …………………………………………………………………………………… P17 Point-lecture/ exposition au 1 bis rue du Mont / le coin historique : le maquis de Saint Mars du Désert VIE ASSIOCIATIVE …………………………………………………………………………………… P19 Comité des fêtes P19 Saint Hubert / GDON P21 GVH / club des bruyères P22 SCH P23 Amicale RPI / CUMA P25 Mutuelle d'entraide agricole / gaule ribayenne /AFN et anciens combattants P26 Numéros utiles Troisième de couverture Calendrier des Manifestations Quatrième de couverture 2 Le Mot du Maire En ce début d’année, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2012. -

Village De Saint-Léger
Pays de la Loire, Mayenne Saint-Léger Village de Saint-Léger Références du dossier Numéro de dossier : IA53003067 Date de l'enquête initiale : 2005 Date(s) de rédaction : 2005 Cadre de l'étude : inventaire topographique Degré d'étude : étudié Désignation Dénomination : village Compléments de localisation Milieu d'implantation : en village Références cadastrales : Historique Le village s'est modestement développé au nord et au sud de l'église, mentionnée en 1125 dans le cartulaire d'Evron (Angot), le long de la voie qui menait à Evron et à Sainte-Suzanne (actuelle RD 560 de Saint-Léger à Sainte-Suzanne) et de celle reliant Vaiges à Saint-Christophe-du-Luat (actuelle RD 582 de Saint-Léger à Chammes et VC 301). En 1841, il ne comprenait que 52 habitants soit 10 % de la population de la commune, répartis en 12 logis. Le bourg s'est légèrement agrandi dans la seconde moitié du XIXe siècle à l'est le long de la route de Sainte-Suzanne et au sud entre l'ancienne et la nouvelle route de Vaiges (RD 144 de Vaiges à Jublains). Huit nouveaux logis ont alors été construits, auxquels s'ajoutent la mairie-école de garçons édifiée entre 1883 et 1892 et l'école privée construite en 1897. Une nouvelle extension s'est opérée dans le dernier quart du XXe siècle par la construction de maisons à l'ouest de la route de Vaiges. Période(s) principale(s) : Milieu du Moyen Age, Fin du Moyen Age, 2e moitié 19e siècle, 2e moitié 20e siècle Description Le village est implanté sur un plateau. -

Merci, Pardon, S'il Vous Plaît !
N° 41 Juillet-août 2020 Le mot de votre curé Merci, pardon, s’il vous plaît ! La plupart d’entre vous ont maintenant connaissance de mon départ et de celui de Frère Omer le 1 er septembre, pour une nouvelle mission ! Je suis donc nommé comme curé de la paroisse Saint- Melaine-en-Val-de-Jouanne, qui regroupe les communes de Louverné, Bonchamp-les-Laval, Argentré, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette et la Chapelle-Anthenaise. De même, avec moi, Frère Omer sera nommé coopérateur. Je vous transmets également le communiqué officiel de l’évêché pour ce qui est du doyenné du Pays des Coëvrons : « Monseigneur Thierry Scherrer, évêque de Laval, avec l’accord de Don Paul Préaux, a nommé, à compter du 1 er septembre 2020, plusieurs prêtres de la Communauté Saint- Martin pour le service pastoral des quatre paroisses du doyenné des Coëvrons. Don Camille Rey (curé, doyen, référent pour la paroisse « Notre-Dame en Coëvrons », et ensei - gnant au séminaire) conduira une équipe - basée au presbytère d’Évron - avec un prêtre auxiliaire (Don Jean-Marcel Veau) et trois prêtres coopérateurs à mi-temps : Don Philippe Seys, professeur stable, et référent pour la paroisse des «Trois Marie de la Jouanne » (Montsûrs-Martigné) ; Don François-Régis Moreau, professeur stable, et référent pour la paroisse « Bienheureux Jacques Burin » (Bais-Saint-Martin-de-Connée) ; et Don Pierre Doat, chargé de mission à la Maison-mère, et référent pour la paroisse « Saint-Barnabé- en-Charnie » (Sainte-Suzanne-Vaiges) . La conduite de la mission pastorale sur le doyenné se fera en étroite collaboration avec les Équipes pastorales de chacune des paroisses, sous l’impulsion des orientations diocésaines de l’Évêque de Laval ». -

Communes Du Département De La Mayenne
Communes du département de la Mayenne MANCHE ORNE Lignières- Orgères Fougerolles- La Pallu Landivy Rennes-en- du-Plessis Désertines Thuboeuf Saint- Grenouilles Saint- Neuilly- Calais-du- Julien- le-Vendin Le Housseau- Sainte- Couptrain Désert Soucé du-Terroux Saint-Aubin- Brétignolles Marie- Madré Saint- La Dorée Aignan-de- Pré-en- Fosse- Lesbois du-Bois Vieuvy Couesmes- Couptrain Pail-Saint- Pontmain Saint- Louvain Mars-sur- Vaucé Samson la-Futaie Chevaigné- Lassay-les- Levaré Hercé du-Maine Saint-Cyr- Ravigny Saint- Saint- Gorron Le Pas Châteaux Ambrières- en-Pail Ellier-du- Berthevin-la- Chantrigné Champfrémont Maine Tannière les-Vallées Boulay- Charchigné Javron-les- les-Ifs Colombiers- Chapelles Carelles Brecé Saint- Villepail Montaudin du-Plessis Saint- Le Horps Saint- Loup- Montreuil- Mars-sur- Pierre- du-Gast Poulay Colmont Crennes-sur- des-Nids Fraubée Le Ribay Le Ham Larchamp Saint- Oisseau La Haie- Gesvres Traversaine Denis-de- Champéon Gastines Châtillon- Saint- Averton La sur-Colmont Fraimbault- Hardanges Villaines- Pellerine de-Prières la-Juhel Marcillé- Loupfougères Parigné- la-Ville La Chapelle- Ernée sur-Braye Mayenne Saint- Saint- au-Riboul Saint- Georges- Aubin-du- Pierre- Vautorte Aron Buttavent Courcité Désert des-Landes Saint- Saint- Montenay Baudelle Champgenéteux Grazay Mars-du- Placé La Bazoge- Trans Désert Moulay Montpinçon Saint- Contest Saint- Thomas-de- Germain-de- Courceriers Juvigné Belgeard Hambers Coulamer La Bais Chailland Saint- Bigottière Alexain Commer Jublains Hilaire- Saint- du-Maine Saint- Saint-