Antoine Arnauld, Ou, La Controverse Dans Les Règles
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

This Electronic Thesis Or Dissertation Has Been Downloaded from Explore Bristol Research
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from Explore Bristol Research, http://research-information.bristol.ac.uk Author: Jenkins, Clare Helen Elizabeth Title: Jansenism as literature : a study into the influence of Augustinian theology on seventeenth-century French literature General rights Access to the thesis is subject to the Creative Commons Attribution - NonCommercial-No Derivatives 4.0 International Public License. A copy of this may be found at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode This license sets out your rights and the restrictions that apply to your access to the thesis so it is important you read this before proceeding. Take down policy Some pages of this thesis may have been removed for copyright restrictions prior to having it been deposited in Explore Bristol Research. However, if you have discovered material within the thesis that you consider to be unlawful e.g. breaches of copyright (either yours or that of a third party) or any other law, including but not limited to those relating to patent, trademark, confidentiality, data protection, obscenity, defamation, libel, then please contact [email protected] and include the following information in your message: •Your contact details •Bibliographic details for the item, including a URL •An outline nature of the complaint Your claim will be investigated and, where appropriate, the item in question will be removed from public view as soon as possible. Jansenism as Literature: A Study into the Influence of Augustinian Theology on Seventeenth-Century French Literature Clare Helen Elizabeth Jenkins A Dissertation submitted to the University of Bristol in accordance with the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Arts. -

HISTORICAL ANTECEDENTS of ST. PIUS X's DECREE on FREQUENT COMMUNION JOHN A
HISTORICAL ANTECEDENTS OF ST. PIUS X's DECREE ON FREQUENT COMMUNION JOHN A. HARDON, SJ. West Baden College HPHE highest tribute to the apostolic genius of St. Pius X was paid by * his successor on the day he raised him to the honors of the altar: "in the profound vision which he had of the Church as a society, Pius X recognized that it was the Blessed Sacrament which had the power to nourish its intimate life substantially, and to elevate it high above all other human societies." To this end "he overcame the prejudices springing from an erroneous practice and resolutely promoted frequent, even daily, Communion among the faithful," thereby leading "the spouse of Christ into a new era of Euchari^tic life."1 In order to appreciate the benefits which Pius X conferred on the Church by his decree on frequent Communion, we might profitably examine the past half-century to see how the practice which he advo cated has revitalized the spiritual life of millions of the faithful. Another way is to go back in history over the centuries preceding St. Pius and show that the discipline which he promulgated in 1905 is at once a vindication of the Church's fidelity to her ancient traditions and a proof of her vitality to be rid of whatever threatens to destroy her divine mission as the sanctifier of souls. The present study will follow the latter method, with an effort to cover all the principal factors in this Eucharistic development which had its roots in the apostolic age but was not destined to bear full fruit until the present time. -

Malebranche's Augustinianism and the Mind's Perfection
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations Spring 2010 Malebranche's Augustinianism and the Mind's Perfection Jason Skirry University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the History of Philosophy Commons Recommended Citation Skirry, Jason, "Malebranche's Augustinianism and the Mind's Perfection" (2010). Publicly Accessible Penn Dissertations. 179. https://repository.upenn.edu/edissertations/179 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/179 For more information, please contact [email protected]. Malebranche's Augustinianism and the Mind's Perfection Abstract This dissertation presents a unified interpretation of Malebranche’s philosophical system that is based on his Augustinian theory of the mind’s perfection, which consists in maximizing the mind’s ability to successfully access, comprehend, and follow God’s Order through practices that purify and cognitively enhance the mind’s attention. I argue that the mind’s perfection figures centrally in Malebranche’s philosophy and is the main hub that connects and reconciles the three fundamental principles of his system, namely, his occasionalism, divine illumination, and freedom. To demonstrate this, I first present, in chapter one, Malebranche’s philosophy within the historical and intellectual context of his membership in the French Oratory, arguing that the Oratory’s particular brand of Augustinianism, initiated by Cardinal Bérulle and propagated by Oratorians such as Andre Martin, is at the core of his philosophy and informs his theory of perfection. Next, in chapter two, I explicate Augustine’s own theory of perfection in order to provide an outline, and a basis of comparison, for Malebranche’s own theory of perfection. -

Les Épreuves De L'incertain 30 Et 31 Mai 2017
Danna Kostroun, histoire, Indiana University, Purdue University-Indianapolis, Etats- Unis et résidente 2016-2017 à l’IEA de Nantes Action against Uncertainty : The Case of Port-Royal This paper examines the relationship between action and uncertainty at Port Royal. The Cistercian convent of Port-Royal-des-Champs became famous in the 17th century as the center of a Catholic reform movement known as Jansenism. The community at Port-Royal was made up of the nuns who lived in the convent and a group of lay men and women who lived on the convent farm in pious retreat. The community is famous not only for its role in religious reform, but for the intellectual work of its members, who published philosophical and polemical treatises on a number of subjects. Port-Royal was an institution designed to confront uncertainty. Its members recognized many forms of uncertainty and developed different responses to them. The first form of uncertainty dealt with the relationship between humans and God. To confront this uncertainty, Port-Royal adhered to tradition (St. Augustine’s writings on grace) and performed acts of routine, ritual, and repetition (i.e. Blaise Pascal’s human “machine” behavior). The next source of uncertainty dealt with the natural universe and human institutions. To confront this uncertainty, they produced treatises on logic, education, grammar, medicine, and other fields, through which they sought to establish a normative order through reason. A third source of uncertainty was that created by human passions. Humans generated uncertainty when they allowed passions (such as a desire for wealth, domination, or power) to obscure, blind, or otherwise obstruct reason. -

Antoine Arnauld | Encyclopedia.Com
encyclopedia.com Antoine Arnauld | Encyclopedia.com Complete Dictionary of Scientific Biography COPYRIGHT 2008 Charles Scribner's Sons 4-5 minutes (b. Paris, France, 1612; d. Brussels, Belgium, 6 August 1694) mathematics, linguistics. Arnauld was the youngest of the twenty children of Antoine Arnauld, a lawyer who defended the University of Paris against the Jesuits in 1594. He was ordained a priest and received the doctorate in theology in 1641, and entered the Sorbonne in 1643, after the death of Richelieu. In 1656 he was expelled from the Sorbonne for his Jansenist views, and spent a good part of the rest of his life in more or less violent theological dispute. He died in self-imposed exile. Although in many of his nontheological writings Arnauld is identified with the Port-Royal school, his voluminous correspondence—with Descartes and Leibniz, among others—bears witness to his own influence and acumen. His philosophical contributions are to be found in his objections to Descartes’s Méditations, in his dispute with Malebranche, and in the Port-Royal Logic, which he wrote with Pierre Nicole. The latter, a text developed from Descartes’s Regulae, elaborates the theory of “clear and distinct” ideas and gives the first account of Pascal’s Méthode. It had an enormous influence as a textbook until comparatively recent times. The profound influence of the Regulae is shown in both the Logic and the Port-Royal Grammar, where it is assumed that linguistic and mental processes are virtually identical, that language is thus to be studied in its “inner” and “outer” aspects. This point of view underlies the project for a universal grammar and the notion of the “transparency” of language: mental processes are common to all human beings, although there are many languages. -

The Hyperbolic Way to Truth from Balzac to Descartes: “Toute Hyperbole Tend Là, De Nous Amener À La Vérité Par L’Excès De La Vérité, C’Estàdire Par Le Mensonge”1
THE HYPERBOLIC WAY TO TRUTH FROM BALZAC TO DESCARTES: “TOUTE HYPERBOLE TEND LÀ, DE NOUS AMENER À LA VÉRITÉ PAR L’EXCÈS DE LA VÉRITÉ, C’ESTÀDIRE PAR LE MENSONGE”1 Giulia Belgioioso* In Th e History of Scepticism From Savonarola to Bayle Richard Popkin refers to Guez de Balzac only four times,2 and never alone: in every reference Balzac is joined with some other relevant intellectual fi gure, such as Antoine Arnauld, the Jesuits, Jean Silhon and—in two occur- rences—Descartes. In his view, these fi gures represent ‘Catholic fanati- cism,’ fi gures who set themselves against La Mothe Le Vayer, assumed to be a monster who threatens religion and faith. According to a hypothesis René Pintard advanced in 1937,3 but now much disputed, La Mothe Le Vayer’s Dialogues could be construed as the “méchant livre” to which Descartes refers in his letter to Mersenne4 of May 6, 1630. Popkin is right to introduce Balzac as the heir of Roman Catholicism as reformed by the Council of Trent, very far from humanist writers and reformers such as Erasmus and George Buchanan (1586–1582). My aim in this paper is not to rehabilitate Balzac, however. Rather, I am especially interested in his notion of “hyperbole”—what he called “the way to reach truth through lying”—for I believe Descartes took advantage of such a hyperbolic procedure in his fi rst three Meditations. Important evidence for this reading is to be found, as I will later show, in the discussion between Descartes and Antoine Arnauld. * Università del Salento, Italy. -

Blaise Pascal: from Birth to Rebirth to Apologist
Blaise Pascal: From Birth to Rebirth to Apologist A Thesis Presented To Dr. Stephen Strehle Liberty University Graduate School In Partial Fulfillment of the Requirements for the Course THEO 690 Thesis by Lew A. Weider May 9, 1990 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION 4 Chapter I. JANSENISM AND ITS INFLUENCE ON BLAISE PASCAL 12 The Origin of Jansenism . 12 Jansenism and Its Influence on the Pascals . 14 Blaise Pascal and his Experiments with Science and Technology . 16 The Pascal's Move Back to Paris . 19 The Pain of Loneliness for Blaise Pascal . 21 The Worldly Period . 23 Blaise Pascal's Second Conversion 26 Pascal and the Provincial Lettres . 28 The Origin of the Pensees . 32 II. PASCAL AND HIS MEANS OF BELIEF 35 The Influence on Pascal's Means of Belief 36 Pascal and His View of Reason . 42 Pascal and His View of Faith . 45 III. THE PENSEES: PASCAL'S APOLOGETIC FOR THE CHRISTIAN FAITH 50 The Wager Argument . 51 The Miracles of Holy Scripture 56 The Prophecies . 60 CONCLUSION . 63 BIBLIOGRAPHY . 65 INTRODUCTION Blaise Pascal was a genius. He was revered as a great mathematician and physicist, an inventor, and the greatest prose stylist in the French language. He was a defender of religious freedom and an apologist of the Christian faith. He was born June 19, 1623, at Clermont, the capital of Auvergne, which was a small town of about nine thousand inhabitants. He was born to Etienne and Antoinette Pascal. Blaise had two sisters, Gilberte, born in 1620, and Jacqueline, born in 1625. Blaise was born into a very influential family. -

Objections to the Meditations and Descartes's Replies
Objections to the Meditations and Descartes’s Replies René Descartes Copyright © Jonathan Bennett 2017. All rights reserved [Brackets] enclose editorial explanations. Small ·dots·enclose material that has been added, but can be read as though it were part of the original text. Occasional •bullets, and also indenting of passages that are not quotations, are meant as aids to grasping the structure of a sentence or a thought. Every four-point ellipsis. .indicates the omission of a brief passage that seems to present more difficulty than it is worth. Longer omissions are reported between brackets in normal-sized type. The seventh set of objections is long, bad, and omitted. Originally only Hobbes’s comments were inter-leaved with Descartes’s replies; but that format is adopted here for all six sets, creating a little strain only with the replies to Caterus. Unadorned surnames in this version usually replace something less blunt—‘Dominus Cartesius’, ‘the author’, ‘my critic’, ‘the learned theologian’ and so on. First launched: July 2006 Last amended: November 2007 Contents First Objections (Caterus) and Descartes’s replies 1 Can God cause God to exist?....................................................3 Inferring God’s existence from his essence............................................. 10 ‘Proving’ the existence of a lion.................................................... 14 Second Objections (mainly Mersenne) and Descartes’s Replies 18 The cause of our idea of God..................................................... 20 Two challenges -
Introduction
Cambridge University Press 978-1-107-00045-2 - Feminism, Absolutism, and Jansenism: Louis XIV and the Port-Royal Nuns Daniella Kostroun Excerpt More information Introduction On October 29, 1709, King Louis XIV sent his royal lieutenant of police, along with 200 troops, into the valley of the Chevreuse, twelve miles west of Paris, to shut down the convent of Port-Royal-des-Champs. Sixty years earlier, Port-Royal had been a flourishing community containing more than 150 nuns. By 1709 there were only twenty-two left, all over the age of fifty and several of them infirm. On arrival, the lieutenant assembled the nuns in the convent’s parlor and read them an order from the royal council stating that they were to be removed from the convent “for the good of the state.” He then presented them with lettres de cachet (special royal warrants signed by the king) sentencing each nun to exile in separate convents across France. They had only three hours to pack their belongings, eat a final meal, and say good-bye to one another. He then loaded them into carriages and drove them away. Shortly after that, Louis XIV’s men exhumed Port-Royal’s cemetery, dumped the remains in a mass grave, and razed the buildings to the ground. How can we account for this episode in which Louis XIV personally ordered the destruction of a convent containing so few nuns? How could these women pose a threat to the state? Port-Royal’s destruction becomes even more mysterious when we consider that it occurred at a time of political and domestic crisis for the French Crown. -
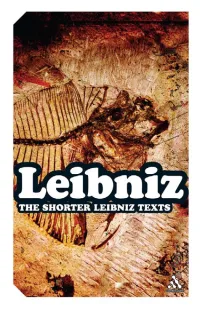
SHORTER LEIBNIZ TEXTS Also Available from Continuum
THE SHORTER LEIBNIZ TEXTS Also available from Continuum Leibniz Reinterpreted, Lloyd Strickland Leibniz: A Guide for the Perplexed, Franklin Perkins THE SHORTER LEIBNIZ TEXTS A Collection of New Translations Lloyd Strickland continuum Continuum The Tower Building 80 Maiden Lane, Suite 704 11 York Road New York, NY 10038 London SE1 7NX © Lloyd Strickland 2006 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publishers. Lloyd Strickland has asserted his right under the Copyright, Designs and Patents Act, 1988, to be identified as Author of this work. British Library Cataloguing-in-Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library. ISBN: 0826489508 (hardback) 0826489516 (paperback) Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A catalog record for this book is available from the Library of Congress. Typeset by Interactive Sciences Ltd, Gloucester Printed and bound in Great Britain by Cromwell Press Ltd, Trowbridge, Wiltshire For Dawn (Bur) This page intentionally left blank This page intentionally left blank Page 2 (recto) of Leibniz's handwritten manuscript LH 37, 4ff 14r-15v This page intentionally left blank This page intentionally left blank Contents Acknowledgements xv Selected Bibliography xvii Introduction 1 A note on the translations 24 I. METAPHYSICS A. Creation 29 1. On first truths (middle-end 1680) 29 2. On the reason why these things exist rather than other things (March-August 1689) 30 3. On the ultimate origination of things (23 November 1697) 31 4. -

Early Modern Catholic Reform and the Synod of Pistoia Shaun London Blanchard Marquette University
Marquette University e-Publications@Marquette Dissertations (2009 -) Dissertations, Theses, and Professional Projects Eighteenth-Century Forerunners of Vatican II: Early Modern Catholic Reform and the Synod of Pistoia Shaun London Blanchard Marquette University Recommended Citation Blanchard, Shaun London, "Eighteenth-Century Forerunners of Vatican II: Early Modern Catholic Reform and the Synod of Pistoia" (2018). Dissertations (2009 -). 774. https://epublications.marquette.edu/dissertations_mu/774 EIGHTEENTH-CENTURY FORERUNNERS OF VATICAN II: EARLY MODERN CATHOLIC REFORM AND THE SYNOD OF PISTOIA by Shaun L. Blanchard, B.A., MSt. A Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School, Marquette University, in Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of Doctor of Philosophy Milwaukee, Wisconsin May 2018 ABSTRACT EIGHTEENTH-CENTURY FORERUNNERS OF VATICAN II: EARLY MODERN CATHOLIC REFORM AND THE SYNOD OF PISTOIA Shaun L. Blanchard Marquette University, 2018 This dissertation sheds further light on the nature of church reform and the roots of the Second Vatican Council (1962–65) through a study of eighteenth-century Catholic reformers who anticipated Vatican II. The most striking of these examples is the Synod of Pistoia (1786), the high-water mark of “late Jansenism.” Most of the reforms of the Synod were harshly condemned by Pope Pius VI in the Bull Auctorem fidei (1794), and late Jansenism was totally discredited in the increasingly ultramontane nineteenth-century Catholic Church. Nevertheless, many of the reforms implicit or explicit in the Pistoian agenda – such as an exaltation of the role of bishops, an emphasis on infallibility as a gift to the entire church, religious liberty, a simpler and more comprehensible liturgy that incorporates the vernacular, and the encouragement of lay Bible reading and Christocentric devotions – were officially promulgated at Vatican II. -

TRUTH and MEANING in the PORT-ROYAL LOGIC Abstract
2014 127 Diálogos, 96 (2014) pp. 127 TRUTH AND MEANING IN THE PORT-ROYAL LOGIC PIERRE BAUMANNi Abstract The redundancy theory of truth, according to which a sentence of the form ‘p’ is true is equivalent to p, is commonly attributed to the philosophers Gottlob Frege (1848-1925) and Frank Ramsey (1903- 1930), and is viewed as an important development in 20th century philosophical logic. In this paper I argue that such a perspective on truth may in fact be found much earlier, in Antoine Arnauld and Pierre Nicole’s Logic, or the Art of Thinking (also known as the Port-Royal Logic and published in its final form in 1683). Although ignored by many philosophers who work on the concept of truth today, Arnauld and Nicole should be credited as the originators of the redundancy theory. In addition to identifying and explaining the relevant passages of the Port-Royal Logic, I discuss the authors’ strikingly modern take on linguistic meaning. Their approach to this issue, also generally overlooked in current discussions, merits serious consideration, and, I argue, is to be preferred to other, currently popular, approaches to this topic. Theirs is a sophisticated and subtle «internalist» account of meaning-one that, as we shall see, is largely immune to the usual objections to semantic internalism. i Department of Philosophy, University of Puerto Rico, Río Piedras. 128 PIERRE BAUMANN D96 Keywords: Port-Royal Logic, Antoine Arnauld, truth, meaning, semantic internalism. Truth and Meaning in the Port-Royal Logic 1. Introduction The redundancy theory of truth,1 according to which a sentence of the form ‘p’ is true is equivalent to p, is commonly attributed to the philosophers Gottlob Frege (1848-1925) and Frank Ramsey (1903- 1930), and is viewed as an important development in 20th century philosophical logic.