Cercle De Sikasso Au Mali)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gold from Children's Hands
SO M O Gold from children’s hands Use of child-mined gold by the electronics sector Irene Schipper & Esther de Haan & Mark van Dorp November 2015 Colophon Gold from children’s hands Use of child-mined gold by the electronics sector November 2015 Authors: Irene Schipper and Esther de Haan With contributions of: Meike Remmers and Vincent Kiezebrink Mali field research: Mark van Dorp Layout: Frans Schupp Photos: Mark van Dorp / SOMO en ELEFAN-SARL ISBN: 978-94-6207-075-2 Published by: Commisioned by: Stichting Onderzoek Multinationale Stop Child Labour Ondernemingen (SOMO) ‘Stop Child Labour – School is the best Centre for Research on Multinational place to work’ (SCL) is a coalition Corporations coordinated by Hivos. The coalition The Centre for Research on Multina- consists of the Algemene Onderwijs- tional Corporations (SOMO) is an bond (AOb), FNV Mondiaal, Hivos, the independent, not-for-profit research and India Committee of the Netherlands network organisation working on social, (ICN), Kerk in Actie & ICCO ecological and economic issues related Cooperation, Stichting Kinderpostzegels to sustainable development. Since 1973, Nederland and local organisations in the organisation investigates multina- Asia, Africa and Latin America. tional corporations and the conse- www.stopchildlabour.org quences of their activities for people and the environment around the world. Sarphatistraat 30 1018 GL Amsterdam The Netherlands T + 31 (20) 6391291 F + 31 (20) 6391321 [email protected] www.somo.nl Gold from children’s hands Use of child-mined gold by the electronics sector SOMO Irene Schipper, Esther de Haan and Mark van Dorp Amsterdam, November 2015 Contents Glossary ................................................................................................................ 4 Acronyms .............................................................................................................. -
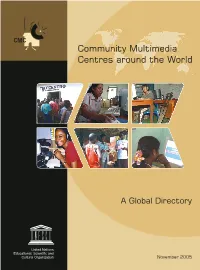
Community Multimedia Centres Around the World C O M M U N I T Y
y r o orld t c e r i November 2005 D l a b o l G A Community Multimedia Centres around the W United Nations C Cultural Organization M Educational, Scientific and C UNESCO Community Multimedia Centres around the World: A Global Directory United Nations Cultural Organization .unesco.org/webworld Educational, Scientific and www Communication and Information Sector .unesco.org/webworld/cmc www C .unesco.org/webworld/cmc M C Community Multimedia Centres www © UNESCO 2005 Published by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ISBN: 81-89218-10-7 Disclaimer The designations employed and the presentation of material throughout this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The authors are responsible for the choice and the presentation of the facts contained in this book and for the opinions expressed therein, which are not necessarily those of UNESCO and do not commit the Organization. Community Multimedia Centres around the World A Global Directory November 2005 Editors Stella Hughes Ian Pringle Foreword UNESCO’s Community Multimedia Centre (CMC) Initiative developed out of the 0rganization’s long-standing work with community media, especially radio, and the increasingly important and promising role played by new information and communication technologies in development efforts. By co-locating traditional media and new technology facilities and promoting innovative local programme initiatives, the CMC approach combines the unique characteristics of community-based media with the enormous power and reach of new information and communication tools and networks. -

Agricultural Diversification in Mali: the Case of the Cotton Zone of Koutiala
AGRICULTURAL DIVERSIFICATION IN MALI: THE CASE OF THE COTTON ZONE OF KOUTIALA By Mariam Sako Thiam A THESIS Submitted to Michigan State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Agricultural, Food, and Resource Economics – Master of Science 2014 ABSTRACT AGRICULTURAL DIVERSIFICATION IN MALI: THE CASE OF THE COTTON ZONE OF KOUTIALA By Mariam Sako Thiam Cotton production plays a central role in the economy and the livelihood of cotton growers in the Koutiala area of Mali. Despite all the investment made in the cotton zones, the cotton farmers in Koutiala suffer substantially from uncertainties in the cotton subsector linked to prices, timely payment, and to the future structure of the industry. This study analyzes empirically how cotton growers with different agricultural characteristics coped with these uncertainties over the period 2006-2010. The data used in this study were collected during the survey that covered 150 households in the Koutiala area during three cropping seasons: 2006-07, 2008-09 and 2009- 10.The results show that despite income diversification among the households surveyed in Koutiala, agricultural production remains the main source of income. The findings also show that the farmers who continued to grow cotton during the three years of the survey and those who started producing cotton after year one diversified within the agricultural sector by producing more peanuts and cowpeas while the farmers who dropped out of cotton production after year one of the survey diversified toward non-farm activities such as commerce and self. We also found that the non-cotton growers are the poorest group of farmers, with less agricultural equipment and labor as well as less overall wealth, limiting their potential to invest in farm activities and start an off-farm business. -

Apiculture Au Sud Mali
TG01 / 2008 Transfert et de la gestion décentralisée Rapport d’étude : Problématique de l’immatriculation, du trans- fert et de la gestion dé- centralisée des équipe- ments et infrastructures productives Intercooperation Jèkasy –www.dicsahel.org Maître Oumar Cissé Maître Tignougou Sanogo Jèkasy Sikasso J Problématique de l’immatriculation, du transfert et de la gestion décentralisée des équipements et infrastructures productives Rapport d’étude Maître Oumar Cissé Maître Tignougou Sanogo Avril 2008 2 TABLE DES MATIERES I. INTRODUCTION........................................................................................................................................... 6 II. ANALYSE CRITIQUE DU CADRE SOCIO-JURIDIQUE .......................................................................7 2.1 CONTEXTE................................................................................................................................................ 7 2.2 POUVOIRS DE L’ETAT SUR LES INFRASTRUCTURES .................................................................................. 7 2.3 PREROGATIVES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES SUR LES INFRASTRUCTURES....................................8 2.3.1 Appropriation communale des équipements ....................................................................................... 9 2.3.2 Gestion communale des équipements................................................................................................ 10 2.3 LES PRETENTIONS DES POPULATIONS SUR LES INFRASTRUCTURES.........................................................10 -
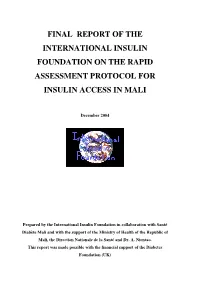
Final Report of the International Insulin Foundation on the Rapid Assessment Protocol for Insulin Access in Mali
FINAL REPORT OF THE INTERNATIONAL INSULIN FOUNDATION ON THE RAPID ASSESSMENT PROTOCOL FOR INSULIN ACCESS IN MALI December 2004 Prepared by the International Insulin Foundation in collaboration with Santé Diabète Mali and with the support of the Ministry of Health of the Republic of Mali, the Direction Nationale de la Santé and Dr. A. Nientao. This report was made possible with the financial support of the Diabetes Foundation (UK) Table of Contents Pages List of Tables 3 List of Figures 3 List of Appendices 3 1. Executive Summary 4 1.1. Key Findings 4 1.2. Recommendations 4-5 2. Background Information 2.1. Diabetes 6 2.2. International Insulin Foundation 6 2.3. Rapid Assessment Protocol for Insulin Access - method of assessment 6 2.4. Mali 7 2.5. Mali’s healthcare system 8-11 2.6. Implementation of RAPIA in Mali 11 3. Type 1 Diabetes in Mali 11-14 4. Mali’s medecine supply 14-16 4.1. Mali's insulin supply and quantification 16-18 4.2. Price of Insulin 18-19 5. Access to Syringes 19 6. Access to Diabetes Care 6.1. Overview 19-20 6.2. Bamako 20 6.3. Sikasso and Kadiolo 21 6.4. Timbuktu and Douentza 21 7. Diagnostic issues 21-22 8. Training 22 9. Diabetes Association of Mali 22-23 10. Policy Framework 23 11. Registers 23 12. Traditional Healers 23-24 13. Other Issues 24 14. Some positive points 24 15. Discussion 24-25 16. Recommendations 26-30 17. Presentation of Results 31-36 18 Acknowledgements 37-38 19. -

Evaluation De L'état Nutritionnel Des Enfants De 6 À 59 Mois Dans Le Cercle De Koutiala
REPUBLIQUE DU MALI Ministère de l’Enseignement Un Peuple-Un But-Une Foi Supérieur et de La Recherche Scientifique FACULTE DE MEDECINE ET D’ODONTO STOMATOLOGIE ANNEE UNIVERSITAIRE: 2012-2013 N°………/ Evaluation de l’état nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois dans le cercle de Koutiala (Région de Sikasso) en 2012 THÈSE Présentée et soutenue publiquement le 28 Mai 2013 Devant la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie PAR Mr : Bakary Moulaye KONE Pour obtenir le Grade de Docteur en Médecine (DIPLOME D’ETAT) Jury Président : Pr Samba DIOP Membre : Dr Fatou DIAWARA Co-directeur : Dr Kadiatou KAMIAN Directeur : Pr Akory AG IKNANE Cette Etude a été financée et commanditée par MSF (Médecins Sans Frontières France) FACULTE DE MEDECINE ET D’ODONTO-STOMATOLOGIE ANNEE UNIVERSITAIRE 2012-2013 ADMINISTRATION DOYEN : FEU ANATOLE TOUNKARA - PROFESSEUR 1er ASSESSEUR : BOUBACAR TRAORE - MAITRE DE CONFERENCES 2ème ASSESSEUR : IBRAHIM I. MAIGA - PROFESSEUR SECRETAIRE PRINCIPAL : IDRISSA AHMADOU CISSE - MAITRE DE CONFERENCES AGENT COMPTABLE : MADAME COULIBALY FATOUMATA TALL - CONTROLEUR DES FINANCES LES PROFESSEURS HONORAIRES Mr Alou BA Ophtalmologie † Mr Bocar SALL Orthopédie Traumatologie - Secourisme Mr Yaya FOFANA Hématologie Mr Mamadou L. TRAORE Chirurgie Générale Mr Balla COULIBALY Pédiatrie Mr Mamadou DEMBELE Chirurgie Générale Mr Mamadou KOUMARE Pharmacognosie Mr Ali Nouhoum DIALLO Médecine interne Mr Aly GUINDO Gastro-Entérologie Mr Mamadou M. KEITA Pédiatrie Mr Siné BAYO Anatomie-Pathologie-Histoembryologie Mr Sidi Yaya SIMAGA Santé Publique Mr Abdoulaye Ag RHALY Médecine Interne Mr Boulkassoum HAIDARA Législation Mr Boubacar Sidiki CISSE Toxicologie Mr Massa SANOGO Chimie Analytique Mr Sambou SOUMARE Chirurgie Générale Mr Sanoussi KONATE Santé Publique Mr Abdou Alassane TOURE Orthopédie - Traumatologie Mr Daouda DIALLO Chimie Générale & Minérale Mr Issa TRAORE Radiologie Mr Mamadou K. -

Analyse the Perception Level and the Causes of Migration in Mali
1 Analyse the perception level and the causes of 2 migration in Mali. 3 4 Abstract: 5 Subsistence farmers in Sahelian Africa are highly exposed to the environmental challenges 6 associated with climate change. Temporary or Permanent emigration can offer to an 7 individual or household the opportunity to cop against these special effects. One of the 8 most important challenge to quantifying the impact of climate change on emigration in 9 Mali is lack of accurate temporal and spatial data. Emigration data must be adequately 10 detailed to take in both long distances and short distances. The objective of this research 11 was to identify the socioeconomic characteristics of migrants based on the push factors. 12 For instance, to identify the characteristics of people who migrant due to bad weather or 13 environmental challenges. From the result, the factors that significantly influenced 14 migration were sex, age and age squared, household size, labour constraint, and location. 15 Multinomial logistic regression was used to analyse the subject. 16 Key words: migration drivers, multinomial logit, rural Mali, environmental challenges. 17 INTRODUCTION 18 Even if movement is a fundamental part of human being, in fact Mali has a long history of 19 migration particularly emigration. Recently it has become an important transit place for 20 migratory flows within the Sahelian region and beyond. The country is specific by its 21 population involved in migration issue that linked to cultural practices in using migration 22 as rite of road for young men. Mali has been experiencing seasonal and circular migration 23 as well as nomadic and pastoral movements. -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

Perceptions and Adaptations to Climate Change in Southern Mali
Preprints (www.preprints.org) | NOT PEER-REVIEWED | Posted: 12 March 2021 doi:10.20944/preprints202103.0353.v1 Perceptions and adaptations to climate change in Southern Mali Tiémoko SOUMAORO PhD student at the UFR of Economics and Management, Gaston Berger University (UGB) of Saint-Louis, Senegal. [email protected] ABSTRACT This study aims to determine the impact of climate change on market garden production in the extreme south of Mali through the perception and adaptation of market gardeners to climatic phenomena. The study used two models, namely the probit selection and Heckman results models and multinomial logistic regression, based on data collected from producers. A total of 194 producers were surveyed. The results of Heckman's probit model indicate that experience in agriculture and the educational level of the producers are the two main determinants of producers' perception and simultaneous adaptation to climate change. Among these variables agricultural experience is both positively and negatively correlated with perception. Keywords: Adaptation, climate change, southern Mali, Heckman probit, vegetable production 1. INTRODUCTION Climate change and its impacts have now become one of the greatest challenges for humanity, its environment and its economies (IPCC, 2013). At the global level, climate change is reflected in the rise in the average temperature of the planet, the melting of glaciers, the rise in sea level and the increase in the frequency of extreme events, the disappearance of species of animal origin, changes in rainfall patterns, etc. The average temperature in the world will increase by 1.8°C to 4°C, and in the worst case 6.4°C by the end of this century (IPCC, 2007). -
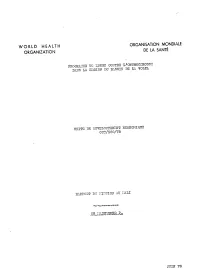
OCP-EPI-78.Pdf (1.012Mb)
,'/ WORLD HEALTH ORGANISATIONMONDIALE ORGANIZATION DE LA SANTÉ PROGTTA:.,tr'T]DIT,UîTECOITîNET.,'O}TCHOCtrRCOSJI VOITÀ D},ITS I,t N]]GIOI\T DÜ B-tSSTliI DE IÂ Ü]TITD DE DE\TEIO?PEIi.II1I{T ECO}TOÏ'ITQUIT o cY/rco/ta Rl,?PO"l,[ Dr] 1;I]SIO]I 'irU i'iittrI -3-3-=-g-=.i= l)B-iË"§trIElE9=L-c JUI}T 78 I 'Dr I'flasumbu]ro Iie Conseiller en Sarrté Publique OMS/oITCrro/ECo RAPPORT DE MISSIO1T AU I\TA],7 Du B Juillet au 14 Juillet 197e, le Dr L[asumbuko srest rend.u par Ia route au Mali pour effectuer une misslon dont les buts étaient de : 1 ) Passer e11 revue avee les Autorités sanitaires m.aliennes' Ies principaux problèmes de Santé Fublique qrri se posent dans llaire malienne du Programne OCP ; Z) Faisant suite à r:ne question posée au Directeur du Progranme par 1a DéIégatlon malierur.e et relative à 1:r Mécteci-ne Îraditionnelter lors de Ia 2ème Coirférence anrruelle des Conttés }Tationaux d.e lutte Coiitre trtO::chocer- cose, il slag:issait d.rexantiner, avec 1es eetfrices d.e trlllnstitut }Tational d.e Recherche sur Ia Phamacopée et Ia i{édecine Îraditionnelletr de Bqmakor d.e son utilisation dans 1a lutte contre Ia nraladie éventuel-lement contre 1 lOnchocercosêo é §ikasso- au Mini st èr3u8 8"8 Ê8*8R8t u* âoÏli,îSt iBû€ îfi g*lSi*tt,i à ttec-nercne sur Ia ?hamacopée"di8"B8fit et Ia Médecine Traditiorurelle. 1. vis.iLe à sihassq Mili-eu Sikasso 2ène Région d.u Mali est frontalièr'e de Ia Har-rte-Volta à ItEst, tle la Côte drlvoire au Sr-rd et de 1a lépubliclue d.e Gulnée au Sud-Ouest. -

Latitudes Longitudes Villages Communes Cercles Regions
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT REPUBLIQUE DU MALI DE L’ASSAINISSEMENT ET UN PEUPLE - UN BUT- UNE FOI DEVELOPEMENT DURABLE DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS(DNEF) SYSTEME D’INFORMATION FORESTIER (SIFOR) SITUATION DES FOYERS DE FEUX DE BROUSSE DU 01 au 03 MARS 2015 SELON LE SATTELITE MODIS. LATITUDES LONGITUDES VILLAGES COMMUNES CERCLES REGIONS 13,7590000000 -11,1200000000 GALOUGO NIAMBIA BAFOULABE KAYES 13,3720000000 -11,1300000000 BOULOUMBA GOUNFAN BAFOULABE KAYES 13,3630000000 -11,1380000000 KENIEDING GOUNFAN BAFOULABE KAYES 13,2690000000 -10,7690000000 LAHANDY DIOKELI BAFOULABE KAYES 13,2680000000 -10,7550000000 BANGAYA DIOKELI BAFOULABE KAYES 13,1800000000 -10,6990000000 KABADA KOUNDIAN BAFOULABE KAYES 12,8550000000 -10,2300000000 DIBA BAMAFELE BAFOULABE KAYES 13,5880000000 -10,4320000000 TAMBAFETO OUALIA BAFOULABE KAYES 13,6200000000 -11,0330000000 DJIMEKOURO MAHINA BAFOULABE KAYES 13,6180000000 -11,0430000000 NEGUETABAL MAHINA BAFOULABE KAYES 14,4590000000 -10,1500000000 TRANTINOU DIAKON BAFOULABE KAYES 13,2600000000 -10,4720000000 SOBELA BAMAFELE BAFOULABE KAYES 13,0910000000 -10,7880000000 NANIFARA KOUNDIAN BAFOULABE KAYES 12,8830000000 -6,5380000000 M^BEDOUGOU SANANDO BARAOUELI SEGOU 12,1340000000 -7,2900000000 TYEMALA MERIDIELA BOUGOUNI SIKASSO 11,8240000000 -7,3790000000 BOROMBILA DOGO BOUGOUNI SIKASSO 11,7890000000 -7,5170000000 FARABA DOGO BOUGOUNI SIKASSO 11,5640000000 -7,3600000000 SABOUDIEBO ZANTIEBOUGOU BOUGOUNI SIKASSO 11,3640000000 -6,8730000000 KOUMANTOU KOUMANTOU BOUGOUNI SIKASSO 11,4000000000 -7,6240000000 FOULOLA -

Memoire Du Diplome D'etude Approfondie (Dea)
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT REPUBLIQUE DU MALI SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE Un Peuple-Un But-Une Foi SCIENTIFIQUE INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE (ISFRA) MEMOIRE DU DIPLOME D’ETUDE APPROFONDIE (DEA) Option : Population-Environnement, Gestion des Zones Humides et Développement Durable THEME : Analyse de l’évolution des pratiques de pêche dans la commune rurale de Zangasso, cercle de Koutiala au Mali Présenté par : Ousmane CISSE Président du Jury : Directeur de mémoire Pr Moussa KAREMBE, Pr Mahamane H. MAIGA, Professeur Professeur Titulaire à l’USTTB Titulaire à l’ISFRA Membres : Co-encadreur de mémoire Dr Hady DIALLO, Maître Dr Edmond TOTIN, Chercheur à Assistant L’ICRISAT Mahamane H. MAIGA, Professeur à l’ISFRA Date et Lieu de soutenance : Année universitaire 2016-2017 10/08/ 2017 à L’ISFRA Avant-propos ............................................................................................................................. V DEDICACE .............................................................................................................................. VI REMERCIEMENTS ............................................................................................................... VII LISTE DES TABLEAUX, DES CARTES, DES PHOTOS, ET DES FIGURES ................ VIII RESUME .................................................................................................................................. IX INTRODUCTION .....................................................................................................................