Saison Violente
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

New Orleans Review LOYOLA UNIVERSITY VOLUM E 16 NUMBER 21$9.00
New Orleans Review LOYOLA UNIVERSITY VOLUM E 16 NUMBER 21$9.00 ) ) New Orleans Review Summer 1989 Editors John Biguenet John Mosier Managing Editor Sarah Elizabeth Spain Design Vilma Pesciallo Contributing Editors Bert Cardullo David Estes Jacek Fuksiewicz Alexis Gonzales, F.S.C. Andrew Horton Peggy McCormack Rainer Schulte Fourzding Editor Miller Williams Advisory Editors Richard Berg Doris Betts Joseph Fichter, S.J. John Irwin Murray Krieger Wesley Morris Walker Percy Herman Rapaport Robert Scholes Miller Williams The New Orleans Review is published by Loyola University, New Orleans, Louisiana 70118, United States. Copyright !fJ 1989 by Loyola University. Critical essays relating to film or literature of up to ten thousand words should be prepared to conform with the new MLA guidelines. All essays, fiction, poetry, photography, or related artwork should be sent to the New Orleans Review, together with a stamped, self-addressed envelope. The address is New Orleans Review, Box 195, Loyola University, New Orleans, Louisiana 70118. Reasonable care is taken in the handling of material, but no responsibility is assumed for the loss of unsolicited material. Accepted manuscripts are the property of the NOR. Rejected manuscripts without stamped, self-addressed envelopes will not be returned. The New Orleans Review is published in February, May, August, and November. Annual Subscription Rate: Institutions $30.00, Individuals $25.00, Foreign Subscribers $35.00. Contents listed in the PMLA Bibliography and the Index of American Periodical Verse. US lSSN 0028-6400 NEW ORLEANS REVIEW CONTENTS SUMMER 1989 VOLUME 16 NUMBER 2 Interrogation Ryszard Bugajski/fr. Michael Szporer 5 Ode to a Pantheress Pablo Nerudaltr. -

Lazarus, Syrkin, Reznikoff, and Roth
Diaspora and Zionism in Jewish American Literature Brandeis Series in American Jewish History,Culture, and Life Jonathan D. Sarna, Editor Sylvia Barack Fishman, Associate Editor Leon A. Jick, The Americanization of the Synagogue, – Sylvia Barack Fishman, editor, Follow My Footprints: Changing Images of Women in American Jewish Fiction Gerald Tulchinsky, Taking Root: The Origins of the Canadian Jewish Community Shalom Goldman, editor, Hebrew and the Bible in America: The First Two Centuries Marshall Sklare, Observing America’s Jews Reena Sigman Friedman, These Are Our Children: Jewish Orphanages in the United States, – Alan Silverstein, Alternatives to Assimilation: The Response of Reform Judaism to American Culture, – Jack Wertheimer, editor, The American Synagogue: A Sanctuary Transformed Sylvia Barack Fishman, A Breath of Life: Feminism in the American Jewish Community Diane Matza, editor, Sephardic-American Voices: Two Hundred Years of a Literary Legacy Joyce Antler, editor, Talking Back: Images of Jewish Women in American Popular Culture Jack Wertheimer, A People Divided: Judaism in Contemporary America Beth S. Wenger and Jeffrey Shandler, editors, Encounters with the “Holy Land”: Place, Past and Future in American Jewish Culture David Kaufman, Shul with a Pool: The “Synagogue-Center” in American Jewish History Roberta Rosenberg Farber and Chaim I. Waxman,editors, Jews in America: A Contemporary Reader Murray Friedman and Albert D. Chernin, editors, A Second Exodus: The American Movement to Free Soviet Jews Stephen J. Whitfield, In Search of American Jewish Culture Naomi W.Cohen, Jacob H. Schiff: A Study in American Jewish Leadership Barbara Kessel, Suddenly Jewish: Jews Raised as Gentiles Jonathan N. Barron and Eric Murphy Selinger, editors, Jewish American Poetry: Poems, Commentary, and Reflections Steven T.Rosenthal, Irreconcilable Differences: The Waning of the American Jewish Love Affair with Israel Pamela S. -
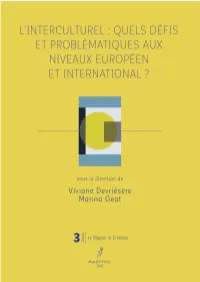
Lint-Deat.Pdf
NELLA STESSA COLLANA 1. MARINA GEAT, VINCENZO A. PICCIONE (a cura di), Le ragioni di Erasmus, 2017 2. MARINA GEAT, VINCENZO A. PICCIONE (a cura di), Infanzia, arti, lavoro: confluenze educative, 2019 Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Scienze della Formazione L’INTERCULTUREL : QUELS DÉFIS ET PROBLÉMATIQUES AUX NIVEAUX EUROPÉEN ET INTERNATIONAL ? sous la direction de Viviane Devriésère Marina Geat Collana 3 Le Ragioni di Erasmus Ricerche e intersezioni scientifiche. Per l’educazione nel presente: le scienze umane, l’internazionalizzazione, le reti, l’innovazione 2020 Ce volume a été publié avec le soutien de l’ISFEC d’Aquitaine et du Département de Sciences de l’Éducation de l’Université Roma Tre. Questo volume è stato pubblicato con il contributo dell’ISFEC d’Aquitaine e del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. Direttore della collana: Marina Geat, Università degli Studi Roma Tre Comitato scientifico della collana: Marina Geat, Università degli Studi Roma Tre Vincenzo A. Piccione, Università degli Studi Roma Tre Anne Douaire-Banny, ICP - Institut Catholique de Paris Viviane Devriésère, ISFEC d’Aquitaine, Bordeaux Miguel Ángel Carbonero Martín, Università diValladolid Maria Teresa Del Olmo Ibañez, Università di Alicante Andrea Rácz, University of Eötvös Loránd, Budapest Revisione editoriale dei testi: Sara Concato Impaginazione e cura editoriale: Libreria Efesto Elaborazione grafica della copertina: Mosquito mosquitoroma.it Edizioni: © Roma, maggio 2020 ISBN: 979-12-80060-17-4 http://romatrepress.uniroma3.it Quest’opera è assoggettata alla disciplina Creative Commons attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l’attribuzione della paternità dell’opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un’altra opera, e ne esclude l’uso per ricavarne un profitto commerciale. -

The Inventory of the Richard Lourie Collection #1355
The Inventory of the Richard Lourie Collection #1355 Howard Gotlieb Archival Research Center lourie.r LOURIE, RICHARD 194O- 241C Deposit January 1988 OUTLINE OF INVENTORY 7 Boxes I. MANUSCRIPTS 1973, 1985-1987. A. Novels B. Translations c. Short Fiction D. Poetry E. Film Script F. Essay G. Translated Short Prose II. PRINTED REVIEWS, 1973-1986. III. CORRESPONDENCE, 1979-1988. IV. FINANCIAL STATEMENTS, 1986-1987. 1 LOURIE, RICHARD Deposit from Author June 1987, January 1988 I. MANUSCRIPTS 1973, 1985-1987 A. Novels, 1973, 1985, 1987 Box 1 1. FIRST LOYALTY. Harcourt Brace Jovanovich, 1985. a. Holograph on legal notepads (7), ca. 275 p. (#1) b. Draft. Under title STOLAT. Typescript with holo. corr., ca. 400 p. (#2) Box 1/2 c. Setting copy. Typescript with holo. corr., ca. 540 p. including front matter. (Box 1, #3; Box 2, #1) Box 2 d. Misc. draft pages. Typescript with holo. corr., 6 p. (#2) e. Outline. Holograph, 7 p. on 6 leaves. (#2) 2. SAGITTARIUS IN WARSAW. Vanguard Press, 1973. a. Setting copy. Typescript photocopy and typescript, both with holo. corr. 164 p. including front matter. (#3) b. Galley proofs. (#4) 3. ZERO GRAVITY. Harcourt Brace Jovanovich, 1987. a. Outlines and draft pages. 5 legal notepads, holograph, 141 p. (#5 - 6) b. Miscellaneous draft pages and notes. Typescript with holo. corr. and holograph, ca. 55 p. (#7) Box 3 c. Miscellaneous draft pages. Typescript with holo. corr. and holograph, ca. 65 p. (#1) d. Miscellaneous draft pages. Typescript with holo. corr., photocopy of typescript with holo. corr., and holograph, ca. 400 p. (#2) e. -

J.B.METZLER Metzler Lexikon Weltliteratur
1682 J.B.METZLER Metzler Lexikon Weltliteratur 1000 Autoren von der Antike bis zur Gegenwart Band 1 A-F Herausgegeben von Axel Ruckaberle Verlag J. B. Metzler Stuttgart . Weimar Der Herausgeber Bibliografische Information Der Deutschen National Axel Ruckaberle ist Redakteur bei der Zeitschrift für bibliothek Literatur »TEXT+ KRITIK«, beim >>Kritischen Lexikon Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur<< (KLG) und Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; beim >>Kritischen Lexikon zur fremdsprachigen detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über Gegenwartsliteratur<< (KLfG). <http://dnb.d-nb.de> abrufbar. Rund die Hälfte der in diesen Bänden versammelten Autorenporträts stammen aus den folgenden Lexika: >>Metzler Lexikon englischsprachiger Autorinnen und Autoren<<, herausgegeben von Eberhard Kreutzer und ISBN-13: 978-3-476-02093-2 Ansgar Nünning, 2002/2006. >>Metzler Autoren Lexikon<<, herausgegeben von Bernd Lutz und Benedikt Jeßing, 3. Auflage 2004. ISBN 978-3-476-02094-9 ISBN 978-3-476-00127-6 (eBook) »Metzler Lexikon amerikanischer Autoren<<, heraus DOI 10.1007/978-3-476-00127-6 gegeben von Bernd Engler und Kurt Müller, 2000. »Metzler Autorinnen Lexikon«, herausgegeben von Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheber rechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Ute Hechtfischer, Renate Hof, Inge Stephan und engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Flora Veit-Wild, 1998. Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das >>Metzler Lexikon -

Explaining the Self: a Contextual Study of Saul Bellow, Philip Roth and Joseph Heller
EXPLAINING THE SELF: A CONTEXTUAL STUDY OF SAUL BELLOW, PHILIP ROTH AND JOSEPH HELLER. DAVID LEON GIDEON BRAUNER PhD THESIS UNIVERSITY COLLEGE LONDON ProQuest Number: 10044352 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest 10044352 Published by ProQuest LLC(2016). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 ABSTRACT I offer an exploration of the work of these three contemporary novelists, focusing on the phenomenon of self-explanation - both in the sense of justifying oneself, and o f seeking to define the nature o f selfhood. I identify three roles in which (and against which) these self-explanations take place; as writers o f comedy, as Jewish writers, and as American writers. Although these roles overlap, I treat them as distinct for the purposes o f structural clarity and contextualise them by locating them in related literary and cultural traditions. I am particularly concerned with the ambivalent attitudes that these writers display towards these roles; with the tensions between - and within - their theory and practice. The thesis is divided into three chapters, framed by an introduction and conclusion. -

Albo D'oro Dei Vincitori Del Mondello
Albo d’Oro dei vincitori del Premio Letterario Internazionale Mondello 1975 BARTOLO CATTAFI, letteratura UGO DELL’ARA, teatro DENIS MCSMITH, Premio speciale della Giuria 1976 ACHILLE CAMPANILE, letteratura ANTONINO ZICHICHI, scienze fisiche DOMENICO SCAGLIONE, scienze finanziarie FELICE CHILANTI, giornalismo FRANCESCO ROSI, cinema GIAMPIERO ORSELLO, informazione PAOLA BORBONI, teatro 1977 GÜNTER GRASS, letteratura SERGIO AMIDEI, SHELLEY WINTERS, cinema ROMOLO VALLI, ROBERTO DE SIMONE, teatro GIULIANA BERLINGUER, EMILIO ROSSI, televisione PIETRO RIZZUTO, lavoro STEFANO D’ARRIGO, Premio speciale della Giuria 1978 MILAN KUNDERA, Il valzer degli addii (Bompiani), narrativa straniera GHIANNIS RITSOS, Tre poemetti (Guanda), poesia straniera CARMELO SAMONÀ, Fratelli (Einaudi), opera prima narrativa GIOVANNI GIUGA, Poesie da Smerdjakov (Lacaita), opera prima poetica ANTONELLO AGLIOTTI, FRANCO CHIARENZA, MUZI LOFFREDO, GIOVANNI POGGIALI, GIULIANO VASILICÒ, teatro JURIJ TRIFONOV, Premio speciale della Giuria 1979 N. S. MOMADAY, Casa fatta di alba (Guanda), narrativa straniera JOSIF BRODSKIJ, Fermata nel deserto (Mondadori), poesia straniera FAUSTA GARAVINI, Gli occhi dei pavoni (Vallecchi), PIERA OPPEZZO, Minuto per minuto (La Tartaruga), opera prima narrativa GILBERTO SACERDOTI, Fabbrica minima e minore (Pratiche), opera prima poetica LEO DE BERARDINIS, PERLA PERAGALLO, teatro JAROSLAW IWASZKIEVICZ, Premio speciale della Giuria 1980 JUAN CARLOS ONETTI, Gli addii (Editori Riuniti), narrativa straniera JUAN GELMAN, Gotan (Guanda), poesia straniera -

Wmrbiblioteka2
Kule, dnia 19 listopada 2020 roku INFORMACJA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U, z 2019r. poz. 2004) Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego Skarbu Państwa do zagospodarowania. 1. Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach w Kaliszu ul. Wrocławska 193-195 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 2. Sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego nastąpi zgodnie z §36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2004). 3. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w §38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2004). 4. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w §39 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2004). 5. Zainteresowani nabywcy proszeni są o przesłanie wniosków do dnia 25 listopada 2020 roku na adres Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, Kule 2, 42 – 110 Popów (adres e-mail: [email protected]). 6. W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby innych jednostek Służby Więziennej. 7. Dodatkowych informacji w sprawie niżej wymienionych składników udziela kierownik działu kwatermistrzowskiego pod nr 34 310 40 40, VoIP 6004070. Stopień L.P Nazwa składnika J. m. Ilość Kod mat. zł /jednostka zużycia Szlakiem Lenina : pejzaże Włodzimierza Zakrzewskiego / 601-000078- 1 0% 0,02 zł Włodzimierz Zakrzewski. -

MAKING SENSE of CZESLAW MILOSZ: a POET's FORMATIVE DIALOGUE with HIS TRANSNATIONAL AUDIENCES by Joanna Mazurska
MAKING SENSE OF CZESLAW MILOSZ: A POET’S FORMATIVE DIALOGUE WITH HIS TRANSNATIONAL AUDIENCES By Joanna Mazurska Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Vanderbilt University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in History August, 2013 Nashville, Tennessee Approved: Professor Michael Bess Professor Marci Shore Professor Helmut W. Smith Professor Frank Wcislo Professor Meike Werner To my parents, Grazyna and Piotr Mazurscy II ACKNOWLEDGEMENTS I would like to express my gratitude to the members of my Dissertation Committee: Michael Bess, Marci Shore, Helmut Smith, Frank Wcislo, and Meike Werner. Each of them has contributed enormously to my project through providing professional guidance and encouragement. It is with immense gratitude that I acknowledge the support of my mentor Professor Michael Bess, who has been for me a constant source of intellectual inspiration, and whose generosity and sense of humor has brightened my academic path from the very first day in graduate school. My thesis would have remained a dream had it not been for the institutional and financial support of my academic home - the Vanderbilt Department of History. I am grateful for the support from the Vanderbilt Graduate School Summer Research Fund, the George J. Graham Jr. Fellowship at the Robert Penn Warren Center for the Humanities, the Max Kade Center Graduate Student Research Grant, the National Program for the Development of the Humanities Grant from the Polish Ministry of Science and Higher Education, and the New York University Remarque Institute Visiting Fellowship. I wish to thank to my friends at the Vanderbilt Department of History who have kept me company on this journey with Milosz. -

WASHINGTON and LEE UNIVERSITY Department of Sociology and Anthropology
WASHINGTON AND LEE UNIVERSITY Department of Sociology and Anthropology SOAN 225 Krzysztof Jasiewicz Peoples of Central Europe through Literature and Film Newcomb 227 Spring 2017: 9:30 — 12:00 (MTWR) film screenings (Huntley 301) 1:30 – 3:00 (MTRW) lectures/discussions (Huntley 301) Special arrangements: No class April 27 and May 3 and 4, make-up meeting April 28 Course Synopsis: This course provides basic information about the citizens of the Central European nations of Poland, the Czech Republic, and Hungary. Beliefs, attitudes, and value systems of the people of Central Europe are examined against the backdrop of major historical events of the 20th century. Core textbook readings are supplemented by feature films, video materials, novels, short stories, plays, and poetry. Class discussions focus on interpreting these works of art in the context of comparative historical-sociological analysis of the Polish, Czech, and Hungarian cultures and societies. Learning Objectives: (1) Students will acquire a basic understanding of contemporary sociology’s major concepts and theories, in particular in the fields of social stratification, social mobility, cultural sociology, social change, ethnic relations, political sociology, and historical sociology. (2) Students will learn how to apply these concepts and theories in analysis of social structure, culture, economy, and politics in societies different from their own. (3) Students will learn basic facts about Central Europe, a diverse region populated by Poles, Czechs, Slovaks, and Hungarians, as well as Jews, Germans, Russians, and others, and the many challenges its inhabitants faced at the times of two world wars and the rise and fall of totalitarian regimes. -

Censorship of Poetry in Post-Revolutionary Iran (1979 to 2014), Growing up with Censorship (A Memoir), and the Kindly Interrogator (A Collection of Poetry)
Censorship of Poetry in Post-Revolutionary Iran (1979 to 2014), Growing up with Censorship (A Memoir), and The Kindly Interrogator (A Collection of Poetry) Alireza Hassani This thesis is submitted in partial fulfilment of the requirements of Newcastle University for the degree of Doctor of Philosophy School of English Literature, Language and Linguistics Department of Creative Writing November 2015 Abstract The thesis comprises a dissertation, a linking piece and a collection of poems. The dissertation is an analysis of state-imposed censorship in Iranian poetry from 1979 through 2014. It investigates the state's rationale for censorship, its mechanism and its effects in order to show how censorship has influenced the trends in poetry and the creativity of poets during the period studied. The introduction outlines attitudes towards censorship in three different categories: Firstly, censorship as "good and necessary", then censorship as "fundamentally wrong yet harmless or even beneficial to poetry", and lastly, censorship as a force that is always destructive and damages poetry. Chapter one investigates the relevant laws, theories and cultural policies in order to identify the underlying causes for censorship of poetry. Chapter two looks at the structure and mechanism of the censorship apparatus and examines the role of cultural organizations as well as judicial and security forces in enforcing censorship. Chapter three contemplates and explores the reaction of Iranian poets to censorship and different strategies and techniques they adopt to protest, challenge and circumvent censorship. Chapter four analyses the outcome of the relationship between the censorship apparatus and the poets, providing a clear picture of how censorship defines, shapes and presents the poetry produced and published in Iran. -

Philip Roth And
Philip Roth and the “Writers from the Other Europe” Series – The Neglected Books Page 2021-05-08, 3:52 PM Philip Roth and the “Writers from the Other Europe” Series 5 March 2021 In the spring of 1972, fascinated by the life and work of Franz Kafka, Philip Roth decided to visit Prague. He returned the following year to see how writers were managing to work under “conditions that were utterly alien to my own writing experience.” In preparation, he read as much as he could find of the work of contemporary Czech writers. He met and became friends with several writers, which led him to look for works in English translation by novelists working throughout Eastern Europe — still behind the Iron Curtain — since the end of World War Two. from this, he was able to interest Penguin Books in starting a series of https://neglectedbooks.com/?p=7808 Page 1 of 6 Philip Roth and the “Writers from the Other Europe” Series – The Neglected Books Page 2021-05-08, 3:52 PM reprints called “Writers from the Other Europe,” for which he served as general editor. Between 1976 and 1983, the series published a total of 17 books, starting with Kundera’s Laughable Loves and Ludvík Vaculík’s The Guinea Pigs. As Roth wrote, The purpose of this paperback series is to bring together outstanding and influential works of fiction by Eastern European writers. In many instances they will be writers who, though recognized as powerful forces within their own cultures, are virtually unknown in America. It is hoped that by reprinting selected Eastern European writers in this format and with introductions that place each work in its literary and historical context, the literature that has evolved in “the other Europe” during the postwar decades will be made more accessible to an interested American readership.