Guémené-Sur-Scorff. Pays Des Pourleths
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lejournal GUÉMENÉ SUR SCORFF
Octobre 2019 lejournal GUÉMENÉ SUR SCORFF LE JARDIN INTERGÉNÉRATIONNEL MAISON DE SERVICES AU PUBLIC BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE 2 L’édito . p . 2 Permanences des élus . p . 2 Conseil Municipal . p . 3 Élections Européennes . .. p . 3 État civil . p . 3 Gendarmerie . p . 4 Expositions . p . 4 Circuit de l'eau . p . 4 Travaux . p . 5 L édito Maison de Services Au Public . p . 6-7 En cette période de rentrée et nouvelles offres ont été présen- Inauguration de la Maison Limbour . p . 8 de reprise d’activités pour nos tées. Je souhaite la bienvenue à La Croix Rouge . p . 8 établissements scolaires et nos l’association Assoleil qui œuvre ADIL . p . 9 associations, je voudrais tout dans trois disciplines le jonglage, L’Épicerie Centrale . p . 9 d’abord souhaiter une année de les percussions et les bulles Sommaire Saison estivale . .. p . 10-11 réussite pour tous. de savon géantes et à Estelle Coté scolaire, nos collèges et D. qui présente aussi tout un EstelleD . p . 12 écoles ont pu démarrer l’année panel d’activités (ateliers de cui- Katell pour vous . p . 12 dans de bonnes conditions. Au- sines, culture du safran, et bien Résidence Clair Logis. p . 13 cune fermeture de classe et les d’autres) au Café Pointu. CCAS . p . 13 équipes pédagogiques au com- Je vous encourage à aller à la La rentrée des classes . p . 14 plet ont contribué à ce constat. rencontre de ce monde associatif École publique Louis Hubert . p . 14 Coté associations, nous avons riche et varié et je ne doute pas vécu un très beau forum et je que vous trouviez l’activité qui École Saint-Jean-Baptiste . -

L'aër À Pont Tournant
L'Aër à Pont Tournant Dépositaires de cartes de pêche EHE: Dépositaires de cartes de pêche Guémené: Priziac / Le Croisty LIBRAIRIE HUARD MILIN RUCHEC LAKE 7 rue du Soleil Milin Ruchec 56320 LE FAOUET 56540 SAINT-CARADEC TREGOMEL Tél : 02 97 23 08 37 Tél : 02 97 51 63 62 Dépositaire d'assortiments migrateurs BAR TABAC PRESSE LA SOURCE BAR RESTAURANT "LA CROIX DES 7 et 9 Rue des Ecoles NATIONS" 56540 LE CROISTY Ce parcours est non La Croix des Nations Tél : 02 97 51 69 72 labellisé par la Fédération Poisson recherché : Truite Fario. 1ère catégorie : Ouverture du 2ème samedi de Mars au nationale de la pêche en 56240 BERNE 3ème dimanche de Septembre. Taille légale de capture: Truite fario : 23cm et 6 France. Tél : 02 97 34 27 11 AAPPMA GUEMENE SUR SCORFF truites/jour/pêcheur. Longueur du Parcours: 4km. Aménagement disponible : Grand Parking "SOCIETE DE PECHE A LA LIGNE DE à Pont Tournant. Largeur moyenne : 8 m. Profondeur moyenne : 70 cm. AAPPMA DU FAOUET "L'ENTENTE DU GUEMENE SUR SCORFF" HAUT ELLE" M. Rémi LE PROVOST - Président M. Benoit BOGARD - Président 9 place Corentin Le Floc'h 2 rue du Midi 56160 LIGNOL 56770 PLOURAY tél : 02 97 27 05 66 tél : 02 97 34 81 12 E-mail : [email protected] L'Aër est un affluent de la rive gauche de la rivière Site Internet : Site Internet : Ellé. Il est également appelé "rivière du Pont-Rouge" http://ehe-lefaouet-plouray.clubeo.com http://peche56.wix.com/aappmaguemene (du nom du pont qui franchit le cours d'eau entre les bourgs de Priziac et Le Croisty). -

Direction Des Services Départementaux De L'éducation
Ste-Brigitte St-Aignan Gourin Langonnet Plouray Roudouallec Silfiac Kergrist Cléguérec Croixanvec Le Saint Langoëlan St-Gonnery St-Tugdual Ploerdut Séglien Neuillac St-Gérand Ménéac Le Gueltas Brignac Faouët Le Croisty Guémené/Scorff Rohan Guiscriff Priziac Pontivy La Trinité Porhoët Locmalo Evriguet St-Brieuc St-Caradec Malguénac Noyal-Pontivy de Mauron St-Léry Trégomel Lignol Bréhan Guern Le Sourn Kerfourn Mohon Mauron Lanvénégen Kernascléden Persquen Crédin Guilliers Concoret Meslan St Thuriau Les Forges Bieuzy Berné St-Malo des Les Eaux Naizin Trois Fontaines Néant/Yvel Bubry Moustoir Pleugriffet La Grée Melrand Réguiny St-Laurent Inguiniel Remungol Lannoué Tréhorenteuc Pluméliau Loyat La Croix Hélléan Plouay Radenac Hélléan Lantillac Taupont St-Barthélèmy Josselin Campénéac Beignon Moréac St-Malo de Beignon Lanvaudan Quistinic Remungol Guégon Buléon Guillac Gourhel Calan Guénin St-Allouestre St-Servant Cléguer Baud Plumelin Guéhenno Ploërmel Augan Porcaro Pont- sur Oust Locminé Bignan Montertelot Guer Scorff Inzinzac Quily La Chapelle Neuve Billio Cruguel Monterrein Languidic Le Roc La Chapelle Lizio St-AndréCaro Monteneuf Caudan Camors Moustoir-Ac Caro Gestel Hennebont St-Jean Réminiac Guidel St-Abraham Brandérion Brévelay Quéven Colpo Plumelec Sérent St-Marcel Missiriac Ruffiac Tréal Quelneuc Lanester Brandivy Malestroit Carentoir Kervignac Pluvigner Lorient Nostang Landévant GrandchampLocqueltas St-Laurent Plaudren Trédion Bohal sur Oust St-Nicolas Ploëmeur Merlevenez St-Guyomard St-Congard du Tertre La Chapelle Locmiquélic Landaul -
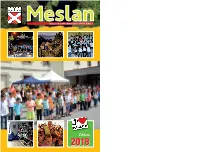
Meslan Bulletin 2018.Pdf
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES Édition 2200 1818 Horaires de la Mairie Meslan en chiffres • Lundi : 9h à 12h Sommaire 14h à 17h État-civil • Mardi : 9h à 12h Édito 3 er 14h à 17h •1 452 habitants (au 1 janvier 2018) Du côté de la mairie 4 En 2017, 14 naissances, 11 décès et 2 mariages • Mercredi : 9h à 12h • Jeudi : 9h à 12h Du côté du CCAS 7 Urbanisme en 2017 14h à 17h Travaux 8 • Vendredi : 9h à 12h 37 certificats d’urbanisme, 18 dossiers de demande préalable, Environnement et cadre de vie 9 11 dossiers de permis de construire, 4 Lots disponibles au Lotissement de Parc Er Mare 14h à 17h • Samedi : 9h à 12h Trucs et astuces 10 Vie scolaire et périscolaire à la rentrée scolaire 2017/2018 Enfance et jeunesse 12 165 enfants scolarisés 8 classes 2 écoles (1 publique / 1 privée) 95 : nombre moyen de repas / jour servis à la cantine en 2017 Contact École Publique de l’Arbre Jaune 13 École Notre-Dame 15 Finances communales Tél : 02 97 34 25 76 Fax : 02 97 34 31 76 Vie associative 17 Dépenses en 2017 : (hors remboursement de dette) : 771 674 € [email protected] soit 533 € par habitant (moyenne des communes de 500 à 2000 habitants : 970 €) Rétro 21 Endettement au 01/01/2018 : 185€ / habitant (moyenne des communes de 500 à 2000 habitants Clins d’œil 24 au 01/01/2017 : 611€/ habitant) WWW. MESLAN .FR Depuis 2008 : aucun emprunt ! @ Contacts utiles 26 Début 2020 : fin des emprunts (sous réserve de projets ultérieurs nécessitant d’éventuels emprunts) Depuis 2012 : 0% = Augmentation des taux des impôts locaux Chers Amis, Santé édito L’évolution positive de la population se confirme, nous sommes aujourd’hui près de 1450 habitants, 1 médecin, 1 dentiste, 1 cabinet infirmier 1 pharmacie ce qui nous ramène à la population de 1990. -

LYCEES DE GOURIN 02 97 01 22 86 - Communes Desservies : Berné, Le Faouët, Lorient, Meslan, Plouay Et Scaër
LYCEES DE GOURIN 02 97 01 22 86 - www.lactm.com Communes desservies : Berné, Le Faouët, Lorient, Meslan, Plouay et Scaër. Année scolaire 2019 / 2020 Entrée de 8h00 Lundi ou jour de rentrée pour les internes Lundi ,Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi Lundi ,Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 1506 (car CTM) Fait par les cars Christien 1505 06:35 LORIENT Gare d'échanges 06:56 BERNE PELLEAN 07:10 Carhaix Gare SNCF 06:41 LANESTER Parc des Expositions 06:57 BERNE KERGAER 07:15 Carhaix République 07:05 PLOUAY CIMETIERE 07:00 BERNE PL EGLISE 07:16 Carhaix Hôpital 07:15 BERNE PLACE DE L'EGLISE 07:09 MESLAN PLACE DE L'EGLISE 07:21 Port de Carhaix 07:22 MESLAN PLACE DE L'EGLISE 07:20 LE FAOUET PLACE DES HALLES 07:31 Motreff Moulin Neuf 07:32 LE FAOUET PLACE DES HALLES 07:24 LE FAOUET LA FOURMI ROUGE 07:32 Motreff Gare 07:45 GOURIN MAIRIE (pour lycées) 07:26 LE FAOUET RESTALGON 07:36 Gourin Guernéac'h 07:50 GOURIN C. JEANNE D'ARC 07:30 LE FAOUET OUARIOUA 07:45 Dépose dans les Ets de Gourin 07:33 LE FAOUET KERANROUE 07:49 GOURIN JEANNE D'ARC 07:53 GOURIN CHATEAUBRIAND 07:57 GOURIN LYCEE ST YVES Sortie de 16h30 Mercredi Lundi, Mardi, Jeudi,Vendredi Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,Vendredi Vendredi pour les internes Fait par les cars Christien Fait par les cars Christien 1518 1513 (car CTM) 16:40 GOURIN C. JEANNE D'ARC 16:40 GOURIN C. JEANNE D'ARC 16:45 GOURIN C. JEANNE D'ARC 16:50 GOURIN Lycée J. -

A Tla S C a R to G R a P H Iq
SYNDICAT MIXTE ELLE-ISOLE-LAÏTA INVENTAIRE DES ZONES QUE D’EXPANSION DES CRUES BASSINS VERSANTS ELLE, ISOLE, DOURDU Source : R.LE BARS, QUIMPERLE COMMUNAUTE ATLAS CARTOGRAPHIQUE ZONES D’EXPANSION DES CRUES PROBABLES COMMUNE DE BERNE MAI 2017 CARTOGRAPHI Source : R.LE BARS, QUIMPERLE COMMUNAUTE ATLAS INVENTAIRE DES ZONES D'EXPANSION DES CRUES ATLAS DES ZONES D'EXPANSION DES CRUES PROBABLES BASSINS VERSANTS ELLÉ, ISOLE, DOURDU MAI SYNDICAT MIXTE ELLÉ-ISOLE-LAÏTA 2017 CARTE GÉNÉRALE - LÉGENDE DES PLANCHE S Plonévez-du-Faou Châteauneuf-du-Faou Motreff Plévin Plouguernével Saint-Hernin Paule Rostrenen Spézet Tréogan Glomel Saint-Goazec Mellionnec Plélauff Laz Gourin Lescouët-Gouarec Langonnet Roudouallec Plouray Langoëlan Leuhan Le Saint Langoëlan LÉGENDE DES PLANCHES ATLAS Coray Saint-Tugdual Ploërdut ZEC PROBABLES Tourch ZEC probables RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE Le Croisty Priziac Cours d'eau (inventaires communaux) Guiscriff Le Faouët Scaër Limites du bassin versant DONNÉES CADASTRALES Saint-Caradec-Trégomel Parcelles cadastrales Lignol Lanvénégen Périmètre de la commune concernée Kernascléden INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Persquen Meslan Périmètre des communes limitrophes Berné Rosporden Bubry Saint-Thurien Querrien Inguiniel Bannalec Guilligomarc'h Melgven Locunolé Plouay INVENTAIRE DES ZEC PROBABLES Tréméven Mellac Le Trévoux ZEC probables Arzano Pont-Aven Limites du bassin versant INFORMATIONS COMPLÉMLaEnNvaTuAdaIRn ES Quimperlé Calan Cléguer Riec-sur-Bélon Inzinzac-Lochrist Baye Rédené Communes Névez Pont-Scorff Inzinzac-Lochrist Moëlan-sur-Mer -

Prefecture Du Morbihan Demande D'autorisation
PREFECTURE DU MORBIHAN DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE PARC EOLIEN DE LA MADELEINE COMMUNE DE PLOERDUT ENQUETE PUBLIQUE 10 décembre 2018 – 10 janvier 2019 1ère Partie : RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR Commissaire enquêteur : Christian JOURDREN Enquête publique E180266 SOMMAIRE DU RAPPORT 1. Objet de l’enquête et élaboration du projet 1.1. Objet de l’enquête 1.2. Elaboration du projet et communication 1.2.1. Contexte 1.2.2. Elaboration du projet 1.2.3. Communication du maitre d’ouvrage autour du projet 2. Organisation et déroulement de l’enquête publique 2.1. Présentation du dossier d’enquête 2.2. Cadre juridique 2.3. Organisation de l’enquête 2.3.1. Décision du Tribunal Administratif portant désignation du commissaire-enquêteur 2.3.2. Arrêté municipal portant ouverture de l’enquête publique 2.3.3. Lieu de consultation du dossier d’enquête et de mise à disposition du registre d’enquête 2.3.4. Définition des permanences du commissaire-enquêteur (lieu et dates) 2.3.5. Information du public (publicité de l’enquête) 2.3.5.1. Information préalable à l’enquête 2.3.5.2. Parution des avis d’ouverture dans la presse 2.3.5.3. Affichage des avis d’ouverture d’enquête 2.3.5.4. Information via internet 2.3.6. Réunions préparatoires à l’enquête 2.4. Visites des lieux 2.5. Déroulement de l’enquête 2.5.1. Conditions d’accueil du public 2.5.2. Ambiance générale de l’enquête publique 2.5.3. Etat des permanences 2.5.4. Clôture de l’enquête 2.5.5. -

LYCEES DE LORIENT 02 97 01 22 87 - Communes Desservies : Berné, Carhaix, Gourin, Guémené/Scorff, Kernascléden, Le Faouët, Le Saint, Lignol Et Meslan
LYCEES DE LORIENT 02 97 01 22 87 - www.lactm.com Communes desservies : Berné, Carhaix, Gourin, Guémené/Scorff, Kernascléden, Le Faouët, Le Saint, Lignol et Meslan. Année scolaire 2020 / 2021 Entrée de 8h00 Entrée de 9h00 Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 1501 1517 1503 1505 05h55 CARHAIX Gare SNCF 06:33 GUEMENE 08:00 LE FAOUET LES HALLES 07:10 CARHAIX Gare SNCF 06h00 CARHAIX REPUBLIQUE 06:42 LIGNOL 08:08 MESLAN PLACE DE L'EGLISE 07:15 CARHAIX REPUBLIQUE 06h01 CARHAIX Hôpital 06:50 KERNASCLEDEN 08:13 BERNE MAIRIE 07:16 CARHAIX Hôpital 06h06 CARHAIX PORT DE CARHAIX 07:05 PLOUAY MANERIO 08:18 BERNE KERHOAT 07:21 CARHAIX PORT DE CARHAIX 06:11 MOTREFF MOULIN NEUF 08:19 BERNE PONTOUZIC 07:31 MOTREFF MOULIN NEUF 06:12 MOTREFF GARE 08:20 BERNE POULHIBET 07:32 MOTREFF GARE 06:16 GOURIN GUERNEAC'H 08:22 PLOUAY MANERIO (A) 07:36 GOURIN GUERNEAC'H 06:20 GOURIN MAIRIE 08:25 PLOUAY CIMETIERE (A) 07:40 GOURIN MAIRIE 06:44 LE FAOUET LES HALLES 08:45 LANESTER PARC DES EXPOS (A) 08:06 LE FAOUET LES HALLES 06:52 MESLAN PLACE DE L'EGLISE Pour les lycées d'Hennebont : correspondance 08:50 LANESTER LES HALLES Lycée J Macé 08:35 LANESTER PARC DES EXPOS (A) 06:58 BERNE MAIRIE possible avec un car à Plouay Manério. 08:55 LORIENT GARE D'ECHANGES 08:40 LANESTER LES HALLES Lycée J Macé Hennebont Place Foch 7h30, Emile Zola 7h35 et 07:03 BERNE KERHOAT 09:00 SECURITE SOCIALE 08:50 LORIENT GARE D'ECHANGES Victor Hugo à 7h40. -
Transports Scolaires En Morbihan Communes Desservies Et Établissements De Rattachement
Transports scolaires en Morbihan Communes desservies et établissements de rattachement Commune(s) Collège(s) public(s) Collège(s) privé(s) Lycée(s) public(s) Lycée(s) privé(s) ALLAIRE REDON ALLAIRE REDON REDON AMBON MUZILLAC MUZILLAC QUESTEMBERT VANNES ARRADON [1] Golfe Morbihan Vannes Agglo [1] Golfe Morbihan Vannes Agglo [1] Golfe Morbihan Vannes Agglo [1] Golfe Morbihan Vannes Agglo ARZAL MUZILLAC MUZILLAC QUESTEMBERT VANNES ARZON [1] Golfe Morbihan Vannes Agglo [1] Golfe Morbihan Vannes Agglo [1] Golfe Morbihan Vannes Agglo [1] Golfe Morbihan Vannes Agglo AUGAN PLOËRMEL PLOËRMEL GUER PLOËRMEL AUGAN GUER GUER AURAY AURAY BRECH AURAY [9] secteur d'AURAY BADEN [1] Golfe Morbihan Vannes Agglo [1] Golfe Morbihan Vannes Agglo [1] Golfe Morbihan Vannes Agglo [1] Golfe Morbihan Vannes Agglo BADEN AURAY [9] secteur d'AURAY BANGOR LE PALAIS LE PALAIS BAUD BAUD BAUD HENNEBONT HENNEBONT BAUD PONTIVY PONTIVY BÉGANNE REDON ALLAIRE REDON REDON BEIGNON GUER GUER GUER PLOËRMEL BELZ ÉTEL CARNAC AURAY [9] secteur d'AURAY BELZ HENNEBONT HENNEBONT BERNÉ LE FAOUËT LE FAOUËT [5] secteur de LORIENT [5] secteur de LORIENT BERNÉ PLOUAY [4] PLOUAY QUIMPERLÉ GOURIN BERRIC QUESTEMBERT QUESTEMBERT QUESTEMBERT VANNES PLUMÉLIAU-BIEUZY-BIEUZY LES EAUX PONTIVY PONTIVY PONTIVY PONTIVY BIGNAN LOCMINÉ LOCMINÉ PONTIVY PONTIVY BIGNAN ST-JEAN BRÉVELAY ST-JEAN BRÉVELAY VANNES VANNES BILLIERS MUZILLAC MUZILLAC QUESTEMBERT VANNES BILLIO PLOËRMEL BILLIO ST-JEAN BRÉVELAY ST-JEAN BRÉVELAY VANNES VANNES BOHAL MALESTROIT MALESTROIT QUESTEMBERT PLOËRMEL BRANDÉRION [2] LORIENT AGGLOMERATION -

Population Totale
PLU i ROI MORVAN COMMUNAUTE Plan Local d’Urbanisme Intercommunal DIAGNOSTIC TERRITORIAL Version amendée suite à la présentation aux membres du Comité Technique (CoTech) lors de la réunion du 9 décembre 2016 1 SOMMAIRE Principaux éléments du diagnostic 1. Population 2. Habitat 3. Economie 4. Environnement 5. Paysage Version du 22/09/2017 > > > DOCUMENT DE TRAVAIL 2 DIAGNOSTIC « POPULATION» 3 DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE Evolution de la population totale Analyse de la « population totale » démographique poids leur selon communes des Répartition .Population totale 25 617 habitants selon INSEE 2013 .Répartition en 3 catégories de communes Les « très petites » communes de moins de 1000 habitants (11 communes) sont plus particulièrement Carte 1 concentrées à l’est du territoire communautaire, dans l’ancien canton de Guémené-sur-Scorff (carte1) Les « petites » communes comptant de 1000 à 2500 habitants (8 communes) couvrent l’ensemble du territoire communautaires (carte 2) Carte 2 Les 2 communes de plus de 2500 habitants Le Faouët et Gourin qui comptent respectivement 2822 et 4079 habitants (carte 3) Carte 3 Version du 22/09/2017 > > > DOCUMENT DE TRAVAIL 4 DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE Evolution de la population totale .Evolution RMCom globalement négative au cours de la période de 1968-2013 en 2 étapes : Baisse démographique de l’ordre de -10 000 habitants entre 1968 et la fin des années 1990 Stagnation démographique qui est la situation actuelle et qui perdure depuis le début des années 2000. La situation de stagnation de RMCom constatée depuis le début des années 2000 est différemment « vécue » à l’échelle des communes faisant apparaître 3 situations (d’après évol pop totale 2008-2013) : Décroissance démographique (en rouge) Les 10 communes qui connaissent une baisse démographique : Gourin, Guiscriff, Le Saint, Langonnet, Lanvénégen, Le Faouët, Ploerdut, Priziac, Saint-Caradec-Trégomel et Guémené-sur- Scorff. -

Horaires Des Trajets Vers Les Établissements Scolaires
Horaires des trajets vers les établissements scolaires XRM120 - Vers Le Faouët Lundi - Mardi- Jeudi- Vendredi GUISCRIFF Commune Arrêt Horaire GUISCRIFF LEURIER CROAJOU 07:53 GUISCRIFF KERGUIVARECH 07:56 LE FAOUET COLL.STE BARBE 08:06 Lundi - Mardi- Jeudi- Vendredi GUISCRIFF - LANVENEGEN Commune Arrêt Horaire LE FAOUET COLL.STE BARBE 17:00 LE FAOUET COLL.JC CARRE 17:05 GUISCRIFF KERGUIVARECH 17:14 GUISCRIFF LEURIER CROAJOU 17:16 LANVENEGENKERHARGOUR 17:24 Mercredi GUISCRIFF Commune Arrêt Horaire LE FAOUET COLL.STE BARBE 12:00 GUISCRIFF KERGUIVARECH 12:10 GUISCRIFF LEURIER CROAJOU 12:12 Horaires prévisionnels 1 XRM121 - Vers Le Faouët Lundi - Mardi- Jeudi- Vendredi LANVENEGEN - LE FAOUET Commune Arrêt Horaire LANVENEGENVETVEUR (vers Lanvénégen) 07:35 LANVENEGENVETVIHAN 07:37 LANVENEGENGUERN VIHAN INTER- 07:38 LANVENEGENTRAOUMAN INTER- 07:42 LANVENEGENKERGOFF D EN BAS 07:43 LANVENEGENCROIX DE KEROUAL 07:44 LANVENEGENKERHELLOU INTER 07:46 LANVENEGENLE LIJOU INTER- 07:49 LANVENEGENLE CLEUSTROU 07:50 LANVENEGENQUILLOTEN INTERS. 07:51 LANVENEGENLE STERLE 07:53 LANVENEGENLE RHEDE (entrée village) 07:55 LE FAOUET PARC CHARLES 07:58 LE FAOUET COLL.JC CARRE 08:01 LE FAOUET COLL.STE BARBE 08:05 Lundi - Mardi- Jeudi- Vendredi LANVENEGEN - LE FAOUET Commune Arrêt Horaire LE FAOUET COLL.STE BARBE 17:05 LE FAOUET COLL.JC CARRE 17:09 LANVENEGENVETVEUR (vers Lanvénégen) 17:15 LANVENEGENVETVIHAN 17:16 LANVENEGENGUERN VIHAN INTER- 17:18 LANVENEGENTRAOUMAN INTER- 17:22 LANVENEGENKERGOFF D EN BAS 17:23 LANVENEGENCROIX DE KEROUAL 17:24 LANVENEGENKERHELLOU INTER -

A Tla S C a R to G R a P H Iq
SYNDICAT MIXTE ELLE-ISOLE-LAÏTA INVENTAIRE DES ZONES QUE D’EXPANSION DES CRUES BASSINS VERSANTS ELLE, ISOLE, DOURDU Source : R.LE BARS, QUIMPERLE COMMUNAUTE ATLAS CARTOGRAPHIQUE ZONES D’EXPANSION DES CRUES PROBABLES COMMUNE DE SAINT-CARADEC-TREGOMEL MAI 2017 CARTOGRAPHI Source : R.LE BARS, QUIMPERLE COMMUNAUTE ATLAS INVENTAIRE DES ZONES D'EXPANSION DES CRUES ATLAS DES ZONES D'EXPANSION DES CRUES PROBABLES BASSINS VERSANTS ELLÉ, ISOLE, DOURDU MAI SYNDICAT MIXTE ELLÉ-ISOLE-LAÏTA 2017 CARTE GÉNÉRALE - LÉGENDE DES PLANCHE S Plonévez-du-Faou Châteauneuf-du-Faou Motreff Plévin Plouguernével Saint-Hernin Paule Rostrenen Spézet Tréogan Glomel Saint-Goazec Mellionnec Plélauff Laz Gourin Lescouët-Gouarec Langonnet Roudouallec Plouray Langoëlan Leuhan Le Saint Langoëlan LÉGENDE DES PLANCHES ATLAS Coray Saint-Tugdual Ploërdut ZEC PROBABLES Tourch ZEC probables RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE Le Croisty Priziac Cours d'eau (inventaires communaux) Guiscriff Le Faouët Scaër Limites du bassin versant DONNÉES CADASTRALES Saint-Caradec-Trégomel Parcelles cadastrales Lignol Lanvénégen Périmètre de la commune concernée Kernascléden INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Persquen Meslan Périmètre des communes limitrophes Berné Rosporden Bubry Saint-Thurien Querrien Inguiniel Bannalec Guilligomarc'h Melgven Locunolé Plouay INVENTAIRE DES ZEC PROBABLES Tréméven Mellac Le Trévoux ZEC probables Arzano Pont-Aven Limites du bassin versant INFORMATIONS COMPLÉMLaEnNvaTuAdaIRn ES Quimperlé Calan Cléguer Riec-sur-Bélon Inzinzac-Lochrist Baye Rédené Communes Névez Pont-Scorff Inzinzac-Lochrist