Combustion De L'ancien Terril Dit Parc À Bois
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
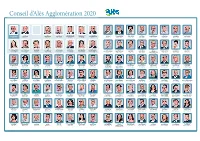
Conseil D'alès Agglomération 2020
Conseil d’Alès Agglomération 2020 ALÈS ALÈS ALÈS ALÈS SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX LA GRAND-COMBE LA VERNARÈDE SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES SAINT-PAUL-LA-COSTE CHAMBON CONCOULES SÉNÉCHAS LES PLANS SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON Christophe RIVENQ Max ROUSTAN Valérie MEUNIER Aimé CAVAILLÉ Jean-Charles BÉNÉZET Philippe RIBOT Patrick MALAVIEILLE Henri CROS Jean-Michel BUREL Adrien CHAPON Marc SASSO Jean-Marie MALAVAL René MEURTIN Gérard BARONI Patrick JULLIAN Président 1er vice-président 3e vice-présidente 4e vice-président 5e vice-président 6e vice-président 7e vice-président Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES ROUSSON SAINT-JEAN-DU-GARD LÉZAN MÉJANNES-LÈS-ALÈS CHAMBORIGAUD MASSILLARGUES-ATUECH CASTELNAU-VALENCE SERVAS MASSANES AUJAC SEYNES CORBÈS SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES LAMELOUZE SOUSTELLE Jennifer WILLENS Ghislain CHASSARY Michel RUAS Éric TORREILLES Christian TEISSIER Patrick DELEUZE Aurélie GÉNOLHER Christophe BOUGAREL Roch VARIN D’AINVELLE Laurent CHAPELLIER Firmin PEYRIC Thierry JONQUET Monique Georges DAUTUN Laure BARAFORT Georges RIBOT 8e vice-présidente 9e vice-président 10e vice-président 11e vice-président 12e vice-président 13e vice-président 14e vice-présidente 15e vice-président Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau CRESPON-LHERISSON Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS ANDUZE SALINDRES SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS -

Cité Des Métiers Du Gard 4 De L’Économie Et D’Accompagnement Vers L’Emploi
s’engage pour l’emploi www.gard.fr www.citedesmetiers.gard.fr Créer Cité son entreprise des Métiers du Gard PROGRAMME d’aCTIONS 2014 2e semestre Trouver un emploi PAR THÈMES Choisir sa formation Construire son projet professionnel ENTRÉE THÉMATIQUE DES INITIATIVES Édito 3 Le Conseil général est sur le front de l’emploi. Bien que la loi ne lui en donne pas obligation, il développe une série d’initiatives d’impulsion La Cité des Métiers du Gard 4 de l’économie et d’accompagnement vers l’emploi. Une des plus novatrices est la Cité des Métiers CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL 6 du Gard : des lieux d’accueil où, anonymement, CHOISIR UNE FORMATION 8 gratuitement, sans formalités, chacun peut TROUVER UN EMPLOI 10 trouver des informations pour construire son projet professionnel, choisir sa formation, créer CRÉER SON ENTREPRISE 12 son entreprise ou reprendre une activité, trouver CHANGER SA VIE PROFESSIONNELLE 14 un emploi ou changer sa vie professionnelle. Les LES FORUMS DES MÉTIERS ET DE L'EMPLOI 15 différents sites du Vigan, ATELIERS PRATIQUES 16 d’Alès et de Vauvert, de Bagnols-sur-Cèze, de Beaucaire et de Nîmes ajoutent à leur panoplie des “ateliers” d’information et d’échange sur une série de thèmes concernant le parcours professionnel. Avec pour objectif de permettre à des Gardois de trouver un appui efficace dans leur parcours professionnel. Damien ALARY Président du Conseil général du Gard Vice-Président de la Région Languedoc-Roussillon Direction du développement, de l’économie et de l’emploi - Hôtel du Département 3, rue Guillemette -

Petit Journal Du Vigan N°22
N°22 TITRE DE RUBRIQUE 1 12/2019 le Vigan fait son cinéma protège l’environnement les bonnes pratiques Du débroussaillement à l’emploi du feu p. 3 p. 4-5 p. 12 p. 14 CAMPUS CONNECTÉ AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT HISTOIRE LE PETIT JOURNAL DU VIGAN N° 22 2 EDITO ERIC DOULCIER d’étudiants se sont inscrits, alors que nous en peronnes à mobilités réduites. attendions qu’entre six et dix. Pour la rentrée Nous continuons, pour les mêmes raisons sur prochaine, nous candidatons pour un deu- le boulevard des châtaigniers. xième tuteur afin d’augmenter le nombre Être acteur du territoire c’est aussi mettre en d’étudiants à une trentaine. Par ailleurs, la avant les forces vives du territoires. faculté des sciences de Montpellier viendra elle aussi installer une licence environnement C’est pourquoi le spectacle de fin d’année sur au Vigan pour la prochaine rentrée. Là aussi il la façade de la mairie qui va prendre posses- faut que chacun se saisisse de cette réussite. sion des lieux pendant 15 jours avec des pro- Entreprises, institutions, développeurs, popu- jections d’images s’intitule « le Vigan fait son lation pour faire de cet équipement un des cinéma ». Nous vous invitons tous à partager fleurons de notre territoire. ce moment pensé et imaginé par l’association C’est dans l’éducation et les apprentissages viganaise WAKO avec le concours des habi- que se prépare l’avenir de tous. Chaque année tants du vigan. nous investissons beaucoup pour notre école. Enfin être acteur du territoire c’est participer Cela faisait longtemps que le Tour de France Cette année un orchestre à l’école a vu le jour. -

Maquet Cdc 19-20.Indd
SAISON CULTURELLE 2O19/2O20 THÉÂTRE D’ALLÈGRELESFUMADES COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CÈZECÉVENNES THÉÂTRE . MUSIQUE . CHANSON . DANSE . HUMOUR . CIRQUE . ARTS DE LA RUE La Région Occitanie est fière d’être un partenaire fidèle de La maison de l’eau. Elle offre, à nouveau, pour la saison 2019-2020 une programmation riche, d’une grande diversité de propositions : musicales, théâtrales, chorégraphiques, circassiennes, avec toujours une large place donnée au jeune public. Le public pourra, comme chaque saison, assister à des spectacles de compagnies régionales dont je vous invite à découvrir le travail. La maison de l’eau participe à l’aménagement culturel du territoire. Elle s’inscrit pleinement dans les axes de la stratégie régionale pour la culture et le patrimoine. Elle permet à des artistes de trouver des espaces de représentation, et de rencontrer les publics, sur tout le territoire de la Communauté de Communes De Cèze-Cévennes. Je tiens ici à saluer l’engagement de toute l’équipe de La maison de l’eau. Elle accueille régulièrement des artistes en résidence et permet au public de découvrir des créations. Belle saison à toutes et tous ! Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée La nouvelle saison culturelle de La maison de l’eau s’annonce encore riche en découverte et en émotion. Et s’il est bien un lieu dans le Gard qui a parfaitement saisi les enjeux de la collaboration et de l’importance des réseaux, c’est, sans aucun doute, le Centre de Développement Culturel. De plus, cette démarche fait écho au travail que mène actuellement le Département en lien avec les acteurs culturels du Gard pour un futur schéma départemental de la Culture à l’horizon 2020. -

51Ème ETOILE DE BESSEGES - TOUR DU GARD Vendredi 5 Février 2021 > 3Ème Étape : Grand Prix De Bessèges - C.C
51ème ETOILE DE BESSEGES - TOUR DU GARD Vendredi 5 février 2021 > 3ème étape : Grand Prix de Bessèges - C.C. de Cèze Cévennes "Souvenir Raymond Poulidor" 156,9 km Horaires Horaires Routes Itinéraires Km Km Observations 44 Km/h 40 Km/h parcourus à parcourir Premier Dernier GARD (30) 12:50 12:50 D17 Bessèges - Place de la Mairie Départ fictif D17 Rue Gambetta - Rue Victor Hugo 12:55 12:55 D17 Départ Réel - Parking DDE du Gard 0.0 156.9 Départ réel Lancé à 1.4 km 13:00 13:00 D17 Peyremale - Giratoire à droite 3.7 153.2 Voitures sur 1 file 13:01 13:01 D17 Le Mas Herm - L'Elzière 4.2 152.7 Pied côte 13:03 13:04 D17 Carrefour à gauche 6.3 150.6 13:06 13:07 D17 Tarabias 8.6 148.3 Sommet côte 13:10 13:11 D17 Dieusses - Vern 11.2 147.7 13:16 13:18 D17/D906 Carrefour à gauche 15.8 141.1 Virage à gauche en épingle D906 Belle Poelle 13:17 13:20 D906 Passage à niveau 16.7 140.2 13:21 13:24 D906 Chamborigaud - Rte Villefort - Rte d'Ales 19.5 137.4 Ralentisseurs 13:24 13:27 D906 Passage à niveau 21.4 135.5 13:27 13:30 D906 Carrefour tout droit 23.8 133.1 Ilot central 13:27 13:31 D906 Le Paulin 24.0 132.9 13:27 13:32 D906 La Tavernole 24.7 132.2 13:30 13:33 D906 La Canebière 25.9 131.0 13:32 13:36 D906 Portes - Rte d'Ales 27.4 129.5 13:33 13:37 D906 Col de Portes - Relais du Château de Portes 27.9 129.0 G.P.M. -

Communiqué De Presse I T M R
LIGNE CONCERTATION ALES - PUBLIQUE DU BESSEGES 8 MARS AU 4 AVRIL 2021 1 N 2 O 0 S I 2 R T A L A Communiqué de presse I T M R R V 8 E A C U Montpellier, le 3 mars 2021 4 N D O U C A Réouverture de la ligne ferroviaire aux voyageurs : la concertation qui s’ouvre constitue une avancée importante dans la concrétisation du projet Du 8 mars au 4 avril 2021, l’ensemble des acteurs du territoire - habitants, salariés, lycéens, représentants associatifs, économiques et touristiques - sont invités à s’informer et à donner leur avis sur la réouverture aux voyageurs de la ligne Alès-Bessèges. Vecteur de dynamisme pour le territoire, ce projet offrira de nouvelles opportunités de déplacement et de développement aux quelques 145 000 habitants et 42 000 salariés du secteur. Fermée depuis 2012, cette ligne fait partie des 6 lignes identifiées comme prioritaires lors des Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité organisés par la Région en 2016. « Depuis 2016, j’ai engagé avec Jean-Luc Gibelin, vice-président délégué aux mobilités et aux infrastructures de transport, un vaste plan de reconquête des usagers du train et des transports collectifs. L’objectif est de permettre au plus grand nombre de privilégier le train, mode de transport le plus écologique dans les déplacements du quotidien. La réouverture et la rénovation des 6 lignes de desserte fine du territoire est une étape essentielle. Mon ambition pour les habitants d’Occitanie, est de leur proposer des trains moins chers, plus confortables, avec des dessertes plus fréquentes au plus près des bassins de vie. -

50Ème ETOILE DE BESSEGES
50ème ETOILE DE BESSEGES Samedi 7 février 2020 > 4ème étape : Grand Prix Département du Gard 138,7 km Le Pont du Gard - Le Mont Bouquet Horaires Horaires Routes Itinéraires Km Km Observations 42 Km/h 38 Km/h parcourus à parcourir Premier Dernier GARD (30) 12:50 12:50 D981 Le Pont du Gard - Rive droite Départ fictif Carrefour à droite - Pont du Gard Giratoire à droite - Parking rive gauche 12:55 12:55 D981 Vers Pont du Gard 0,0 138,7 Départ réel Arrêté à 1.1 km 12:55 12:55 D981/D19 Giratoire à droite 0,1 138,6 Ilot central 12:55 12:55 D19 Bégude de Vers Pont du Gard 12:55 12:55 D19/D19A Giratoire tout droit 0,6 138,1 12:56 12:57 D19A/D228 Giratoire à gauche - Ch. Neuf 1,1 137,6 12:56 12:57 D228 Castillon du Gard - Ch. Neuf 1,3 137,4 12:57 12:57 D228 Passage à Niveau 1,4 137,3 12:59 12:59 D228 Carrefour à doite - Pl. 8 mai 1945 - Rue du Château 3,0 135,7 12:59 12:59 D228 Carrefour à gauche - Ch. De la Coste 3,1 135,6 12:59 12:59 D228/D192 Carrefour tout droit - Rte de St-Hilaire 3,5 135,2 13:02 13:03 D192/D6086 Carrefour à gauche - Rte de Bagnols 5,2 133,5 Ilot central 13:05 13:06 D6086 Valliguières 8,3 130,4 Ilot central 13:07 13:09 D6086/D4 Carrefour à gauche - Rte de Flaux 9,0 129,7 13:18 13:20 D4 Flaux 16,4 122,3 13:18 13:20 D4/D125 Carrefour tout droit 16,8 121,9 13:21 13:24 D125 Saint-Hippolyte-de-Montaigu 18,6 120,1 Ilot central - passage gauche 13:21 13:24 D125/D982 Carrefour à gauche - Rte d'Uzès 18,7 120,0 13:29 13:33 D982 Uzès - Av. -

SM D'électricité Du Gard (Siren : 200039543)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 SM d'électricité du Gard (Siren : 200039543) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Syndicat mixte fermé Syndicat à la carte oui Commune siège Nîmes Arrondissement Nîmes Département Gard Interdépartemental non Date de création Date de création 01/04/2014 Date d'effet 01/04/2014 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Nombre de sièges dépend de la population Nom du président M. Roland CANAYER Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Numéro et libellé dans la voie 4 rue Bridaine Distribution spéciale Code postal - Ville 30000 NIMES Téléphone Fax Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Contributions budgétaires et fiscalisées des membres Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non 1/11 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population Population totale regroupée 759 050 Densité moyenne 130,57 Périmètres Nombre total de membres : 337 - Dont 336 communes membres : Dept Commune (N° SIREN) Population 30 Aigaliers (213000011) 525 30 Aigremont (213000029) 799 30 Aigues-Mortes (213000037) 8 535 30 Aigues-Vives (213000045) 3 400 30 Aiguèze (213000052) 217 30 Aimargues (213000060) 5 734 30 Alès (213000078) 41 412 30 Allègre-les-Fumades (213000086) 945 30 Alzon (213000094) 175 30 Anduze (213000102) 3 423 30 Aramon (213000128) 4 299 30 Argilliers (213000136) 491 30 Arpaillargues-et-Aureillac -

Calendrier Du Déploiement Du Très Haut Débit Dans Le Gard
LISTE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR LES TRAVAUX DE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE EN 2019-2020 : AIGUES-MORTES CROS AIGUES-VIVES DOMAZAN AIMARGUES DOMESSARGUES ANDUZE DURFORT-ET-SAINT-MARTIN-DE-SOSSENAC ARAMON ESTÉZARGUES ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC FLAUX ARPHY FONS ASPÈRES FONTANÈS AUBAIS FOURNÈS AUBORD FOURQUES AUBUSSARGUES FRESSAC AUJARGUES GAGNIÈRES AULAS GAILHAN AVÈZE GAJAN BEAUVOISIN GALLARGUES-LE-MONTUEUX BELLEGARDE GÉNÉRARGUES BELVÉZET GÉNOLHAC BESSÈGES JUNAS du Très Haut Débit dans le Gard dans Très Haut Débit du Calendrier du déploiement déploiement Calendrier du BLAUZAC LA CADIÈRE-ET-CAMBO BOISSIÈRES LA GRAND-COMBE BORDEZAC LA ROUVIÈRE BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES LAMELOUZE BOURDIC LAUDUN-L'ARDOISE BRAGASSARGUES LAVAL-PRADEL BRANOUX-LES-TAILLADES LE CAILAR BRÉAU-ET-SALAGOSSE LE GRAU-DU-ROI BRIGNON LE VIGAN BROUZET-LÈS-QUISSAC LECQUES CALVISSON LES SALLES-DU-GARDON CANNES-ET-CLAIRAN LIOUC CARNAS LIRAC CARSAN LOGRIAN-FLORIAN CASTILLON-DU-GARD MANDAGOUT CENDRAS MARS CODOGNAN MASSILLARGUES-ATTUECH COMBAS MAURESSARGUES COMPS MEYNES CONGÉNIES MEYRANNES CONQUEYRAC MOLIÈRES-CAVAILLAC CORCONNE MOLIÈRES-SUR-CÈZE COURRY MONOBLET CRESPIAN LISTE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR LES TRAVAUX DE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE EN 2019-2020 (SUITE) : MONTAGNAC SAINT-LAURENT-DES-ARBRES MONTAREN-ET-SAINT-MÉDIERS SAINT-MAMERT-DU-GARD MONTFAUCON SAINT-MAXIMIN MONTFRIN SAINT-NAZAIRE MONTIGNARGUES SAINT-NAZAIRE-DES-GARDIES MONTMIRAT SAINT-PAULET-DE-CAISSON MONTPEZAT SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE MOULÉZAN SAINT-SÉBASTIEN-D'AIGREFEUILLE MOUSSAC SAINT-SIFFRET MUS SAINT-VICTOR-DE-MALCAP -

Commune De Saint Jean De Valériscle
Marché de prestations intellectuelles Procédure adaptée Révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme Commune d e Saint Jean de Valériscle CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES TABLE DES MATIERES I. Objet de la mission ____________________________________________________ 3 II. Contexte et enjeux ____________________________________________________ 5 A. Le contexte réglementaire ________________________________________________ 5 B. Politiques publiques et orientations générales applicables sur le territoire ____ 7 C. Le contexte territorial __________________________________________________ 133 D. Les enjeux du projet communal et les souhaits de l’équipe municipale _______ 29 III. Contenu de la mission ________________________________________________ 32 A. Phase 1 : Analyse territoriale et diagnostic partagé _________________________ 33 B. Phase 2 : Elaboration des orientations et du projet communal : Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) __________________________ 37 C. Phase 3 : Elaboration des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) _______________________________________________________________________ 39 D. Phase 4 : Réalisation du dossier pour le projet de PLU arrêté ________________ 41 E. Phase 5 : Consultation des PPA & Enquête Publique _________________________ 43 F. Phase 6 : Réalisation du dossier soumis à approbation_______________________ 44 G. Tranche Conditionnelle : Evaluation Environnementale _____________________ 44 IV. Animation de la démarche -

36 Les Cévennes Des Serres Et Des Valats
Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon http://paysages.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/Ga... Fondements des paysages Organisation des paysages Unités de paysage Enjeux majeurs > Le Gard > Les Cévennes > 36. Les Cévennes des serres et des valats Situation : Cartes et communes concernées 36. Les Cévennes des serres et des Description : valats Valeurs paysagères clefs Analyse critique : Identification d'enjeux Généralités, carte, bloc diagramme Enjeux de protection/préservation Enjeux de valorisation/création Enjeux de réhabilitation/requalification Avec la Camargue et les garrigues, les Cévennes constituent un troisième monde pour le Gard, radicalement différent. Bien des discussions ont eu lieu et ont encore cours pour savoir où commencent et où finissent les Cévennes. En matière de paysage, on peut néanmoins distinguer au moins trois ensembles : les Cévennes des vallées et du Mont Aigoual, essentiellement schisteuses, objet du présent chapitre, les plateaux granitiques aux surfaces mollement accidentées (Mont Lozère, ...), les causses et cans calcaires aux plateaux ondulés. Dans les Cévennes schisteuses, chaque vallée constitue un paysage en soi, et mériterait de composer une unité de paysage propre. Néanmoins les traits de caractères communs sont forts et permettent de rassembler les vallées cévenoles dans un même ensemble, très unitaire et à la forte personnalité. Ces vallées courent des sommets granitiques du Mont Lozère et de l'Aigoual à l'amont jusqu'à la plaine d'Alès à l'aval, allongée au pied des Cévennes de Saint-Ambroix à Anduze, et jusqu'aux reliefs calcaires qui cernent Ganges et le Vigan plus au sud. 1 sur 3 06/09/2016 10:35 Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon http://paysages.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/Ga.. -

Ñ 25 Marchés Municipaux Maintenus Dans Le Gard
Newsletter n°6 - 30 mars 2020 Au sein de la cellule de crise, les Organisations professionnels agricoles continuent à mettre tout en œuvre pour faciliter le travail des agriculteurs. Pas facile, tant les nouvelles contraintes sont nombreuses et en perpétuel changement. Conseils pour la gestion du personnel, mise en relation agriculteurs et volontaires, demande de dérogations auprès de l’Administration (ex : déplacements…), négociations pour faciliter la vente locale (ex : démarches auprès du Préfet, des maires, des grandes surfaces…). Si vous avez des questions sur les conséquences de l’épidémie de coronavirus sur les exploitations agricoles : Consulter cette newsletter ou le site internet régulièrement mis à jour : www.gard.chambre-agriculture.fr Envoyez un mail à [email protected] un guichet unique des OPA gardoises pour vous répondre au mieux. Main d’œuvre : adressez-vous au groupement d’employeur AGRIEMPLOI30 ! Pour toutes les questions relatives à la main d’œuvre (ex : salariés actuels, volontaires, besoins futurs…) Adressez-vous au groupement d’employeur AGRIEMPLOI30 - [email protected] - 06.30.94.36.27 25 marchés municipaux maintenus dans le Gard Merci aux Maires des 25 communes gardoises dans lesquelles un marché ouvert est maintenu pour permettre aux agriculteurs de vendre leurs produits locaux aux consommateurs. Arrondissement Alès : Brignon, Brouzet-lès-Alès, Gagnières, Générargues, Rochegude, St-Maurice-de-Cazevieille. Arrondissement Nîmes : Bourdic, Codolet, Estézargues, Garrigues-Ste-Eulalie, Montfaucon, Nages et Solorgues, St-Bonnet-du-Gard, St-Étienne-des-Sorts, St- Geniès-de-Comolas, St-Hilaire-d’Ozilhan,St-Nazaire, Ste-Anastasie, Théziers, Vénéjan, Verfeuil. Arrondissement Le Vigan : Canaules-et-Argentières, Colognac, Durfort-et-St-Martin-de-Sossenac, Monoblet.