Contrat Global 2012-2017 : Bilan Et Perspectives
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mise En Page
Annexe 1 Quincampoix-Quincampoix-Quincampoix- FleuzyFleuzyFleuzy Escles-Saint-Escles-Saint-Escles-Saint- Distribution d'eau potable PierrePierrePierre FouilloyFouilloyFouilloy Saint-ValerySaint-ValerySaint-Valery Saint-ValerySaint-ValerySaint-Valery GourchellesGourchellesGourchelles RomescampsRomescampsRomescamps Lannoy-Lannoy-Lannoy- RomescampsRomescampsRomescamps en gestion communale CuillèreCuillèreCuillère DaméraucourtDaméraucourtDaméraucourt DargiesDargiesDargies(( GolancourtGolancourtGolancourt AbancourtAbancourtAbancourt Saint-ThibaultSaint-ThibaultSaint-Thibault Gouy-les-Gouy-les-Gouy-les- Saint-ThibaultSaint-ThibaultSaint-Thibault OffoyOffoyOffoy Gouy-les-Gouy-les-Gouy-les- SolenteSolenteSolente ElencourtElencourtElencourt SolenteSolenteSolente ElencourtElencourtElencourt GroseillersGroseillersGroseillers Croissy-sur-CelleCroissy-sur-CelleCroissy-sur-Celle GroseillersGroseillersGroseillers Flavy-le-Flavy-le-Flavy-le- (( OgnollesOgnollesOgnolles Flavy-le-Flavy-le-Flavy-le- LaverrièreLaverrièreLaverrière OgnollesOgnollesOgnolles VilleselveVilleselveVilleselve (( MeldeuxMeldeuxMeldeux (( SarnoisSarnoisSarnois (( LibermontLibermontLibermont MeldeuxMeldeuxMeldeux LeLeLe Plessis- Plessis-Plessis- (( SarcusSarcusSarcus SarnoisSarnoisSarnois BeaudéduitBeaudéduitBeaudéduit Bonneuil-les-EauxBonneuil-les-EauxBonneuil-les-Eaux LeLeLe Plessis- Plessis-Plessis- (( LavacquerieLavacquerieLavacquerie (( Bonneuil-les-EauxBonneuil-les-EauxBonneuil-les-Eaux BlargiesBlargiesBlargies SommereuxSommereuxSommereux Patte-d'OiePatte-d'OiePatte-d'Oie (( -

Saintines.Com » Et Sur Lioration Du Cadre De Edouard Collas Et Rue Notre Site Internet
N°29— JANVIER 2013 EDITO Nous avons : • Continué l’enfouisse- Mesdames, Messieurs, Mes ment des réseaux chers administrés, électriques et télé- phoniques, Les vœux de bonne année • Rénové 80% de nos 2013 et de bonne santé éclairages publics, que votre Conseil Munici- équipés d’économi- pal et moi-même forment, seur d’énergie, vont à vous, vos enfants, • Construit un groupe Mes remerciements vos parents et tous ceux scolaire maternelle, s’adressent également à qui vous sont chers. • Renforcé et renouve- l’ensemble du personnel lé le réseau d’eau communal tant adminis- Ils s’adressent également potable et de dé- tratif que technique, sans à notre commune, à tous fense incendie, oublier notre assistante les bénévoles des associa- • Aménagé et requali- maternelle, pour l’accom- tions sans l’action des- fié la rue Maurice plissement de leurs tâches quels notre petite cité ne Thorez et la Sente de respectives. serait pas aussi vivante. Fay, • Réalisé une salle in- Au-delà des réalisations en C’est pour cette raison que formatique dotée de matière de sécurité que nous continuerons, en 8 ordinateurs, une nous avons effectuées : 2013, à leur apporter bibliothèque / média- notre soutien tant logis- thèque, • Bassin d’orage cavée tique que financier, à dif- • Aménagé l’accès à du cimetière, fuser leurs informations l’école dans un souci • Captage des eaux de d a n s n o s de sécurité et d’amé- ruissellement rue « Saintines.Com » et sur lioration du cadre de Edouard Collas et rue notre site internet. vie. du Moulin Rouge, Je tiens tout particulière- • Différentes actions en Ils s’adressent enfin à ment à remercier nos vue d’obtenir la dé- ceux qui sont les plus dé- partenaires financiers ; le pollution de l’ancienne munis, qui n’ont pas d’em- Conseil Général de l’Oise décharge Néry/ ploi et qui sont hélas dans et l’Etat. -

Le Bus Er Départemental Pour Du 5 Au 1 Janvier Avril 2021
LE BUS ER DÉPARTEMENTAL POUR DU 5 AU 1 JANVIER AVRIL 2021 INSERTION EMPLOI FORMATION INFORMATIONS CRÉPY-EN-VALOIS • NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ÉCOUTE SUIVI SERVICE DÉPARTEMENTAL ITINÉRANT OUVERT À TOUS BÉTHISY-ST-PIERRE BÉTHISY-ST-MARTIN UN ITINÉRAIRE VERS L’EMPLOI 09H45-12H30 5 JANVIER 09H45-12H30 GILOCOURT RENDEZ-VOUS SUR L’UNE DES PERMANENCES DE VOTRE CHOIX 14H00-16H30 QUELLE QUE SOIT VOTRE COMMUNE DE RÉSIDENCE LAGNY-LE-SEC 09H45-12H30 6 JANVIER VER-SUR-LAUNETTE NADÈGE 14H00-16H30 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN LEFEBVRE 09H45-12H30 7 JANVIER BARON BOISSY-FRESNOY Présidente du Conseil 14H00-16H30 14H00-16H30 départemental de l’Oise VERBERIE 09H45-12H30 12 JANVIER ORROUY 14H00-16H30 Depuis 2018, le Bus départemental pour l’Emploi sillonne les communes du Valois. BONNEUIL-EN-VALOIS BÉTHISY-ST-PIERRE 09H45-12H30 13 JANVIER 09H45-12H30 Avec 1 personne sur 3 retrouvant un emploi FRESNOY-LA-RIVIÈRE ou une formation, l’intérêt de ce service 14H00-16H30 départemental n’est plus à démontrer. Dans le contexte économique difficile lié à la ERMENONVILLE crise sanitaire, ce dispositif répond à toutes 09H45-12H30 14 JANVIER MONTAGNY STE-FÉLICITÉ vos questions concernant votre parcours 14H00-16H30 professionnel et participe ainsi à la lutte contre le chômage. CRÉPY-EN-VALOIS 09H30-12H30 19 JANVIER DUVY 14H00-16H30 LE PLESSIS-BELLEVILLE 09H45-12H30 20 JANVIER Vice-président chargé SILLY-LE-LONG de l’administration 14H00-16H30 générale, des services au public et des FRANCK ORMOY-VILLERS financements européens PIA 09H45-12H30 21 JANVIER LEVIGNEN 14H00-16H30 MAREUIL-SUR-OURCQ 09H45-12H30 CRÉPY-EN-VALOIS 26 JANVIER 09H30-12H30 AUTHEUIL-EN-VALOIS Le Bus départemental pour l’Emploi va à la 14H00-16H30 rencontre des habitants dans leurs recherches d’emploi et de formation en répondant à des FEIGNEUX problématiques d’isolement, d’éloignement des 09H45-12H30 27 JANVIER services publics de l’emploi ou des difficultés MORIENVAL liées à la mobilité. -

Saint-Sébastien Se Présenter À Une Permanence Paroissiale
Valois LES SACREMENTS LES MOUVEMENTS DE LAÏCS ET LES SERVICES D’ÉGLISE LES PERSONNES RELAIS Paroisse LE BAPTÊME PRIÈRE CRÉPY-EN-VALOIS Les parents qui désirent le baptême pour leur enfant doivent SERVANTS D’AUTEL OU SERVANTES DE LA LITURGIE VIEUX CRÉPY - SAINT-DENIS Saint-Sébastien se présenter à une permanence paroissiale. Père Guillaume - tél. : 03 44 59 11 66 Danièle Migodzinski - tél. : 03 44 87 10 26 BAPTÊME DES ENFANTS JUSQU’À 7 ANS Maison paroissiale - tél. : 03 44 59 11 66 CRÉPY-EN-VALOIS ET LES VILLAGES ALENTOURS GROUPE DE PRIÈRE ET DE LOUANGE - NOTRE-DAME 0 à 4 ans : inscription 3 mois avant la date désirée. SAINT-LAZARE « SOLEIL LEVANT » Maison paroissiale - tél. : 03 44 59 11 66 4 à 7 ans : inscription 6 mois avant la date désirée. Élizabeth et Patrick Payet - tél. : 03 64 23 19 50 BOUILLANT - SAINT-MARTIN GUIDE 2019-2020 BAPTÊME APRÈS 8 ANS Christine Métais - tél. : 03 44 87 08 32 ÉQUIPES DU ROSAIRE Le baptême se prépare au cours du catéchisme. La première Marie Dubreuil - tél. : 03 44 59 27 89 étape est donc d’inscrire l’enfant au catéchisme. SECTEUR D’AUGER-SAINT-VINCENT AUGER-SAINT-VINCENT - SAINT-CAPRAIS LE PARRAIN ET LA MARRAINE PRIÈRE DES MÈRES Daniel Herbain - tél. : 03 44 59 22 67 Ils s’engagent à accompagner l’enfant dans sa vie chrétienne. Clotilde Paulot - tél. : 06 76 59 45 38 Régis de Romblay – tél. : 03 44 59 02 49 Aussi est-il nécessaire qu’il (elle) soit âgé(e) de plus de 16 ans Des plats raffinés et une ambiance conviviale vous y attendent DUVY - SAINT-PIERRE Menus à découvrir sur notre site : et soit baptisé(e). -

Carte-Oise-Velo-2018-2.Pdf
M1 M11 M4 Rotterdam 18 D6 ROYAUME-UNI 32 51 GAREGARE T.G.V.T.G.V. A 3131 A29 2 PAYS-BAS LE TRÉPOR D211 16 HAUTEHAUTE PPICARDIEICARDIE Londres Hornoy- AMIENS AMIENS L' M4 A29 5252 T AMIENS Omignon Saint- A29 D1029 D116 AMIENS 53 LILLE le-Bourg LILLE A29 Anvers D 6 CALAIS 17 M5 M25 M20 Bruges www.oise-a-velo.com920 D9 ALBER CALAIS, Quentin CALAIS ABBEVILLE, D138 D934 D141 Breteuil ABBEVILLE, D5 42 PÉRONNE,CAMBRAI Douvres E17 T AMIENS D A26 1 ABBEVILLE, D935 D337 D79 54 A3 Calais E40 1 vélorouteA28 - voie verte départementale : La Trans’Oise Boves BRUXELLES, TUNNEL D1015 D38 Noyon D3 A27 SOUS LA 6 D210 A31 2 MANCHE E15 Bruxelles - CALAIS, LONDRES Portsmouth D18 D7 Gerberoy A38 BELGIQUESAINT D1 E402 Lille 2 itinéraires européens : L’Avenue verte London - Paris et La Scandibérique (EV3) A16 D28 28 km D930 6 D1001 Rosières- Plymouth QUENTIN 24 km A1 D316 Luce D920 La en-Santerre 24 km D4 nche 27 circuits cyclotouristiques,9 11 randonnées permanentes, 13 voies de circulation douce, 4 vélopromenades Chaulnes a 1111 3 M 13 D28 ROUEN 25 km Amiens LAON, 9 D2 BEAUVAIS E402 e REIMS A2 CLERMONT 26 km E44 m D103 Cherbourg m COMPIÈGNE o E17 029 S Plus de 100 départs de circuits VTT / VTC D1 22 km Le Havre A29 A16 E46 Basse Forêt d'Eu D18 D934 a E15 28 km 1 Rouen SOMME L Laon E46 5 km REIMS Aéroport de D1901 Caen E46 Beauvais Beauvais-Tillé Reims Nouveau Carnets de route en français et en anglais (rubrique voies vertes) Saint-Lô D930 E46 D321 D928 Poix-de- 80 Crépy- E50 La Selle 10 A28 D28 Chaumont- Creil en-Valois Aéroport de Picardie D138 Bois Moreuil -
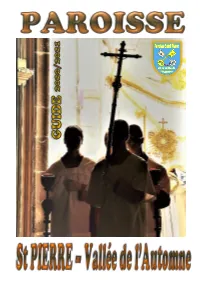
Guide-Paroissiale-2020-2021.Pdf
A partir du CE2, pour les enfants de 8 à 12 ans Catéchisme dans les villages, contacter Mme Geneviève FRENOIS (03 44 40 99 29) ou l’abbé FLAMANT Aumônerie pour les jeunes de la 5ème à la Terminale, contacter l’abbé FLAMANT (06 08 96 85 34) 20 septembre 2020 11h30 : Messe à VERBERIE, 11 octobre 2020 12h45 : Pique-nique tiré du sac, 13h40 : Enseignement et échanges, 15 novembre 2020 15h00 : Temps de prière, 13 décembre 2020 15h30 : fin de la rencontre. 17 janvier 2021 14 février 2021 14 mars 2021 9 mai 2021 Page internet : sur tout moteur de recherche : « Paroisse de la Vallée de l’Automne » L a p a r o i s s e VERBERIE MORIENVAL BÉTHISY St PIERRE ORROUY St SAUVEUR FRESNOY la R BÉTHISY St MARTIN GLAIGNES SAINTINES SÉRY-MAGNEVAL St VAAST de L GILOCOURT NÉRY BÉTHANCOURT en V IPNS « Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle » Jn.3,16. Presbytère : Place de l’église 60410 VERBERIE Curé : Abbé FLAMANT 06 08 96 85 34 [email protected] Diacre : Maison paroissiale : Roland GRUART 317, rue Jean Jaurès 137, rue de l’église 60320 BÉTHISY St PIERRE 60410 SAINTINES 03 44 39 70 35 03 44 85 55 67 03 44 85 55 67 Demandes de baptêmes et mariages Confessions – Tous renseignements A la maison paroissiale de BÉTHISY St PIERRE : - les mercredis de 17h30 à 19h, - les samedis de 9h à 11h. -

Syndicat D'aménagement Et De Gestion Des Eaux Du Bassin De L
Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de l’Automne Rapport d'Activités 2015 © Daniel Prévot sageba Syndicat d’Aménagement et de Gestion Des Eaux du Bassin Automne - 1 sente de l'école 60127 Morienval Tél. : 03 44 88 49 48 www.bassin-automne.fr SOMMAIRE LE SAGEBA ________________________________________________________ 5 LE SAGE DE L’AUTOMNE ______________________________________________ 6 LE CONTRAT GLOBAL ________________________________________________ 7 LES ACTIONS DU SAGEBA EN 2015 ______________________________________ 8 I. Sur les ressources en eaux souterraines __________________________________ 8 I. 1) Etude « Connaissance des aquifères Lutétien et Yprésien supérieur (Cuisien) - Campagnes de mesures et cartes piézométriques basses-eaux et hautes-eaux dans le Bassin Parisien » _________ 8 I. 2) Le Bassin d’Alimentation de Captages (BAC) d’Auger-Saint-Vincent ____________________ 11 2) a) Le territoire ______________________________________________________________ 11 2) b) Actions engagées __________________________________________________________ 12 I. 3) Autres captages d’eau potable du bassin versant ___________________________________ 14 II. Sur les ressources en eaux superficielles _______________________________ 15 II. 1) Réseau de mesures de la qualité des affluents de l’Automne _______________________ 15 II. 2) Mise en œuvre du Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) ______ 17 2) a) Travaux de restauration et de continuité écologique du PPRE ____________________ 17 2) b) Typologie des -

211266-FICHE TIC Ligne 112-2021.Indd
Ligne 112 ligne Depuis Compiègne 112 Ligne 112 - Période scolaire LMJV Me Me Me LMJV Me LMJV LMJV Me LMJV LMJV LMJV N° CAR 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 LACROIX-SAINT-OUEN - Lycée Charles de Gaulle | | | | | | 16:45 | 17:40 17:55 | | COMPIÈGNE - Les Lycées 12:30 12:45 12:45 12:46 16:25 16:40 16:56 17:30 17:55 | | | COMPIÈGNE - Lycée Mireille Grenet 12:32 12:48 12:48 12:49 16:29 | 17:00 17:35 18:05 | 18:05 18:05 LACROIX-SAINT-OUEN - Lycée Charles de Gaulle 12:41 12:58 12:58 12:59 16:40 16:50 | 17:40 | | | | SAINTINES - Jaurès 12:54 | 13:10 13:13 | | 17:19 18:00 | | | 18:20 SAINTINES - Debuire 12:56 | 13:11 | | 17:04 17:20 18:01 18:20 | | 18:21 SAINTINES - Mairie de Saintines | | 13:12 | | 17:05 17:21 | 18:21 | | 18:22 SAINTINES - Curie 12:58 | 13:13 13:15 | 17:07 17:22 18:02 18:22 | | 18:23 SAINT-VAAST-DE-LONGMONT - Rue du Fin 12:59 | 13:14 13:16 | 17:08 17:23 18:03 18:23 | | 18:24 VERBERIE - Rue de Saintines | | 13:15 | 16:58 17:09 | 18:06 18:24 | | 18:25 VERBERIE - Église 13:00 13:08 13:16 13:18 17:00 17:10 17:25 18:07 18:25 18:11 18:20 | VERBERIE - Collège d'Aramont | 13:12 13:17 13:19 17:01 17:11 | 18:10 18:27 18:14 18:22 | Arrêts Correspondances Les transports GRATUITS LACROIX-SAINT-OUEN - Lycée Charles de Gaulle COMPIÈGNE - Les lycées de l’Agglomération COMPIÈGNE - Lycée Mireille Grenet LACROIX-SAINT-OUEN - Lycée Charles de Gaulle de la Région de COMPIÈGNE Ces lignes ne sont pas réservées SAINTINES - Jaurès aux lycéens, n’hésitez pas SAINTINES - Debuire à les emprunter c’est gratuit ! SAINTINES - Mairie de Saintines SAINTINES - Curie SAINT-VAAST-DE-LONGMONT - Rue du Fin VERBERIE - Rue de Saintines Saintines St-Vaast-de-Longmont VERBERIE - Église VERBERIE - Collège d’Aramont Verberie Lacroix-St-Ouen Compiègne Service organisé par : Calculez votre itinéraire Ligne 1 - Gare > Hôpital Ligne 2 - C.C. -

211266-FICHE TIC Ligne 112-2021.Indd
Ligne 112 ligne Depuis Compiègne 112 Ligne 112 - Période scolaire LMJV Me Me Me LMJV Me LMJV LMJV Me LMJV LMJV LMJV N° CAR 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 LACROIX-SAINT-OUEN - Lycée Charles de Gaulle | | | | | | 16:45 | 17:40 17:55 | | COMPIÈGNE - Les Lycées 12:30 12:45 12:45 12:46 16:25 16:40 16:56 17:30 17:55 | | | COMPIÈGNE - Lycée Mireille Grenet 12:32 12:48 12:48 12:49 16:29 | 17:00 17:35 18:05 | 18:05 18:05 LACROIX-SAINT-OUEN - Lycée Charles de Gaulle 12:41 12:58 12:58 12:59 16:40 16:50 | 17:40 | | | | SAINTINES - Jaurès 12:54 | 13:10 13:13 | | 17:19 18:00 | | | 18:20 SAINTINES - Debuire 12:56 | 13:11 | | 17:04 17:20 18:01 18:20 | | 18:21 SAINTINES - Mairie de Saintines | | 13:12 | | 17:05 17:21 | 18:21 | | 18:22 SAINTINES - Curie 12:58 | 13:13 13:15 | 17:07 17:22 18:02 18:22 | | 18:23 SAINT-VAAST-DE-LONGMONT - Rue du Fin 12:59 | 13:14 13:16 | 17:08 17:23 18:03 18:23 | | 18:24 VERBERIE - Rue de Saintines | | 13:15 | 16:58 17:09 | 18:06 18:24 | | 18:25 VERBERIE - Église 13:00 13:08 13:16 13:18 17:00 17:10 17:25 18:07 18:25 18:11 18:20 | VERBERIE - Collège d'Aramont | 13:12 13:17 13:19 17:01 17:11 | 18:10 18:27 18:14 18:22 | Arrêts Correspondances Les transports GRATUITS LACROIX-SAINT-OUEN - Lycée Charles de Gaulle COMPIÈGNE - Les lycées de l’Agglomération COMPIÈGNE - Lycée Mireille Grenet LACROIX-SAINT-OUEN - Lycée Charles de Gaulle de la Région de COMPIÈGNE Ces lignes ne sont pas réservées SAINTINES - Jaurès aux lycéens, n’hésitez pas SAINTINES - Debuire à les emprunter c’est gratuit ! SAINTINES - Mairie de Saintines SAINTINES - Curie SAINT-VAAST-DE-LONGMONT - Rue du Fin VERBERIE - Rue de Saintines Saintines St-Vaast-de-Longmont VERBERIE - Église VERBERIE - Collège d’Aramont Verberie Lacroix-St-Ouen Compiègne Service organisé par : Calculez votre itinéraire Ligne 1 - Gare > Hôpital Ligne 2 - C.C. -

Federation Equestre Internationale 1996
CHECKLIST FOR DRAFT SCHEDULE ENDURANCE 2013 Please note that schedules will only be accepted when submitted in the provided format of the Official FEI Draft Schedule. I. DENOMINATION OF THE EVENT √ Event :CEI1* Place: SAINTINES Country : France NF: FRA Dates :30 juin - 2013 Status : CEI3* km CEIYJ3* km CEI2* km CEIYJ2* km CEI1* 90 km CEIYJ1* km CEIO3* km CEIOYJ3* km CEIO2* km CEIOYJ2* km CEIO1* km CEIOYJ1* km II. GENERAL CONDITIONS This event is organised in accordance with: FEI Statutes, 23rd edition, effective 8th November 2012 FEI General Regulations, 23rd edition, effective 1st January 2009, updates effective 1st January 2013 FEI Veterinary Regulations, 13th edition, effective 1st January 2013 The FEI Rules for Endurance , 9th edition, effective 1st January 2013 Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations (EADCMR), 1st Edition, effective 5th April 2010, updates effective 1st January 2013 FEI Anti-Doping Rules for Human Athletes (ADRHA), based on the 2009 revised Code, effective 1st January 2012, updates effective 1st January 2013 All subsequent published revisions, the provisions of which will take precedence. An arbitration procedure is provided for in the FEI Statutes and General Regulations referred to above. In accordance with this procedure, any appeal against a decision rendered by the FEI or its official bodies is to be settled exclusively by the Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne, Switzerland. It is the responsibility of NFs to ensure their participants are of the correct age. *********************************************************************** -

Les Nouvelles De Morienval
HP DateN° 11de Février parution 2013 P2 Les nouvelles de Morienval Titre de l'article principal Les Nouvelles de Morienval Chères Morienvaloises, chers Morienvalois, Le bulletin C’est avec un peu de retard que le Conseil Municipal et moi-même nous vous d’informations souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. municipales La crise économique et son impact, le chômage sont malheureusement au cœur de cette nouvelle année. La solidarité sera nécessaire pour se sortir de cette situation. Difficile, elle le sera également pour le Conseil Municipal qui va devoir établir un budget en équilibre, en tenant compte des nouvelles réformes gouvernementales et des objectifs des structures territoriales auxquelles nous adhérons. Le change- Le mot ment des rythmes scolaires voulu par L’Education Nationale implique un impact financier pour les collectivités locales. Le Conseil Général, de son côté, veut ren- du Maire dre accessible à tous le très haut débit pour l’informatique en mettant à contribu- tion les communes. Le projet de territoire de la Communauté de Communes pré- voit des investissements pour relancer l’économie locale et donner au Valois des services indispensables pour la croissance et l’équilibre de notre secteur. Oui, l’avenir ne semble pas facile, le contexte international n’est pas favorable et pourtant nous devons continuer à gérer au mieux notre Commune. Cette conjoncture nécessite une évolution de nos pratiques afin de rester une collectivité attractive et agréable à vivre pour chacun de nous. Nous travaillons dans ce sens et mettons en œuvre les outils nécessaires pour gé- nérer des recettes qui permettront de soulager les impôts à la charge des contri- buables. -

Commune De SAINTINES Compte Rendu De La Réunion Du Conseil
Commune de SAINTINES Compte rendu de la réunion du conseil municipal du 20 septembre 2016 Date de convocation : 10 septembre 2016. Le vingt septembre deux mille seize, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni à la mairie de Saintines, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre DESMOULINS, Maire de Saintines. Présents : MM ANDRE, DESMOULINS, GOESSENS, PERDU, POINTIN, SRACZYK, THIEUX, et Mmes COPIGNY, DEBRAY, FERRET, RIBOULEAU. Absents : Mme GREBAUT, Mme LEMAIRE, Mme MARCOLLA, M DESMAREST. Ont donné procuration : Mme MARCOLLA à Mme COPIGNY, Mme GREBAUT à M SRACZYK. Secrétaire de séance : M GOESSENS. Adoption du compte rendu de la séance du 21 juin 2016. Le procès-verbal de la séance du 21 juin 2016 n’appelant plus d’autre observation est adopté à l’unanimité. 0. Compte rendu des décisions prises en application des délégations du Conseil Municipal. - Gravillonnage de la Cavée Philippe pour un montant de 800 € HT. 1. Rénovation du toit du garage et de la réfection de l’alimentation électrique de la salle paroissiale. Après que Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter ce point à l’ordre du jour. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. Ce point est donc ajouté à l’ordre du jour. Vu l’orage de grêle qui a touché Saintines le 26 et 27 juillet 2013, Vu les dommages causés sur les différents bâtiments communaux : écoles, salle des fêtes, gymnase, logements communaux, salle paroissiale, Eglise, … Vu les travaux de mise hors d’eau effectués à la salle paroissiale et au presbytère (toiture), Vu l’arrêté