La Presse Algérienne
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Algeria: Free Press, Opaque Political Economy
Algeria: Free Press, Opaque Political Economy One of the bright spots in Algerian politics since 1988 has been a vibrant printed press, privately owned in large part. Readership in both French and Arabic forged rapidly ahead of those in neighboring countries in the late 1980s, and Algeria exemplified the freest press in the region. During the Islamist insurrection readership plummeted but then recovered slightly in 1998, the last year of available World Bank statistics. Morocco, experiencing a gradual political opening after 1996 and a more diversified press, was now catching up with Algeria, although Moroccan literacy rates were much lower. Comparisons between Algeria and Tunisia are perhaps more instructive because the two countries have roughly similar literacy rates, but the latter has a much duller, controlled press and less readership. This paper will try to explain why Algeria’s press still attracts fewer readers than might be expected, given its contents and levels of public literacy. First I will illustrate how freely it operates, compared to its Maghribi counterparts, by examining how the Algerian press treats its president, Abdelaziz Bouteflika, and how it handled the news of the failure of a big Algerian private sector conglomerate, the Khalifa Group. But I also argue that press readership may reflect not only the relative liberty of the press but also the possibilities of the readership to respond to the news by engaging in forms of collective action. Newspaper readership is largely a function of per capita income, but within a given economy, at least along the Southern Mediterranean, it also tracks pretty well with political openings and closures in a number of Southern Mediterranean countries for which World Bank data are available 1980-1998 (Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Syria, and Tunisia). -
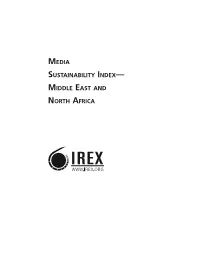
G-606 Txt A.Indd
MEDIA SUSTAINABILITY INDEX— MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA MEDIA SUSTAINABILITY INDEX 2005 The Development of Sustainable Independent Media in the Middle East and North Africa www.irex.org/msi Copyright © 2006 by IREX IREX 2121 K Street, NW, Suite 700 Washington, DC 20037 E-mail: [email protected] Phone: (202) 628-8188 Fax: (202) 628-8189 www.irex.org Project managers: Theo Dolan and Mark Whitehouse Editorial support: IREX/DC staff—Theo Dolan, Drusilla Menaker, and Mark Whitehouse Copyeditor: Kelly Kramer, WORDtoWORD Editorial Services Design and layout: OmniStudio Printer: Kirby Lithographics Inc. Acknowledgment: This publication was made possible through support provided by UNESCO, the United States Department of State’s Middle East Partnership Initiative (MEPI), and the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. #DFD-A-00-05-00243 (MSI-MENA) via a Task Order by the Academy for Educational Development. Disclaimer: The opinions expressed herein are those of the panelists and other project researchers and do not necessarily reflect the views of USAID, MEPI, UNESCO, or IREX. Notice of Rights: Permission is granted to display, copy, and distribute the MSI in whole or in part, provided that: (a) the materials are used with the acknowledgment “The Media Sustainability Index (MSI) is a product of IREX with funding from USAID and MEPI, and the Iraq chapter was produced with the support and funding of UNESCO.”; (b) the MSI is used solely for personal, noncommercial, or informational use; and (c) no modifications of the MSI are made. ISSN 1546-0878 USAID The United States Agency for International Development (USAID) is an independent agency that provides economic, development, and humanitarian assistance around the world in support of the foreign-policy goals of the United States. -

El Humor Gráfico Como Medio De La Opinión Pública Durante La Crisis
Facultad de letras y lenguas extranjeras Departamento de francés Sección de español ⃰ ⃰ ⃰ Trabajo de fin de Máster En Lengua Y Comunicación Hispánicas ⃰ ⃰ ⃰ El humor gráfico como medio de l a opinión pública durante la cri sis argelina 1990 y 1998 Pre sentado por: Bajo la dirección de: S r . SLIMANI Mohamed Amine Sr. BANMAAMAR Fouad. Miembros del jurado: Sr. BENSAHLA TANI Sidi Mohammed Universidad Tlemcen P residente Sr. BENMMAAMAR Fouad Universidad Tlemcen Director Sr. BOUTALEB Fatima Universidad Tlemcen Vocal Curso académico : 2016 - 2017 A mi familia…. Primero doy las gracias a ALLAH que me dio la fuerza y la voluntad para realizar este trabajo. A mi profesor, amigo y hermano Sr BENMAAMAR FOUAD, que todas las palabras son insuficientes para decirle gracias. Espec ial agradecimiento al Sr Mohammedi Ismail quien me enseñó el español, al Sr BOUSSAID Housine mi amigo y hermano. Gracias a todas las personas que me ayudaron de cerca o de lejos para llevar a cabo este modesto trabajo, especialmente a mis profesores coleg as y amigos: TAGHLI, BENMJAHAD, SAIDI y BENSAHLA y todos los profesores de la sección de español. GRACIAS INDICE GENERAL… …………. ……………… ……….. …………………………….. Pág. INTRODUCCIÓN GENERAL …………………………………………… ………. ……… . 0 1 CAPITULO I: LOS DIARIOS Y LA COMUNICACIÓN DE MASAS I. 1 La comunicación en masas y los medios de comunicación masiva ……...… …………….0 5 I. 2 La prensa escrita l a Crisis 1988 - 1989…………………………………… …………. … ..... 09 I. 3 Historia de la prensa argelina …………… ……………………………… . … ……………. 1 1 I.4 .1 Diario ELKHABAR ……….. ……………………………...…………… ...… ………….1 7 I.4.2 Conclusiones del capítulo …... ……………………………………………… ………….. 17 CAPITULO II: HUMOR GRÁFICO EN LA PRENSA ARGELINA II. -

January 2019 Artical History
Route Educational & Social Science Journal Volume 6(1) ; January 2019 Artical History Received/ Geliş Accepted/ Kabul Available Online/yayınlanma 1121121.12 8121121.12 12121.11 The new media’s environment manifestations in Algeria: The electronic press versus the traditional press: An integration relationship or a competitive one Ibtissem Ounis Ouafa Metrouh, Abstract The modern communication technologies have contributed in changing the features of the media environment in Algeria due to individuals and companies’ growing use of that technologies thanks to the applications and services that it provides. Also its characteristics have changed actors roles in this media phenomenon, Route Educational & Social Science Journal 89 Volume 6(1) ; January 2019 Route Educational & Social Science Journal Volume 6(1) ; January 2019 overcoming all the limits and conditions, this is what led to skip the traditional, simple and known perceptions in producing static written press, toward a dynamic electronic and wide spread electronic press. Therefore, we will try, in this research to recognize the interactive landscape’s appearances between this media outlet and readers audience, through a reading of the real Algerian new technologies use’s indicators, in order to detect the relationship between these two media forms. Route Educational & Social Science Journal 90 Volume 6(1) ; January 2019 Route Educational & Social Science Journal Volume 6(1) ; January 2019 1 Route Educational & Social Science Journal 91 Volume 6(1) ; January 2019 Route Educational & Social Science Journal Volume 6(1) ; January 2019 3 3 Route Educational & Social Science Journal 92 Volume 6(1) ; January 2019 Route Educational & Social Science Journal Volume 6(1) ; January 2019 4- عهً عبذ انفتاح كىعان ، انصحافت اﻻنكتزووٍت ، دار انٍاسوري ، اﻻردن ، عمان،4102 ، ص 10. -

Minority Radio & Post/Colonial Identity
LES PERIPHERIES QUI PARLENT : MINORITY RADIO & POST/COLONIAL IDENTITY DISCOURSES FROM THE ALGERIAN REVOLUTION TO THE BEUR MOVEMENT A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA BY ANNEMARIE IDDINS IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OFARTS DONALD R. BROWNE, ADVISOR MAY 2010 © Annemarie Iddins 2010 i Acknowledgements First, I would like to acknowledge and thank my advisor Don Browne for all his patience and guidance over the past year – working with him has been both intellectually stimulating and an incredible privilege. I would also like to thank Brian Southwell for convincing me to attend the University of Minnesota and introducing me to Don, Mark Pedelty and Hakim Abderrezak for serving on my committee, and TK Chang and Kathy Roberts Forde for their encouragement and examples of what great professors should be. Finally, thanks to Ruth DeFoster, Patrick File, Amy Snow Landa, Sada Reed, Sara Cannon and all those in the Silha Center for filling our workplace with inspiring ideas and great conversation. ii Dedication This thesis is dedicated to my family, which always encourages me in my academic endeavors, and to Andrei, who kept me laughing while writing it. iii Abstract In “ Les périphéries qui parlent : minority radio and post/colonial discourses of identity from the Algerian Revolution to the Beur movement,” I examine the role of minority broadcasting in postcolonial identity formation via two case studies: radio broadcasting from the National Liberation Front (FLN) during its war for Algerian independence from France, and radio broadcasting from Radio Beur, a station run by French of North African heritage in 1980s France. -

ALGERIA COUNTRY ASSESSMENT Apr 2001
ALGERIA COUNTRY ASSESSMENT October 2001 Country Information and Policy Unit CONTENTS 1. SCOPE OF DOCUMENT 1.1 - 1.5 2. GEOGRAPHY 2.1 - 2.3 3. HISTORY A. Origins of Algeria 3.1 - 3.5 B. Rise of the FIS 3.6 - 3.9 C. Elections and events of 1991 3.10- 3.13 D. Events of 1992-5 3.14 - 3.18 E. Presidential Elections of 1995 3.19 - 3.20 F. Events of 1995-1997 3.21 - 3.25 G. Elections of 1997 3.26 - 3.28 H. Events of 1998 3.29 - 3.35 I. Presidential Elections of April 1999 3.36 - 3.37 J. Events of 1999 3.38 - 3.42 K. Events of 2000 3.43 - 3.47 L. Events of 2001 3.48 - 3.53 3.54 M. Economic situation 4. INSTRUMENTS OF THE STATE A. Political Structure 4.1 - 4.3 B. Judicial System (including Prisons) 4.4 - 4.8 C. Medical System 4.9 - 4.12 D. Education System 4.13 - 4.15 E. Security Forces 4.16 - 4.22 F. MILITARY SERVICE Background 4.23 - 4.24 Registration 4.25 - 4.27 Selection 4.28 - 4.29 The Reserve 4.30 4.31 - 4.34 Reserve Recalls 4.35 - 4.40 Exemptions and Amnesties 4.41 Postponed Enlistment 4.42 Deferments 4.43 - 4.44 Documents Relating to Military Service 4.45 Penalties for Draft Evasion/Desertion 5. HUMAN RIGHTS: A. GENERAL ASSESSMENT Political and Human Rights Situation A.1 - A.2 Security Situation A.3 - A.7 B. SPECIFIC GROUPS Security forces B.1-B.4 Local Militias - "Patriots" B.5 Missing People B.6 - B.7 Armed Groups /Terrorists B.8 -B.13 Military Servicemen - - Background B.14 - B.16 - Absence Without Leave-Conscripts, Reservists and Deserters B.17 -B.23 - Threat to Military Servicemen From Terrorists B.24 - B.25 Ethnic Groups including Berbers B.26 - B.32 Religious Groups B.33 - B.34 Women B.35 - B.41 Children B.42 - B.45 Homosexuality B.46 C. -
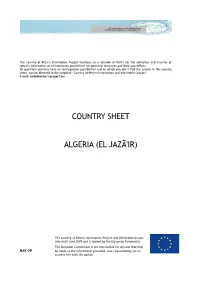
Country Sheet Algeria Is a Product of the CRI Project
The Country of Return Information Project functions as a network of NGO’s for the collection and transfer of specific information on reintegration possibilities for potential returnees and their counsellors. All questions you may have on reintegration possibilities and on which you don’t find the answer in this country sheet, can be directed to the helpdesk “Country of Return Information and Vulnerable Groups”. E-mail: [email protected] COUNTRY SHEET ALGERIA (EL JAZĀ'IR) The Country of Return Information Project and Vulnerable Groups runs until June 2009 and is funded by the European Community. The European Commission is not responsible for any use that may MAY 09 be made of the information provided. Sole responsibility for its content lies with the author. DISCLAIMER This Country Sheet is for informational purposes only and no rights can be derived from its contents. The CRI-partners will do their utmost to include accurate, corroborated, transparent and up-to-date information, but make no warrants as to its accuracy or completeness. Consequently, the CRI-partners do not accept responsibility in any way for the information in this Country Sheet and accept no liability for damages of any kind arising from using the information in this Country Sheet. The information in this Country Sheet has been retrieved in collaboration with local partners. This Country Sheet contains links to websites that are created and maintained by other organizations. The CRI-project does not take any responsibility for the content of these websites. The CRI-partners are the partners who participate fully in the CRI-project: Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Asociación Comissión Católica Española de Migración, Caritas International Belgium, Consiglio Italiano Per I Rifugiati, Coordination et Initiatives pour les Réfugiés et Étrangers and Dansk Flygtningehjælp. -

Avis D'attribution
AVIS D’ATTRIBUTION BOMOP N° 1696 REPUBLIQUE ALGERIENNE imprimes médicaux et administratifs pour Avis d’Attribution : DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE l’année 2020, Paru dans le quotidien « El Administration Centrale....………… 01 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA Moharir El Yawmi » le 25 /02/2020 en langue Administration Régionale .....…........ 81 POPULATION ET DE LA REFORME nationale, et le quotidien « Compétition » le 25 HOSPITALERE /02/2020 langue française. Avis d’Appel à la Concurrence National : ANEP N° 2016004388 Administration Centrale ....……….... 122 WILAYA DE BOUIRA DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA Administration Régionale ................. 225 POPULATION REPUBLIQUE ALGERIENNE Avis d’Appel à la Concurrence NIF: 001310019015948 DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE National et International………......... 318 WILAYA DE TIPAZA Divers.....................…………….....… 323 AVIS D’ANNULATION DE L’AVIS DAÏRA DE FOUKA D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE COMMUNE DE FOUKA Edité par : TÉLÉ : 024-31-14-66 Entreprise Nationale de Communication, Conformément aux dispositions de l’article n°73 NF:098542259597508 d’Edition et de Publicité du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 AVIS D’ANNULATION D’ATTRIBUTION Anep SPA au capital 7.750.000.000 DA portant réglementation des marchés publics et des délégation de service public, la direction de PROVISOIRE D’UN MARCHE 50, Rue KHALIFA BOUKHALFA, Alger ; la santé et de la population de la wilaya de Bouira Tél. 021 23.64.85 / FAX : 021 23.64.90 informe l’ensemble des soumissionnaires ayant Conformément aux dispositions de l’article