"La Légende Du Siècle"
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bibliographie
BIBLIOGRAPHIE I. ŒUVRES DE VICTOR HUGO A. ŒUVRES COMPLETES 1. Éditions publiées du vivant de Victor Hugo 2. Les grandes éditions de référence. B. ŒUVRES PAR GENRES 1. Poésie Anthologies Recueils collectifs Œuvres particulières 2. Théâtre Recueils collectifs Divers Œuvres particulières 3. Romans Recueils collectifs L’Intégrale Œuvres particulières 4. Œuvres « intimes » Correspondance Journaux et carnets intimes 5. Littérature et politique Littérature Politique Divers 6. Voyages 7. Fragments et textes divers 8. Œuvre graphique II. L’HOMME ET SON ŒUVRE Études d’ensemble A. L’HOMME 1. Biographies 2. Victor Hugo et ses contemporains Ses proches Le monde artistique et littéraire 3. Aspects, événements ou épisodes de sa vie Exil Lieux familiers Politique Voyages B. L’ŒUVRE 1. Œuvre littéraire Critique et interprétation Hugo vu par des écrivains du XXe siècle Esthétique Thématique Influence, appréciation 2. Genres littéraires Poésie Récits de voyage Romans Théâtre 3. Œuvres particulières 4. Œuvre graphique, illustration I. ŒUVRES DE VICTOR HUGO A. ŒUVRES COMPLÈTES Cette rubrique présente une sélection d’éditions des œuvres complètes de Victor Hugo : d’abord celles parues du vivant de l’auteur, puis quatre éditions qui font autorité. On trouve plus loin, classées aux différents genres abordés par l’écrivain : la collection « L’Intégrale », publiée par les Éditions du Seuil (Théâtre, Romans, Poésie) et divers recueils collectifs, en particulier les « Œuvres poétiques », publiées par Gallimard dans la « Bibliothèque de la Pléiade ». 1. Éditions publiées du vivant de Victor Hugo Il ne s’agit pas d’œuvres complètes au vrai sens du terme, puisque Victor Hugo continuait à écrire au moment même de leur publication. -

L'année Terrible
L'année terrible Victor Hugo L'année terrible Table of Contents L'année terrible...................................................................................................................................................1 Victor Hugo.............................................................................................................................................1 Prologue ..................................................................................................................................................1 AOUT 1870.............................................................................................................................................6 SEPTEMBRE........................................................................................................................................12 OCTOBRE.............................................................................................................................................18 NOVEMBRE.........................................................................................................................................22 DECEMBRE..........................................................................................................................................31 JANVIER 1871......................................................................................................................................42 FEVRIER...............................................................................................................................................55 -

"Victor Hugo, Les Noirs Et L'esclavage"
VICTOR HUGO, LES NOIRS ET L'ESCLAVAGE par Léon-François HOFFMANN Publication initiale dans Françofonia [Univ. Bologna] N°16, 30, 1996, p.47-90 Figure de référence de l'écrivain engagé dans la lutte contre l'absolutisme politique et religieux, porte- parole des droits de l'homme, Victor Hugo est resté pour la postérité le défenseur des opprimés. Des questions se posent néanmoins quant aux sentiments de fraternité qu'il affirmait ressentir envers tous ses semblables. Envers les Noirs, en l'occurrence. Les chercheurs intéressés par l'image de l'homme noir dans 1'oeuvre de Victor Hugo se sont généralement limités à gloser Bug-Jargal. Le héros noir Bug-Jargal dit Pierrot, le griffe Habibrah, le sacatras Biassoui ont suscité de nombreux commentaires et des controverses parfois acerbes. Moralement exemplaire bien qu'appartenant à un groupe humain méprisé, le personnage éponyme, a été vu par certains comme l'admirable apôtre de la lutte des Noirs pour la dignité humaine, par d'autres comme l'ancêtre de l'oncle Tom, prototype du Noir servile et résigné éminemment rassurant pour le lecteur blanc. Le nain Habibrah et le sinistre Biassou ont été considérés le plus souvent comme pures incarnations du mal...encore que des analyses récentes soient venues, nous le verrons, nuancer cette condamnation. Personnage historique tout comme Biassou, son allié mulâtre André Rigaud ne vaut guère mieux que lui. Toujours dans Bug-Jargal, la masse anonyme des esclaves soulevés contre les maîtres blancs n'est nulle part décrite de façon à susciter chez le lecteur -

200824 Pass 2 Press.Indd
Copyrighted Material Contents Preface xv Acknowledgments xxi Editions and Abbreviations xxv Introduction to Victor Hugo and His Works 1 Part I • Victor Hugo in Private Life 23 Le Gai Château* 34 Vieille Maison* 35 Chapter 1 • On Love and Passion 37 Encore à toi, Odes et ballades V, xii 42 Ô mes lettres d’amour, . , Les Feuilles d’automne XIV 43 “Sourd,” Notre-Dame de Paris IX, 3 45 “Lasciate ogni speranza” (excerpts), Notre-Dame de Paris VIII, 4 48 Ruy Blas II, iii (excerpt) 51 Puisque j’ai mis ma lèvre . , Les Chants du crépuscule XXV 56 À Ol., Les Voix intérieures XII 57 An asterisk (*) marks selections of Hugo’s artwork. Copyrighted Material Copyrighted Material viii contents Aimons toujours! aimons encore! . , Les Contemplations II, xxii 59 Letters to Juliette Drouet, 1835, 1842 61 Marine Terrace* 64 Letter to Léonie d’Aunet Biard 66 Lorsque ma main frémit si la tienne l’effleure, . , Toute la lyre VI, i 67 Je pressais ton bras qui tremble; . , Toute la lyre VI, lvi 68 La Coccinelle, Les Contemplations I, xv 69 Amour, Les Contemplations III, x 70 Eviradnus: Un peu de musique, La Légende des siècles, Première série V, 2, xi 72 À une âme qui ne s’aperçoit pas qu’elle est une femme, Les Chansons des rues et des bois, Reliquat 75 SVB CLARÂ NVDA LVCERNÂ* 77 “Ève,” L’Homme qui rit II, 7, iii 78 Danger d’aller dans les bois, Toute la lyre VI, lx 85 Chapter 2 • On Children 87 Lorsque l’enfant paraît, . , Les Feuilles d’automne XIX 90 À quoi je songe? . -

F63d05 0451A84428bf46c6b117
Victor Hugo et ses proches Collection de Monsieur Éric Bertin Livres et documents Catalogue chronologique Avant-propos de Jean-Marc Hovasse Ce catalogue est dédié à Françoise Dreyfus, savante, discrète et généreuse catalographe qui, malgré son abondante production, a rarement vu son nom inscrit sur un catalogue. LES DESTINS DE LA VENDÉE (ET D'UNE COLLECTION) […] Vicaire était vicaire, il est pape, infaillible, Sa bibliographie est la nouvelle bible. Ainsi prophétisions-nous il y a plus d'un lustre déjà à propos d'Éric Bertin, en tête de sa désormais fameuse Chronologie des livres de Victor Hugo imprimés en France entre 1819 et 1851. Contrairement à l'épigraphe de saint Jean choisie par Victor Hugo pour son premier livre, notre voix ne clamait pas dans le désert : le Syndicat de la librai- rie ancienne et moderne lui a décerné en 2014 son prestigieux Prix français de la biblio- graphie et de l'histoire du livre. Au début de la même année, le futur lauréat énumérait dans le Magazine du bibliophile (n° 110, p. 11), au nombre des “satisfactions” que lui avait apportées ce long et minutieux travail de huit années, celle “d'avoir pu constituer dans de bonnes conditions une petite bibliothèque littéraire”. Cette “petite biblio- thèque littéraire”, la voici mise en vente par Michel Bouvier, et le moins que l'on puis- se dire est qu'elle n'est pas si petite que cela : elle compte à peu près autant de numé- ros que la Chronologie, même si les deux ne se superposent évidemment pas. Il aura fallu à cet éminent bibliographe, de son aveu même, dix-huit années pour la constituer, et pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit des dix-huit premières années du troisième millénaire, de 2000 à 2017. -

Victor Hugo (1802-1885)
Victor Hugo (1802-1885) 1 Biographie ictor Hugo est né à Besançon le 26 février 1802. Son enfance s’écoula dans la maison des Feuillantines, qu’il a chantée dans ses vers célèbres, à l’exception de Vl’année 1811 qu’il passa à Madrid où Mme Hugo, avec ses trois enfants, a rejoint son mari promu général en avril 1809. Fin mars 1812 et jusqu’à fin décembre 1813, la vie reprit aux Feuillantines. La vocation du jeune Victor s’affirma vite. En 1816, il note : «Je veux être Chateaubriand ou rien» ; en 1819, il fut couronné par l’Académie des Jeux Floraux et fonda, avec ses frères Adel et Eugène, le Conservateur littéraire qui durera jusqu’en mars 1821. Il a écrit son premier roman Bug-Jargal, publié en 1826, dont le sujet est une révolte des Noirs à Saint- Domingue. En 1820, il reçoit une gratification du roi Louis XVIII pour son Ode sur la mort du duc de Berry - Odes et Ballades. En 1821, il perd sa mère et se remarie peu après. ‘’Victor Hugo : Conscience et combat’’, Nature et poésie, http://www.nature-et-poesie.fr/fr/reperes/articletype/articleview/articleId/49.aspx 120319 Bibliotheca Alexandrina Établi par Alaa Mahmoud 1 1822 marqua son véritable début dans la vie comme dans la carrière des lettres. Le 8 juin, il publia son premier recueil poétique : Odes et poésies diverses - Odes et ballades - et, en octobre, il épousa son amie d’enfance, Adèle Foucher. Viennent ensuite un roman, Han d’Islande (1823), Nouvelles odes (1824), Bug-Jargal (1826), Odes et ballades (1826), recueil complet des premières poésies, le drame de Cromwell (1827). -
Life of Victor Hugo
H1--I71 I L LIN I S UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN PRODUCTION NOTE University of Illinois at Urbana-Champaign Library Brittle Books Project, 2010. COPYRIGHT NOTIFICATION In Public Domain. Published prior to 1923. This digital copy was made from the printed version held by the University of Illinois at Urbana-Champaign. It was made in compliance with copyright law. Prepared for the Brittle Books Project, Main Library, University of Illinois at Urbana-Champaign by Northern Micrographics Brookhaven Bindery La Crosse, Wisconsin 2010 BRAIZY---- OF THE UNIVERSITY Of ILLINOIS f 3 ro "Great Writers." EDITED BY PROFESSOR ERIC S. ROBERTSON, M.A. LIfE OF VICTOR H UGO. LIFE OF VICTOR HUGO FRANK T. ARZIALS LONDON WALTER SCOTT 24 WARWICK LANE, PATERNOSTER ROW 1888 (All rights reserved.) CONTENTS. CHAPTER I. PAGE Battle-field of Victor Hugo's life and work; his birth at Besangon, February 26, 1802; his parents; ancestral pretensions; his delicacy in infancy; nursed in the lap of war; at Paris in 1805 ; Colonel Hugo appointed Governor of Avellino ; his wife and children journey thither, October, I807; brigands hung along the road ; life at Avellino; Colonel Hugo follows King Joseph to Spain, June, 1808; the family return to Paris; happy days; the family join General Hugo in Spain, I8II ; adventuresby the way ; schooldays at Madrid; the family again returns to Paris, 1812; Victor's education, political and religious; M. Larivibre; General and Madame Hugo separate; Victor sent to the Pension Cordier et Decotte; he leaves school, August, 1818 . .. ...... II CHAPTER II. First exhibitions of genius; schoolboy versification; competes for the Academy prize for French poetry; honourably mentioned, 1817; resolves to devote himself to literature; General Hugo cuts off supplies; Victor resides with his mother; awarded medals for two odes at the "Floral Games " of Toulouse, 1819; writes for Conservateur Litteraire, December, 1819, to March, 1821; early allegiance to the classic school of poetry; "Odes et Podsies Diverses" published June, 1822 . -

Toilers of the Sea by Victor Hugo
Toilers of the Sea By Victor Hugo 1 INTRODUCTION Victor Hugo was thinking much of Æschylus and his Prometheus at the time he conceived the figure of Gilliatt, heroic warrer with the elements. But it is to a creature of the Gothic mind like Byron's Manfred, and not to any earlier, or classic, type of the eternal rebellion against fate or time or circumstance, that Hugo's readers will be tempted to turn for the fellow to his Guernsey hero: "My joy was in the wilderness--to breathe The difficult air of the iced mountain's top, Where the birds dare not build--nor insects wing Flit o'er the herbless granite; or to plunge Into the torrent, and to roll along On the swift whirl of the new-breaking wave Of river-stream, or ocean, in their flow." The island of Guernsey was Gilliatt's Alp and sea-solitude, where he, too, had his avalanches waiting to fall "like foam from the round ocean of old Hell." And as Byron figured his own revolt against the bonds in Manfred, so Hugo, being in exile, put himself with lyrical and rhetorical impetuosity into the island marcou and child of destiny that he concocted with "a little sand and a little blood and a deal of fantasy" in the years 1864 and 1865. There is a familiar glimpse of the Hugo household to be had in the first winter of its transference to the 2 Channel Islands, years before Les Travailleurs was written, which betrays the mood from which finally sprang this concrete fable of the man-at-odds. -

Infallibility and the French Minority Bishops of the First Vatican Council
SEMINAR PAPER INFALLIBILITY AND THE FRENCH MINORITY BISHOPS OF THE FIRST VATICAN COUNCIL "Mon ami, je bénis Dieu de m'appeler à lui avant la définition."1 These words were murmured by Jean Devoucoux, bishop of Evreux, as he lay on his deathbed in the spring of 1870, his last energies spent in the fight against the definition of papal infallibility by the First Vatican Council. His comment highlights the dilemma which remained for his fellow minority bishops from France who opposed the definition on papal infallibility throughout the Council and yet found themselves faced at its end with Pastor aeternus. With twenty-two members, the French minority bishops were the single largest nationality group in the Council's minority. They left the Council before the final vote was taken because their consciences would not allow them to vote for Pastor John Ford has noted that "a spectrum of interpretations" of papal infallibility "was legitimated" after the close of the First Vatican Coun- cil.2 I would like to show how the French minority bishops can help us to appreciate the complexity of one part of that spectrum. Trained in the moderate gallicanism that dominated French semi- nary education before the encyclical Inter multiplices in 1853, the French minority bishops came to the Council with the conviction that the Church and its councils were infallible but unconvinced by the arguments in favor of papal infallibility. The ultramontanist excesses sweeping nineteenth century France bound the group together to fight a common fear: that the Council would define the separate, personal, absolute infallibility of the pope. -

The Doctrinal Value of the Ordinary Teaching of the Holy Father in View of Humani Generis
THE DOCTRINAL VALUE OF THE ORDINARY TEACHING OF THE HOLY FATHER IN VIEW OF HUMANI GENERIS In the Nouvelle revue théologique last fall, Father Jean Levie, S.J., wrote: "The Encyclical Letter Humani generis comes to us as an illuminating work destined to dispel a confusion which was tend- ing to increase and which, in the present situation, could have become extremely harmful. From us it calls for that complete intellectual docility which seeks to understand fully in order to obey perfectly."1 Father Levie, I think, has expressed admirably the spirit in which any theologian or group of theologians must approach the study of the Encyclical. I have been asked to discuss the doctrinal value of the Ordinary Teaching of the Holy Father in view of Humani generis. As a pre- liminary, however, some few words must be said about the Ordinary Teaching Authority itself. While I do not believe that there is any real disagreement among Catholic theologians about the substance of their teaching on the Ordinary Magisterium, there definitely is a difference in the terminology employed—a difference that creates a difficulty in teaching the matter to theological students and might possibly be the cause of some confusion. Do we say, for instance, with Dublanchy, that the Pope can be infallible by virtue of his Ordinary Magisterium; 2 or do we, with Dieckmann, make equiva- 1 "L'encyclique 'Humani generis,' " NRT, Sept.-Oct. 1950, p. 793. 2 Cf. the article "Infaillibilité du Pape," DTC, VII, col. 1705. The text is reproduced below in footnote 18. It should be remarked here that Dublanchy's position on the Ordinary Magisterium of the Pope and the Ordinary and Universal Magisterium of the Church stems from that of Jean-Michel-Alfred Vacant, whose Le magistère ordinaire de l'église et ses organes (Paris-Lyon, 1887) is a pioneer work in the field. -
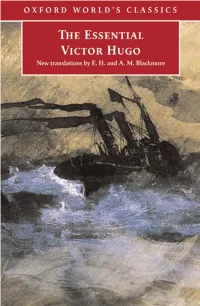
The Essential Victor Hugo
’ THE ESSENTIAL VICTOR HUGO V H was born in Besançon in , the youngest of three sons of an officer (eventually a general), who took his family with him from posting to posting, as far as Italy and Spain. Victor’s prolific literary career began with publication of poems (), a novel (), and a drama, Cromwell (), the preface of which remains a major manifesto of French Romanticism. The riot occasioned at the first performance of his drama Hernani () established him as a leading figure among the Romantics, and Notre- Dame () added to his prestige at home and abroad. Favoured by Louis-Philippe (–), he chose exile rather than live under Napoleon III. In exile in Brussels (), Jersey (), and Guernsey () he published some of his finest works, notably the satirical poems Les Châtiments (), the lyrical poems Les Contemplations (), the first series of epic poems La Légende des siècles (), and the lengthy novel Les Misérables (). Only with Napoleon III’s defeat and replacement by the Third Republic did Hugo return, to be elected deputy, and later senator. His opposition to tyranny and continuing immense literary output established him as a national hero. When he died in he was honoured by interment in the Panthéon. E. H. B and A. M. B are freelance writers and translators. Their previous Hugo translations have appeared in Six French Poets of the Nineteenth Century (Oxford World’s Classics), Selected Poems of Victor Hugo (winner of the American Literary Translators’ Association Prize and the Modern Language Association Scaglione Prize for Literary Translation), The Major Epics of Victor Hugo, and Contemplations, Lyrics, and Dramatic Monologues by Victor Hugo. -

The Zouaves Pontificaux and the Volontaires De L'ouest
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by UWE Bristol Research Repository 1 From Zouaves Pontificaux to the Volontaires de l’Ouest: Catholic Volunteers and the French Nation, 1860-1910 By Martin Simpson Comment [AN1]: Confirm that this is your preferred publishing name. Comment [MS2]: Confirmed Abstract: This article examines the French papal zouaves, volunteers who fought for the defence of the temporal sovereignty of the Pope in the decade 1860-1870, and their successors, the irregular Volunteers of the West. The latter was a volunteer force formed around the returning zouaves in the context of the 1870-71 Franco-Prussian war. It explores Catholic discourse on the zouaves and the Volontaires between 1860 and 1910, comparing the defenders of Rome with the defenders of France. The concern is to understand how service in the Franco- Prussian war impacted upon Catholic interpretations of the zouaves. In particular, their heroic if suicidal charge in the battle of Loigny under the banner of the Sacred Heart aligned them with this devotion, that flourished in 1870-71 and would culminate in the Sacré-Cœur de Montmartre. The Volontaires also offered political arguments about the relationship between patriotism and Catholic convictions, deployed in the context of debates about French regeneration. Yet in terms of ideas of expiation, national history and counter-revolution the discourse on the Volontaires reflected the original discourse on the zouaves developed in the decade 1860-70. Ultimately they stood for a vision of French history and French identity diametrically opposed to the legacy of 1789, a challenge to the Republic’s official vision.