Plu Dessinons Ensemble
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fermeture Voie Mercureaux 2021 02 03
DIR Est Direction interdépartementale des routes de l’Est ARRÊTÉ N°2021_DIR-Est_B25-001 portant arrêté particulier pour la réglementation de la circulation au droit d’un « chantier non courant » sur le réseau routier national, hors agglomération LE PRÉFET DU DOUBS Chevalier de l’Ordre National du Mérite VU le code de la voirie routière ; VU le code de la route ; VU le code de justice administrative ; VU le code pénal ; VU le code de procédure pénale ; VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ; VU le décret du Président de la République, en date du 24 septembre 2018 portant nomination de M. Joël MATHURIN, préfet du Doubs ; VU l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et l’ensemble des arrêtés modificatifs, ainsi que l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977 et l’ensemble des textes d'application (guides techniques spécifiques) ; VU l’arrêté SGARE n°2018-433 du 28 août 18 du Préfet coordonnateur des itinéraires routiers Est portant organisation de la direction interdépartementale des routes Est ; VU l’arrêté n°25-2017-12-22-05 en date du 22 décembre 2017 du Préfet de département portant réglementation de la circulation au droit des « chantiers courants -

Note D'information
ANNEXE 8 Composition des zones de secteur d’ajustement. zone de secteur d'ajustement de BESANCON (IEN B6) 025034GV (distance maximum de 20km de Besançon) COMMUNES Distance COMMUNES Distance de Besançon de Besançon BESANCON 0 MISEREY-SALINES 9 AUDEUX 13 MONCEY 21 LES AUXONS 10 MONTFAUCON 9 AVANNE-AVENEY 9 MONTFERRAND LE CHATEAU 14 BEURE 7 MORRE 7 BOUCLANS 20 NANCRAY 16 BOUSSIERES 16 NOIRONTE 14 CHALEZEULE 6 NOVILLARS 10 CHATILLON LE DUC 9 OSSE 20 CHAUCENNE 13 OSSELLE 20 CHEMAUDIN ET VAUX 14 PELOUSEY 12 CUSSEY/L'OGNON 14 PIREY 7 DANNEMARIE/CRETE 16 POUILLEY LES VIGNES 6 DEVECEY 12 RECOLOGNE 16 ECOLE-VALENTIN 6 ROCHE LEZ BEAUPRE 8 EMAGNY 17 ROSET FLUANS 20 FONTAIN 12 ROUTELLE 20 FRANOIS 11 SAINT-VIT 20 GENEUILLE 12 SAONE 13 GENNES 12 SERRE LES SAPINS 12 GRANDFONTAINE 14 THISE 8 LAISSEY 20 THORAISE 14 LARNOD 15 TORPES 16 LAVERNAY 20 VAIRE-ARCIER 13 MAMIROLLE 14 VIEILLEY 17 MARCHAUX 13 VILLERS-BUZON 17 DELUZ 20 VORGES LES PINS 15 Zone de secteur d'ajustement de BAUME LES DAMES (IEN B3) 025036GM (distance maximum de 20 km de Baume les Dames) COMMUNES Distance COMMUNES Distance de Baume les de Baume les Dames Dames BAUME LES DAMES 0 POULIGNEY LUSANS 15 AISSEY 14 ROUGEMONT 16 AUTECHAUX 5 ROULANS 11 CHAMPLIVE 13 SAINT-HILAIRE 10 CUSE ET ADRISANS 15 SAINT-JUAN 11 GUILLON LES BAINS 10 SERVIN 17 MESANDANS 10 TOUR DE SCAY 17 PASSAVANT 14 VILLERS SAINT-MARTIN 7 PONT LES MOULINS 6 Zone de secteur d'ajustement de VALDAHON (IEN B2) 025035GD (distance maximum de 20 km de Valdahon) COMMUNES Distance COMMUNES Distance de Valdahon de Valdahon VALDAHON 0 LES -

Collège Voltaire 2021 • 2022
Collège Voltaire 2021 • 2022 COMMUNES DESSERVIES : Avanne-Aveney • Besançon • Beure • Busy • Grandfontaine • Larnod • Montferrand-le-Château • Rancenay • Thoraise • Vorges-les-Pins Lignes régulières LIANES : arrêt « Voltaire » ou « Pavie » Lignes et 58 : arrêt « Pavie » Lignes Diabolo Essarts L’Amour <> Pôle Micropolis Diabolo 111 Aller Diabolo 10 Avanne-Aveney • Rancenay du lundi au vendredi Aller Diabolo 111 Bois 7:38 8:35 du lundi au vendredi Mirounes 7:39 8:36 Avanne-Aveney Pépinières 7:25 Marot 7:41 8:38 Rancenay Carrefour 7:27 Pavie 7:44 8:41 Rancenay Village 7:29 Collège Diderot 7:46 8:43 Avanne-Aveney Stade 7:31 Pôle Micropolis 7:51 8:48 Avanne-Aveney Mairie 7:33 Avanne-Aveney Chenoz 7:35 Retour Diabolo 10 Avanne-Aveney Grand Prés 7:37 Avanne-Aveney Vallon 7:39 du lun. lun. mar. du lun. au ven. jeu. ven. au ven. Avanne-Aveney Maison de retraite 7:40 Pôle Micropolis 12:08 16:06 17:10 Collège Voltaire 7:45 Collège Diderot 12:11 16:08 17:13 Voltaire 12:13 16:10 17:15 Retour Diabolo 111 Marot 12:15 16:11 17:17 lundi mardi mer. jeudi vendredi Mirounes 12:18 16:14 17:20 Collège Voltaire 12:05 16:00 17:05 Bois 12:20 16:16 17:22 Avanne-Aveney Maison de retraite 12:10 16:05 17:10 Avanne-Aveney Vallon 12:11 16:06 17:11 Avanne-Aveney Grand Prés 12:13 16:08 17:13 Avanne-Aveney Chenoz 12:15 16:10 17:15 Diabolo 110 Avanne-Aveney Mairie 12:17 16:12 17:17 Avanne-Aveney Stade 12:19 16:14 17:19 Busy • Vorges-les-Pins • Besançon • Beure • Avanne-Aveney Pépinières 12:21 16:16 17:21 Larnod • Rancenay Carrefour 12:23 16:18 17:23 Rancenay Village 12:25 16:20 17:25 Aller Diabolo 110 du lundi au vendredi Busy Moulinot 7:10 Busy École 7:12 Vorges-les-Pins Boulangerie 7:14 Vorges-les-Pins Village 7:16 Vorges-les-Pins École 7:18 Vorges-les-Pins Riette 7:20 Collège Voltaire 7:45 Retour Diabolo 110 lundi mardi mer. -

Compte Rendu Du Conseil Municipal Du 25 Octobre 2016
MAIRIE D E BEURE 45 rue de Besançon 25720 BEURE Téléphone : 0 381 526 130 Fax: 0 381 515 553 courriel : [email protected] [email protected] COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2016 L’an deux mille seize, le 25 octobre à 18H30mn s’est tenue une réunion du conseil municipal en son lieu habituel de séance après convocation réglementaire envoyée le 18 octobre 2016. Etaient présents : M. Ph. CHANEY, Maire, M. Michel PIDANCET, Mmes Agnès FANDELET, Chantal JARROT , M. Fabrice ARENA, Adjoints Mmes Lily BAILLY, Valérie DONAT, Sylviane GAMBADE, Stéphanie KHOURI, Gaelle PELLETIER, M&M Frédéric PROST, Henri LEBORGNE, Cédric CLERVAUX. Etaient absents : Néant Madame Gaelle PELLETIER est élue secrétaire de séance à l’unanimité. Le compte rendu précédent n’apporte aucune remarque. On passe à l’ordre du jour. ORDRE DU JOUR Taxe assainissement 2017 – Dél n°35/2016 Après avoir entendu les explications de Mr Philippe CHANEY, Maire , le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité des présents et des représentés de porter les taxes communales 2017 concernant l’assainissement à : 1.11€ / M3 pour les raccordés 2.22€ / M3 pour les raccordables qui ne sont pas raccordés 1 Composition du Conseil Communautaire du Grand Besançon au 1er janvier 2017 – Dél n°36/2016 Après avoir entendu les explications de Mr Philippe CHANEY, Maire , lequel a exposé les éléments suivants : Par courrier en date du 26 septembre 2016, Monsieur le Préfet du Doubs a notifié aux communes l'arrêté portant extension du périmètre de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon au 1er janvier 2017 a 70 communes. -

Tout Pour Passer De Belles Vacances Chez Nous !
plus.grandbesancon.fr www.grandbesancon.fr / 2,50 € 104 JUILLET AOÛT 2021 TOUT POUR PASSER DE BELLES VACANCES CHEZ NOUS ! + D’ACTUS + D’INSPIRATION + DE PROXIMITÉ La zone de l’Échange accueille Juliette Labous de La nouvelle base outdoor de nouvelles entreprises Roche-lez-Beaupré à Tokyo de la Rodia se dévoile Le fil de votre magazine PLUS SOMMAIRE P.39 P.7 PLUS Pourquoi ce nom ? Car le Grand Besançon n’a cessé de croître depuis sa création en 2001, dans son périmètre, le nombre de ses habitants, ses statuts P.10 et ses compétences. Ainsi, Grand Besançon Métropole agit toujours plus dans la vie quotidienne des Grand Bisontines et des Grand Bisontins. P.41 04 PLUS de liens P.29 L’actualité des réseaux 05 PLUS d’échos Le Territoire dans la presse PLUS de proximité 29 Communes périphériques 06 PLUS d’actus 34 Ville de Besançon Les informations du Territoire 39 PLUS d’inspiration 12 PLUS dossier Un sujet à 360° 44 PLUS d’expression 20 PLUS d’actions 46 PLUS d’emploi Août 2021 Juillet La métropole agit pour vous On recrute ! 2 N°104 | JUILLET / AOÛT 2021 PLUS ÉDITO Restons 68 connectés ENSEMBLE Grand Besançon Métropole Grand Besançon Développement Amagney Besançon ville Audeux et communauté urbaine Avanne-Aveney Besançon GrandBesançon Beure Bonnay Boussières @BesançonBoosteur Braillans deBonheur Busy Byans-sur-Doubs Retrouvez les compléments Chalèze d’information sur : Chalezeule plus.grandbesancon.fr Champagney Champoux Champvans- grandbesancon.fr les-Moulins Tout pour passer de bonnes Châtillon-le-Duc boosteurdebonheur.besancon.fr Chaucenne vacances chez nous ! Chemaudin et Vaux La Chevillotte Chevroz es beaux jours sont là bergements, pour passer de Cussey-sur-l’Ognon et, avec eux, les va- formidables vacances. -

EN BREF... Qui Le Composent, Des Disparités Qui Peuvent Parfois Mener À Un Renforcement, Dans Certains Domaines, De La Spécialisation De Ce Dernier
OBSERVATOIRE socio-urbain Juin 2015 Synthèse des secteurs L’agglomération bisontine sous l’angle socio-urbain Le phénomène de périurbanisation se poursuit aujourd’hui, et avec lui s’est mis en place un fonctionnement en couronnes au sein de l’agglomération et au-delà. Parallèlement, l’entremêlement de la ville et de la campagne s’est accentué : la ville centre ne fonctionne pas sans sa périphérie, et inversement, l’organisation de la périphérie reste liée à celle de sa ville centre. L’analyse des indicateurs socio-démographiques montre que, ces dernières années, un ralentissement démographique est en cours dans l’ensemble de l’agglomération. L’évolution du territoire fait aussi ressortir, entre les secteurs EN BREF... qui le composent, des disparités qui peuvent parfois mener à un renforcement, dans certains domaines, de la spécialisation de ce dernier. Une fragilisation de certains ménages, due notamment à la crise économique de 2009, est aussi à prendre en compte. Enfin, Besançon se distingue souvent des autres secteurs et accumule des caractéristiques qui lui sont propres. L’Observatoire Socio-Urbain (OSU) des quartiers et des secteurs de Besançon et des communes du Grand Besançon est un outil de veille des disparités territoriales au sein de l’agglomération. Des indicateurs, suivis sur des périodes longues et déclinés aux échelles communales et infracommunales (IRIS), permettent d’identifier les fragilités sociales en y apportant une clé de lecture urbaine et de fonctionnement territorial. Cette publication permet, par la mise en avant des particularités de chacun des six secteurs de l’agglomération, de parvenir à construire une vue d’ensemble de cette dernière, de son état actuel et des évolutions qui s’y font jour. -

Présentation Relais Petite Enfance Des Petits Voyageurs
Relais Petite Enfance des Petits Voyageurs Coordonnées Relais Petite Enfance des Petits Voyageurs 2 A rue Saint Vincent, 25 720 Avanne-Aveney 03 81 52 09 47 [email protected] www.famillesrurales.org/relais-petite-enfance-franche-comte www.facebook.com/relaispetiteenfance.petitsvoyageurs Les missions du relais Le relais est un lieu d'informations, de rencontres et d'échanges au service des parents, des assistants maternels et des professionnels de la petite enfance. Les relais ont différentes missions : Auprès des professionnels de la petite enfance : information actualisée sur leurs droits et obligations (statut, agrément, formation, rémunération), accompagnement dans les relations avec leurs employeurs liées à l'accueil de l'enfant (écoute et orientation) et accès à la formation professionnelle. Auprès des parents : information globale sur les modes d'accueil de la petite enfance, accompagnement dans les relations avec leur salarié liées à l'accueil de l'enfant (écoute, orientation et soutien), accès à la liste des assistants maternels agréés, information sur leurs droits et obligations d'employeur ainsi que sur les démarches administratives (contrat de travail, déclaration d'embauche, statut). Auprès des enfants : accès à un lieu d'éveil et de socialisation grâce à des animations en itinérance sur les différentes communes. Zone de couverture du relais Le relais couvre 18 communes : Avanne – Aveney, Beure, Boussières, Busy, Byans-sur-Doubs, Grandfontaine, Larnod, Montferrand-le-Château, Osselle-Routelle, Pugey, Rancenay, Roset-Fluans, Saint Vit, Thoraise, Torpes, Velesmes -Essart, Villars-Saint -Georges, Vorges-les-Pins Les temps d’accueil du public Permanences téléphoniques : Les mardis de 13h00 à 16h00, Les mercredis de 9h à 12h Les jeudis de 14h à 17h. -

Fiche Structure : Alliance Villes Emploi
Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr TERRITOIRE Région : Bourgogne et Franche-Comté Département : (25) Doubs Ville : Besançon Liste des communes couvertes : Amagney ((25) Doubs), Arguel ((25) Doubs), Audeux ((25) Doubs), Auxon-Dessous ((25) Doubs), Auxon-Dessus ((25) Doubs), Avanne-Aveney ((25) Doubs), Beure ((25) Doubs), Bonnay ((25) Doubs), Boussières ((25) Doubs), Braillans ((25) Doubs), Busy ((25) Doubs), Byans-sur-Doubs ((25) Doubs), Chalèze ((25) Doubs), Chalezeule ((25) Doubs), Champagney ((25) Doubs), Champoux ((25) Doubs), Champvans-les-Moulins ((25) Doubs), Châtillon-le-Duc ((25) Doubs), Chaucenne ((25) Doubs), Chaudefontaine ((25) Doubs), Chemaudin ((25) Doubs), Chevillotte (La) ((25) Doubs), Chevroz ((25) Doubs), Cussey-sur-l'Ognon ((25) Doubs), Dannemarie-sur-Crète ((25) Doubs), Deluz ((25) Doubs), Devecey ((25) Doubs), École-Valentin ((25) Doubs), Fontain ((25) Doubs), Franois ((25) Doubs), Geneuille ((25) Doubs), Gennes ((25) Doubs), Grandfontaine ((25) Doubs), Gratteris (Le) ((25) Doubs), Larnod ((25) Doubs), Mamirolle ((25) Doubs), Marchaux ((25) Doubs), Mazerolles-le-Salin ((25) Doubs), Mérey-Vieilley ((25) Doubs), Miserey-Salines ((25) Doubs), Montfaucon ((25) Doubs), Montferrand-le-Château ((25) Doubs), Morre ((25) Doubs), Nancray ((25) Doubs), Noironte ((25) Doubs), Novillars ((25) Doubs), Osselle ((25) Doubs), Palise ((25) Doubs), Pelousey ((25) Doubs), Pirey ((25) Doubs), Pouilley-Français ((25) Doubs), Pouilley-les-Vignes ((25) Doubs), Pugey ((25) Doubs), Rancenay ((25) Doubs), Roche-lez-Beaupré -
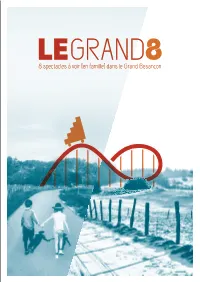
Grand-8-Programmea5-Web.Pdf
ÉDITO PROGRAMME « La ville est comme un grand manège », DATE SPECTACLE ÂGE LIEU Mercredi DISTRACTION(S) Nancray chantait Charles Trenet dans Quand les beaux jours seront là. 30 octobre 2019 + Cirque Gônes 5 Espace du Vaizot 17H30 ANS Avec le Grand 8, c’est tout un territoire Samedi L’HEURE BLEUE Geneuille 30 novembre 2019 + qui va se transformer en une fête foraine. Cie Prune 6 Salle de la Libération 11H MOIS Grâce à l’engagement de Grand Besançon Métropole, Dimanche Côté Cour, la scène conventionnée Art, enfance, jeunesse GROU! Pouilley-les-Vignes 12 janvier 2020 + Cie Renards 6 Salle des fêtes de Besançon vous propose de venir partager 17H ANS des émotions fortes en familles. Mercredi HISTOIRE Amagney 26 février 2020 D’UNE MOUETTE... + 7 Salle des fêtes 17H Cie La Bouillonnante ANS Le Grand 8, ce sont 8 spectacles, sur 8 mois, Samedi dans 8 communes partenaires du Grand Besançon. LA FEMME À BARBE Pelousey 14 mars 2020 + Théâtre des Chardons 9 Maison de la Noue 8 occasions de s’étonner, de découvrir, 19H30 ANS d’échanger, de grandir aussi. Samedi ESCARGOT Pouilley-Français 11 avril 2020 2+ Teatro del Piccione ANS Maison pour tous Alors attention au départ, dégustez le programme 11H Dimanche et en voiture pour un premier tour à Nancray le 30 octobre. 10:10 Mamirolle 10 mai 2020 + Cie Nyash 6 Salle des fêtes 17H ANS L’équipe de Côté Cour Samedi BONNE PÊCHE, Audeux 30 mai 2020 MAUVAISE PIOCHE + 2 Maison pour tous 11H Groupe maritime de théâtre ANS Palise BONNE PÊCHE, L’HEURE HISTOIRE MAUVAISE PIOCHE BLEUE D’UNE MOUETTE.. -

JOURNAL MUNICIPAL N°10 – Avril 2021
A V R I L 2 0 2 1 | N ° 1 0 Chemaudin & Vaux V O T R E J O U R N A L M U N I C I P A L D ' I N F O R M A T I O N S NOMBREUSES TRAVAUX CCAS : REGISTRE INFOS RÉALISÉS SUR DES PERSONNES PRATIQUES LA COMMUNE VULNÉRABLES P A G E S 3 À 8 P A G E 9 P A G E 1 2 https://www.chemaudin.fr Sommaire NOTRE VIVRE À VILLAGE CHEMAUDIN ET VAUX Chemaudin 02 LE MOT DU MAIRE 12 ACTIONS DU CCAS & Vaux 03 INFOS PRATIQUES 14 CSC JOURNAL MUNICIPAL D'INFORMATIONS N°10 05 GESTION DECHETS 15 MÉDIATHÈQUE Direction de la publication : Mairie de Chemaudin 08 SERVICES 16 VIE ASSOCIATIVE et Vaux Mouv'ados Responsable de rédaction : MÉDICAUX Gilbert GAVIGNET Comité de jumelage Photo de couverture : 09 TRAVAUX Audrey MAJCICA Impression : 18 AGENDA Imprimerie Dodane 1 0 CONSEILS Rue de Blanchot 25770 MUNICIPAUX Serre-les-Sapins Recevez les actualités de votre commune NEWSLETTER : L'ACTUALITÉ VIENT À VOUS ! Donnez votre adresse mail. Validez votre inscription dans le courriel de confirmation. Quelques clics pour ne manquer aucune info ! Infos pratiques, vie de la commune (CCAS, centre socio- culturel, vie associative...), conseils municipaux, arrêtés... retrouvez tout cela et bien plus sur le site de la commune : https://chemaudin.fr et inscrivez-vous à la lettre d'information C H E M A U D I N & V A U X A V R I L 2 0 2 1 | P A G E 1 Le mot du maire Après une année de pandémie due à la Covid 19 et ses variants, le respect des gestes barrières reste indispensable. -

MARIAGES CANTONAUX an 7 ET an 8 (Liste Des Cantons Du Doubs Par Districts)
MARIAGES CANTONAUX AN 7 ET AN 8 (Liste des cantons du Doubs par districts) DISTRICT DE BESANCON Canton de Besançon 1ère section l’Egalité 2ème section le Capitole 3ème section la Loi 4ème section la Liberté 5ème section l’Abondance 6ème section la Fraternité 7ème section la Constitution 8ème section la Victoire La Vèze Canton de Beure Arguel Avanne Aveney Beure Busy Fontain Larnod Montferrand le Château Pugey Rancenay Vorges les Pins Canton de Bonnay Bonnay Châtillon le Duc Chevroz Devecey Geneuille Merey Vieilley Palise Tallenay Valentin (voir Ecole Valentin) Venise Vieilley Canton de Pouilley les Vignes Auxon Dessous Auxon Dessus Champagney Champvans les Moulins Chaucenne Chemaudin Cussey sur l’Ognon Ecole Franois Miserey Salines Pelousey Pirey Pouilley les vignes Sauvagney Serre Les Sapins Vaux-les –Près Canton de Nancray Bouclans Champlive La Chevillotte Dammartin les Templiers Gennes Gonsans Granges de Vienney Le Gratteris Mamirolle Montfaucon Morre Naisey Nancray Osse Ougney Douvot Saône Vauchamps Canton de Recologne Audeux Burgille Chazoy Chevigney sur l’Ognon Cordiron Courchapon Emagny Franey Jallerange Lavernay Mazerolles le Salin Moncley Le Moutherot Noironte Placey Recologne Ruffey le Château Canton de Rigney Blarians La Bretenière Cendrey Champoux Châtillon Guyotte Chaudefontaine Corcelle Mieslot Flagey Rigney Germondans La Tour de Scay Moncey Ollans Rigney Rignosot Rougemontot Thurey le Mont Valleroy Canton de Roche lez Beaupré Amagney Arcier Braillans Chalèze Chalezeule Marchaux Novillars Roche lez Beaupré Thise Vaire le -

2017-0000016
LETTRE CIRCULAIRE n° 2017-0000016 Montreuil, le 24/04/2017 DRCPM OBJET Sous-direction production, Modification du champ d'application et du taux de versement gestion des comptes, transport (art. L. 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités fiabilisation Territoriales VLU-grands comptes et VT Texte(s) à annoter : LCIRC-2009-0000005 Affaire suivie par : ANGUELOV Nathalie A compter du 01/01/2017, le périmètre de transports urbains de la Communauté d'Agglomération du Grand Besancon est étendu aux communes de Bonnay, Byans sur Doubs, Chevroz, Cussey sur l'Ognon, Devecey, Geneuille, Merey Vieillez, Palise, Pouilley Français, Roset Fluans, St Vit, Velesmes Essarts, Venise, Vieilley, Villars St Georges. A compter du 01/05/2017, le versement transport s’applique à ces communes au taux de 0,90 puis 1,80 au 01/01/2018 Par un arrêté du 22/09/2016, la Préfecture du Doubs a autorisé l’adhésion des communes de Bonnay, Byans sur Doubs, Chevroz, Cussey sur l'Ognon, Devecey, Geneuille, Merey Vieillez, Palise, Pouilley Français, Roset Fluans, St Vit, Velesmes Essarts, Venise, Vieilley, Villars St Georges, avec prise d’effet à compter du au 01/01/2017. Par une délibération du 19/09/2016, la Communauté d’Agglomération du Grand Besancon (9302504) a décidé de mettre en place le versement transport sur le territoire des communes comprises dans son périmètre de transports urbains. Les nouveaux taux prennent effet à compter du : - 01/05/2017 à 0,90 % - 01/01/2018 à 1,80 % Dans ces conditions, un nouvel identifiant est attribué 9302506 La Communauté d’Agglomération du Grand Besancon (9302504) nous informe de son changement d’adresse.