Située Entre
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Plu Ostricourt
R u e R es u R ni u ag C e e h h a e P ro d W m ng e in a le s s Sa T d t r r s a i e J l e t e g u e o u d le u o te 00015 n s s R ê e R r s e h p 3 i lie r u 42B a 27B 25B is Résidence Centre 1 0 g igo R P o 16 22 00001 h s 44 38B C 37 o R 44C 42A s 100 B e e 38 lie le 44A e on 12 u rd Louis-Marie Cordonnier d'incendie et de l 38A 00048 te r it u d la Place e 3913 d 44B im e f c s u 42 R S u f x o in 118 0404033 96 R l'O Ronde secours n le 100 39 41 Louis e m e 46 u e l R e 45 e 14 d e 5 12 40 119 s 2 40 d e 3 h 46A ss d 37 a 00001 i r Crombez 0 46 a 00055 r s e r 1 e e 4780 C R 48A 100 p l t 6 a D u s d 00003 é r 1 43 u Cité des m 4 a Château u o e I e 8 R n 23 R G 2 r 121 d s o i 2 e u R g r 94 M B T h 60 Ateliers 5 n 130 R 1 2 e e le g tt e la le 10 J 48 17 u li de BEGHIN é e s é d 4 a 137 e l u R p 93 92 00039 00002 g c T B e e 3 0 S 00032 a e u n o 8 ri R s 9613 a 47 u er 141 L e 90 33 TEREOS h 1 e R n lm G n 51 d 91 00003 i r 3 e Cité Henri 12 u T g i 9610 P n d t u 1 35 a e a e o 80 - b e 80 36 i e H tt a D e l R B 62 s r 26 C J u 9605 Cité e 155 143 e a 4 é 88 9611 e 2 ité Béghin B o s le b n p R r 89 2 49 é l se l é o u 5 84 6 e 31901 10 R t a e C e R n is ue 113 u 61 19 R r g s r u 9606 9607 9608 9609 e t t s 13 9612 27 8 p Quintiches 157 e i d R u u h s PLU OSTRICOURT DM d o u s 00002 i h u i l a u e e e 64 58 r 50 00005 9 e n o e l 2A s in i H n l d R Le Paradis s R r P 2B e 1 u è 60 a 30 d Cité des s u 00050 d 3 9 ui 111 R v u 00038 12 e e e 29 B 1 é R 4 t 00036 55 4770 e é 71 57 M f F u ls u 5 27 Marronniers a lle Ateliers -

AAC CLEA Pévèle Carembault 2022 Arts De La Rue.Pdf Pdf 401 Ko
CLÉA PEVELE CAREMBAULT édition 2022 Appel à candidatures en direction d’un collectif ou d’une compagnie des arts de la rue pour qui les notions de bonheur, de bien vivre ensemble et d’échanges entre les générations sont fondamentales, aussi bien dans sa recherche que dans sa production. 1/10 Dans le cadre du CLÉA, la communauté de communes Pévèle Carembault, la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, le rectorat de l’académie de Lille, en partenariat étroit avec le conseil départemental du Nord, le conseil régional des Hauts-de-France, lancent un Appel à candidatures en direction d’un collectif ou d’une compagnie des arts de la rue pour qui les notions de bonheur, de bien vivre ensemble et d’échanges entre les générations sont fondamentales, aussi bien dans sa recherche que dans sa production. 1° Cadre de la résidence-mission Animés par la volonté de réduire les inégalités en matière d’accès à l’art et à la culture, en se donnant un objectif ambitieux de généralisation d’une éducation artistique et culturelle, la Communauté de communes Pévèle Carembault, la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France (DRAC), le rectorat de l’académie de Lille – délégation académique aux arts et à la culture (DAAC) – se sont engagés dans une politique de sensibilisation à l’art et à la culture auprès des jeunes et d’un public plus large encore. 2/10 Cette volonté s’exprime par le contrat local d’éducation artistique tout au long de la vie qu’ont signé ces différents partenaires ; ceci en lien avec les politiques portées par d’autres partenaires tels le conseil départemental du Nord et le conseil régional Hauts-de-France. -

Schema Regional De Coherence Ecologique - Trame Verte Et Bleue Du Nord-Pas De Calais
SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE - TRAME VERTE ET BLEUE DU NORD-PAS DE CALAIS Docu ment proviso BOESCHEPE GODEWAERSVELDE HALLUIN secteur B1 BERTHEN BOUSBECQUE WERVICQ-SUD SAINT-JANS-CAPPEL Les continuités écologiques FLETRE NEUVILLE-EN-FERRAIN COMINES RONCQ ir WARNETON e et les espaces à renaturer METEREN LINSELLES TOURCOING DEULEMONT CONTINUITES ECOLOGIQUES BAILLEUL QUESNOY-SUR-DEULE BONDUES Réservoirs de biodiversité WATTRELOS MERRIS MOUVAUX FRELINGHIEN Réservoirs de biodiversité linéaires WAMBRECHIES NIEPPE ROUBAIX Réservoirs de Biodiversité VIEUX-BERQUIN ARMENTIERES LEERS STEENWERCK HOUPLINES VERLINGHEM Espaces naturels relais CROIX MARQUETTE-LEZ-LILLE LYS-LEZ-LANNOY MARCQ-EN-BAROEUL LE DOULIEU WASQUEHAL LANNOY PERENCHIES ERQUINGHEM-LYS LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES TOUFFLERS Sous-trames des Réservoirs de Biodiversit é LOMPRET SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE PREMESQUES HEM NEUF-BERQUIN et des Espaces naturels relais LA MADELEINE LAMBERSART SAILLY-LEZ-LANNOY ESTAIRES SAILLY-SUR-LA-LYS zones humides BOIS-GRENIER CAPINGHEM MONS-EN-BAROEUL ENNETIERES-EN-WEPPES FOREST-SUR-MARQUE forêts VILLENEUVE-D'ASCQ WILLEMS MERVILLE FLEURBAIX creuses LILLE RADINGHEM-EN-WEPPES LA GORGUE ENGLOS SEQUEDIN ESCOBECQUES TRESSIN prairies et/ ou bocage BAISIEUX LEZENNES CHERENG LE MAISNIL HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN côteaux calcaires LOOS ANSTAING LAVENTIE FROMELLES ERQUINGHEM-LE-SEC RONCHIN LESTREM BEAUCAMPS-LIGNY HAUBOURDIN CAMPHIN-EN-PEVELE landes et pelouses acidiphiles GRUSON FACHES-THUMESNIL LESQUIN BOUVINES AUBERS EMMERIN SAINGHIN-EN-MELANTOIS CALONNE-SUR-LA-LYS -

Journal Officiel Du District Flandre De Football - Page 1 - "L'officiel Flandre" N°529 Du 06 / 02/ 2017
Journal Officiel du District Flandre de Football - Page 1 - "L'Officiel Flandre" N°529 du 06 / 02/ 2017 Lesquin 14h U8: Lesquin x2, Seclin, Faches, Templeuve ? Secteur Genech Losc U6:Templeuve x2, Seclin, Lesquin LILLE U7:Templeuve x2, Seclin, Ronchin Wahagnies 10h U8: Templeuve x2, Seclin, Ronchin RESPONSABLE DU SECTEUR: U6:Wahagnies, Lesquin x2, Anstaing BACHELET MICHEL U9: Wahagnies, Losc, Fretin, Anstaing Wattignies 10h [email protected] 06.63.92.25.30 U6: Wattignies x2, Wahagnies Templemars 10h U7: Wattignies x2, Anstaing, Templemars Samedi 4 Février 2017 U6: Templemars x3, Wattignies U8: Wattignies, Anstaing, Fretin LES OLIVEAUX 14H30 Salle Léo Lagrange U7: Templemars, Templeuve, Wattignies x2 U9: Wattignies, Wahagnies, Anstaing, Fretin U6: Oliveaux, FC Lambersart, Fives, SRLD, Carrel, Sequedin Lezennes 10h30 Lesquin 14h U8: Lezennes, Wattignies, Wattignies, U7: Lesquin x2, Cysoing, Genech, Faches LILLE SUD 13H30, Salle Templeuve U8: Lesquin, Lesquin, Cysoing, Genech, U6 : Lille Sudx2, La Madeleine, Antillais, U9: Lezennes x2, Wattignies x2 Camphin Wazemmes, Iris Samedi 11 Février 2017 Samedi 18 Mars 2017 LILLE SUD 15H, Salle Baisieux 14h Ronchin 15h30 U9 : Lille Sudx3, Fives, FC Lambersart, U7: Baiseux x2, Camphin, Lesquin U6: Ronchin, Avelin, Phalemin, Cysoing Wazemmes ? Oliveaux, Vieux Lille U8: Baisieux x2, Camphin, Lesquin U7: Ronchin, Avelin, Phalempin, Cysoing U8: Ronchin, Avelin, Phalempin, Cysoing Dimanche 5 Février 2017 Seclin 14h IRIS 10H Synthé U6: Seclin, Templeuve, Faches, Avelin Wahagnies 10h U7:Seclin, Templeuve, -

LISTE-DES-ELECTEURS.Pdf
CIVILITE NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE N° Ordinal MADAME ABBAR AMAL 830 A RUE JEAN JAURES 59156 LOURCHES 62678 MADAME ABDELMOUMEN INES 257 RUE PIERRE LEGRAND 59000 LILLE 106378 MADAME ABDELMOUMENE LOUISA 144 RUE D'ARRAS 59000 LILLE 110898 MONSIEUR ABU IBIEH LUTFI 11 RUE DES INGERS 07500 TOURNAI 119015 MONSIEUR ADAMIAK LUDOVIC 117 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE 80384 MONSIEUR ADENIS NICOLAS 42 RUE DU BUISSON 59000 LILLE 101388 MONSIEUR ADIASSE RENE 3 RUE DE WALINCOURT 59830 WANNEHAIN 76027 MONSIEUR ADIGARD LUCAS 53 RUE DE LA STATION 59650 VILLENEUVE D ASCQ 116892 MONSIEUR ADONEL GREGORY 84 AVENUE DE LA LIBERATION 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES 12934 CRF L'ESPOIR DE LILLE HELLEMMES 25 BOULEVARD PAVE DU MONSIEUR ADURRIAGA XIMUN 59260 LILLE 119230 MOULIN BP 1 MADAME AELVOET LAURENCE CLINIQUE DU CROISE LAROCHE 199 RUE DE LA RIANDERIE 59700 MARCQ EN BAROEUL 43822 MONSIEUR AFCHAIN JEAN-MARIE 43 RUE ALBERT SAMAIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35417 MADAME AFCHAIN JACQUELINE 267 ALLEE CHARDIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35416 MADAME AGAG ELODIE 137 RUE PASTEUR 59700 MARCQ EN BAROEUL 71682 MADAME AGIL CELINE 39 RUE DU PREAVIN LA MOTTE AU BOIS 59190 MORBECQUE 89403 MADAME AGNELLO SYLVIE 77 RUE DU PEUPLE BELGE 07340 colfontaine 55083 MONSIEUR AGNELLO CATALDO Centre L'ADAPT 121 ROUTE DE SOLESMES BP 401 59407 CAMBRAI CEDEX 55082 MONSIEUR AGOSTINELLI TONI 63 RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT 59750 FEIGNIES 115348 MONSIEUR AGUILAR BARTHELEMY 9 RUE LAMARTINE 59280 ARMENTIERES 111851 MONSIEUR AHODEGNON DODEME 2 RUELLE DEDALE 1348 LOUVAIN LA NEUVE - Belgique121345 MONSIEUR -

Rue De La Libération - 59242 GENECH Année Scolaire 2019-2020 Tel : 03.20.84.57.08 DU MARDI AU VENDREDI MATIN
INSTITUT DE GENECH - Rue de la Libération - 59242 GENECH Année scolaire 2019-2020 Tel : 03.20.84.57.08 DU MARDI AU VENDREDI MATIN 250/811 - IAH 1 (MARIOT-GAMELIN) 220/341 - IAH 5 (NOT'CAR) CARVIN Place J Jaures 6 H 45 VILLENEUVE D'ASCQ Les Près - Edgard Pisani 6 H 50 OIGNIES Crombez 6 H 53 MONS EN BAROEUL Fort de Mons 6 H 55 LIBERCOURT Place Léon Blum (Poste) 6 H 57 VILLENEUVE D'ASCQ 4 Cantons Stade P. Mauroy 7 H 10 WAHAGNIES 106 Pas 7 H 00 LESQUIN Gare 7 H 20 WAHAGNIES Place 7 H 02 LESQUIN Jaurès 7 H 23 THUMERIES Pasteur 7 H 07 LESQUIN Descat 7 H 25 THUMERIES Collège A. Camus (Rue J. Béghin) 7 H 12 AVELIN Pont d'Ennetières 7 H 33 THUMERIES Le Paradis 7 H 13 ENNEVELIN Place 7 H 38 THUMERIES Gare 7 H 14 GENECH Institut 7 H 55 LA NEUVILLE Centre 7 H 18 LA NEUVILLE Leu Pindu 7 H 19 226/531 - IAH 6 (DELAHOUTRE) ATTICHES Eglise 7 H 23 ROUBAIX Eurotéléport 7 H 05 TOURMIGNIES Rue des fonds 7 H 26 WILLEMS Beau Coin 7 H 25 MERIGNIES Rue Leclerc 7 H 29 WILLEMS Petit Baptiste 7 H 26 GENECH Institut 7 H 55 WILLEMS Pureur 7 H 27 BAISIEUX Ogimont 7 H 30 250/831 - IAH 2 (MARIOT-GAMELIN) BAISIEUX Monnet 7 H 31 ALLENNES LES MARAIS Place 6 H 55 BAISIEUX Les Poètes 7 H 32 HERRIN Mairie 6 H 59 BAISIEUX Cimetière 7 H 35 GONDECOURT Lycée M. -

A.8. Le Sud Interurbain
LA CONTRIBUTION DES TERRITOIRES A.8. LE SUD INTERURBAIN A.8.1. LA SITUATION européennes majeures : l’autoroute A1, la roca- Le sud de l’arrondissement de Lille, de la de minière, le canal à grand gabarit de la Deûle Deûle à l’ouest jusqu’à la Pévèle à l’est, assu- connecté au réseau européen, l’aéroport de re la transition entre l’agglomération lilloise et Lille-Lesquin ; le Bassin minier. Cette double appartenance a caractérisé l’évolution de ce territoire. • l’environnement : le Carembault est encadré par deux zones naturelles importantes : la vallée Le secteur rassemble, de chaque côté du de la Haute-Deûle à l’ouest, d’une grande richesse Carembault, deux nébuleuses de petites villes écologique, la forêt domaniale de Phalempin dont la population se situe entre 2 000 et 9 000 à l’est. habitants environ. On distingue : • à l’est : Phalempin, La Neuville, Wahagnies, Thumeries, Ostricourt ; A.8.2. LES ENJEUX • à l’ouest : Bauvin, Provin, Annœullin, Allennes-les-Marais ; Le sud de l’arrondissement de Lille ne trou- • au centre : le Carembault, plaine agricole vera sa pleine vocation que par rapport à la autour des villages de Chemy, Camphin, Carnin, métropole lilloise, grâce à l’affirmation d’une Herrin et Gondecourt. vocation résidentielle, au développement de services, et par une requalification urbaine et Après une croissance industrielle et démo- paysagère. graphique relativement importante du début du siècle aux années 70, les villes ont connu Cette intégration suppose, par ailleurs, la prise certaines difficultés économiques et ont peu en compte de deux éléments d’échelle métropo- bénéficié de leur situation périurbaine : leur litaine, intéressant directement le sud de l’ar- population stagne ou diminue depuis 1975. -
Secteur Weppes & Sud De Lille
LES TRANSPORTS DE LA MEL Secteur Weppes & Sud de Lille Horaires hiver 2020/2021 valables du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 • 202 - 206 - 209 • 205 • 220 • 229 - 232 • 230 • 233 • 236 • 250 2 B.B ■ Billy-Berclau Mairie 09 . BAUVIN ■ Stade 20 ■ Marais Limite MEL 2 ■ Mairie PROVIN ■ Cornet ■ Église 20 ■ Mairie 6 ANNOEULLIN ■ Touraine ■ Centre pénitentiaire 20 ■ Saint Martin ■ Gare 9 ALLENNES LESMARAIS ■ Salengro ■ Gare Ve ■ Place ■ Cèdre Bleu rs HERRIN Lill ■ Mairie GONDECOURT Limite MEL ■ Collège Hergé e ■ Lycée M. de Flandre ■ Rue Nationale ■ Tissage ■ Seclin SECLIN Centre Hospitalier Limite MEL ■ Apolda ■ Hôtel de Ville ■ Seclin ■ Seclin Martinsart Route d’Avelin 20 2 20 ■ École 6 CORRESPONDANCES ■ SECLIN Vieux Moulin SECLIN Métro ligne1/2 ■ Lebas ■ École ■ Saint Piat ■ Église ■ Collège Immaculée Conception ■ Vieux Moulin Tramway Roubaix /Tourcoing ■ Route de Pont à Marcq TEMPLEMARS ■ Z.I. Rouge Bouton ■ Petite Barrière ■ Villa Saint Eloi ■ Hôtel de Ville WATTIGNIES ■ Blum ■ Philippe De Girard FACHES ■ Bourget Liane ■ Rue de l’Oise LILLE ■ Lille Porte d’A SNCF ■ Diderot ■ Lille Porte de Douai rras 202 206 209 Du lundi au samedi Direction Lille S1 S1 S1 S2 VVSVS2 S1 SV SS1 BAUVIN Stade 06:01 06:29 06:50 07:00 07:00 07:47 07:47 07:47 08:49 BAUVIN Marais 06:02 06:30 06:51 07:01 07:01 07:48 07:48 07:48 08:50 BAUVIN Mairie 06:03 06:31 06:52 07:02 07:02 07:49 07:49 07:49 08:51 BAUVIN Cornet 06:05 06:32 06:54 07:04 07:04 07:51 07:51 07:51 08:53 PROVINEglise 06:07 06:34 06:56 07:06 07:06 07:53 07:53 07:53 08:55 PROVINMairie 06:09 06:36 06:58 -

2021-0000002
LETTRE CIRCULAIRE n° 2021-0000002 Montreuil, le 30/04/2021 DRCPM OBJET Sous-direction production, Modification du champ d'application du versement transport (art. L. gestion des comptes, 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales) fiabilisation Texte(s) à annoter : VLU-grands comptes et VT LCIRC-2019-0000022 ; LCIRC-2016-0000020 Affaire suivie par : BLAYE DUBOIS Nadine, Suite à l’entrée dans le ressort territorial du SITAC (9306209) des communes WINTGENS Claire de PEUPLINGUES (62654), ESCALLES (62307), SAINT-TRICAT (62769), BONNINGUES-LES-CALAIS (62156) et PIHEN-LES-GUINES (62657), ces communes sont exclues du périmètre du versement mobilité additionnel (VMa) auprès du Syndicat des Hauts-de-France Mobilités (9315901) à compter du 1er mai 2021. Par une délibération du 12 février 2020, le Comité Syndical du SITAC (9306209) a décidé l’application du versement transport à ces communes avec des taux progressifs à compter du 01/05/2021 avec un taux de 0,80 % pour atteindre 2% en 2025. L’application de la délibération entraîne la création de l’identifiant n° 9306223 au 1er mai 2021. Suite à l’entrée dans le ressort territorial du SITAC (9306209) des communes de PEUPLINGUES (62654), ESCALLES (62307), SAINT-TRICAT (62769), BONNINGUES-LES-CALAIS (62156) et PIHEN-LES-GUINES (62657), ces communes sont exclues du périmètre de la taxe mobilité additionnelle (VMa) auprès du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités (9315901) à compter du 1er mai 2021. Les informations relatives au champ d’application, au taux, au recouvrement et au reversement du VMa du Syndicat Mixte Hauts De France Mobilités, sont regroupées dans le tableau ci-joint (annexe 1). -
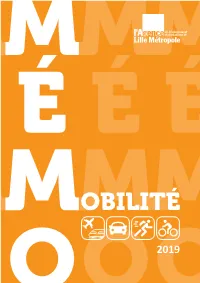
1928-Memomobilite Web.Pdf
2019 UNE MÉTROPOLE EUROPÉENNE CONNECTÉE 2,7 ers/an 201 Gare Lille-Flandres Gare Lille-Europe 19,5 7,2 millions millions ers ers ère gar1 GV e de voyageurs (hor aris) e Strasbourg 2 3e gare er (TG 1 Lyon e Part Dieu de voyageurs (hor aris) P 3e port fluvial de France 1,9 ers/an à l’aéroport Lille-Lesquin 201 ZWEVEGEM KORTRIJK Kortrijk Voie ferroviaire TER structurante MENEN Gare accessible avec l’intégration tarifaire Voie ferroviaire TER structurante dont la Leie BOESCHEPE Gare hors intégration tarifaire fermeture est programmée en décembre 2019 WERVIK HEUVELLAND UNE RESSOURCE FERROVIAIRE AVELGEM Voie ferroviaire dont le trac est suspendu HALLUIN Gare extérieure au SCOT BERTHEN COMINES CAPITALE Voie ferroviaire externe au SCOT Ypres / Ieper 18 min Temps d’accès* à partir d’Euraandre SAINT-JANS-CAPPEL WERVICQ- MESEN COMINES SUD Temps d’accès* à partir d’Euraandre BOUSBECQUE 26 min La Lys NEUVILLE- EN-FERRAIN (pour les gares hors SCOT) MOUSCRON * Optimal GARE RONCQ WARNETON DE COMINES GARE BAILLEUL 30 min 2 2 LINSELLES GARE DE MOUSCRON usagers dans les gares Dunkerque 26 min Calais DEÛLEMONT DE TOURCOING 18 min SPIERE-HELKIJN du territoire du SCOT QUESNOY- tr 201 SUR-DEÛLE TOURCOING La Deûle Lys BONDUES FRELINGHIEN MOUVAUX WATTRELOS NIEPPE La ARMENTIÈRES MONTÉES ET DESCENTES PAR JOUR WAMBRECHIES Canal de Roubaix ROUBAIX ESTAIMPUIS PECQ LE DOULIEU STEENWERCK HOUPLINES VERLINGHEM WASQUEHAL GARE de ROUBAIX GARE (Jean-Lebas) LEERS PÉRENCHIES MARQUETTE- CROIX LYS-LEZ- 10 000 D’ARMENTIÈRES LEZ-LILLE LANNOY LA CHAPELLE- 13 min -

Territoires De Rattachement À La Caf Du Nord
Territoires de rattachement à la Caf du Nord COMMUNES TERRITOIRE ABANCOURT CAMBRAI ABSCON VALENCIENNES AIBES MAUBEUGE AIX DOUAI ALLENNES-LES-MARAIS LILLE AMFROIPRET MAUBEUGE ANHIERS DOUAI ANICHE DOUAI ANNEUX CAMBRAI ANNOEULLIN LILLE ANOR MAUBEUGE ANSTAING ROUBAIX ANZIN VALENCIENNES ARLEUX DOUAI ARMBOUTS-CAPPEL DUNKERQUE ARMENTIERES ARMENTIERES ARNEKE DUNKERQUE ARTRES VALENCIENNES ASSEVENT MAUBEUGE ATTICHES LILLE AUBENCHEUL-AU-BAC CAMBRAI AUBERCHICOURT DOUAI AUBERS LILLE AUBIGNY-AU-BAC DOUAI AUBRY-DU-HAINAUT VALENCIENNES AUBY DOUAI AUCHY-LEZ-ORCHIES DOUAI AUDIGNIES MAUBEUGE AULNOY-LEZ-VALENCIENNES VALENCIENNES AULNOYE-AYMERIES MAUBEUGE AVELIN LILLE AVESNELLES MAUBEUGE AVESNES-LE-SEC VALENCIENNES AVESNES-LES-AUBERT CAMBRAI AVESNES-SUR-HELPE MAUBEUGE AWOINGT CAMBRAI BACHANT MAUBEUGE BACHY LILLE BAILLEUL ARMENTIERES BAISIEUX ROUBAIX BAIVES MAUBEUGE BAMBECQUE DUNKERQUE BANTEUX CAMBRAI BANTIGNY CAMBRAI BANTOUZELLE CAMBRAI BAS-LIEU MAUBEUGE BAUVIN LILLE BAVAY MAUBEUGE BAVINCHOVE DUNKERQUE BAZUEL CAMBRAI BEAUCAMPS-LIGNY LILLE BEAUDIGNIES MAUBEUGE BEAUFORT MAUBEUGE BEAUMONT-EN-CAMBRESIS CAMBRAI BEAURAIN CAMBRAI BEAUREPAIRE-SUR-SAMBRE MAUBEUGE BEAURIEUX MAUBEUGE BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS CAMBRAI BELLAING VALENCIENNES BELLIGNIES MAUBEUGE BERELLES MAUBEUGE BERGUES DUNKERQUE BERLAIMONT MAUBEUGE BERMERAIN CAMBRAI BERMERIES MAUBEUGE BERSEE LILLE BERSILLIES MAUBEUGE BERTHEN ARMENTIERES BERTRY CAMBRAI BETHENCOURT CAMBRAI BETTIGNIES MAUBEUGE BETTRECHIES MAUBEUGE BEUGNIES MAUBEUGE BEUVRAGES VALENCIENNES BEUVRY-LA-FORET DOUAI BEVILLERS CAMBRAI BIERNE DUNKERQUE -

Tracking Selenium in the Chalk Aquifer of Northern France: Sr Isotope
Tracking selenium in the Chalk aquifer of northern France: Sr isotope constraints Lise Cary, Hind Benabderraziq, Jamal Elkhattabi, Laurence Gourcy, Marc Parmentier, Julie Picot, M. Khaska, Alexandra Laurent, Philippe Négrel To cite this version: Lise Cary, Hind Benabderraziq, Jamal Elkhattabi, Laurence Gourcy, Marc Parmentier, et al.. Tracking selenium in the Chalk aquifer of northern France: Sr isotope constraints. Applied Geochemistry, Elsevier, 2014, 48, pp.70-82. 10.1016/j.apgeochem.2014.07.014. hal-01053410 HAL Id: hal-01053410 https://hal-brgm.archives-ouvertes.fr/hal-01053410 Submitted on 30 Jul 2014 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Tracking selenium in the Chalk aquifer of northern France: Sr isotope constraints Cary L.1*, Benabderraziq H.2, Elkhattabi J.2, Gourcy L.1, Parmentier M.3, Picot J.3, Khaska, M.4, Laurent A1., Négrel Ph.1 1 BRGM (French Geological Survey), 3 av. C. Guillemin, BP 36009, 45060 Orléans Cedex 2, France 2 University of Lille 1, Polytech'Lille, Laboratoire de Génie Civil et Géo-Environnement LGCgE, Lille, France 3 BRGM, Synergie Park, 6 ter, rue Pierre et Marie Curie, 59260 LEZENNES 4 GIS Laboratory, University of Nîmes, Georges Besse Scientific Park, Georges Besse street 150, Nîmes cedex 1, 30035, France *Corresponding author: Tel.