Plan Local D'urbanisme
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

[email protected] LES ACCUEILLANTS
Maison Des Adolescents ADOBASE Pôle Femme et enfant Site de Marne-la-Vallée PERMANENCES gratuites Lieu d’accueil, d’écoute, de conseils et d’orientation pour répondre aux questions que se posent les adolescents, les jeunes adultes et les parents Dr Isabelle LATINIS-HERITIER Chef de service Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30 Tél. : 01 60 54 30 73 - Fax : 01 60 54 30 61 Mail : [email protected] LES ACCUEILLANTS Ce sont des professionnels travaillant dans différents domaines : éducatif, soignant, social, psychologique… LES JEUNES Nous recevons les jeunes de 11 à 25 ans (accompagnés ou non de leurs proches, famille, amis et ou parents). NOTRE ÉQUIPE SE COMPOSE • d’un médecin responsable pédopsychiatre, • d’une cadre de santé coordonnateur, • d’une infirmière, • d’une secrétaire, • d’une psychologue. NOS PARTENAIRES PROFESSIONNELS SONT • L’Agence Régionale de Santé (ARS), • Les Maisons Départementales des Solidarités (MDS) de Lagny-sur-Marne, Meaux, Noisiel et Roissy-en-Brie, • Val d’Europe Agglomération et Pays de Meaux, • L’Association La Brèche, • Les villes de Thorigny-sur-Marne et de Meaux, • L’ADSEA 77, • La MJC - Maison Pour Tous de Noisiel. L’ACCUEIL La MDA propose un accueil sur 5 lieux de permanences : sans rendez-vous, confidentiel, gratuit, anonyme si demandé. Centre Social Maison Pour Tous « Arc en Ciel » 16, rue d’Annet 77400 Thorigny-sur-Marne Les mardis des semaines impaires de 18h à 20h MJC « La Ferme du Buisson» 8, passage Louis Logre 77186 Noisiel Tous les mercredis de 13h30 à 16h Centre Social Intercommunal -

Escapades Et Découvertes En Marne&Gondoire
D418 PRÉCY-SUR-MARNE A B ANNET-SUR-MARNE C D E F Escapades et découvertes en Marne&Gondoire Getaways and discoveries in Marne&Gondoire 1 D418 D45 Ausflüge und Entdeckungen in der Region Saint-Sidoine D45 Marne&Gondoire D404 ENTRÉE DE JABLINES Uitstapjes en bezienswaardigheden L'ÎLE DE LOISIRS in Marne&Gondoire VILLEVAUDE Marais du LÉGENDE, LEGEND, TEXT, LEGENDA : Refuge D105a Points de vue, FORÊT RÉGIONALE Plage LESCHES Viewpoints, Aussichtspunkt, Uitzichtpunt DE VALLIÈRES Stations, Bahnhof, Stations Fontaine sulfureuse Gares, Île de Loisirs Île de Loisirs D45 Notre-Dame D404 GR-14 a de Jablines-Annet de Jablines-Annet D89 Bois, forêts, vignes et jardins, "Ne se visite plus pour le moment" Gare d'Esbly Woods, forests, vineyards and gardens, SNCF Gehölze, Wälder, Weinberge und Gärten, 2 D418 Bossen, wouden, wijngaarden en tuinen La Francilienne - A104 Saint-Antoine Villes, villages et hameaux, Ecluse Towns, villages and hamlets, Halte fluviale Städte, Dörfer und Weiler, CARNETIN Le cabaret Steden, dorpjes en gehuchten Ermitage Ecluse D105b Tour Taratte Etangs et rivières, (privé) Ponds and rivers, Teiche und Flüsse, Aqu Vijvers en rivieren Château edu de Chaâlis (privé) c de D418 la Bois des D CHALIFERT hu Réseau routier, Bouleaux is TGV Road network, Straßennetz, Wegen Bois de Chaâlis Eolienne Bollée Puits THORIGNY-SUR-MARNE Café nature Réseau ferré, D86 Railway network, DAMPMART Saint-André Eisenbahnnetz, Spoorwegen Vignes Ferme de D5 la Marche LA POMPONNETTE Fontaine Saint-Médard Saint-Martin Sainte-Anne Les sculptures de la Dhuys Point -

Rapport Général Tome III Annexe 20
N° 101 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1993 - 1994 Annexe au procès-verbal de la séance du 22 novembre 1993 . RAPPORT GÉNÉRAL <0 FAIT au. nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1 ) sur le projet de loi de finances pour 1994 ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, Par M. Jean ARTHUIS , j ■ Sénateur , Rapporteur général. 1 TOME in LES MOYENS DES SERVICES ET LES DISPOSITIONS SPÉCIALES (Deuxième partie de la loi de finances) il } ANNEXE N° 20 ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS ET TOURISME II. Transports : 2. Routes 3. Sécurité routière Rapporteur spécial : M. Paul LORIDANT (1 ) Cette commission est composée de : MM . Christian Poncelet, président ; Jean Cluzel , Paul Girod, Jean Clouet, Jean - Pierre Masseret, vice-présidents ; Jacques Oudin , Louis Perrein, François Trucy , Robert Vizet, secrétaires ; Jean Arthuis , rapporteur général ; Philippe Adnot, René Ballayer, Bernard Barbier, Claude Belot, Mme* Maryse Bergé-Lavigne , MM. Maurice Blin , Camille Cabana , Ernest Cartigny , Auguste Cazalet, Michel Charasse , Jacques Chaumont, Henri Collard, Maurice Couve de Murville, Pierre Croze, Jacques Delong, Mme Paulette Fost, MM . Henri Goetschy , Emmanuel Hamel, Alain Lambert, Tony Larue, Paul Loridant, Roland du Luart, Michel Manet , Philippe Marini , Michel Moreigne, Jacques Mossion, Bernard Pellarin, René Régnault, Michel Sergent , Jacques Sourdille , Henri Torre, René Trégouët, Jacques Valade. Voir les numéros : Assemblée nationale ( 10e législ.) : 536, 580, 585 et T.A.66 . Sénat : 100(1993-1994). Lois de finances . -2- SOMMAIRE Pages PRINCIPALES OBSERVATIONS -T. .... : 5 i CHAPITRE PREMIER : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES CRÉDITS il 1 . Les changements de structure 12 /> . " 2 . Le développement du réseau routier 13 3 . -

Communes Arrdts Et Zone
Commune Arrondissement Zone Sécurité ACHERES-LA-FORET Fontainebleau Gendarmerie AMILLIS Meaux Gendarmerie AMPONVILLE Fontainebleau Gendarmerie ANDREZEL Melun Gendarmerie ANNET Meaux Gendarmerie ARBONNE-LA-FORET Fontainebleau Gendarmerie ARGENTIERES Melun Gendarmerie ARMENTIERES-EN-BRIE Meaux Gendarmerie ARVILLE Fontainebleau Gendarmerie AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS Provins Gendarmerie AUFFERVILLE Fontainebleau Gendarmerie AUGERS-EN-BRIE Provins Gendarmerie AULNOY Meaux Police AVON Fontainebleau Police BABY Provins Gendarmerie BAGNEAUX-SUR-LOING Fontainebleau Police BAILLY-ROMAINVILLIERS Torcy Police BALLOY Provins Gendarmerie BANNOST-VILLEGAGNON Provins Gendarmerie BARBEY Provins Police BARBIZON Fontainebleau Gendarmerie BARCY Meaux Gendarmerie BASSEVELLE Meaux Gendarmerie BAZOCHES-LES-BRAY Provins Gendarmerie BEAUCHERY-SAINT-MARTIN Provins Gendarmerie BEAUMONT-DU-GATINAIS Fontainebleau Gendarmerie BEAUTHEIL Meaux Police BEAUVOIR Melun Gendarmerie BELLOT Provins Gendarmerie BERNAY-VILBERT Provins Gendarmerie BETON-BAZOCHES Provins Gendarmerie BEZALLES Provins Gendarmerie BLANDY Melun Gendarmerie BLENNES Provins Gendarmerie BOISDON Provins Gendarmerie BOIS-LE-ROI Fontainebleau Police BOISSETTES Melun Police BOISSISE-LA-BERTRAND Melun Police BOISSISE-LE-ROI Melun Police BOISSY-AUX-CAILLES Fontainebleau Gendarmerie BOISSY-LE-CHATEL Meaux Police BOITRON Provins Gendarmerie BOMBON Melun Gendarmerie BOUGLIGNY Fontainebleau Gendarmerie BOULANCOURT Fontainebleau Gendarmerie BOULEURS Meaux Gendarmerie BOURRON-MARLOTTE Fontainebleau Police BOUTIGNY -

L'intercommunalité À Votre Service
Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart Ferrières-en-Brie Jablines Jossigny Guermantes Gouvernes Lagny-sur-Marne Lesches Montévrain Pomponne Pontcarré Saint-Thibault-des-Vignes Thorigny-sur-Marne Bussy-Saint-Georges Bus- sy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart Ferrières-en-Brie Jablines Jossigny Guermantes Gouvernes Lagny-sur-Marne Lesches Montévrain Pomponne Pontcarré Saint-Thibault-des-Vignes Thorigny-sur-Marne Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart Ferrières-en-Brie Jablines Jossigny Guermantes Gouvernes Lagny-sur-Marne Lesches L’actualitéMontévrain Pomponne Pontcarré Saint-Thibault-des-Vignes intercommunale Thorigny-sur-Marne Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart Ferrières-en-Brie Jablines Jossigny Guermantes Gouvernes Lagny-sur-Marne Lesches Montévrain Pomponne Pontcarré Saint-Thibault-des-VignesN° 123 - 25 mai Thorigny-sur-Marne 2020 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Si l’épidémie bouscule nombre de nos certitudes, elle en renforce d’autres : plus que jamais l’action publique doit être agile, décloisonnée et en prise avec le terrain. Jean-Paul Michel L’intercommunalité à votre service Services Le Parc culturel de Rentilly Michel-Chartier, Urbanisme, assainissement, marchés les sites d’enseignement musical, le centre publics, services techniques, culture, etc. aquatique, l’office de tourisme, le moulin Le 11 mai, les services intercommunaux ont Russon, la Maison de la nature restent pour repris leur activité dans leurs locaux de tra- l’instant fermés. -
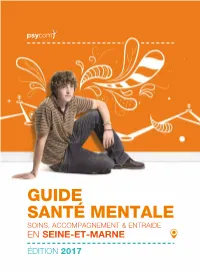
Psycom-GS77-2017-Web-Small.Pdf
GUIDE SANTÉ MENTALE SOINS, ACCOMPAGNEMENT & ENTRAIDE EN SEINE-ET-MARNE ÉDITION 2017 2 EDITO a publication d’un guide santé mentale pour chaque territoire L francilien est une action phare du Psycom soutenue par l’Agence régionale de santé d’Île-de-France. Né d’une initiative parisienne, le Psycom est devenu un groupement de coopération sanitaire à vocation régionale. L’une de ses principales missions est l’information du public et des professionnels impliqués dans la prise en charge des troubles psychiques. Il apporte ainsi une contribution de premier plan à un des principaux objectifs du projet régional de santé : assurer une meilleure lisibilité de l’offre de soins, de prises en charge médico-sociales ou d’accompagnement social. Chaque guide santé mentale est le fruit d’un travail de collaboration du Psycom avec les acteurs du territoire qui doivent être remerciés de leur participation et de leur engagement dans ces projets. L’édition du guide de papier que vous avez en mains s’accompagne de la mise en ligne des informations sur le site du Psycom : www.psycom.org. Je vous invite à le visiter pour y découvrir les autres actions développées par le Psycom, qu’il s’agisse de documentation, de formation et de conseil en santé mentale. Raphaël Yven Administrateur du Psycom 3 4 INTRODUCTION u cours des 30 dernières années, l’organisation des soins psychiatriques a beaucoup évolué, passant A des soins hospitaliers aux soins dans la Cité, au plus près des lieux de vie des patients et de leur entourage. Simultanément, de nouveaux dispositifs se sont développés afin d’apporter des réponses adaptées, favorisant l’insertion sociale et la vie quotidienne des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. -

Création De La Voie Sud Francilienne (Liaison Centre-Essonne)
RD 117 LCE Création de la voie Sud Francilienne (Liaison Centre-Essonne) Dossier d’étude d’impact février 2018 / version finale http://www.somival.fr/ Ce dossier a été réalisé par Contact: Vianney LEPINE : [email protected] ; 06 74 78 48 01 http://www.somival.fr/ 2 /169 Liaison Centre Essonne– Version finale Etude d’impact – février 2017- 33080 Fiche de validation interne Historique Création de la voie Sud Francilienne - Liaison Centre Essonne (LCE) Affaire : Dossier d’enquête publique Indice Date Observations Rédigé par Vérifié par Décembre Première édition du document ML Wasier V1 V LEPINE 2015 Etat initial M SOCIER Reprise de l’état initial suite remarques V2 Avril 2016 ML WASIER V LEPINE MO Propriétaire du V3 – V4 Mai 2016 Impacts et mesures ML WASIER V LEPINE rapport « Propriétaire du rapport»: CDEA : Chef de Projet B. Autrive, DGA Patrimoine – V5 Juin 2016 Document final ML WASIER V LEPINE Equipe Projet : A. Humberdot, E. Monpays, C. Moreau, O. Quittard Interlocuteur : S. Royer, SORGEM, AMO V6 Juillet 2016 Remarques client ML WASIER V LEPINE V7 Août 2016 Modification légendes acoustiques ML WASIER V LEPINE Compléments et modifications suite à Commentaire Janvier V8 l’avis de l’Autorité Environnementale V. LEPINE 2017 du 10 novembre 2016 Rapport provisoire V finale Février 2017 Finalisation V. LEPINE Statut : Rapport définitif Numéro d’affaire : 33080 Chef de projet Chargé d’étude Cartographe Projeteur Intervenants ML Wasier V. LEPINE S. Roure – paysagiste SOMIVAL G. Maurizot E. Boutier P. Philbée – acousticien M. Socier - stagiaire Nom du fichier : Liaison Centre-EssonneV7.docx Site de Clermont-Ferrand 2 rue Saint Théodore 23 rue Jean Claret 69003 Lyon 63 000 Clermont-Ferrand Tél : 04 72 33 91 67 Tel 04 73 34 75 00 Courriel : [email protected] Rédigé par Vérifié par Rédacteurs : Somival Technisim Nom Signature V. -

CLIC De Lagny/Marne La Vallée
Notre territoire d’intervention : 48 communes BAILLY ROMAINVILLIERS BOULEURS BOUTIGNY BUSSY ST GEORGES BUSSY ST MARTIN CARNETIN Ayez le réflexe CHALIFERT CHAMPS S/MARNE CHANTELOUP EN BRIE CHESSY COLLEGIEN CONCHES S/GONDOIRE CLIC COUPVRAY CONDE STE LIBIAIRE COUTEVROULT pour vous COULOMMES COUILLY P/A DAMES CRECY LA CHAPELLE CROISSY BEAUBOURG DAMPMART EMERAINVILLE simplifier ESBLY FERRIERES EN BRIE GOUVERNES GUERMANTES JABLINES JOSSIGNY la vie LA HAUTE MAISON LAGNY SUR MARNE LESCHES LOGNES MAGNY LE HONGRE MONTEVRAIN ! MONTRY NOISIEL POMPONNE QUINCY VOISINS SANCY LES MEAUX SERRIS ST FIACRE ST GERMAIN S/MORIN ST THIBAULT THORIGNY S/MARNE TORCY VAUCOURTOIS VILLEMAREUIL VILLIERS S/MORIN VOULANGIS Service Ouverture du lundi au vendredi d’information 9h30/12h30 et 14h00/17h00 d’orientation et 33 rue Henri Dunant d’accompagnement 77400 Lagny-sur-Marne médico-social gratuit Tél. : 01 60 31 52 80 Fax : 01 64 02 96 69 Mail : [email protected] A destination des personnes Site : clicreliage.fr de + de 60 ans et de leur entourage Le CLIC Lagny-Marne-la-Vallée est financé par : certaines communes de son territoire ; CLIC Lagny-Marne-la-Vallée le Conseil général de Seine-et-Marne ; Coordination gérontologique l’Agence Régionale de Santé ; la Région Ile-de-France ; 01 60 31 52 80 la CNAV ; clicreliage.fr le RSI… Le CLIC : Le CLIC c’est : Ses missions une équipe à votre écoute, un centre de ressources, un lieu de réflexion et d’expertise, Accueil Accueil personnalisé gratuit pour les personnes âgées et leur un observatoire du vieillissement. entourage Notes personnelles Informations Information et orientation vers les organismes et professionnels du territoire : protection juridique, aides et/ou soins à domicile, modalités de rémunération, repas à domicile, téléalarme, recherche lieu de vie : maison de retraite, foyer logement.. -

Ppbe) 2019-2024
Projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement (PPBE) 2019-2024 Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne Le présent document, Projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement, est mis à la disposition du public pendant une durée de 2 mois, conformément aux textes de transposition de la Directive Européenne 2002/49/CE. Le document final intègrera les remarques formulées par le public pendant cette période et sera soumis à l’approbation du Conseil Communautaire avant transmission au Préfet du département de Seine-et-Marne 1 Projet de PPBE 17 Janvier 2020 Sommaire Introduction : Résumé non technique du document à destination du public consulté . 5 I. Contexte ........................................................................................................................ 6 1) Contexte réglementaire ........................................................................................ 6 2) Présentation du territoire...................................................................................... 8 1. Situation géographique ........................................................................................................... 8 2. Superficie et population ........................................................................................................ 10 3. Habitat ................................................................................................................................... 10 4. Infrastructures ...................................................................................................................... -

Plan D'exposition Au Bruit (PEB)
Projet itre du rapport MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Direction générale de l’Aviation civile Direction Départementale des Territoires de Seine et Marne Service Environnement et Prévention des Risques (SEPR) Direction de la sécurité de l’Aviation civile Pôle de Prévention des Risques et Lutte contre les Nuisances Direction de la sécurité de l’Aviation civile Nord Direction Départementale des Territoires de Seine Saint Denis Département Surveillance et Régulation d’Athis-Mons Division Régulation et Développement durable Subdivision développement durable AERODROME DE LOGNES EMERAINVILLE Rapport de présentation du Plan d’Exposition au Bruit Version V1 du 11 février 2019 Rédacteur DSAC-N/SR2/RDD/DD Référence PEB/SR2 RDD-DD/LFPL www.ecologique-solidaire.gouv.fr Rapport de présentation du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Lognes-Émerainville 11 février 2019 SOMMAIRE INTRODUCTION........................................................................................................................................................ 3 1. GENERALITES SUR LES PLANS D’EXPOSITION AU BRUIT ............................................................ 4 1.1. BASES REGLEMENTAIRES ........................................................................................................................ 4 1.1.1. INDICATEUR DE BRUIT LDEN ....................................................................................................................... 4 1.1.2. DEFINITION DES ZONES DE BRUIT............................................................................................................... -

Carte Des MDS2
TERRITOIRE ET COORDONNÉES DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES SOLIDARITÉS Meaux 31 rue du Palais de Justice Mitry-Mory 77109 MEAUX Cedes Tél. : 01 64 36 42 00 1 avenue du Dauphiné - BP31 77290 MITRY-LE-NEUF Directeur : M. PIETRI Tél. : 01 60 21 29 00 Crouy-sur-Ourcq Directeur : M. REGENT Othis Coulombs-en-Valois Saint- Vincy- Moussy-le-Neuf Pathus Oissery May-en-Multien Germigny- Manoeuvre Douy-la- sous- Rouvres Puisieux Dammartin- Ramée Le Plessis- Coulombs Lagny-sur-Marne en-Goële Forfry Placy Longperrier Marchémoret Moussy- Trocy-en- le-Vieux Coulommiers Gesvres- Multien Vendrest Saint-Mard le- Marcilly Dhuisy Saint-Soupplets Etrépilly Lizy-sur-Ourcq 15 boulevard Galliéni - BP204 Montgé- Chapitre Villeneuve-sous- en-Goële Ocquerre 26-28 rue du Palais de Justice 77400 LAGNY-SUR-MARNE Dammartin Mauregard Juilly Cuisy Cocherel Barcy Congis-sur- Mary-sur- 77120 COULOMMIERS Tél. : 01 64 12 43 30 Le Mesnil-Amelot Thérouanne Marne Le Plessis- Monthyon Thieux l'Evêque Le Plessis- Sainte-Aulde Tél. : 01 64 75 58 00 Directeur : E. PETIT Vinantes Varreddes Tancrou Nantouillet aux-Bois Iverny Chambry Isles-les- Meldeuses Directeur : E. MONNET Compans Penchard Méry- Jaignes Chamigny Nanteuil- Saint-Mesmes Germigny-l'Evêque Armentières- sur- Villeroy Crégy-lès- sur-Marne en-Brie Luzancy Marne Mitry-Mory Chauconin- Meaux Neufmontiers Poincy Charny Gressy Messy Changis- Chelles Trilport sur-Marne Ussy-sur-Marne Reuil- Citry Meaux La Ferté- en-Brie Charmentray Saint-Jean-les- sous-Jouarre Saâcy-sur-Marne Fresnes-sur- Trilbardou Deux-Jumeaux Montceaux- Sept- 25 rue du Gendarme Castermant Villeparisis Marne Villenoy Claye-Souilly lès-Meaux Sammeron Sorts Fublaines 77500 CHELLES Précy-sur- Vignely Nanteuil- Marne lès-Meaux Saint- Mareuil- Bussières Bassevelle Isles-lès- Fiacre Tél. -

N°113 - 11 Septembre 2019
Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart Ferrières-en-Brie Ja- blines Jossigny Guermantes Gouvernes Lagny-sur-Marne Lesches Montévrain Pomponne Pontcarré Saint-Thibault-des-Vignes Thorigny-sur-Marne Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart Ferrières-en-Brie Ja- blines Jossigny Guermantes Gouvernes Lagny-sur-Marne Lesches Montévrain Pomponne Pontcarré Saint-Thibault-des-Vignes Thorigny-sur-Marne Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart Ferrières-en-Brie Jablines L’actualitéJossigny Guermantes Gouvernes Lagny-sur-Marneintercommunale Lesches Montévrain Pomponne Pontcarré Saint-Thibault-des-Vignes Thorigny-sur-Marne Bus- sy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart Ferrières-en-Brie Jablines N°113 - 11 septembre 2019 Le mot du président L’approche environnementale de Marne et Gondoire n’est pas nouvelle mais elle va être accélérée par le Contrat de transition écologique. Nous avons peu de temps pour le concevoir, ce qui est un atout pour aller à l’essentiel, c’est-à-dire développer des projets concrets et opérationnels. Jean-Paul Michel Dans ce numéro Il fait beau : à vélo ! Les professeurs de musique Page 3 font leur rentrée. Page 6 Le CTE est lancé Réunion Mardi avait lieu à Rentilly le séminaire de lance- plénière en ment du Contrat de transition écologique pour présence de lequel une collectivité a été sélectionnée en nombreux Seine-et-Marne : Marne et Gondoire, en juillet. maires et Le but est d’accélerer l’action locale pour faire élus de de l’écologie un moteur de l’économie.