Etat Initial Partie 4 : Connaissance Des
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Proces-Verbal Du Conseil De La Communaute Urbaine D
J EUDI 16 N OVEMBRE 2017 2017 - 6 DGS/RS/VRD P ROCES - VERBAL DU C ONSEIL D E LA C OMMUNAUTE U RBAINE D ’A RRAS P RESENTS : MM., Mmes, Melles KRETOWICZ, LACHAMBRE, LEBLANC, PARIS, SACCHETTI, d’Achicourt DELCOUR, d’Acq THUILOT, d’Agny HECQ, d’Anzin - Saint - Aubin BEAUMONT, BECUE, CANLERS, DELRUE, FERET, GHEERBRANT, HEUSELE, HODENT, LAPOUILLE - FLAJOLET, LEFEBVRE, LETURQUE, NOCLERCQ, RAPENEAU, SPAS, d ’Arras PARMENTIER, d’Athies DERUY, de Bailleul - Sire - Berthoult KARPINSKI, de Basseux TILLARD, de Bea umetz - Les - Loges ANSART, BLONDEL, de Beaurains DOLLET, de Boiry - Becquerelle DELMOTTE, de Boiry - Saint - Martin PLU, de Boiry - Sainte - Rictrude DISTINGUIN, de Boisleux - Au - Mont DELMOTTE, de Boisleux - Saint - Marc CAVE, ROSSIGNOL, VIARD, de Dainville MATHISSART, d’Etr un COULON, de Fampoux DEPRET, de Farbus POTEZ, de Feuchy BLOUIN, de Ficheux ROCHE, de Guémappe FOURNIER, d’ Heninel ROUSSEZ, d’Henin - Sur - Cojeul DAMART, de Maroeuil MASTIN, de Mercatel ZECHEL, de Monchy - le - Preux BAVIERE, de Mont - Saint - Eloi PUCHOIS, de Neuvil le - Saint - Vaast CONTART, de Ransart DESAILLY, de Rivière Procès - verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 16 Novembre 2017 2 MONTEL, de Roclincourt NORMAND, de Roeux DESFACHELLE, FACHAUX - CAVROS, KUSMIEREK, de Saint - Laurent - Blangy DELATTRE, de Saint - Martin - Sur - Cojeul CATTO, CAYET, de Saint - Nicolas - Lez - Arras VAN GHELDER, de S ainte - Catherine MILLEVILLE, de Thélus MICHEL, de Tilloy - Les - Mofflaines ZIEBA, de Wailly GORIN, de Willerval E XCUSES : Madame OUAGUEF donne pouvoir à -

Inventaire Des Cavités Souterraines Achicourt – Arras – Beaurains
Inventaire des cavités souterraines Achicourt – Arras – Beaurains Réunion de concertation du 24 avril 2018 Déroulement Contexte Objectifs Présentation des résultats d’étude (Alp’géorisques) Débat Inventaire des cavités souterraines Achicourt – Arras – Beaurains Réunion de concertation du 24 avril 2018 Contexte général Les cavités souterraines : une réalité Des cavités connues et valorisées ; Des mouvements de terrains recensés ; Des nouvelles carrières découvertes impactant des projets de rénovation urbaine. Source : https://www.carrierewellington.com/ Inventaire des cavités souterraines Achicourt – Arras – Beaurains Réunion de concertation du 24 avril 2018 Source : Rapport d’étude SEMOFI Contexte : Les impacts => Impacts sur le bâti : - Fissures ; - Tassements ; - effondrement. => Impacts sur les réseaux : - Fuites de réseaux ; - Canalisations rompus. => Impacts économiques : - Relogement ; - Arrêt d’activités. => Impacts sur les personnes : - Foyers privés d’électricité, gaz, eau ; - Mise en place de déviation ; - Danger pour les vies humaines Inventaire des cavités souterrainesSource : Achicourt DDTM – Arras 62 – Beaurains Réunion de concertation du 24 avril 2018 Objectifs => Sensibiliser et accompagner ; => Améliorer la prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire ; => Proposer un programme d’étude ou de surveillance des cavités recensées avérées. Diagnostic : S’assurer de l’état et la stabilité de la carrière ; Intervenir au plus tôt pour limiter les coûts ; Pérenniser la connaissance. Inventaire des cavités souterraines Achicourt – Arras – Beaurains Réunion de concertation du 24 avril 2018 Étude du risques de mouvements de terrain liés aux cavités souterraines sur le territoire de la communauté urbaine d’Arras. Direction Départementale des Territoires Communes d’Arras, Beaurains et et de la Mer du Pas-de-Calais Achicourt (Tranche Ferme) Préfet du Pas-de-Calais COCON – 24 avril 2018 Ordre du jour Rappel du contexte ; Type de cavités identifiées ; Travaux réalisés ; Restitution des travaux ; Échanges. -

Www .Pasdecalais.Fr
11 Mars 2020 no 198 ISSN 1254-5171 Quand qué ch’four i’est caud, tertousse veul’té cuire www.pasdecalais.fr p. 6 ric Desaunois É Photo © La 2 Caps Nordic p. 14 Photo Jérôme Pouille Taxi jaune en Artois p. 24 Photo Yannick Cadart Sculpteur de photos OBJECTIF Lire pages 16-17 NATURE Le Platier d’Oye - Février 2020 Photo Yannick Cadart 2 360°À l’air livre L’Écho du Pas-de-Calais no 198 – Mars 2020 Sommaire 4 Vie des territoires Révision avant le pôle Photo Jérôme Pouille 16 Dossier 18 Identité 20 Expression des élus 21 Vécu 22 Sports 24 Arts & Spectacles 26 À l’air livre 27 Tout ouïe BOULOGNE-SUR-MER • En mars 2019, L’Écho du Pas-de-Calais présentait le Polarfront, une ancienne station météorologique norvé- gienne transformée en navire de croisière paré à emmener des touristes aux confins de l’Arctique. Le bateau de 55 mètres, propriété de la compagnie Latitude Blanche, faisait alors, après une première série de croisières, une escale technique à Boulogne-sur-Mer où il avait « changé de physiono- 28 Agenda mie » en 2017 et 2018. Au début du mois de février dernier, Polarfront a retrouvé une nouvelle fois le bassin Napoléon à l’issue d’une deuxième « vi- rée » de neuf mois et de 37 000 kilomètres dans les eaux froides entre la Norvège et le Spitzberg. À Boulogne-sur-Mer, durant deux mois, Polarfront va « recharger ses batteries ». Pour l’équipage, il s’agit de réviser les machines (notre photo), de refaire le plein de nourriture et de boissons… Puis Coup d’éclat Polarfront larguera les amarres et voguera vers les « joyaux norvégiens » avant des expéditions polaires au Spitzberg de mai à octobre. -

We Remember Those Members of the Lloyd's Community Who Lost Their
Surname First names Rank We remember those members of the Lloyd’s community who lost their lives in the First World War 1 We remember those who lost their lives in the First World War SurnameIntroduction Today, as we do each year, Lloyd’s is holding a But this book is the story of the Lloyd’s men who fought. Firstby John names Nelson, Remembrance Ceremony in the Underwriting Room, Many joined the County of London Regiment, either the ChairmanRank of Lloyd’s with many thousands of people attending. 5th Battalion (known as the London Rifle Brigade) or the 14th Battalion (known as the London Scottish). By June This book, brilliantly researched by John Hamblin is 1916, when compulsory military service was introduced, another act of remembrance. It is the story of the Lloyd’s 2485 men from Lloyd’s had undertaken military service. men who did not return from the First World War. Tragically, many did not return. This book honours those 214 men. Nine men from Lloyd’s fell in the first day of Like every organisation in Britain, Lloyd’s was deeply affected the battle of the Somme. The list of those who were by World War One. The market’s strong connections with killed contains members of the famous family firms that the Territorial Army led to hundreds of underwriters, dominated Lloyd’s at the outbreak of war – Willis, Poland, brokers, members and staff being mobilised within weeks Tyser, Walsham. of war being declared on 4 August 1914. Many of those who could not take part in actual combat also relinquished their This book is a labour of love by John Hamblin who is well business duties in order to serve the country in other ways. -
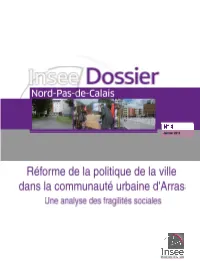
Synthèse Urbaine D'arras
Sommaire Synthèse 2 Des revenus plus élevés pour la communauté urbaine d’Arras mais de fortes disparités internes 5 Du district d’Arras à la communauté urbaine actuelle 5 Une démographie plus favorable 5 Des revenus plus élevés qu’en région dans la communauté urbaine comme dans le cœur urbain 8 Des disparités de situation entre communes 9 Une approche multidimensionnelle de la pauvreté dans les quartiers prioritaires 11 Une population nettement plus jeune sur le territoire des nouveaux quartiers prioritaires 12 Un revenu inférieur de 40 % dans les quartiers prioritaires par rapport au reste de la communauté urbaine 12 Les actifs en emploi sans diplôme se concentrent dans les nouveaux quartiers prioritaires…14 … mais pas seulement 14 Six actifs en emploi sur dix sont des ouvriers ou des employés du privé 16 Un recours au temps partiel très élevé dans le quartier « Nouvelles résidences » 16 Davantage de chômeurs dans les quartiers « Arras Ouest » et « Nouvelles résidences »… 17 … et de chômeurs de longue durée à « Arras Ouest » 17 Une personne sur quatre vit dans une famille monoparentale… 19 … et une proportion encore plus élevée dans les quartiers « Arras Ouest » et « Nouvelles résidences » 19 Des locataires en logement social largement surreprésentés 20 Annexe I - La fragilité sociale à l’échelle de la commune d’Arras 22 Annexe II - La réforme de la géographie prioritaire au sein de la communauté urbaine d’Arras 25 Annexe III - Le calcul des indicateurs à l’échelle des quartiers prioritaires 30 Définitions 32 Dossier réalisé par : Betty Becuwe, David Desrivierre, Sébastien Terra Rédaction en chef : Élisabeth Vilain Directeur de la publication : Daniel Huart Suivi partenarial : Sylvain Baudoin, Sandrine Joffres (Communauté urbaine d’Arras) Insee Dossier Nord-Pas-de-Calais n° 4 – Janvier 2015 Synthèse Composée de 39 communes, la communauté urbaine d'Arras compte 102 000 habitants en 2011. -
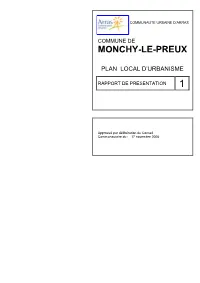
Monchy-Le-Preux
COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS COMMUNE DE MONCHY-LE-PREUX PLAN LOCAL D’URBANISME RAPPORT DE PRESENTATION 1 Approuvé par délibération du Conseil Communautaire du : 17 novembre 2006 COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS COMMUNE DE MONCHY-LE-PREUX – PAS-DE-CALAIS 2 PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION SOMMAIRE INTRODUCTION 4 Présentation de la commune 5 1 - DIAGNOSTIC PROSPECTIF ET BESOINS REPERTORIES 8 1.01 - Le Schéma Directeur de l’Arrageois 9 1.02 - Démographie 12 1.03 - Habitat 20 1.04 - Activités Economiques 30 1.05 - Besoins en surfaces urbanisables 43 1.06 - Circulation et déplacements 44 1.07 - Equipements et services 49 1.08 - Protection de l’environnement 53 2- ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 56 2.01 - Le site et le milieu naturel 57 2.02 - Les paysages et l’environnement 61 2.03 - Les éléments d’histoire locale et le patrimoine 65 2.04 - La structure du bâti 70 2.05 - Les risques 73 2.06 - Données environnementales 76 COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS COMMUNE DE MONCHY-LE-PREUX – PAS-DE-CALAIS 3 PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 3 – JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU P.L.U. 80 3.01 - Les objectifs de l’élaboration du P.L.U. de Monchy-le-Preux 81 3.02 - Le zonage du P.L.U. et la vocation des zones 84 3.03 - La réglementation du P.L.U. 90 3.04 - La réponse aux objectifs de développement Durable 104 3.05 - Les documents d’urbanisme supracommunaux 109 3.06 - Cohérence avec les documents d’urbanisme des communes contiguës 111 4 - LES INCIDENCES DU P.L.U. -
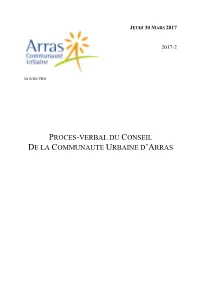
Procès-Verbal
J EUDI 30 M ARS 2017 2017 - 2 DGS/RS/VRD P ROCES - VERBAL DU C ONSEIL D E LA C OMMUNAUTE U RBAINE D ’A RRAS P RESENTS : MM., Mmes, Melles KRETOWICZ, LACHAMBRE, LEBLANC, PARIS, SACCHETTI, d’Achicourt THUILOT, d’Agny HECQ, d’Anzin - Saint - Aubin BOCQUILLET, CANLERS, DESRAMAUT, FATIEN, FERET, GHEERBRANT, HEUSELE, LAPOUILLE - FLAJOLET, LEFEBVRE, MALFAIT, MUYLAERT, NOCLERCQ, PATRIS, RAPENEAU, SPAS, SULIGERE, VANLERENBERGHE, d ’Arras PARMENTIER, d’Athies ZIOLKOWSKI, de Bailleul - Sire - Berthoult KARPINSKI, de Basseux TILLARD, de Beaumetz - Les - Loges ANSART, BLONDEL, de Beaura ins DELMOTTE, de Boiry - Saint - Martin DISTINGUIN, de Boisleux - au - Mont DELMOTTE, de Boisleux - Saint - Marc LESAGE, de Boyelles CAVE, ROSSIGNOL, VIARD, de Dainville GUFFROY, d’Ecurie MATHISSART, d’Etrun COULON, de Fampoux DEPRET, de Farbus BLOUIN, de Ficheux THERY, de Gavrelle ROUSSEZ, d’Hénin - Sur - Cojeul DAMART, de Maroeuil MASTIN, de Mercatel BAVIERE, de Mont - Saint - Eloi PUCHOIS, de Neuville - Saint - Vaast LEVIS, de Neuville - Vitasse CONTART, de Ransart DESAILLY, de Rivière MONTEL, de Roclincourt DELEURY, DESFACHELLE, KUSMIEREK, de Saint - Laurent - Blangy DELATTRE, de Saint - Martin - Sur - Cojeul Procès - verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 30 M ars 2017 2 CAYET, de Saint - Nicolas - Lez - Arras ROUX, VAN GHELDER, de Sainte - Catherine MILLEVILLE, de Thélus ZIEBA, de Wailly E XCUSES : Madame BEAUMONT donne pouvoir à Monsieur MUYLAERT Madame FACHAUX - CAVROS donne pouvoir à Monsieur DESFACHELLE Monsieur LETURQUE donne pouvoir à Monsieur FERET Madame -

Rapport D'enquête AFAF Ficheux Poids
Décision N° E19000110/59 du Tribunal Administratif du 18 Juillet 2019 Enquête publique du 18 Décembre 2019 au 24 Janvier 2020 de la Commune de FICHEUX CONSEIL DEPARTEMENTAL du Pas-de-Calais Direction du Développement, de l’Aménagement et de l’Environnement Service de l’Aménagement Foncier et du Boisement COMMUNE DE FICHEUX AVEC EXTENSION SUR LES COMMUNES DE BLAIRVILLE, HENDECOURT-LES- RANSART, MERCATEL ET BOISLEUX-AU-MONT Rapport du Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de LILLE Commissaire N° E19000110/59 du 18 Juillet 2019 Arrêté du 14 Octobre 2019 Monsieur le Président du Conseil Enquêteur Départemental du Pas-de-Calais Objet PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE FICHEUX avec extension sur les communes de BLAIRVILLE, HENDECOURT-LES-RANSART, MERCATEL ET BOISLEUX- AU-MONT Demandeur Vu la demande de Monsieur le Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais datée du 3 Juin 2019 Période de Enquête Publique du 18 Décembre 2019 au 24 Janvier 2020 Inclus l'enquête soit 37 Jours Siège de l'enquête Mairie de FICHEUX Commissaire Enquêteur Bernard PORQUIER Rapport de l’enquête publique sur le périmètre, le mode d'aménagement foncier et les prescriptions d'aménagement sur le territoire de la Commune de FICHEUX.. Commissaire Enquêteur Bernard PORQUIER Page 1 sur 54 Décision N° E19000110/59 du Tribunal Administratif du 18 Juillet 2019 Enquête publique du 18 Décembre 2019 au 24 Janvier 2020 de la Commune de FICHEUX SOMMAIRE 1 Généralité concernant l'enquête 1 1 Présentation du contexte de l'étude page 3 1 2 Objet de l'enquête publique. -

Dossiers De Personnel Des Instituteurs
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS DOSSIERS DE PERSONNEL DES INSTITUTEURS Arras-Dainville 1 INTRODUCTION Les dossiers de personnel des instituteurs ont fait l’objet de plusieurs versements qui n’ont pas tous été décrits avec le même degré de précision et qui se chevauchent chronologiquement. Le chercheur consultera : - les dossiers classés en série T1 qui ont fait l’objet d’un index patronymique et géographique par Thérèse Louage2 et Jean-Yves Léopold en 1995. Les instituteurs dont les dossiers sont conservés dans cette série ont exercé durant la période 1878- 1945 ; - le versement 1304 W qui contient les dossiers des instituteurs nés entre 1842 et 1916 ; le répertoire est constitué d’un index patronymique ; - les cotes 1 W 58001-62365 (passim)3 qui constituent les dossiers des instituteurs nés entre 1889 et 1939 ; le répertoire est constitué d’un index patronymique ; - le versement 6 W dont le répertoire manque de précision : indication des noms extrêmes du dossier uniquement et pas d’indication de date ; un sondage rapide permet toutefois d’affirmer que cette série paraît la plus récente et recouvre peu ou prou des années de naissance entre 1910 et 1960. Composition-type d’un dossier : - fiche individuelle de renseignements : elle indique l’état civil du postulant à l’enseignement, ses diplômes et une appréciation de l’inspecteur primaire sur ses aptitudes décelées lors d’un entretien préalable ; - rapports semestriels puis annuels du directeur sur son adjoint : y sont décrites non seulement ses qualités professionnelles, mais aussi sa conduite en dehors de l’école ; - rapports de l’inspecteur primaire ; - lettres de félicitation ou de blâme adressées par l’inspecteur d’académie ; - lettres de plainte contre l’instituteur transmises à l’inspecteur primaire ; - demandes de changement de poste : elles sont accompagnées des arrêtés de nomination. -

Recueil Des Actes Administratifs
PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS RECUEIL SPECIAL n° 110 du 30 novembre 2017 Le Recueil des Actes Administratifs sous sa forme intégrale est consultable en Préfecture, dans les Sous-Préfectures, ainsi que sur le site Internet de la Préfecture (www.pas-de-calais.gouv.fr) rue Ferdinand BUISSON - 62020 ARRAS CEDEX 9 tél. 03.21.21.20.00 fax 03.21.55.30.30 SOUS PRÉFECTURE DE BOULOGNE SUR MER.................................................................3 Arrêté accordant la médaille d’honneur agricole a l’occasion de la promotion du 14 juillet 2017.......................................3 Arrêté portant attribution de la médaille de la famille promotion 2017................................................................................9 Arrêté accordant la médaille d'honneur régionale, départementale et communale..............................................................12 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER.............................43 Arrêté de poursuite temporaire d’activité agricole pour madame marie-france blanpain....................................................43 Arrêté de poursuite temporaire d’activité agricole pour monsieur yves demailly...............................................................44 Arrêté de poursuite temporaire d’activité agricole pour monsieur philippe huret...............................................................44 Arrêté de poursuite temporaire d’activité agricole pour monsieur michel manidren...........................................................44 -

Consultation Publique Opérateurs
Consultation publique préalable à la réalisation d’un projet de montée en débit via l’offre PRM de FRANCE TELECOM 1. Description sommaire du projet de montée en débit La communauté urbaine d’Arras (CUA) compte pour son périmètre actuel 24 communes et environ 94 000 habitants, dont une partie n’a pas accès à des connexions Internet haut débit. Hors Arras, 21 942 lignes téléphoniques sont répertoriées sur 23 communes : 38 % de ces lignes ont un débit inférieur à 2 Méga. En matière de Très Haut Débit, l’ensemble des 24 communes du territoire communautaire fait partie du périmètre des annonces des opérateurs dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intentions d’Investissements (AMII), lancé par le Gouvernement dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. Selon les communications des opérateurs (France Télécom / Orange, ainsi que SFR en cofinancement), les déploiements devraient être réalisés progressivement jusqu’à 2020. La Communauté Urbaine d’Arras souhaite néanmoins régler les problèmes de condition d’accès à Internet rencontrés par les communes concernées et leurs habitants dans des délais plus acceptables afin que les services Triple Play soient accessibles par l’ensemble des usagers présents sur le territoire. A ce titre, certaines communes ne sont pas éligibles à la montée en débit. Les 17 communes éligibles sont : ACHICOURT, AGNY, ANZIN SAINT AUBIN, ATHIES, BAILLEUL SIRE BERTHOULT, BEAURAINS, DAINVILLE, FARBUS, FEUCHY, GAVRELLE, MERCATEL, MONCHY LE PREUX, NEUVILLE VITASSE, SAINTE CATHERINE, SAINT LAURENT BLANGY, WANCOURT et WILLERVAL. Dans le cadre de l’offre Points de Raccordements Mutualisés de France Télécom / Orange, les critères complémentaires d’éligibilités des Sous Répartiteurs nous contraignent à effectuer une consultation formelle des opérateurs afin de connaitre les intentions de démarrage effectif des déploiements de réseaux Très Haut Débit en fibre optique. -

18 Dossier L’Écho Du Pas-De-Calais No 209 – Juin 2021
18 Dossier L’Écho du Pas-de-Calais no 209 – Juin 2021 Liste des cantons du Pas-de-Calais Canton d’Aire-sur-la-Lys : Aire-sur-la- Amplier, Aubigny-en-Artois, Avesnes-le- Capelle-lès-Boulogne, Conteville-lès-Bou- Canton de Calais-3 : Partie de la commune ris, Saint-Venant, Westrehem. Lys, Blessy, Estrée-Blanche, Guarbecque, Comte, Bailleul-aux-Cornailles, Bailleulmont, logne, Pernes-lès-Boulogne, Pittefaux, de Calais non incluse dans les cantons de Ca- Canton de Longuenesse : Arques, Blen- Isbergues, Lambres, Liettres, Ligny-lès-Aire, Bailleulval, Barly, Basseux, Bavincourt, Beau- Wimereux, Wimille. lais-1 et de Calais-2. decques, Campagne-lès-Wardrecques, Hal- Linghem, Mazinghem, Quernes, Rely, Rom- dricourt, Beaufort-Blavincourt, Berlencourt- La partie de la commune de Boulogne-sur- Canton de Carvin : Carvin, Courrières, lines, Helfaut, Longuenesse, Wizernes. bly, Roquetoire, Saint-Hilaire-Cottes, Witter- le-Cauroy, Berles-au-Bois, Berles-Monchel, Mer située au nord d’une ligne définie par Libercourt. Canton de Lumbres : Acquin-Westbé- nesse, Wittes. Berneville, Béthonsart, Bienvillers-au-Bois, l’axe des voies et limites suivantes : depuis Canton de Desvres : Alincthun, Amble- court, Affringues, Aix-en-Ergny, Alette, Canton d’Arras-1 : Acq, Anzin-Saint-Aubin, Blairville, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte- le littoral, jetée Nord-Est, quai des Paque- teuse, Audembert, Audinghen, Audresselles, Alquines, Audrehem, Avesnes, Bayenghem- Beaumetz-lès-Loges, Dainville, Écurie, Étrun, Rictrude, Cambligneul, Camblain-l’Abbé, bots, quai Léon-Gambetta, boulevard Fran- Bazinghen, Bellebrune, Belle-et-Houllefort, lès-Seninghem, Bécourt, Beussent, Bezin- Marœuil, Mont-Saint-Éloi, Neuville-Saint- Canettemont, Capelle-Fermont, La Cauchie, çois-Mitterrand, boulevard Daunou, rue de Beuvrequen, Bournonville, Brunembert, Car- ghem, Bimont, Bléquin, Boisdinghem, Bon- Vaast, Roclincourt, Sainte-Catherine, Wailly.