Gedinne Nature
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
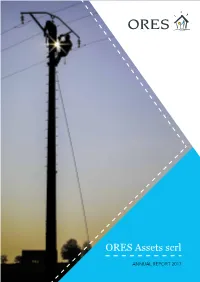
ORES Assets Scrl
ORES Assets scrl ANNUAL REPORT 2017 1 TABLE OF ORES Assets scrl ANNUAL REPORT 2017 CONTENTS I. Introductory message from the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer p.4 II. ORES Assets consolidated management report p.6 Activity report and non-financial information p.6 True and fair view of the development of business, profits/losses and financial situation of the Group p.36 III. Annual financial statements p.54 Balance sheet p.54 Balance sheet by sector p.56 Profit and loss statement p.60 Profit and loss statement by sector p.61 Allocations and deductions p.69 Appendices p.70 List of contractors p.87 Valuation rules p.92 IV. Profit distribution p.96 V. Auditor’s report p.100 VI. ORES scrl - ORES Assets consolidated Name and form ORES. cooperative company with limited liability salaries report p.110 VII. Specific report on equity investments p.128 Registered office Avenue Jean Monnet 2, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium. VIII. Appendix 1 point 1 – List of shareholders updated on 31 December 2017 p.129 Incorporation Certificate of incorporation published in the appen- dix of the Moniteur belge [Belgian Official Journal] on 10 January 2014 under number 14012014. Memorandum and articles of association and their modifications The memorandum and articles of association were modified for the last time on 22 June 2017 and published in the appendix of the Moniteur belge on 18 July 2017 under number 2017-07-18/0104150. 2 3 networks. However, it also determining a strategy essen- Supported by a suitable training path, the setting up of a tially hinged around energy transition; several of our major "new world of work" within the company should also pro- business programmes and plans are in effect conducted to mote the creativity, agility and efficiency of all ORES’ active succeed in this challenge with the public authorities, other forces. -

Profil Local De Santé De La Commune De Gedinne
3 6 1 Au cœur INDICE COMPARATIF DE MORTALITÉ LOGEMENT ET HABITAT de votre quotidien Service de l'Observation, de la Programmation et du Développement territorial Province de Indice comparatif de mortalité Gedinne Wallonie Années Namur Hommes 97,8 101,0 100,0 2012-2016 Femmes 95,9 100,0 100,0 PROFIL LOCAL DE SANTÉ Source: SPF Economie-DGS, calculs Cellule Observation Cette fiche présente de manière synthétique les principaux indicateurs en lien avec la santé des habitants d’une commune. L’objectif est de rendre l’information sanitaire accessible à tous. Celle-ci devrait aider à identifier les priorités d’actions en matière de santé. La mortalité des habitants de Gedinne ne présente pas de différence statistiquement significative avec la mortalité en province de Namur et en Wallonie. PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS GEDINNE DANS L’ARRONDISSEMENT DE DINANT Source: SPF Economie-DGS, calculs Cellule Observation La commune de Gedinne est située dans le sud de l’arrondissement de Dinant en province de Namur. Elle En 2017, Gedinne compte 9 logements sociaux sur son territoire, ce qui représente 0,3 % de l’ensemble du parc est frontalière avec les communes de Eghezée Fernelmont Beauraing, Bièvre et Vresse-sur-Semois Gembloux immobilier. C’est une proportion faible au regard de l’objectif des 10 % fixé par la Région wallonne. La Bruyère en province de Namur, Daverdisse en Sombreffe province de Luxembourg et avec le Jemeppe Andenne En vingt ans, bien qu’ayant connu des fluctuations, le prix moyen des maisons a augmenté de 119 %, passant de 55.642€ sur département français des Ardennes. -

Avis D'attribution De Marché
1 / 14 BE001 31/01/2020 - Numéro BDA: 2020-503237 Formulaire standard 3 - FR Marché public de travaux d'entretien des cours d'eau de 2e catégorie - Cerfontaine, Gedinne, Walcourt, Eghezée, Fosses-La-Ville et Somme-Leuze Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-Procurement SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30 B-1000 Bruxelles +32 27408000 [email protected] www.publicprocurement.be Avis d’attribution de marché Résultats de la procédure de marché Directive 2014/24/UE Section I: Pouvoir adjudicateur I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure) Nom officiel: Province de Namur - Service des marchés publics Numéro national d'identification: 2 0207.656.511_538952 Adresse postale: Rempart de la Vierge, 2/1 Ville: Namur Code NUTS: BE352 Code postal: 5000 Pays: Belgique Point(s) de contact: Téléphone: +32 81775947 Courriel: [email protected] Fax: Adresse(s) internet Adresse principale: (URL) https://www.province.namur.be/ Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364098 I.2) Procédure conjointe Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe, En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés: Le marché est attribué par une centrale d’achat. I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y Agence/office régional(e) ou local(e) compris leurs subdivisions régionales ou locales -

Using Geographically Weighted Poisson Regression to Examine the Association Between Socioeconomic Factors and Hysterectomy Incidence in Wallonia, Belgium
Using Geographically Weighted Poisson Regression to Examine the Association Between Socioeconomic Factors and Hysterectomy Incidence in Wallonia, Belgium Aline Clara Poliart ( [email protected] ) ULB École de Santé Publique: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique https://orcid.org/0000-0003-1510-0648 Fati Kirakoya-Samadoulougou ULB École de Santé Publique: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Mady Ouédraogo ULB School of Public Health: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Philippe Collart ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Dominique Dubourg ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Sékou Samadoulougou ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Research article Keywords: geographically weighted Poisson regression, Wallonia, hysterectomy, socioeconomic factors Posted Date: May 11th, 2021 DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-505108/v1 License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Read Full License 1 Using geographically weighted Poisson regression to examine the 2 association between socioeconomic factors and hysterectomy 3 incidence in Wallonia, Belgium 4 Aline Poliart1, Fati Kirakoya-Samadoulougou1, Mady Ouédraogo1, Philippe Collart1,2, Dominique 5 Dubourg2, Sékou Samadoulougou 3,4 6 1 Centre de Recherche en Epidémiologie, Biostatistiques et Recherche Clinique, Ecole de Santé 7 Publique, Université Libre de Bruxelles, 1070 Brussels, Belgium; [email protected] (AP); 8 [email protected] (MO); [email protected] (PC) ; [email protected] (FKS) 9 2 Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), 6061 Charleroi, Belgium ; [email protected] 10 (PC), [email protected] (DD) 11 3 Evaluation Platform on Obesity Prevention, Quebec Heart and Lung Institute, Quebec, QC, G1V 12 4G5, Canada; [email protected] (SS). -

Profondeville
Une dizaine d’itinéraires ou de points Les explications se font à partir de fiches d’observation ont été sélectionnés. Chaque ou d’un livret combinant à la fois des itinéraire illustrera une étape spécifique de photographies du paysage à l’évolution de notre continent. observer et des schémas explicatifs. COMMISARIAT Les sentiers géologiques et pédologiques GénéRAl Au touRISMe partent de sites remarquables (Tour du le projet poursuit donc les objectifs Millénaire à Gedinne, Rocher de Freyr à pédagogiques suivants : Dinant, Église romane de Celles, etc.) et sont prévus pour un parcours à pied d’une • Apprendre à observer distance de 5 à 10 km. (un paysage, une roche, un sol, ...) ; SENTIERS GÉOLOGIQUES & PÉDOLOGIQUES • Apprendre à décrire le milieu physique ; • Comprendre les processus locaux EN PROVINCE DE NAMUR (géomorphologie, géologie, pédologie) ; • Expliquer le contexte paléo-environne- 500 millions d’années de façonnement mental de mise en place des roches ; de notre paysage • Intégrer les processus dans l’espa ce (liens entre les différents itinéraires) ; • Intégrer les processus dans le temps (évolution sur 500 Ma) ; • Comprendre la géomorphologie, la géolo- gie et la pédologie de la région wallonne et plus particulièrement de la Province de Namur. Sentier de L’office du Tourisme de Profondeville Entité asbl et l’Administration communale de Profondeville PROFONDEVILLE remercient toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce sentier géologique et pédologique. INFOS Administration communale de Profondeville 081/42 02 37 ou 081/42 02 36 - Service tourisme I www.profondeville.be Une publication du circuit a été réalisée par les presses universitaires namuroises et sera présentée à cette occasion. -

Vos Zones De Police En Province De Namur
Vos zones de police en province de Namur : Place du Théâtre, 5 - 5000 NAMUR Zone de police de NAMUR Tél. : 081/24.66.11 www.polnam.be Chaussée de Tirlemont, 105 - 5030 GEMBLOUX Zone de police ORNEAU-MEHAIGNE Tél. : 081/62.05.40 (Eghezée, Gembloux, La Bruyère) www.policelocale.be/orneau-mehaigne Zone de police des ARCHES Avenue Reine Elisabeth, 29 - 5300 ANDENNE (Andenne, Assesse, Fernelmont, Gesves, Tél. : 085/82.36.00 Ohey) www.policedesarches.be Zone de police ENTRE SAMBRE ET MEUSE Route de Bambois, 2 - 5070 FOSSES-LA-VILLE (Floreffe, Fosses-La-Ville, Mettet, Tél. : 071/26.28.00 Profondeville) www.policeentresambreetmeuse.be Rue Saint Martin, 18- 5060 SAMBREVILLE Zone de police SAMSOM Tél. : 071/26.08.00 (Sambreville, Sombreffe) www.policesamsom.be Rue Thibaut, 4 - 5190 JEMEPPE S/SAMBRE Zone de police JEMEPPE S/SAMBRE Tél. : 071/78.71.01 www.policejemeppe.be Rue du Couvent, 23 - 5650 WALCOURT Zone de police FLOWAL Tél. : 071/66.24.00 (Florennes, Walcourt) www.flowal.be Zone de police HOUILLE-SEMOIS Rue de Dinant, 36 - 5575 GEDINNE (Beauraing, Bièvre, Gedinne, Tél. : 061/24.24.00 Vresse S/Semois) www.houillesemois.be Avenue de la Libération, 52 - 5560 COUVIN Zone de police des 3 VALLEES Tél. : 060/31.02.02 (Couvin, Viroinval) www.police3vallees.be Quai J-B. Culot, 24 - 5500 DINANT cole Albert Jacquard de Namur - Lauréat du concours d’idées 2012 «Prévenez le cambriolage» organisé sous l’égide du Gouverneur de la Province de Namur. Zone de police HAUTE MEUSE É Tél. : 082/67.68.10 (Anhée, Dinant, Hastière, Onhaye, Yvoir) users.skynet.be/hautemeuse Rue de Behogne, 28 - 5580 ROCHEFORT Zone de police LESSE ET LHOMME Tél. -

Plaquette Du Tableau De Bord De La Santé En
Classes d'âges Eghezée Eghezée ≥ 95 105 479 Fernelmont Gembloux 90 - 94 839 2 517 La Fernelmont Bruyère Gembloux Sombreffe La 85 - 89 2 497 5 385 Bruyère Jemeppe Sombreffe 80 - 84 4 876 8 028 sur Andenne Sambre 75 - 79 6 777 9 290 Jemeppe Andenne Sambre- Namur sur ville Ohey Sambre 70 - 74 7 599 8 976 Floreffe Gesves Sambre- Namur 65 - 69 13 085 14 095 ville Floreffe Ohey Fosses-la-Ville Gesves 60 - 64 14 875 15 393 Profondeville Assesse Havelange Fosses-la-Ville 55 - 59 16 283 16 615 Hamois Assesse Anhée Profondeville 50 - 5417 654 17 701 Mettet Yvoir Havelange 45 - 49 16 815 16 861 Hamois Somme Ciney Leuze Anhée 40 - 44 16 642 16 415 Walcourt Dinant Mettet Yvoir Onhaye 35 - 39 15 232 14 883 Florennes Somme 30 - 34 15 221 15 270 Ciney Leuze Walcourt Dinant Hastière Onhaye 25 - 29 15 620 15 615 Houyet Cerfontaine Philippeville Florennes 20 - 24 16 027 15 434 Rochefort 15 - 19 14 895 14 384 Doische Hastière Houyet 10 - 14 14 529 14 227 Beauraing Cerfontaine Philippeville 5 - 9 14 678 13 948 Rochefort < 5 14 007 13 373 Viroinval Doische Couvin 20000 15000 10000 5000 0 5000 10000 15000 20000 Beauraing Gedinne Effectifs Viroinval Couvin Bièvre Gedinne Vresse Indice de vieillissement de la population sur au 1er janvier 2015 Semois 0,48 - 0,56 Bièvre 0,57 - 0,69 0,70 - 0,82 0,83 - 0,98 Vresse 0 10 20 sur 0,99 - 1,31 Km Proportion de femmes ayant eu un examen Semois de dépistage du cancer du sein 45,7 - 50,0 50,1 - 55,0 55,1 - 60,0 60,1 - 63,4 0 10 20 Km SANTE PERCUE SEDENTARITE TABAC MEDECIN GENERALISTE Nombre d’habitants par médecin généraliste, -

Willerzie - Gedinne 63/3-4
WILLERZIE - GEDINNE 63/3-4 CARTE HYDROGÉOLOGIQUE DE WALLONIE Echelle : 1/25 000 Photos couverture © SPW-DGARNE(DGO 3) Fontaine de l'ours à Andenne Forage exploité Argilière de Celles à Houyet Puits et sonde de mesure de niveau piézométrique Emergence (source) Essai de traçage au Chantoir de Rostenne à Dinant Galerie de Hesbaye Extrait de la carte hydrogéologique de Willerzie – Gedinne WILLERZIE - GEDINNE 63/3-4 Ludovic CAPETTE , Vincent HALLET Université de Namur Rue de Bruxelles, 61 - B-5000 Namur (Belgique) NOTICE EXPLICATIVE 2016 Première version : Novembre 2013 Actualisation partielle : Janvier 2016 Dépôt légal – D/2016/12.796/2 - ISBN : 978-2-8056-0216-0 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE DIRECTION GENERALE OPERATIONNELLE DE L 'A GRICULTURE , DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L 'E NVIRONNEMENT (DGARNE-DGO 3) AVENUE PRINCE DE LIEGE , 15 B-5100 NAMUR (J AMBES ) - BELGIQUE AVANT-PROPOS ................................................................................................................................... 1 I. INTRODUCTION ................................................................................................................................. 3 II. CADRES GEOGRAPHIQUE, GEOMORPHOLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE ......................... 5 III. CADRE GEOLOGIQUE .................................................................................................................... 8 III.1. CADRE GEOLOGIQUE GENERAL ........................................................................................... 8 III.1.1. Massifs calédoniens et -

Ommaire Office Du Tourisme
Mot du Bourgmestre ...........................................3 Procès-verbaux du Conseil Communal ................3 Permanences du Collège ......................................5 Etat-civil du 1er juillet au 30 septembre 2018 ....5 Bibliothèque ........................................................6 Nouvelles du CPAS ..............................................6 Service Accueil Temps Libre ................................7 Charte des communes rurales d’Europe ...............7 ommaire Office du Tourisme ..............................................8 S Zone de Police Houille-Semois ...........................9 L’Etincelle .................................................... 11-14 BEP ....................................................................16 Guichet énergie .................................................16 Un petit bout d’histoire ....................................17 UTAN ................................................................17 Agenda ..............................................................18 Don de sang ......................................................19 Calendrier 2019 des collectes de sang ...............19 Infos activités ....................................................19 2 MOT DU BOURGMESTRE Mesdames et Messieurs, Inauguration de la nouvelle bibliothèque communale Il y a 15 ans, la création d’une bibliothèque communale devenait C’est un réel plaisir pour moi de prendre la plume aujourd’hui afin de réalité. Ce lieu, aux senteurs de papier et de bouquins, anciens rédiger ce mot du bourgmestre -

Oak Open Day in Belgium
Oak Open Day in Belgium Charles Snyers 32, Rue Alphonse Asselbergs, 1180 Brussels, Belgium [email protected] The fog had invaded the valley of the Ourthe that morning of the 4th of September. Béatrice Chassé, our Franco-American president, had driven up from the Dordogne to spend the night here before our planned visit to Daniel Dumont's oak collection. I did not know Daniel Dumont until my return from the IOS conference in Dallas in 2006, although early members of the IOS had known him for some time. He had heard that I had come back from the conference and a pre-tour organized by Guy Sternberg with quite a few acorns. And it is with great pleasure that I gave him acorns from the lots he was interested in. In the summer 2007, I finally visited Daniel’s “Belgian” collections (see below) and I was happily surprised by the number of trees it included and that it was relatively unknown in local dendrological circles. Moreover, it was less than an hour away from the Arboretum Robert Lenoir, an arboretum I myself am taking care of in my free time. As we left the valley to drive to Daniel and Arlette Dumont’s place, we also left the fog behind us. Up on the plateau the skies were blue and the sun was shining. This would prove to be the finest week-end of the latter part of the summer. Soon after we arrived, we were joined by about 15 other people, mostly from Belgium (many of these were members of the Belgian Dendrology Society) and from the Netherlands. -

Gedinne Wallonie Belgique Années Namur
Au cœur Offre de votre quotidien Observation de la santé, du social et du logement Province de Offre de soins Gedinne Wallonie Belgique Années Namur Nombre de lits de soins 0 2.709 20.502 2014 hospitaliers¹ PROFILS LOCAUX DE SANTÉ Il n’y a pas de structure Nombre de lits MR¹ 41 2.957 25.332 62.545 Cette fiche présente de manière synthétique les principaux indicateurs en lien avec la santé des hospitalière sur la commune habitants d’une commune. L’objectif est de rendre l’information sanitaire accessible à tous. Celle-ci de Gedinne. On recense sur le Densité pour devrait pouvoir aider à identifier les priorités d’actions en matière de santé. 1000 habitants de 138 121 136 105 territoire 41 lits agréés 80 ans et + « maison de repos » mais aucun lit MRS. Nombre de lits MRS¹ 0 2.787 21.886 69.705 2013 En 2013, l’Inami comptabilise Densité pour 7 médecins généralistes, ce 1000 habitants de 0 114 117 117 Eghezée 80 ans et + qui représente un médecin Gembloux Fernelmont La pour 644 habitants. Sombreffe Bruyère Nombre de médecins Jemeppe Andenne 7 717 4.497 12.830 sur généralistes² Sambre Namur GEDINNE Sambreville Floreffe Gesves Ohey Nombre d’habitants Fosses-la-Ville Havelange 644 676 795 869 Profondeville Assesse par généraliste² Hamois Mettet Anhée Yvoir Sources: 1.SPW- DGO5 (Santé)- Pour la Belgique, les données proviennent de l’Inami 2. Inami Somme Ciney Leuze Walcourt Onhaye Dinant Florennes Hastière Houyet Cerfontaine Fédération Philippeville Rochefort Province de Mère et enfant Gedinne Wallonie- Années Doische Mère et Namur Bruxelles La commune de Gedinne est Beauraing située dans l’arrondissement de Couvin Viroinval Dinant. -

Vresse-Sur-Semois Ne Présente Pas De Différence Statistiquement Significative Par Rapport À La Mortalité En Wallonie
3 6 1 Au cœur INDICE COMPARATIF DE MORTALITÉ LOGEMENT ET HABITAT de votre quotidien Service de l'Observation, de la Programmation et du Développement territorial Vresse-sur- Province de Indice comparatif de mortalité Wallonie Années semois Namur Hommes 115,7 101,0 100,0 2012-2016 Femmes 102,4 100,0 100,0 PROFIL LOCAL DE SANTÉ Source: SPF Economie-DGS, calculs Cellule Observation Cette fiche présente de manière synthétique les principaux indicateurs en lien avec la santé des habitants d’une commune. L’objectif est de rendre l’information sanitaire accessible à tous. Celle-ci devrait aider à identifier les priorités d’actions en matière de santé. Bien qu’apparaissant supérieure, la mortalité des femmes et des hommes à Vresse-sur-Semois ne présente pas de différence statistiquement significative par rapport à la mortalité en Wallonie. VRESSE-SUR-SEMOIS PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS DANS L’ARRONDISSEMENT DE DINANT Source: SPF Economie-DGS, calculs Cellule Observation La commune de Vresse-sur- Semois se situe à l’extrême sud de l’arrondissement de Dinant en La commune compte 2 logements sociaux sur son territoire, ce qui représente 0,1 % de l’ensemble du parc immobilier. province de Namur. Elle est frontalière Eghezée Fernelmont avec les communes de Bièvre et Gembloux C’est largement inférieur à l’objectif des 10 % fixé par la Région wallonne. La Bruyère Gedinne en province de Namur, la Sombreffe commune de Bouillon en province de Jemeppe Andenne Vresse-sur-Semois compte plusieurs zones d’habitat permanent, dans lesquelles vivent 41 personnes (source : DICS, sur Luxembourg et avec le département Sambre données au 31/12/2017).