Schéma De Structure Communal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
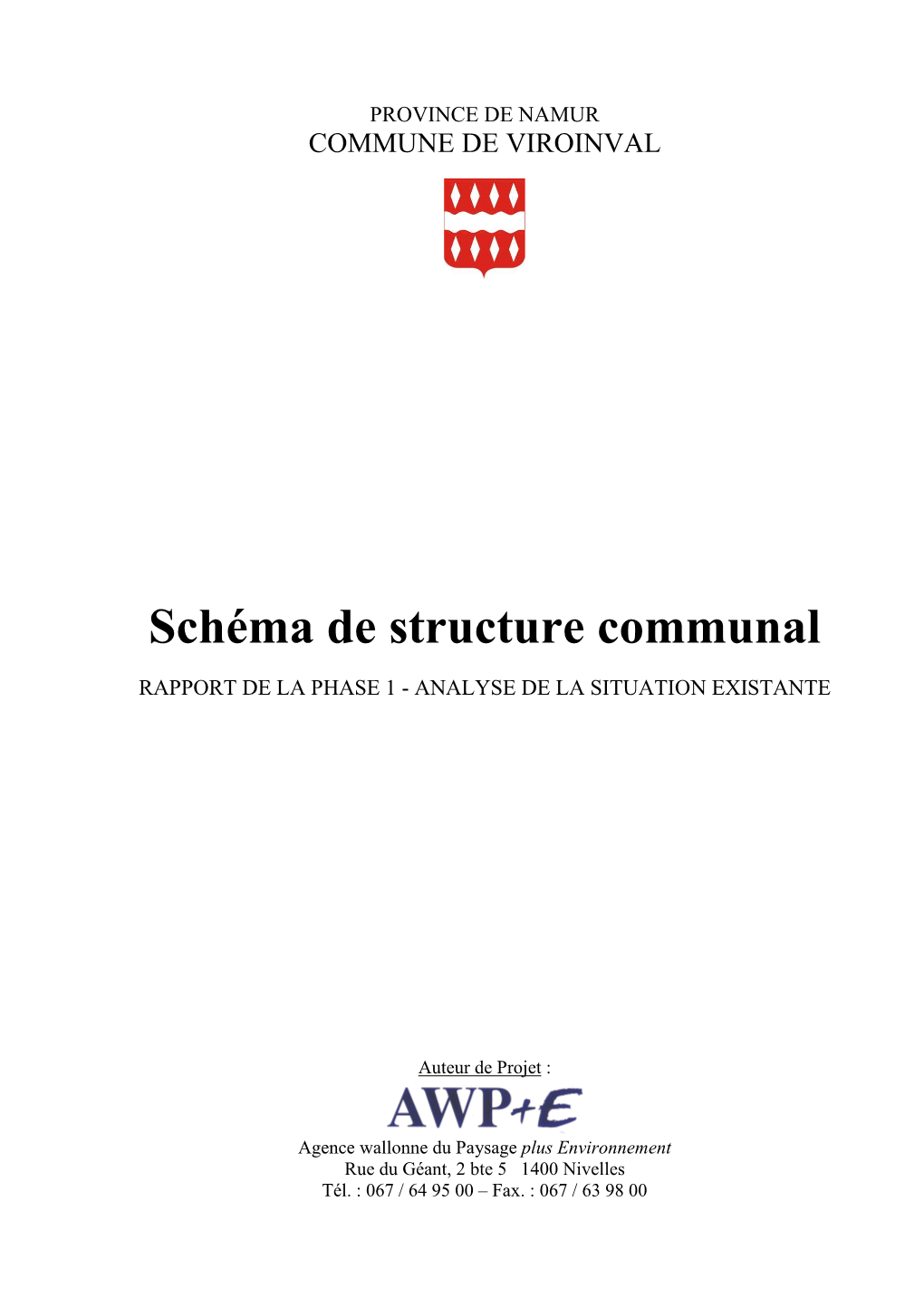
Load more
Recommended publications
-
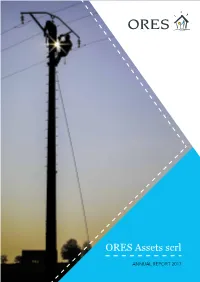
ORES Assets Scrl
ORES Assets scrl ANNUAL REPORT 2017 1 TABLE OF ORES Assets scrl ANNUAL REPORT 2017 CONTENTS I. Introductory message from the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer p.4 II. ORES Assets consolidated management report p.6 Activity report and non-financial information p.6 True and fair view of the development of business, profits/losses and financial situation of the Group p.36 III. Annual financial statements p.54 Balance sheet p.54 Balance sheet by sector p.56 Profit and loss statement p.60 Profit and loss statement by sector p.61 Allocations and deductions p.69 Appendices p.70 List of contractors p.87 Valuation rules p.92 IV. Profit distribution p.96 V. Auditor’s report p.100 VI. ORES scrl - ORES Assets consolidated Name and form ORES. cooperative company with limited liability salaries report p.110 VII. Specific report on equity investments p.128 Registered office Avenue Jean Monnet 2, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium. VIII. Appendix 1 point 1 – List of shareholders updated on 31 December 2017 p.129 Incorporation Certificate of incorporation published in the appen- dix of the Moniteur belge [Belgian Official Journal] on 10 January 2014 under number 14012014. Memorandum and articles of association and their modifications The memorandum and articles of association were modified for the last time on 22 June 2017 and published in the appendix of the Moniteur belge on 18 July 2017 under number 2017-07-18/0104150. 2 3 networks. However, it also determining a strategy essen- Supported by a suitable training path, the setting up of a tially hinged around energy transition; several of our major "new world of work" within the company should also pro- business programmes and plans are in effect conducted to mote the creativity, agility and efficiency of all ORES’ active succeed in this challenge with the public authorities, other forces. -

La Grotte Genvier À Matignolle (Treignes, Viroinval, Prov. De
La grotte Genvierr à Matignolle N La grotte Genvier à Matignolle otae (Treignes, Viroinval, Prov. de Namur, BE) Pr Résultats préliminaires des campagnes de fouilles 2017-2018 ae hi sto ri cae Pierre CATTELAIN, Nicolas CAUWE, Marie GILLARD, , 38 Éric GOEMAERE, Quentin GOFFETTE, Michaël HOREVOETS, POLET & SMOLDEREN / Caroline Alison : 149-16 2018 En 2017 et 2018, l’équipe du Cedarc/Musée du Malgré-Tout a repris des fouilles sur le site de la grotte Genvier (Viroinval, Province de Namur). Un sondage effectué en 1984 sur la terrasse a révélé la présence de restes humains associés à de la céramique et à quelques 7 éléments d’industrie lithique suggérant une attribution au Néolithique final. Les résultats des campagnes 2017 et 2018 permettent de préciser et de prolonger ce premier diagnostic. Le matériel mis au jour est relativement riche tant du point de vue des assemblages fauni- que et anthropologique que du point de vue du matériel archéologique. L’étude de ces différentes catégories de vestiges ainsi que l’analyse géoarchéologique du gisement sont toujours en cours, mais les résultats préliminaires de ces différentes approches permettent d’ores et déjà d’entrevoir le potentiel informatif important du site. 1. Situation et présentation générale du gisement La cavité se situe environ 1,5 km au nord-nord-ouest du village de Treignes (coordonnées Lambert72 : X = 170,160, Y = 87,900, Z = 185 ; Fig. 1). Elle est implantée à la base d’une falaise calcaire longeant le plateau du hameau de Matignolle. Le porche s’ouvre au nord- ouest sur une étroite terrasse surplombant la rive gauche du ruisseau des Fonds de Ry, un affluent du Viroin. -

Taux De La Taxe Communale 2021 | SPF Finances
TAUX DE LA TAXE COMMUNALE (%) POUR L'EXERCICE D'IMPOSITION 2021 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z VILLE OU COMMUNE Taux (%) VILLE OU COMMUNE Taux (%) VILLE OU COMMUNE Taux (%) A Aalst 7,50 Anderlues 8,80 Assenede 7,00 Aalter 5,90 Anhée 8,50 Assesse 8,50 Aarschot 8,00 Ans 8,50 Ath 8,80 Aartselaar 4,90 Anthisnes 8,50 Attert 7,00 Affligem 7,00 Antoing 7,00 Aubange 8,00 Aiseau-Presles 8,50 Antwerpen 8,00 Aubel 7,70 Alken 7,00 Anzegem 8,00 Auderghem 6,00 Alveringem 8,00 Ardooie 6,00 Avelgem 7,00 Amay 8,50 Arendonk 7,00 Awans 8,50 Amel 6,00 Arlon 7,00 Aywaille 8,60 Andenne 8,60 As 7,50 Anderlecht 5,50 Asse 6,90 B Baarle-Hertog 7,20 Bertogne 6,00 Boutersem 7,60 Baelen 7,70 Bertrix 8,00 Braine-l'Alleud 5,90 Balen 8,00 Bever 8,00 Braine-le-Château 8,00 Bassenge 8,00 Beveren 5,00 Braine-le-Comte 8,80 Bastogne 7,50 Beyne-Heusay 8,50 Braives 8,00 Beaumont 8,80 Bierbeek 7,00 Brakel 8,00 Beauraing 8,00 Bièvre 6,00 Brasschaat 6,00 Beauvechain 7,00 Bilzen 7,90 Brecht 7,00 Beernem 7,80 Binche 8,00 Bredene 7,00 Beerse 6,90 Blankenberge 6,00 Bree 8,00 Beersel 6,90 Blegny 8,50 Brugelette 8,50 Begijnendijk 8,00 Bocholt 8,00 Brugge 6,90 Bekkevoort 7,60 Boechout 7,10 Brunehaut 8,20 Beloeil 8,50 Bonheiden 7,50 Buggenhout 7,80 Berchem-Sainte-Agathe 6,80 Boom 7,90 Büllingen 6,00 Beringen 7,60 Boortmeerbeek 5,80 Burdinne 8,00 Berlaar 7,80 Borgloon 8,50 Burg-Reuland 7,00 Berlare 7,00 Bornem 7,50 Bütgenbach 6,00 Berloz 8,50 Borsbeek 7,00 Bernissart 8,50 Bouillon 8,00 Bertem 7,50 Boussu 8,50 1/7 COMMUNES Taux (%) COMMUNES Taux (%) COMMUNES Taux (%) -

Planning Nmaw 2020 - 2024
PLANNING NMAW 2020 - 2024 BEAUVECHAIN BASSENGE COMINES-WARNETON FLOBECQ GREZ-DOICEAU HELECINE VISE MOUSCRON MONT-DE-L'ENCLUS LA HULPE PLOMBIERES LA CALAMINE JODOIGNE OREYE OUPEYE DALHEM ELLEZELLES RIXENSART LINCENT JUPRELLE LESSINES WAVRE CRISNEE ESTAIMPUIS AUBEL CELLES WATERLOO BERLOZ WAREMME AWANS ORP-JAUCHE PECQ TUBIZE INCOURT REMICOURT HERSTAL LONTZEN FRASNES-LEZ-ANVAING ENGHIEN LASNE BLEGNY BRAINE-LE-CHATEAU CHAUMONT-GISTOUX ANS RAEREN REBECQ GEER THIMISTER-CLERMONT WELKENRAEDT OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE HANNUT FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER RAMILLIES HERVE BRAINE-L'ALLEUD DONCEEL ATH SILLY FAIMES SOUMAGNE ITTRE GRACE-HOLLOGNE MONT-SAINT-GUIBERT PERWEZ SAINT-NICOLAS LIEGE BEYNE-HEUSAY TOURNAI COURT-SAINT-ETIENNE WALHAIN WASSEIGES FLERON DISON LIMBOURG EUPEN BRAINE-LE-COMTE BRAIVES GENAPPE VERLAINE BRUGELETTE SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE OLNE LEUZE-EN-HAINAUT NIVELLES FLEMALLE VILLERS-LE-BOUILLET SERAING VERVIERS BAELEN EGHEZEE BURDINNE CHAUDFONTAINE CHASTRE PEPINSTER CHIEVRES LENS SOIGNIES TROOZ ANTOING ECAUSSINNES VILLERS-LA-VILLE ENGIS AMAY GEMBLOUX FERNELMONT WANZE RUMES SENEFFE NEUPRE HERON ESNEUX JALHAY BRUNEHAUT PERUWELZ BELOEIL JURBISE LES BONS VILLERS LA BRUYERE SPRIMONT HUY SOMBREFFE NANDRIN THEUX PONT-A-CELLES LE ROEULX SAINT-GHISLAIN MANAGE ANDENNE ANTHISNES FLEURUS COMBLAIN-AU-PONT TINLOT SPA BERNISSART MODAVE WAIMES LA LOUVIERE COURCELLES MARCHIN BUTGENBACH AYWAILLE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT JEMEPPE-SUR-SAMBRE NAMUR MONS MORLANWELZ SAMBREVILLE OUFFET MALMEDY QUAREGNON HAMOIR HENSIES FARCIENNES FLOREFFE OHEY BOUSSU GESVES STAVELOT CHARLEROI -

Ajustement Tactique Du Réseau Cible À Court Terme
Date : 27 avril 2021 Page 1 sur 2 Déploiement du réseau structurant intercommunal Express : ajustement tactique du réseau cible à court terme (document préparatoire au point 2.1.1 de l’Organe de Consultation du bassin de mobilité de Namur du 18 mai 2021) Plusieurs propositions émanant de Communes et de l’OTW, émises à la fois l’OCBM de Namur du 24 septembre 2020 et lors de réunions techniques, ont mené à une évolution du niveau de service des liaisons du réseau Express desservant le bassin de Namur. Lors de sa réunion du 24/09/2020, l’Organe avait émis « un avis favorable sur l’évolution de l’offre cible qui lui est soumise pour les liaisons Express suivantes : • Bastogne – Sainte-Ode Bastogne - Tenneville - Nassogne - Marche-en-Famenne (- Somme-Leuze - Namur) • Gembloux – Sombreffe – Fleurus – Charleroi • Gesves – Namur • Jodoigne – Incourt – Perwez – Ramillies – Eghezée – Namur • Nivelles – Genappe – Villers-la-Ville – Sombreffe – Namur • Philippeville – Florennes – Mettet – Fosses-la-Ville – Floreffe – Namur (informations générales) (informations • Sambreville - Jemeppe-sur-Sambre – Gembloux • Marche -Somme-Leuze-Havelange-Clavier -Tinlot-Nandrin-Neupré–Liège : 1718 : 1718 Pour la nouvelle liaison Ciney – Dinant, l’Organe recommande d’analyser son extension vert vers l’est. o N www.wallonie.be L’Organe recommande enfin la mise en place d’une concertation avec l’OTW et le SPW pour l’opérationnalisation de ces liaisons Express, notamment au niveau du choix et des aménagements des arrêts à anticiper. » La liaison qui verra l’évolution de son offre cible mise en oeuvre en 2021 est présentée ci-dessous. La fiche tactique est présentée en annexe à ce document. -

Profil Local De Santé De La Commune De Gedinne
3 6 1 Au cœur INDICE COMPARATIF DE MORTALITÉ LOGEMENT ET HABITAT de votre quotidien Service de l'Observation, de la Programmation et du Développement territorial Province de Indice comparatif de mortalité Gedinne Wallonie Années Namur Hommes 97,8 101,0 100,0 2012-2016 Femmes 95,9 100,0 100,0 PROFIL LOCAL DE SANTÉ Source: SPF Economie-DGS, calculs Cellule Observation Cette fiche présente de manière synthétique les principaux indicateurs en lien avec la santé des habitants d’une commune. L’objectif est de rendre l’information sanitaire accessible à tous. Celle-ci devrait aider à identifier les priorités d’actions en matière de santé. La mortalité des habitants de Gedinne ne présente pas de différence statistiquement significative avec la mortalité en province de Namur et en Wallonie. PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS GEDINNE DANS L’ARRONDISSEMENT DE DINANT Source: SPF Economie-DGS, calculs Cellule Observation La commune de Gedinne est située dans le sud de l’arrondissement de Dinant en province de Namur. Elle En 2017, Gedinne compte 9 logements sociaux sur son territoire, ce qui représente 0,3 % de l’ensemble du parc est frontalière avec les communes de Eghezée Fernelmont Beauraing, Bièvre et Vresse-sur-Semois Gembloux immobilier. C’est une proportion faible au regard de l’objectif des 10 % fixé par la Région wallonne. La Bruyère en province de Namur, Daverdisse en Sombreffe province de Luxembourg et avec le Jemeppe Andenne En vingt ans, bien qu’ayant connu des fluctuations, le prix moyen des maisons a augmenté de 119 %, passant de 55.642€ sur département français des Ardennes. -

Avis D'attribution De Marché
1 / 14 BE001 31/01/2020 - Numéro BDA: 2020-503237 Formulaire standard 3 - FR Marché public de travaux d'entretien des cours d'eau de 2e catégorie - Cerfontaine, Gedinne, Walcourt, Eghezée, Fosses-La-Ville et Somme-Leuze Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-Procurement SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30 B-1000 Bruxelles +32 27408000 [email protected] www.publicprocurement.be Avis d’attribution de marché Résultats de la procédure de marché Directive 2014/24/UE Section I: Pouvoir adjudicateur I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure) Nom officiel: Province de Namur - Service des marchés publics Numéro national d'identification: 2 0207.656.511_538952 Adresse postale: Rempart de la Vierge, 2/1 Ville: Namur Code NUTS: BE352 Code postal: 5000 Pays: Belgique Point(s) de contact: Téléphone: +32 81775947 Courriel: [email protected] Fax: Adresse(s) internet Adresse principale: (URL) https://www.province.namur.be/ Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364098 I.2) Procédure conjointe Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe, En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés: Le marché est attribué par une centrale d’achat. I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y Agence/office régional(e) ou local(e) compris leurs subdivisions régionales ou locales -

Fiche D'utilisation Du Sol Commune De Hamois
Fiche d'utilisation du sol Commune de Hamois Province: Namur Secteur d'aménagement: DINANT ‐ CINEY ‐ ROCHEFORT Statut de la commune selon le SDER: Commune rurale Principales catégories d’utilisation du sol 2008 Catégories d'utilisation du sol Ha % Terrains résidentiels 301 3,9 Terrains occupés par des commerces, 3,1 0 bureaux et services Terrains occupés par des services publics 19 0,2 et équipements communautaires Terrains à usage de loisirs et espaces 25 0,3 verts urbains Terrains occupés par des bâtiments 47 0,6 artificialisés agricoles Terrains à usage industriel et artisanal 16 0,2 Terrains Terrains dévolus au transport 23 0,3 Carrières, décharges et espaces 0,4 0 abandonnés Bâtiments spéciaux 0,5 0 Sous‐total 435 5,7 Terres cultivées et cultures permanentes 2.491 32,5 Prés et pâtures 2.765 36,1 Forêts, bois et production de "sapins de 1.538 20,1 Noël" artificialisés Terres vaines et vagues 99 1,3 Terrains Milieux naturels non exploités 5,4 0 non Plans d'eau et principaux cours d'eau 23 0,3 Sous‐total 6.921 90,4 Terrains non cadastrés ou de nature inconnue 303 4,0 (voiries, cours d'eau…) Total 7.659 100 Remarques : les valeurs non existantes sont symbolisées par un tiret ("‐"), de même que les valeurs de pourcentage inférieures à 0,1 % (non significatives) sont indiquées par la valeur "0". Cette remarque est d'application pour tous les taleaux de cette fiche. L’ensemble des calculs est réalisé sur la base des natures cadastrales issues de la matrice cadastrale et du PLI V07 du 1er janvier 2008 ainsi que de la version coordonnée vectorielle du plan de secteur de février 2008. -

Using Geographically Weighted Poisson Regression to Examine the Association Between Socioeconomic Factors and Hysterectomy Incidence in Wallonia, Belgium
Using Geographically Weighted Poisson Regression to Examine the Association Between Socioeconomic Factors and Hysterectomy Incidence in Wallonia, Belgium Aline Clara Poliart ( [email protected] ) ULB École de Santé Publique: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique https://orcid.org/0000-0003-1510-0648 Fati Kirakoya-Samadoulougou ULB École de Santé Publique: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Mady Ouédraogo ULB School of Public Health: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Philippe Collart ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Dominique Dubourg ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Sékou Samadoulougou ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Research article Keywords: geographically weighted Poisson regression, Wallonia, hysterectomy, socioeconomic factors Posted Date: May 11th, 2021 DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-505108/v1 License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Read Full License 1 Using geographically weighted Poisson regression to examine the 2 association between socioeconomic factors and hysterectomy 3 incidence in Wallonia, Belgium 4 Aline Poliart1, Fati Kirakoya-Samadoulougou1, Mady Ouédraogo1, Philippe Collart1,2, Dominique 5 Dubourg2, Sékou Samadoulougou 3,4 6 1 Centre de Recherche en Epidémiologie, Biostatistiques et Recherche Clinique, Ecole de Santé 7 Publique, Université Libre de Bruxelles, 1070 Brussels, Belgium; [email protected] (AP); 8 [email protected] (MO); [email protected] (PC) ; [email protected] (FKS) 9 2 Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), 6061 Charleroi, Belgium ; [email protected] 10 (PC), [email protected] (DD) 11 3 Evaluation Platform on Obesity Prevention, Quebec Heart and Lung Institute, Quebec, QC, G1V 12 4G5, Canada; [email protected] (SS). -

Points De Vente Pour Les Habitants Des Communes De La Province De Namur Mise À Jour Le 07/03/17
Points de vente pour les habitants des Communes de la Province de Namur Mise à jour le 07/03/17 Administration Service Rue CD LOCALITE Téléphone communale ANDENNE Office du Tourisme Promenade des Ours, 33 5300 ANDENNE 085/849.640 Complexe sportif Rue du Docteur Melin, 14 5300 ANDENNE 085/84.95.23 ANHEE Service population Place Communale, 6 5537 ANHEE 082/698.610 ASSESSE Service Population Esplanade des Citoyens, 4 5330 ASSESSE 083/655.055 083/668.578 Office du Tourisme Rue Haute, 7 5332 CRUPET 0477/22.17.01 BEAURAING Service Etat-Civil Place de Seurre, 3-5 5570 BEAURAING 082/710.030 BIEVRE Service Population Rue de Bouillon, 39 5555 BIEVRE 061/239.660 CERFONTAINE Office du Tourisme Place de l’Eglise, 9 5630 CERFONTAINE 071/644.667 CINEY Office du Tourisme Place Monseu, 23 5590 CINEY 083/750.115 COUVIN Office du Tourisme Rue de la Falaise, 3 5660 COUVIN 060/340 .140 DINANT Service Recette Rue grande, 112 5500 DINANT 082/213.299 DOISCHE Service Population Rue Martin Sandron, 114 5680 DOISCHE 082/214.722 EGHEZEE Service Population Route de Gembloux, 43 5310 EGHEZEE 081/810.132 FERNELMONT Service population Rue Goffin, 2 5380 FERNELMONT 081/830.250 FLOREFFE Service population Rue Romedenne, 9 5150 FLOREFFE 081/447.115 Office du Tourisme Rue Romedenne, 9 5150 FLOREFFE 081/44.71.19 FLORENNES Service Population Place de l'Hôtel de Ville, 1 5620 FLORENNES 071/681.118 FOSSES-LA- Service Culture - FOSSES-LA- Place du Marché, 12 5070 071/712.701 VILLE Tourisme VILLE Maison Languilier GEDINNE Office du Tourisme 5575 GEDINNE 061/587.484 Place Languillier, 6 GEMBLOUX Office du Tourisme Rue Sigebert, 1 5030 GEMBLOUX 081/626.960 Chaussée de Gramptinne, GESVES Service Population 5340 GESVES 083/670.339 112 HAMOIS Service Population Rue du Relais, 1 5360 HAMOIS 083/615.230 Service Cartes HASTIERE Av. -

2005 - BELGIUM (Walloon Region)
Inf.EUROBATS.AC10.22 Division de la Nature et de Forêts Direction de la Nature Avenue Prince de Liège, 15 5100 JAMBES (BELGIUM) REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON BATS - 2005 - BELGIUM (Walloon Region) - Direction de la Nature – Division de la Nature et de Forêts – Avenue Prince de Liège, 15 – 5100 JAMBES (BELGIUM) – Tél. : 081/33.58.83 – Fax : 081/33.58.22 – E-mail : [email protected] 2 A. GENERAL INFORMATION Party : The Agreement was signed by the government of the Walloon Region the 16 February 1995. The date of ratification by Belgium Federal Government is the 14 may 2003. Date of final report : april 2005. Period covered by report : march 2004 – april 2005. Competent authority : in part, the Ministry of the Walloon Region Division de la Nature et de Forêts Direction de la Nature Avenue Prince de Liège, 15 5100 JAMBES (BELGIUM) Tél. : 00 32 (0)81 33.58.83 Fax : 00 32 (0)81 33.58.22 E-mail : [email protected] B. STATUS OF BATS WITHIN THE WALLONIAN TERRITORY There are 20 species of bat resident in the Walloon Region. Different species find their extension limits on this territory. This fact means that the geographical position is strategic to follow the sense of the general dynamic of those species population : - to the north: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis emarginatus ; - to the south: Myotis dasycneme. The territory is situated on the migration route at least for Myotis dasycneme, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula 1. Summary details of the species : Situation similar to the report of the year 2000. -

Hamois Somme-Leuze Ciney Havelange
CINEY HAMOIS HAVELANGE SOMME-LEUZE +2 COMMUNE DE COMMUNE DE COMMUNE DE HAMOIS HAVELANGE SOMME-LEUZE Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales. INTRODUCTION SOMMAIRE INTRODUCTION SOMMAIRE a problématique de la mobilité touche de manière spécifique le milieu rural CARTE en raison, notamment, de la dispersion de l’habitat, de l’éloignement géogra- 04 DU TERRITOIRE L phique par rapport aux services et de la disparition des services de proximité. TRANSPORTS La mobilité des habitants y est essentiellement tributaire de la voiture. Outre les 06 EN COMMUN conséquences négatives connues sur l’environnement, la place importante de la voi- 6 TEC 8 SNCB ture (dont le coût d’achat et de fonctionnement est élevé) entraîne la précarisation des catégories sociales modestes n’ayant pas les moyens d’investir dans un tel TRANSPORTS équipement. Or, l’enjeu est de taille puisque les problèmes de transport sont un des PARTAGÉS 10 principaux freins à l’accès à la formation, à l’emploi, à la santé, et aux activités de 10 Covoiturage 12 Autopartage loisirs, sportives, culturelles et sociales. 11 Taxi C’est pourquoi, le GROUPE D’ACTION LOCALE CONDROZ-FAMENNE, actif sur les TRANSPORTS À LA DEMANDE communes de CINEY, HAMOIS, HAVELANGE et SOMME-LEUZE, mène, depuis 2017, 14 & INITIATIVES DE MOBILITÉ un plan d’actions en vue de soutenir et développer une mobilité durable et acces- 14 Synthèse des services 21 MobiliSud sible à tous. 16 Solumob 22 CPAS de HAVELANGE 16 MobiSpaf 22 Le Forum de la Mobilité Sur le territoire, il existe plusieurs initiatives proposant des solutions de transport.