Volet Risques Et Nuisances
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL Du 2 Avril 2019
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 2 Avril 2019 L’an 2019, le 2 Avril à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Maroeuil s’est réuni à la mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur DAMART Daniel, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles, contenant l’ordre du jour, ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 27/03/2019. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 28/03/2019. Présents : M. DAMART Daniel, Maire, Mmes : DUPENT Marie-Andrée, HARLE Florence, LAGACHE Armel, LOURDE-ROCHEBLAVE Alexandra, SERLET Véronique, Melle JOLIBOIS Karine, MM : CARBONNET Thomas, DEBOVE Marcel, DEMAREST Marc, DUEZ François-Xavier, FRANCOIS Serge, PUCHOIS Michel, VANIET Vincent Procuration(s): Mmes : CUISINIER Anne-Sylvie à M. DAMART Daniel, RAMS Dominique à Mme HARLE Florence, MM : DESAILLY Frédéric à Mme DUPENT Marie-Andrée, DOUDAIN Jean-Luc à M. FRANCOIS Serge Excusé(s) : Mme LEMAIRE Nathalie A été nommé(e) secrétaire : Mme LOURDE-ROCHEBLAVE Alexandra Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal en demandant aux personnes présentes d’observer une minute de silence en hommage de Monsieur Jean-Jacques PAYEN, agent communal décédé le 29 mars 2019. 2019DE9 : Subvention à l'association "A.I.M.E" CONSIDÉRANT le contexte budgétaire particulièrement contraint pour les collectivités territoriales, CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité de ne pas répercuter sur les associations les baisses de recettes liées à la baisse des dotations de l'Etat, CONSIDÉRANT la proposition du bureau municipal de maintenir en 2019, sauf demande inférieure de l'association, le niveau des subventions attribuées aux associations en 2018, hors subventions exceptionnelles, CONSIDÉRANT la demande de subvention déposée par l'association, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE d’attribuer une subvention de 800 € à l’association "A.I.M.E" au titre de l’année 2019. -

Inventaire Des Cavités Souterraines Achicourt – Arras – Beaurains
Inventaire des cavités souterraines Achicourt – Arras – Beaurains Réunion de concertation du 24 avril 2018 Déroulement Contexte Objectifs Présentation des résultats d’étude (Alp’géorisques) Débat Inventaire des cavités souterraines Achicourt – Arras – Beaurains Réunion de concertation du 24 avril 2018 Contexte général Les cavités souterraines : une réalité Des cavités connues et valorisées ; Des mouvements de terrains recensés ; Des nouvelles carrières découvertes impactant des projets de rénovation urbaine. Source : https://www.carrierewellington.com/ Inventaire des cavités souterraines Achicourt – Arras – Beaurains Réunion de concertation du 24 avril 2018 Source : Rapport d’étude SEMOFI Contexte : Les impacts => Impacts sur le bâti : - Fissures ; - Tassements ; - effondrement. => Impacts sur les réseaux : - Fuites de réseaux ; - Canalisations rompus. => Impacts économiques : - Relogement ; - Arrêt d’activités. => Impacts sur les personnes : - Foyers privés d’électricité, gaz, eau ; - Mise en place de déviation ; - Danger pour les vies humaines Inventaire des cavités souterrainesSource : Achicourt DDTM – Arras 62 – Beaurains Réunion de concertation du 24 avril 2018 Objectifs => Sensibiliser et accompagner ; => Améliorer la prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire ; => Proposer un programme d’étude ou de surveillance des cavités recensées avérées. Diagnostic : S’assurer de l’état et la stabilité de la carrière ; Intervenir au plus tôt pour limiter les coûts ; Pérenniser la connaissance. Inventaire des cavités souterraines Achicourt – Arras – Beaurains Réunion de concertation du 24 avril 2018 Étude du risques de mouvements de terrain liés aux cavités souterraines sur le territoire de la communauté urbaine d’Arras. Direction Départementale des Territoires Communes d’Arras, Beaurains et et de la Mer du Pas-de-Calais Achicourt (Tranche Ferme) Préfet du Pas-de-Calais COCON – 24 avril 2018 Ordre du jour Rappel du contexte ; Type de cavités identifiées ; Travaux réalisés ; Restitution des travaux ; Échanges. -

Barrières De Dégel 2019-2020
CLASSEMENT DES ROUTES DEPARTEMENTALES EN PERIODE DE POSE DE BARRIERES DE DEGEL Limitation du tonnage autorisé Tableau annexé à l'arrêté N° AD19046 (Hiver 2019/2020) RD n° LOCALISATION Hiver courant T Hiver rigoureux T 1 A Pas-en-Artois jusqu'à Thievres 12 7.5 1 De Beaumets à la RD 6 vers Mondicourt à Pas en Artois 12 7.5 3 De Agny à la RD 23 à Sailly au bois 12 7.5 3 entre les deux branches de la RD 60 LL 3 De Arras (RD 917) à la RD 60 à Achicourt 12 7.5 3E1 Entre la résidenceSt Michel et la SERNAM 12 7.5 3E1 A Arras et St Laurent Blangy (rue des Rosatis) 12 7.5 3E1 De la rue St Michel à la résidence St Michel LL 3E1 Entre la rue St Michel et la résidence St Michel à Arras LL 3E1 Accés à la SERNAM à partir de la RD 260 LL 3E1 Entre la RD 260 et la voie d'accès au port fluvial LL 5 De la limite du Département du Nord à la RD 15 à Havrincourt 12 7.5 5 De la limite du Département du Nord à la RD 14 à Lagnicourt- Marcel 12 7.5 5 De la RD 956 à Ecoust St Mein à la RD 14 Lagnicourt-Marcel 12 7.5 5 De Ecoust St Mein à la RD 60 à Beaurains 12 7.5 5E4 De la RD 917 à Beaurains à la RD 3 à Achicourt 12 7.5 6 De la RN 25 (Mondicourt) à la RD 1 (Pas-en-Artois) 12 12 6E1 De la RN 25 à la RD 6 en direction de Pas-en-Artois 7.5 7.5 6E1 De la RN 25 à la limite de la Somme (Lucheux) LL 7 De Bancourt à la RD 19 à Bertincourt 12 7.5 7 De la RD 339 à Habarcq à la RD 919 à Avette 12 7.5 7 De Bapaume (RD 917) à Bancourt L 12 7 A Beaumetz-les-Loges entre la RN 25 et la RD 62 LL 7 Entre Achiet-le-Grand et la RD 929 à Avesnes-les-Bapaume LL 8 Entre la RN 25 et -

Recueil Des Actes Administratifs
PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS RECUEIL n° 23 du 5 avril 2019 Le Recueil des Actes Administratifs sous sa forme intégrale est consultable en Préfecture, dans les Sous-Préfectures, ainsi que sur le site Internet de la Préfecture (www.pas-de-calais.gouv.fr) rue Ferdinand BUISSON - 62020 ARRAS CEDEX 9 tél. 03.21.21.20.00 fax 03.21.55.30.30 PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS.......................................................................................3 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d’honneur communale, départementale et régionale..........................................3 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d’honneur agricole............................................................................................53 MINISTERE DE LA JUSTICE-DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES...................................................................................................................61 Maison d’arrêt d’Arras........................................................................................................................................................61 Décision du 2 avril 2019 portant délégation de signature...................................................................................................61 DIRECCTE HAUTS-DE-FRANCE..........................................................................................62 - Modifications apportées à la décision du 30 novembre 2018 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et organisation -

La Communauté Urbaine D'arras Crée Les Conditions Pour Que Le Vélo
Mardi 15 mai 2018 La Communauté Urbaine d’Arras crée les conditions pour que le vélo devienne facile dans le territoire La nouvelle piste cyclable dans le bois de la Citadelle d’Arras. Après avoir choisi de subventionner l’achat de vélo à assistance électrique, avoir mis en place un système de location longue durée de vélo à assistance électrique, la Communauté Urbaine d’Arras poursuit le développement des aménagements cyclables sur son territoire. Depuis le début de l’année 2018, des travaux ont été engagés pour créer des garages à vélos ainsi que des liaisons cyclables pour faciliter les trajets domicile-travail à l’aide de son vélo. Nouvelles pistes cyclables Dans le courant de l’année 2018, trois liaisons cyclables seront réalisées par le service voirie de la Communauté Urbaine d’Arras. Ces pistes sont situées sur les communes d’Achicourt, Arras, Saint-Laurent-Blangy, Fampoux et Roeux. • Liaison boulevard du Général de Gaulle – cité du Polygone à Achicourt : o La piste est terminée, avec un éclairage public à leds qui déclenche avec un détecteur de présence. o Montant des travaux : 187 645,70 € HT dont 87 000 euros de subventions. • Liaison Fampoux (rue des Moulins) – Roeux (rue du Pont) sur le chemin de halage et sur 2,7 km : o Démarrage des travaux le 28 mai pour une durée d’un mois. o Montant des travaux : 607 958,00 € HT dont 280 000 euros de subventions TEPCV • Liaison Darse Méaulens (rue de l’Abbé Pierre) – Saint Laurent Blangy (rue Laurent Gers) sur le chemin de halage et sur 2,5 km o Remplacement du revêtement en sable stabilisé par un revêtement comme celui utilisé à la Citadelle. -

100 % Ressourcé N° 1 -2019 PDF 6.18 Mo Télécharger
100%RESSOURCĒ MAGAZINE ANNUEL DU SYNDICAT MIXTE ARTOIS VALORISATION 2019 56 En infographie LE CALENDRIER DES COLLECTES 2019 54 Il était une fois… LA FAMILLE (PRESQUE) ZÉRO DÉCHET QUI VIVAIT DANS UNE MAISON RECYCLÉE 24 Solutions BIENTÔT 100% DES DÉCHETS VALORISÉS AVEC LA MISE EN SERVICE DU SÉLECTROM TERRITOIRES SOLUTIONS INITIATIVES Intercommunalités en Le SMAV moteur de Citoyens à la conquête transition écologique l'économie circulaire de la planète verte 17 23 39 • COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS • COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD-ARTOIS • COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES CAMPAGNES DE L’ARTOIS : 3 intercommunalités AU SEIN DU SMAV Magnicourt-en-Comté Frévillers Béthonsart Centre de valorisation Chelers Cambligneul énergétique par DENSITÉ DE POPULATION Bailleul-aux- Mingoval Villers- incinération Cornailles Villers- Châtel Camblain-l’Abbé de 0 à 49 hab./km2 Brûlin (Saint-Saulve) de 50 à 99 hab./km2 Tincques Savy- Agnières Farbus Willerval Berlette Frévin- Neuville- 2 Saint-Vaast de 100 à 199 hab./km Berles- Capelle Mont- Thélus 2 Monchel Aubigny-D Capelle- Saint-Éloi de 200 à 399 hab./km en-Artois Fermont Acq D de 400 à 599 hab./km2 Penin Écurie Bailleul-Sire- Tilloy-lès- Haute- D Roclincourt Berthoult 2 Maizières Hermaville Avesnes Marœuil Gavrelle de 600 à 999 hab./km Anzin- Saint- Villers- Izel-lès- Hermaville Laurent- 1 000 hab./km2 et plus Sir-Simon Hameau Agnez-lès- Étrun St-Aubin Ste- Duisans Blangy Magnicourt- Lattre- Habarcq Catherine Fampoux sur-Canche Ambrines Saint- St- Athies Quentin Nicolas Communauté de Communes Givenchy- Duisans D Houvin- -

Charles Whitley
169: Charles Whitley MC Basic Information [as recorded on local memorial or by CWGC] Name as recorded on local memorial or by CWGC: Charles Whitley Rank: Captain Battalion / Regiment: 7th Battalion King's Royal Rifle Corps Service Number: Date of Death: 11 April 1917 Age at Death: 28 Buried / Commemorated at: Hibers Trench British Cemetery, Wancourt, Departement du Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Additional information given by CWGC: Born at Halewood, Liverpool. Son of Mr. Ed. and Elizabeth Eleanor Whitley, of Primley, Paignton, Devon. Charles Whitley, the second son of wealthy prominent solicitor and Everton Member of Parliament Edward and Elizabeth Whitley, was born on 9 October 1888 in Halewood and baptised on 11 February 1989 at Halewood and Tarbuck. Edward Whitley and Elizabeth Eleanor Walker were married in early 1878 at St Mary’s Church, Walton, Liverpool, and they had two residences, The Grange, Halewood and his ‘town address’ was 185 Piccadilly, London (a boarding house). Following their marriage the Conservative Party presented him ‘…with a service of plate worth £750’. At the time of the 1881 census they were boarding at 185 Piccadilly; Edward Whitley, 55, was recorded as a solicitor, Member of Parliament and Magistrate & Town Councillor of Liverpool. Elizabeth Eleanor was 33 and had been born in Bootle and their son, Edward, was with them Edward Whitley was the son of John and Isabella Whitley of and recorded as being 1 Liverpool. Edward was educated at Rugby School and was admitted year old and born in Anfield. as a solicitor in 1849, becoming a partner with his father in the Liverpool firm of J. -

Marais De Wancourt-Guemappe (Identifiant National : 310030032)
Date d'édition : 05/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030032 Marais de Wancourt-Guemappe (Identifiant national : 310030032) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 00120011) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBl, GON, CSN NPDC, DREAL NPDC, .- 310030032, Marais de Wancourt-Guemappe. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030032.pdf Région en charge de la zone : Nord-Pas-de-Calais Rédacteur(s) :CBNBl, GON, CSN NPDC, DREAL NPDC Centroïde calculé : 640420°-2584217° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 13/04/2011 Date actuelle d'avis CSRPN : 13/04/2011 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 04/02/2015 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 5 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 5 7. ESPECES ...................................................................................................................................... -

RÉFÉRENDUM DE 1958 Constitution De La Vème République Préfecture
RÉFÉRENDUMS - 1 RÉFÉRENDUM DE 1958 Constitution de la V ème République Préfecture. Cabinet du préfet • Déroulement de la campagne électorale 1W45524/2 Prévisions des résultats : rapports des sous-préfets et du préfet au ministre de l’Intérieur. 1W45524/3 Propagande communiste : rapports des Renseignements généraux. 1W45524/4 Propagande socialiste : rapports des Renseignements généraux. 1W45524/7 Note sur la présence de ressortissants marocains sur certaines listes électorales. • Résultats 1W45524/6 Déroulement du référendum : rapport du préfet au ministre de l’Intérieur. 1W45524/5 Suivi des résultats. Sous-préfecture de Lens 1724W41/1 Activité politique et presse : rapports des Renseignements généraux antérieurs et postérieurs à la consultation. Coupures de presse. RÉFÉRENDUMS - 2 RÉFÉRENDUM DE 1961 Autodétermination de l’Algérie Préfecture. Cabinet du préfet • Déroulement de la campagne électorale 1W45524/8 Organisation matérielle du scrutin : circulaire ministérielle. Allocution prononcée le 20 décembre 1960 par le général de Gaulle. 1W45524/8 Prévisions : rapport du 23 décembre 1960. 1W45524/8 Position des organisations politiques : rapport des Renseignements généraux. • Résultats 1W45524/8 Rapport post-électoral du préfet au ministre de l’Intérieur. Sous-préfecture de Lens 1724W41/2 Affiche de l’allocution du général de Gaulle. Affiche reproduisant l’arrêté de convocation des électeurs. 1724W41/3 Activité politique et presse : rapports des Renseignements généraux. Coupures de presse et tracts de propagande. RÉFÉRENDUMS - 3 RÉFÉRENDUM DU 8 AVRIL 1962 Accords d’Évian Préfecture. Cabinet du préfet • Instructions 1W45528/1 Instructions ministérielles et préfectorales. • Résultats 1W45528/3 Prévisions sur les résultats, exposé et appréciations sur les résultats du référendum : rapport du préfet au ministre de l’Intérieur. 1W45528/2 Résultats par circonscription, par canton et par commune. -

Memoire Technique Justificatif
RRééssuumméé nnoonn tteecchhnniiqquuee Recyclage des boues par épandage agricole Communauté Urbaine d’Arras Station d’épuration d’ARRAS (62) SVI/KTO/002016 - Septembre 2016 RRééssuumméé nnoonn tteecchhnniiqquuee ddee ll’’ééttuuddee dd’’iimmppaacctt La Communauté Urbaine d’Arras traite ses effluents au sein de stations d’épuration. Ce présent dossier concerne l’épandage des boues de la station d’épuration de la Communauté Urbaine d’Arras implantée sur la commune de Saint Laurent Blangy. Cet ouvrage a une capacité de traitement de 140 000 équivalents-habitants par aération prolongée à faible charge avec un traitement spécifique de l’azote et du phosphore. Les boues sont épandues dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Les boues issues de cet ouvrage sont conditionnées au chlorure ferrique et à la chaux puis déshydratées par filtre-presse. Les boues sont ensuite orientées vers une aire de stockage permettant d’entreposer les boues avant leur épandage en agriculture. L'étude est basée sur un fonctionnement à long terme tenant compte des prévisions de raccordements au réseau d’assainissement ainsi que le traitement des boues des stations d’épuration de Bailleul Sir Berthoult, Wailly les Arras, Fampoux, Feuchy/Athies, Thélus, Gavrelle et Mercatel sur la station d’épuration de Saint Laurent Blangy. La production prévue est de 15 600 tonnes de brutes de boues déshydratées et chaulées. L’azote, le phosphore, la magnésie et le calcium constituent l’intérêt majeur de ces boues. La valeur fertilisante des boues est présentée dans le tableau -

Monchy Le Preux 85 90 90
90 85 85 95 VC N2 DE FAMPOUX A MONCHY LE PREUX 85 90 90 105 90 90 90 95 90 85 85 95 100 85 90 100 95 105 90 90 105 100 105 105 85 95 90 90 85 95 105 95 95 95 100 LES CINQUANTE 95 100 90 100 95 95 100 100 95 95 95 95 100 95 95 95 85 95 100 100 100 100 B 100 100 90 100 100 Vidange Chteau d’eau b b C C 300 B ALLEE DE LA GRECE C 200 AC C B LE GROS CAILLOU B 100 B b C 300 B b b C 300 b B 85 b C 200 ACb C C 200 AC C 100 C 95 286 B B C B B b C 300 B C 200 B 100 b C 200 ACb b b B B C B B C 300 B C 400 B B CC 300200 AC B C 200 AC C B b B C B 90 b C C B B b C 400 100 C 200 AC 100100 B 85 b b 100 b B C C 400 B C 300b C 200 B B C 200 AC B C C B 90 b b b 100 95 100 b b C 400 B B B C 200 AC b b 100 C 400 B C 300 B 100 C 200A AC C 300 B ALLEE DE FRANCE A b b 85 C 200 AC B B b D C 300 B B b C 300 B A C C 200 b C C B B b b A 90 100 C 200 AC b 100 C 400 b C 300 B 100 b C 200 B C 200 100 C B C 200 AC C C C B B b b B 100 b C 300 B O B C 500 B B A 100 C 200 AC D b b b b C 300 b b C 400 b C 200 AC B C B C 400 B C C C 400 B B B C 500 b C 200 AC ALLEE DU PORTUGAL 95 b b A B C 400 b B C 100 b C B C 200 AC B B B C 400 C 400 b b 100 b C 500 ALLEE DUb DANEMARK (Feuchy) b b B C 400 C 400 C 500C 200 B AC b C 200 b b B B C 200 B B B b LEGENDE C C 200 B b B b 100 C 200 C 200 AC B C 500 C C 400 B C B B b b C 200 AC b 90 : C 400 100 B C 500 C 200 AC C B 100 C 90 b 100 C 90 B B b B b B L D C C 500 B C 200 AC O ALLEE DU BENELUX 100 C 200 100 C 0 Bb b b 100 95 P C C C C 300 B B C 300 B C B C 400 B b 100 W C 200 AC 95 C 200 B C 300 B C B b Y b C b B C 300 C ALLEE D'ALLEMAGNE -
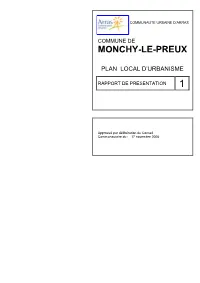
Monchy-Le-Preux
COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS COMMUNE DE MONCHY-LE-PREUX PLAN LOCAL D’URBANISME RAPPORT DE PRESENTATION 1 Approuvé par délibération du Conseil Communautaire du : 17 novembre 2006 COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS COMMUNE DE MONCHY-LE-PREUX – PAS-DE-CALAIS 2 PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION SOMMAIRE INTRODUCTION 4 Présentation de la commune 5 1 - DIAGNOSTIC PROSPECTIF ET BESOINS REPERTORIES 8 1.01 - Le Schéma Directeur de l’Arrageois 9 1.02 - Démographie 12 1.03 - Habitat 20 1.04 - Activités Economiques 30 1.05 - Besoins en surfaces urbanisables 43 1.06 - Circulation et déplacements 44 1.07 - Equipements et services 49 1.08 - Protection de l’environnement 53 2- ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 56 2.01 - Le site et le milieu naturel 57 2.02 - Les paysages et l’environnement 61 2.03 - Les éléments d’histoire locale et le patrimoine 65 2.04 - La structure du bâti 70 2.05 - Les risques 73 2.06 - Données environnementales 76 COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS COMMUNE DE MONCHY-LE-PREUX – PAS-DE-CALAIS 3 PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 3 – JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU P.L.U. 80 3.01 - Les objectifs de l’élaboration du P.L.U. de Monchy-le-Preux 81 3.02 - Le zonage du P.L.U. et la vocation des zones 84 3.03 - La réglementation du P.L.U. 90 3.04 - La réponse aux objectifs de développement Durable 104 3.05 - Les documents d’urbanisme supracommunaux 109 3.06 - Cohérence avec les documents d’urbanisme des communes contiguës 111 4 - LES INCIDENCES DU P.L.U.