Demande D'autorisation Environnementale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

I-Eau Potable
RAPPORT DU PRESIDENT EXERCICE 2018 PRIX ET QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE L 'E AU POTABLE ET DE L'A SSAINISSEMENT Rapport sur les Prix et la Qualité des Services Publics de l’Eau Potable et l’Assainissement – 2018 1 Références : Code Général des Collectivités Territoriales articles D 2224- 1 à 3 et ses annexes V et VI. - Décrets n° 94-469 et n° 95.635 relatifs aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. - Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement Le présent rapport sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement regroupe les indicateurs techniques et financiers des deux services, Chartres métropole exerçant les compétences dans ces deux domaines. Il est complété par les rapports annuels d’activité et les comptes rendu financiers du même exercice, établi par les délégataires de ces services. Toutefois, les deux services seront identifiés et différenciés dans deux parties bien distinctes. Une partie spécifique à chaque délégataire de l’eau potable y sera consacrée. Une cinquième partie récapitule l'ensemble des composantes du prix de l'eau facturé aux usagers et son évolution. Rapport sur les Prix et la Qualité des Services Publics de l’Eau Potable et l’Assainissement – 2018 2 Sommaire INTRODUCTION – PRESENTATION GENERALE ....................................................................................5 *** LIVRE I Eau et assainissement sur le territoire urbain de Chartres métropole en 2018…………………………………...… 11 Titre Premier : Le Service Public de l'Eau Potable…………………………………………………............................................ -

Teneurs En Pesticides Dans Les Eaux Distribuées En 2017
LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES en Eure-et-Loir en 2017 La représentation cartographique ! Atrazine déséthyl est basée sur les unités de Guainville Gilles ! Atrazine déséthyl déisopropyl distribution (UDI). Une UDI Le Mesnil Simon correspond à un secteur où La Chaussée d'Ivry l’eau est de qualité homogène, Oulins Anet Saint-Ouen Boncourt géré par un même exploitant Saussay Marchefroy Berchères et appartenant à une même Sorel Rouvres sur-Vesgre Moussel Saint Lubin-de-la entité administrative, ce qui peut Haye amener à partager une commune Abondant Bû ! Atrazine déséthyl Havelu Guainville en plusieurs UDI. Marchezais Gilles Montreuil Serville Goussainville ! Atrazine déséthyl déisopropyl Saint Ver t- en Cherisy Le Mesnil Dampierre Lubin-des Saint-Rémy Drouais Broué Bérou-la sur-Avre Dreu x Simon sur Joncherets Sainte Germainville Mulotière Boissy La Chaussée Avre Louvilliers Gemme La Chapelle Boutigny en-Drouais d'Ivry Prudemanche en-Drouais Moronval Mézières Forainvilliers Prouais Montigny Revercourt Oulins Escorpain Allainville Luray en-Drouais Rueil sur-Avre Vernouillet Anet Saint-Ouen Saint-Lubin Garancières Boncourt Marchefroy la-Gadelière Fessanvilliers ÉcluzellesSaussayOuerre Les Pinthières Mattanvilliers de-Cravant Laons en-Drouais Berchères Garnay Charpont Saint Brezolles Châtaincourt Sorel RouvresLaurent-la sur-Vesgre Boissy-lès Crécy Croisilles MarvilleMoussel Gâtine FaverollesSaint Perche Beauche Couvé Tréon Crucey Moutiers Villemeux Lubin-de-la Rohaire Villages sur-Eure Bréchamps Haye Les Châtelets -

Plaquette PLATEFORME DE REPIT
Pour qui ? Différentes interventions Horaires Les aidants d’un proche âgé de plus de Répit à domicile sur réservation et 60 ans et souffrant de : uniquement en agglomération chartraine. Répit à domicile : le matin de 9H à Un assistant de soins en gérontologie se 12H -Maladie d’Alzheimer ou apparentée déplace à votre domicile afin de vous -Maladie neurodégénérative libérer pour permettre de réaliser vos Activités diverses : démarches et prendre soin de vous. (sclérose en plaque, maladie de Parkinson) -Lèves mardi 14H30 17H30 Répit sur les sites de Lèves, Toury et Voves sur réservation jeudi 10H30 12H -Activités pour les aidés dans l’objectif vendredi 14H 15H30 (groupe de parole) A quels endroits ? de libérer du temps pour l’aidant. -Activités pour les aidants -Voves -Activités aidants/aidés pour maintenir lundi 14H 17H les liens sociaux Sur sites : Lèves, Toury, Voves. Sorties, loisirs, relaxation, activités -Toury A domicile : Chartres Agglomération physiques, culturelles, manuelles, (périmètre de 15 kilomètres autour de la rencontres entre les aidants, groupe de jeudi 14H 17H Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse) parole… Soutien et informations à l’aidant : Aide administrative/ Via Trajectoire /Renseignements divers /Orientation… Quand ? Accueil Temporaire d’urgence ou La plateforme d’accompagnement et Accueil de Jour d’urgence pour de répit est ouverte depuis le 1er permettre de trouver une solution février 2019. alternative en cas de maladie, Financés par l’Agence Régionale de Santé, les d’hospitalisation soudaine de l’aidant... activités sur site ainsi que le répit à domicile n’engendrent aucune participation financière pour les bénéficiaires Prestations de répit gratuites Répit à domicile Qui sommes nous ? Plateforme L’EHPAD de la Fondation d’Aligre d’accompagnement comprend : 48 lits d’hébergement permanent dont 24 lits au sein d’une unité et de répit aidants / aidés fermée dédiée à la maladie d’Alzheimer + 2 lits d’hébergement temporaire + 10 places d’accueil de jour Alzheimer . -

Ville D'épernon
VILLE D’ÉPERNON CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019 à 20h30 SALLE DES TOURELLES COMPTE RENDU 1 11/19 FB/LN/CJ COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2019 L’an deux mille dix-neuf, le 04 novembre à 20h30, les membres du Conseil municipal de DATE DE LA CONVOCATION la ville d’EPERNON se sont réunis, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur 29/10/2019 François BELHOMME, Maire. Étaient présents : NOMBRE DE CONSEILLERS : Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : BELHOMME François, DAVID Guy, BONVIN Béatrice, BOMMER Danièle, MATHIAU En exercice Jacques, QUAGLIARELLA Lydie, GAUTIER Martine, DUCOUTUMANY Franck, RAMOND 29 Françoise, JOSEPH Jean, BASSEZ Rosane, BEULE Simone, CASANOVA Paulette, GUITARD Régine, POISSONNIER Philippe, MARCHAND Isabelle, ESTAMPE Bruno, ROYNEL Eric, BLANCHARD Flavien, HAMARD Roland, BROUSSEAU Claudine, BREVIER Chantal, Présents 24 LARCHER Annick, METRAL-CHARVET Denis. Absente excusée : VAN CAPPEL Nathalie, pouvoir à MARCHAND Isabelle Pouvoir 1 Absents : MARCHAND Jean-Paul, PHILIPPE Didier, CHERGUI Cendrine, BEAUFORT Arnaud Votants 25 Secrétaire de séance : B. BONVIN _______________________ ORDRE DU JOUR I – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 DU DÉLÉGATAIRE DU SIVOM HADREP II – APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DES 9 ET 30/09/2019 III – INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL : ARRÊTÉS PRIS PAR LE MAIRE IV – MARCHÉS PUBLICS 4.1 – Convention portant constitution d’un groupement de commandes avec la Communes de Raizeux (78) pour la passation d’un marché pour -

Communautés De Communes Et D'agglomérations
Communautés de communes et d'agglomérations Gu ainville Gilles La Ch aussée-d 'Ivry Le Mesnil-Simo n ¯ Ou lin s Saint-Ouen-March efroy Anet Sau ssay Bonco urt Berchères-sur-Vesgre So rel-M oussel Rouvres Saint-Lub in -d e-la-Haye EURE Pays Houdanais Bû Abon dant (partie E&L) Havelu Serville Marchezais Go ussainville Montreuil Damp ierre-su r-Avre Saint-Lub in -d es-Jo ncherets Cherisy Saint-Rémy-su r-Avre Vert-en-Drouais Bro ué Dreux Pays de Bérou -la-Mulotière Germainville Lou villiers-en-Drou ais Sainte-Gemme-Moronval Boutigny-Pro uais Boissy-en-Drou ais VerneuMionltigny-sur-Avre Revercourt Prudemanche La Ch apelle-F orainvilliers Mézières-en-D rou ais Escorpain Allainville Verno uillet (partie E&L) Luray Ou erre Rueil-la-Gadelière Fessan villiers-Mattanvilliers Saint-Lub in -d e-Cravant Écluzelles Laons Garan cières-en-Drouais Garnay Les Pin th ières Charp ont Brezo lles Saint-Laurent-la-Gâtine Cro isilles Boissy-lès-Perche Châtain co urt Beauche Crécy-Cou vé Faverolles Rohaire Dreux Tréon Marville-Mo utiers-B rûlé Cru cey-Villages Villemeux-sur-Eu re Bréchamps Sau lnières Les Ch âtelets agglomération Saint-Ang e-et-Torçay Aunay-sou s-C récy La Ch apelle-F ortin Morvilliers Fon taine-les-Ribou ts Chaud on Coulombs Sen an tes Le Bo ullay-Mivoye La Man celière Lamb lo re Pu iseux Lormaye Saint-Lucien La Saucelle Maillebois Le Bo ullay-Thierry Le Bo ullay-les-Deux-Églises Orée du Nogen t-le-Roi Saint-Jean -de-Rebervilliers Lou villiers-lès-Perche Ormo y Perche La Puisaye Villiers-le-Mo rhier La Ferté-Vid ame Saint-Martin-de-Nigelles Saint-Sau -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 28 EURE-ET-LOIR INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 28 - EURE-ET-LOIR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 28-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 28-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 28-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 28-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

Plan Du Réseau Péri-Urbain Filibus
TREMBLAY-LES-VILLAGES Boulay St-Chéron-les-Champs 151 D05 d’Achères BOUGLAINVAL CLÉVILLIERS Maintenon Houx Bois du Boulay Grand Gland Les Chaises Liévreville Bouglainval Clévilliers Église Challet Berchères- Théléville D04 Mairie Saint-Germain La Dragonnerie CLÉVILLIERS La Maingot Emerville Centre Bréqueille Av. de Aonville Bouard St-Germain Chartres Chartainvilliers La GâtineGâtine La Maingot Centre Rue du Moulin La Leu Briconville Le Luat D02 BERCHÈRES La Croix ST-GERMAIN 153A Vérigny de Vérigny Bout SOULAIRES Rue du Fresnay- Dalonne d’Anguy Mittainvilliers- Château Dangers Briconville le-Gilmert D03 Vérigny Centre Vaux Jouy Roussins Chatenay École Poisvilliers Fresnay- D04 Rue des Lilas D939 Gare Place le-Gilmert D05 Stade Senainville Le Mesnil des Bruyères D17 Sénarmont Moulins COLTAINVILLE Mittainvilliers Neufs D05 D01 D02 D03 D04 D05 La Roche D04 Collège Soutine Centre D03 Église D03 Coltainville Bailleau- Saint-Prest Génainvilliers Tourelles D03 Champseru l'Evêque ST-PREST D71 150 Dallonville D939 D03 Roguenette Moulin à Vent République MITTAINVILLIERS Lèves Gasville 165 Vallain Le Gorget Mainvilliers Chesnaie D01 D71 ST-AUBIN DES BOIS D05 D04 GASVILLE-OISÈME COURVILLE-SUR-EURE Centre 140 141 150 151 Madeleine Oinville- Saint-Aubin- Libération Champhol Gasville-Oisème sous-Auneau Collège des-Bois 153A 157 158 159 L. Pergaud 165 150 165 Bréharet Umpeau Chazay D30 15 Grognault Chazay Mare Pôle d’échange D12 D15 D16 Bois Paris D31 D17 D19 153A D32 Mondonville D11A D11B D12 D13 Croix CINTRAY Château d’Eau Lycée Fulbert de Fer Villers-le-Bois Chartres 11 D14 D16 D17 D19 Petit Chêne Mairie Novembre Tertre D31 V. Hugo Collège V. Hugo D30 D31 Cintray D32 Amilly Ablis Centre A. -

25Èmes Rencontres Archéologiques D'eure-&-Loir À SOULAIRES
25èmes rencontres archéologiques d’Eure-&-Loir à SOULAIRES Samedi 22 octobre 2016 PROGRAMME 14h Accueil des participants. Ancienne salle de classe de SOULAIRES (Dans la cour, derrière la mairie) 14h15 Visite de l’église St Jacques-St Philippe : découverte des engoulants, des hauts-reliefs et de la dalle funéraire d’Agnès de SOULAIRES 15h Communications sur l’actualité archéologique départementale - Michel Merlingeas & Gérard Girout : Des thuillots à une villa gallo-romaine - Laurent Coulon – Service archéologique de la Ville de Chartres : Actualités archéologiques chartraines - François Capron - INRAP : Essai de chrono-typologie des inhumations en Eure-et- Loir Ve-XVIIe siècles - Dominique Jagu : Le musée des mégalithes de Changé à Saint-Piat - Alain Lelong : Le cellier des moines à Bonneval - Jean-Luc Renaud : Relations entre l'Eglise et les mégalithes en Eure-et-Loir. - Hervé Selles – SDA 28 : 2015-2016 - Principaux résultats des opérations archéologiques réalisées par le Service départemental - Isabelle Heitz : Prospection LiDAR aéroportée par drone pour cartographier le Camp de César de Changé sous végétation ; méthodologie et projet en cours Exposition de matériel de prospection aérienne par drones 17h30 Pot de l’amitié offert par la municipalité de SOULAIRES La villa gallo-romaine des Thuillots à Coltainville Gérard Girout – Michel Merlingeas Bien avant les années 1988/1989 la parcelle des Thuillots avait suscité intérêt et curiosité des exploitants agricoles qui y trouvaient des outils lithiques à l’époque des labours. Au printemps 1985 lors de la pose de drain en sous-sol profond, la trancheuse arracha un large bloc de maçonnerie sur les parcelles 99 et 100. Il révéla un bassin aux murs épais muni d’un orifice versoir constitué par un imbrex retourné et scellé. -

HISTORIQUE Et PATRIMOINE Du Val De VOISE
HISTORIQUE et PATRIMOINE du Val de VOISE Mémoire régionale d’Histoire de France par Serge de Labrusse Sommaire Page Situation du Bassin de Voise – carte géographique 1 1. PRESENCE HUMAINE 1 depuis plus de 5.000 ans - de la préhistoire à l’an 1000 2. LES SEIGNEURS et les CONSTRUCTIONS FORTIFIEES 3 au MOYEN ÂGE (du X au XIIème siècle) 3. Les TROUBLES des PERIODES GUERRIERES 5 (du XIV au XVIème siècle) 4. L’ALLEE du ROI – GLOIRE de MAINTENON 7 et misère paysanne (XVII et XVIIIèmes siècles) 5. Les MUTATIONS de la REVOLUTION 8 (de 1789 à 1815) 6. Des PRUSSIENS en BEAUCE à la VOIE de la LIBERTE 10 (développement de l’économie aux XIXème et XXème siècles) 7. La SPECIFICITE ACTUELLE (à l’aube du XXIème siècle) 13 15 novembre 2003 _____________________________________________________________________________________________ N.B.- Cette chronique a été préparée à l’occasion d’une exposition organisée à Yermenonville (Eure et Loir) le 13 septembre 2003 pour le 20 ème anniversaire de l’Association pour la Protection et l’Environnement du Val de Voise (A.P.E.V.) et d’une manifestation culturelle à St-Symphorien-le-Château le 26 octobre 2003. Une exposition de 80 illustrations accompagne et présente les principaux sites du bassin de Voise. (2 ème édition corrigée – 15 novembre 2003) HISTORIQUE et PATRIMOINE du Val de VOISE Mémoire régionale d’Histoire de France Le pays de la rivière « Voise », adossé au pays chartrain et au Hurepoix, est une terre d’ habitat et un lieu de passage , riche en évènements de toute nature depuis la légende de Gargantua, avatar d’un héros divin gaulois. -

PPRI) De La Vallée De L’Eure Sur La Commune De Saint-Prest
PRÉFÈTE D'EURE ET LOIR Direction Départementale des Territoires d’Eure-et-Loir Service de la Gestion des Risques, de l’Eau et de la Biodiversité Bureau : GEMAPRIN Dossier d’évaluation environnementale d'examen au cas par cas de la modification du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la Vallée de l’Eure sur la commune de Saint-Prest. Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 et vend 9h-12h /14h00-16h00 Tél. : 02 37 20 40 60 – fax : 02 37 36 37 03 17, place de la république - CS 40517 28 008 Chartres cedex www.eure-et-loir.equipement-agriculture.gouv.fr 1 Table des matières Introduction Présentation du PPRI de Saint-Prest Motif de la modification Périmètre de la modification Description de la modification de la carte des aléas et de la carte du zonage réglementaire Document d'urbanisme sur la commune Incidences sur l'environnement et la santé humaine ANNEXE : Planche 4/10 des aléas et du zonage réglementaire avant modification ANNEXE : Planche 4/10 des aléas et du zonage réglementaire – projet de modification 2 Introduction : L'article R122-17 II du code de l'environnement prévoit que les plans de prévention des risques sont susceptibles d'être soumis à une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. Cet examen est basé sur les dispositions de l'article R122-18 du code de l'environnement. Présentation du PPRI de la Vallée de l'Eure sur la commune de Saint-Prest Le Plan de Prévention des Risques Inondation de la commune de Saint-Prest a été prescrit le 24 décembre 2001 (arrêté n° 2206). -

À L'école Du « Fabuleux Noël » : Ils Racontent
MAGAZINE #38 DEC 2017 LE MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR DOSSIER À L’ÉCOLE DU « FABULEUX NOËL » : ILS RACONTENT ELECTION NOUVEAU EMPLOI #06 > Le nouveau président du #27 > En un clic, je trouve #37 > Retrouvez nos Conseil départemental s’exprime mon assistante maternelle offres Boostemploi EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #38 - DÉCEMBRE 2017 01 DES BD À GAGNER AVEC « L’EURÉLIEN » ! Pour découvrir quelques-uns des auteurs jeunesse mis à l’honneur pendant le salon, surveillez dès à présent notre page Facebook. Le magazine du Conseil départemental d’Eure-et-Loir vous fait gagner trois exemplaires de « Famille Nombreuse », LE DÉCLIC DU MOIS : édité aux éditions Marabout. Remportez aussi cinq albums de la DES MÉTIERS D’ART EN FÊTE maison d’édition Bamboo : « les Profs », Luisant (canton de Lucé) a accueilli l’évènement ludique de « Pilo », « les Sisters », « Studio Danse » et « Les Amis de Papiers ». la rentrée, pour les petits comme les grands. « Bulles en Balade », 9e salon de la Bande dessinée et de l’illustration jeunesse, est le seul festival eureliens du genre dans le département. Une ambiance atypique et conviviale pour toute la famille : les curieux y rencontrent auteurs et illustrateurs, avant de fl âner à la recherche de l’album parfait pour compléter leur collection. Les petits s’amusent dans les ateliers maquillage, coloriage et storyboard ; les grands découvrent l’imprimerie à l’ancienne ou les expositions… Côté vedettes, Chadia Chaibi Loueslati, invitée d’honneur du salon, a connu un succès national avec son album Famille nombreuse. Le scénariste de Boule & Bill et des Gendarmes, Christophe Cazenove était aussi présent ainsi que Maureen Dor, ex-animatrice de télé désormais à la tête d’une maison Retrouvez le magazine Eurélien d’édition jeunesse. -
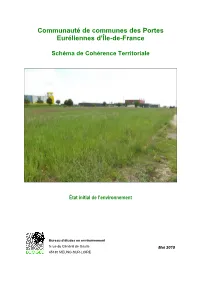
Etat Initial De L'environnement
Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France Schéma de Cohérence Territoriale État initial de l’environnement Bureau d’études en environnement 5 rue du Général de Gaulle Mai 2019 45130 MEUNG-SUR-LOIRE SCOT Portes euréliennes d’Île-de-France SOMMAIRE 1. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE ...................................................................... 3 1.1. GÉOMORPHOLOGIE .................................................................................................................................. 3 1.1.1. Relief ............................................................................................................................................... 3 1.1.2. Géologie .......................................................................................................................................... 4 1.2. DONNÉES CLIMATIQUES ........................................................................................................................... 5 1.3. EAU SUPERFICIELLE ................................................................................................................................. 7 1.3.1. Bassin versant ................................................................................................................................. 7 1.3.2. Cours d’eau ..................................................................................................................................... 7 1.4. EAU SOUTERRAINE ................................................................................................................................