Pierre Mariétan Compositeur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

We Are Proud to Offer to You the Largest Catalog of Vocal Music in The
Dear Reader: We are proud to offer to you the largest catalog of vocal music in the world. It includes several thousand publications: classical,musical theatre, popular music, jazz,instructional publications, books,videos and DVDs. We feel sure that anyone who sings,no matter what the style of music, will find plenty of interesting and intriguing choices. Hal Leonard is distributor of several important publishers. The following have publications in the vocal catalog: Applause Books Associated Music Publishers Berklee Press Publications Leonard Bernstein Music Publishing Company Cherry Lane Music Company Creative Concepts DSCH Editions Durand E.B. Marks Music Editions Max Eschig Ricordi Editions Salabert G. Schirmer Sikorski Please take note on the contents page of some special features of the catalog: • Recent Vocal Publications – complete list of all titles released in 2001 and 2002, conveniently categorized for easy access • Index of Publications with Companion CDs – our ever expanding list of titles with recorded accompaniments • Copyright Guidelines for Music Teachers – get the facts about the laws in place that impact your life as a teacher and musician. We encourage you to visit our website: www.halleonard.com. From the main page,you can navigate to several other areas,including the Vocal page, which has updates about vocal publications. Searches for publications by title or composer are possible at the website. Complete table of contents can be found for many publications on the website. You may order any of the publications in this catalog from any music retailer. Our aim is always to serve the singers and teachers of the world in the very best way possible. -

FRENCH SYMPHONIES from the Nineteenth Century to the Present
FRENCH SYMPHONIES From the Nineteenth Century To The Present A Discography Of CDs And LPs Prepared by Michael Herman NICOLAS BACRI (b. 1961) Born in Paris. He began piano lessons at the age of seven and continued with the study of harmony, counterpoint, analysis and composition as a teenager with Françoise Gangloff-Levéchin, Christian Manen and Louis Saguer. He then entered the Paris Conservatory where he studied with a number of composers including Claude Ballif, Marius Constant, Serge Nigg, and Michel Philippot. He attended the French Academy in Rome and after returning to Paris, he worked as head of chamber music for Radio France. He has since concentrated on composing. He has composed orchestral, chamber, instrumental, vocal and choral works. His unrecorded Symphonies are: Nos. 1, Op. 11 (1983-4), 2, Op. 22 (1986-8), 3, Op. 33 "Sinfonia da Requiem" (1988-94) and 5 , Op. 55 "Concerto for Orchestra" (1996-7).There is also a Sinfonietta for String Orchestra, Op. 72 (2001) and a Sinfonia Concertante for Orchestra, Op. 83a (1995-96/rév.2006) . Symphony No. 4, Op. 49 "Symphonie Classique - Sturm und Drang" (1995-6) Jean-Jacques Kantorow/Tapiola Sinfonietta ( + Flute Concerto, Concerto Amoroso, Concerto Nostalgico and Nocturne for Cello and Strings) BIS CD-1579 (2009) Symphony No. 6, Op. 60 (1998) Leonard Slatkin/Orchestre National de France ( + Henderson: Einstein's Violin, El Khoury: Les Fleuves Engloutis, Maskats: Tango, Plate: You Must Finish Your Journey Alone, and Theofanidis: Rainbow Body) GRAMOPHONE MASTE (2003) (issued by Gramophone Magazine) CLAUDE BALLIF (1924-2004) Born in Paris. His musical training began at the Bordeaux Conservatory but he went on to the Paris Conservatory where he was taught by Tony Aubin, Noël Gallon and Olivier Messiaen. -

Annales 2005
annales 2005 annales des concours d’entrée 2005 Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon 1 sommaire département des cordes violon page 3 alto page 5 violoncelle page 6 contrebasse page 7 département des bois flûte page 8 hautbois page 10 clarinette page 11 basson allemand et français page 13 département des cuivres cor page 14 trompette page 15 trombone page 16 trombone basse page 17 tuba page 19 saxhorn, euphonium page 20 département des claviers piano page 21 orgue page 23 harpe page 25 percussions page 26 accompagnement au piano page 27 département des voix chant page 30 direction de chœur page 31 département de composition écriture page 32 composition page 32 orchestration page 33 département de musique ancienne page 34 département de danse page 39 annexe composition des jurys page 40 ____________________________________________ Note préliminaire : Pour tous les concours d’entrée de l’année 2005, le jury se réservait le droit d’interrompre les candidats au cours de l’admissibilité ou de l’admission, notamment en cas de dépassement du temps imparti. 2 violon du 19 au 24 septembre 2005 conditions d’admission épreuve d’admissibilité Les candidats devaient présenter : une oeuvre choisie dans chacune des listes a et b suivantes : liste a : Ludwig van Beethoven Concerto en ré majeur opus 61, 3ème mouvement : rondo (sans cadence). (éditions Henle) Wolfgang Amadeus Mozart Rondo en do majeur KV 373. Wolfgang Amadeus Mozart Concerto en sol majeur KV 216, 3ème mouvement : rondo (éditions Bärenreiter) liste b : Edouard Lalo Symphonie -

Perspectives on Harmony and Timbre in the Music of Olivier Messiaen, Tristan Murail, and Kaija Saariaho
University of Louisville ThinkIR: The University of Louisville's Institutional Repository Electronic Theses and Dissertations 5-2019 Liminal aesthetics : perspectives on harmony and timbre in the music of Olivier Messiaen, Tristan Murail, and Kaija Saariaho. Jackson Harmeyer University of Louisville Follow this and additional works at: https://ir.library.louisville.edu/etd Part of the Musicology Commons Recommended Citation Harmeyer, Jackson, "Liminal aesthetics : perspectives on harmony and timbre in the music of Olivier Messiaen, Tristan Murail, and Kaija Saariaho." (2019). Electronic Theses and Dissertations. Paper 3177. https://doi.org/10.18297/etd/3177 This Master's Thesis is brought to you for free and open access by ThinkIR: The nivU ersity of Louisville's Institutional Repository. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of ThinkIR: The nivU ersity of Louisville's Institutional Repository. This title appears here courtesy of the author, who has retained all other copyrights. For more information, please contact [email protected]. LIMINAL AESTHETICS: PERSPECTIVES ON HARMONY AND TIMBRE IN THE MUSIC OF OLIVIER MESSIAEN, TRISTAN MURAIL, AND KAIJA SAARIAHO By Jackson Harmeyer B.A., Louisiana Scholars’ College, 2013 A Thesis Submitted to the Faculty of the School of Music of the University of Louisville in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Music in Music History and Literature Department of Music History and Literature University of -

Scores 384 SCORES
383 Scores 384 SCORES GEORGES AURIC ______50409370 Phedre SCORES Salabert SEAS15642......................................................$30.00 For orchestra unless otherwise specified. MILTON BABBITT ______50237950 All Set (1957) 8 instruments JOHN ADAMS AMP96417-48 ..............................................................$50.00 ______50480014 Chairman Dances, The ______50237880 Composition 12 instruments AMP7974.......................................................................$30.00 AMP96418-52 ..............................................................$30.00 ______50480554 Grand Pianola ______50236700 String Quartet No. 2 (1954) Mini-score AMP7995.......................................................................$60.00 AMP6716-45 ................................................................$30.00 ______50488949 Harmonielehre CARL PHILLIP EMANUEL BACH AMP7991.......................................................................$60.00 ______50480489 Concerto in G Major for Organ (Winter) ______50480015 Harmonium Chorus & orchestra Harpsichord, piano, strings & continuo AMP7924.......................................................................$60.00 Sikorski SIK638P ..........................................................$32.00 ______50488934 Shaker Loops (revision) String orchestra AMP7983.......................................................................$40.00 JOHANN SEBASTIAN BACH ISAAC ALBENIZ ______50086400 6 Brandenburg Concertos Study score Ricordi RPR733.............................................................$24.95 -

FRENCH CONCERTOS from the 19Th Century to the Present A
FRENCH CONCERTOS From the 19th Century to the Present A Discography Of CDs And LPs Prepared by Michael Herman Edited by Stephen Ellis Composers A-K LOUIS ABBIATE (1866-1933) Born in Monaco. He learned the piano, organ and cello as a child and then attended the Conservatories Turin and Paris where he studied the cello. He worked as a cellist in the Monte Carlo Orchestra and then at Milan's La Scala. He taught the cello at the St. Petersburg Conservatory for some years and after the Russian Revolution returned to Monaco and became the first director of its École Municipale de Musique. He composed orchestral, chamber, instrumental and vocal works. Concerto Italien in A major for Piano and Orchestra, Op. 96 (1922) Maurice Bousquet (piano)/Louis Frémaux/Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Monte Carlo ( + Monaecencis) ECCE MUSICA CM 306 (LP) (1970s) Concerto for Cello and Orchestra in D minor, Op. 35 (1895) Elaine Magnan (cello)/Louis Frémaux/Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Monte Carlo ( + Les Elfes and Le Songe d'Or) ECCE MUSICA CM 312 (LP) (1970s) Monaecencis for Piano and Orchestra, Op. 110 (1925) Maurice Bousquet (piano)/Richard Blareau /Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Monte Carlo ( + Concerto Italien) ECCE MUSICA CM 306 (LP) (1970s) JEAN-LOUIS AGOBET (b. 1968) Born in Blois, Loir-et-Cher, Centre. He studied composition and electronic music at the Ecole Normale de Musique in Aix-en-Provence, followed by further studies at the Conservatoire National à Rayonnement in Nice and then with Philippe Manoury at the Conservatoire de Lyon. -

Direction De La Musique Et De La Danse ; Département Création, Musiques D'aujourd'hui (1957-1991)
Culture ; Direction de la musique et de la danse ; Département création, musiques d'aujourd'hui (1957-1991) Répertoire (19970068/1-19970068/32) Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 1997 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_009290 Cet instrument de recherche a été encodé en 2011 par l'entreprise diadeis dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence 19970068/1-19970068/32 Niveau de description fonds Intitulé Culture ; Direction de la musique et de la danse ; Département création, musiques d'aujourd'hui Date(s) extrême(s) 1957-1991 Nom du producteur • Département de la création et des musiques d'aujourd'hui (direction de la musique et de la danse) Localisation physique Pierrefitte DESCRIPTION Présentation du contenu Sommaire Art 1-21 : Commandes musicales, 1957-1990. Art 22-27 : Festivals de musique contemporaine : Subventions, 1981-1991. Art 28-29. Aide à la recherche, à la création et à l’édition, 1977-1990. Art 30-31 : Facture instrumentale, 1972-1990. Art 32 : Fondation pour la création musicale, 1990-1991 TERMES D'INDEXATION subvention; recherche; musique; festival; facture instrumentale; édition; création artistique; commande publique; artiste; financement; aide de l'etat 3 Archives nationales (France) Répertoire (19970068/1-19970068/32) 19970068/1-19970068/21 I) Commandes musicales : 1957-1990 19970068/1 - Tableaux récapitulatifs par année de commandes musicales : 1967-1972, 1974-1976, 1979, 1980. -

Table of Contents
Town The copyright of this thesis rests with the University of Cape Town. No quotation from it or information derivedCape from it is to be published without full acknowledgement of theof source. The thesis is to be used for private study or non-commercial research purposes only. University A STUDY AND CATALOGUE OF FRENCH FLUTE MUSIC WRITTEN BETWEEN 1945 AND 2008 Town LIESL STOLTZ SUPERVISOR: PROF.Cape JAMES MAY of University Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctorate in Music by performance and thesis in the faculty of humanities, University of Cape Town February 2010 DECLARATION I, the understated, hereby declare that this dissertation is my own work. It is being submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctorate of Music at the University of Cape Town and has not been previously submitted for a degree at any other institution. Town Cape of University Liesl Stoltz Cape Town, 2 February, 2010 i TO MY GRANNY Town OUMA JACOBA JANSE VAN RENSBURG Cape of University ii ACKNOWLEDGEMENTS Upon completion of this work, I would like to thank the following people and institutions: Prof. James May, my supervisor, for his patience, time, guidance and the sharing of his incredible knowledge; My parents and sister, Christélle, who is always there for me and without whom this thesis would not have been completed; Wilhelm, my husband, for his love and support and for accepting the inevitable; Eva Tamassy, my first flute teacher, for always believing in me; Pierre-Yves Artaud, for his role -

16 July 2010 Page 1 of 10 SATURDAY 10 JULY 2010 Monique Zanetti (Soprano), Musica Alta Ripa Rondo Brillant
Radio 3 Listings for 10 – 16 July 2010 Page 1 of 10 SATURDAY 10 JULY 2010 Monique Zanetti (soprano), Musica Alta Ripa Rondo Brillant. SAT 01:00 Through the Night (b00swk61) 5:30 AM Presented by Fiona Talkington John Shea presents rarities, archive and concert recordings from Carissimi, Giacomo (1605-1674) Europe's leading broadcasters Vanitas vanitatum Shostakovich: Violin Sonata Op.134 Olga Pasiecznik & Marta Boberska (sopranos), Il Tempo Schubert: Rondo Brillant in B minor, D895 1:01 AM Baroque Ensemble Ravel, Maurice (1875-1937) Leila Josefowicz (violin) Valses nobles et sentimentales 5:41 AM John Novacek (piano). Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) 1:19 AM Sonata for violin and piano in G major Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) Peter Michalica (violin), Elena Michalicova (piano) SAT 15:00 World Routes (b00swpnj) Concerto for piano and orchestra no. 27 (K.595) in B flat major Ladysmith Black Mambazo Christian Zacharias (piano) 5:50 AM Cavalli, Francesco (1602-1676) Ladysmith Black Mambazo in South Africa: in a rare World 1:50 AM Salve Regina Cup vuvuzela-free zone, Africa's most famous group go back to Bizet, Georges (1838-1875) Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, John Eliot their roots in this special concert in a Zulu workers' hostel in Symphony in C major Gardiner (conductor) Clermont Township. Lopa Kothari introduces the perfect antidote, as well as the perfect preparation, for tomorrow's Oslo Philharmonic Orchestra, Christian Zacharias (conductor) 5:58 AM World Cup Final. Nees, Vic (b.1936) 2:24 AM Salve Regina -
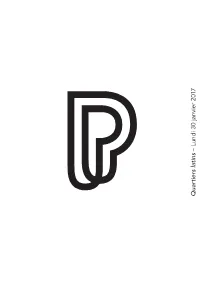
Q U a Rtie Rs Latins – L U N D I 3 0 Ja N Vie R 2 0 17
Quartiers latins – Lundi 30 janvier 2017 CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS SAISON 2016-2017 ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN GRAND SOIR 24 SEPTEMBRE BRAHMS / LIGETI 8 MARS Ives, Dessner, Neuwirth, Zappa Brahms, Ligeti MÉCANIQUES CÉLESTES 15 NOVEMBRE À LIVRES OUVERTS 17 MARS Lazkano, Pintscher Berio, Boulez, Donatoni, Grisey, Kurtág, Ligeti, Xenakis, Benjamin, Birtwistle, LUDWIG VAN 19 NOVEMBRE Carter, Dalbavie, Dusapin, Fedele, Kagel Rihm, Chin, Harvey, Hurel, Manoury, Maresz, Eötvös, Jarrell, Mantovani, POPPE MUSIC 9 DÉCEMBRE Pintscher, Robin Poppe, Zubel, Dusapin HOMMAGE À PIERRE BOULEZ 18 MARS SCHUMANN / KURTÁG 16 DÉCEMBRE Schönberg, Webern, Boulez Schumann, Kurtág GENESIS 30 MARS JARDINS DIVERS 20 JANVIER Andre, Bedrossian, Czernowin, Ravel, Pintscher, Purcell, Britten Gervasoni, Magrané Figuera, GRAND SOIR 21 JANVIER Nikodijević, Thorvaldsdottir Crumb, Pintscher, Furrer, Bedrossian, AU BOUT DE LA NUIT 21 MAI Žuraj, Josquin, Magrané Figuera Schönberg, Dutilleux . LE CHÂTEAU DE BARBE-BLEUE ENTREZ DANS LA DANSE 2 JUIN 28 JANVIER Avec José Montalvo Ligeti, Kurtág, Bartók HERMÈS V 9 JUIN QUARTIERS LATINS 30 JANVIER Blondeau, Vivier, Schoeller Debussy, Maderna, Messiaen, Schoeller, Berio, Ravel, Franceschini VENTS NOUVEAUX 16 AVRIL Ligeti, Žuraj, Maderna, Holliger, 24 FÉVRIER ROTHKO CHAPEL Ferneyhough, Birtwistle Schwartz, Pintscher, Mayrhofer, Attahir, Feldman Photo : W. Beaucardet - Licences ES : 1083294 - 1041550 - 1041546 - 1041547 Licences ES : 1083294 - 1041550 - - Beaucardet : W. Photo 01 44 84 44 84 - PHILHARMONIEDEPARIS.FR PORTE -

FRENCH CONCERTOS from the 19Th Century to the Present A
FRENCH CONCERTOS From the 19th Century to the Present A Discography Of CDs And LPs Prepared by Michael Herman Edited by Stephen Ellis Composers A-K LOUIS ABBIATE (1866-1933) Born in Monaco. He learned the piano, organ and cello as a child and then attended the Conservatories Turin and Paris where he studied the cello. He worked as a cellist in the Monte Carlo Orchestra and then at Milan's La Scala. He taught the cello at the St. Petersburg Conservatory for some years and after the Russian Revolution returned to Monaco and became the first director of its École Municipale de Musique. He composed orchestral, chamber, instrumental and vocal works. Concerto Italien in A major for Piano and Orchestra, Op. 96 (1922) Maurice Bousquet (piano)/Louis Frémaux/Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Monte Carlo ( + Monaecencis) ECCE MUSICA CM 306 (LP) (1970s) Concerto for Cello and Orchestra in D minor, Op. 35 (1895) Elaine Magnan (cello)/Louis Frémaux/Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Monte Carlo ( + Les Elfes and Le Songe d'Or) ECCE MUSICA CM 312 (LP) (1970s) Monaecencis for Piano and Orchestra, Op. 110 (1925) Maurice Bousquet (piano)/Richard Blareau /Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Monte Carlo ( + Concerto Italien) ECCE MUSICA CM 306 (LP) (1970s) JEAN-LOUIS AGOBET (b. 1968) Born in Blois, Loir-et-Cher, Centre. He studied composition and electronic music at the Ecole Normale de Musique in Aix-en-Provence, followed by further studies at the Conservatoire National à Rayonnement in Nice and then with Philippe Manoury at the Conservatoire de Lyon. -

Discographie Des Musiques Microtonales Inharmoniques Et Non-Tempérées
DISCOGRAPHIE DES MUSIQUES MICROTONALES INHARMONIQUES ET NON-TEMPÉRÉES FRANCK JEDRZEJEWSKI NOVEMBRE 2003 Bill Alves The Terrain of Possibilities, Computer music, Distrib. Just Intonation • Store. Static Cling,surleCDMaking Tracks, Xenharmonic Alliance Member Con- • tribution CD 1, Oeuvres de William Alves, Warren Burt, Jonathan Glasier, Kraig Grady, Jacky Ligon, John Loffink, Brink McGoogy, Brian McLaren, Gary Morrison, William Sethares, Jeff Stayton, John Starett, Dan Steams, Elaine Walker, Bill Wesley. Jon Appleton DegitaruOngaku pour synclavier, Computer Music Series vol. 6 (1991), • Centaur Records (CRC 2079). Jon Appleton, Eros Ex Machina. Alyson Reeves. Minuet, Canon 4. CD • du livre de Max Mathews New Directions in Computer Music (1991), MIT Press (MATCCD 0-262-63121-0). Henk Badings Sämtliche Sonaten für zwei violinen par Bouw Lemkes et Jeanne Vos, vio- • lons. Marhel (Esslingen, Pays-Bas), Disques Marhel LP (LC-3647). 50 Jaar Stichting Huygens Fokker. Peter Schat, Collages, Henk Badings, • Sonate no. 3, Reeks van kleine klankstukken, Ivan Wyschnegradsky, Etude ultrachromatique, Jos Zwaanenburg, Cherub’s Chirrup, Rafael Reina, Drag on, Claustrophobia par Joop van Goozen, orgue tricesimoprimal, Jos Zwaa- nenburg, flûte, Janice Jackson, soprano, Orchestre de chambre Interval, dir. José Vicente. Alain Bancquart Thrène I et II. L’Amant Déserté. Trio à cordes de Paris, Ensemble d’instru- • ments électroniques de l’Itinéraire, Tristan Murail, Claude Pavy, François Bousch, Françoise Pellié, sous la direction de A. Bancquart. Disques Sappho