AIEMA - Türkiye
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Open Skoutelas Thesis.Pdf
THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY SCHREYER HONORS COLLEGE DEPARTMENT OF CLASSICS & ANCIENT MEDITERRANEAN STUDIES THE CARTOGRAPHY OF POWER IN GREEK EPIC: HOMER’S ODYSSEY & THE RECEPTION OF HOMERIC GEOGRAPHIES IN THE HELLENISTIC AND IMPERIAL PERIODS CHARISSA SKOUTELAS SPRING 2020 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for baccalaureate degrees in Classics & Ancient Mediterranean Studies and Global & International Studies with honors in Classics & Ancient Mediterranean Studies Reviewed and approved* by the following: Anna Peterson Tombros Early Career Professor of Classical Studies and Assistant Professor of Classics and Ancient Mediterranean Studies Thesis Supervisor Erin Hanses Lecturer in Classics and Ancient Mediterranean Studies Honors Adviser * Electronic approvals are on file. i ABSTRACT As modern scholarship has transitioned from analyzing literature in terms of its temporal components towards a focus on narrative spaces, scholars like Alex Purves and Donald Lateiner have applied this framework also to ancient Greek literature. Homer’s Odyssey provides a critical recipient for such inquiry, and Purves has explored the construction of space in the poem with relation to its implications on Greek epic as a genre. This paper seeks to expand upon the spatial discourse on Homer’s Odyssey by pinpointing the modern geographic concept of power, tracing a term inspired by Michael Foucault, or a “cartography of power,” in the poem. In Chapter 2 I employ a narratological approach to examine power dynamics played out over specific spaces of Odysseus’ wanderings, and then on Ithaca, analyzing the intersection of space, power, knowledge, and deception. The second half of this chapter discusses the threshold of Odysseus’ palace and flows of power across spheres of gender and class. -
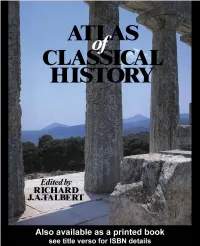
ATLAS of CLASSICAL HISTORY
ATLAS of CLASSICAL HISTORY EDITED BY RICHARD J.A.TALBERT London and New York First published 1985 by Croom Helm Ltd Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2003. © 1985 Richard J.A.Talbert and contributors All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers. British Library Cataloguing in Publication Data Atlas of classical history. 1. History, Ancient—Maps I. Talbert, Richard J.A. 911.3 G3201.S2 ISBN 0-203-40535-8 Master e-book ISBN ISBN 0-203-71359-1 (Adobe eReader Format) ISBN 0-415-03463-9 (pbk) Library of Congress Cataloguing in Publication Data Also available CONTENTS Preface v Northern Greece, Macedonia and Thrace 32 Contributors vi The Eastern Aegean and the Asia Minor Equivalent Measurements vi Hinterland 33 Attica 34–5, 181 Maps: map and text page reference placed first, Classical Athens 35–6, 181 further reading reference second Roman Athens 35–6, 181 Halicarnassus 36, 181 The Mediterranean World: Physical 1 Miletus 37, 181 The Aegean in the Bronze Age 2–5, 179 Priene 37, 181 Troy 3, 179 Greek Sicily 38–9, 181 Knossos 3, 179 Syracuse 39, 181 Minoan Crete 4–5, 179 Akragas 40, 181 Mycenae 5, 179 Cyrene 40, 182 Mycenaean Greece 4–6, 179 Olympia 41, 182 Mainland Greece in the Homeric Poems 7–8, Greek Dialects c. -

HETAIREIA in HOMER John Elias Esposito a Dissertation Submitted to the Faculty at the University of North Carolina at Chapel
HETAIREIA IN HOMER John Elias Esposito A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Classics in the College of Arts and Sciences. Chapel Hill 2015 Approved by: Fred Naiden William H. Race James J. O’Hara Emily Baragwanath James Rives © 2015 John Elias Esposito ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT John Elias Esposito: Hetaireia in Homer (Under the direction of Fred Naiden) This study addresses the neglected subject of hetaireia (roughly, “warrior- companionship”) in Homer. Although many discussions of Homer mention hetairoi in passing, no study treats semantic, poetic, social, and military aspects comprehensively. The purpose of this dissertation is to fill this gap. To this end I explicate the meaning of the heta(i)r- root, survey the social and military roles of Homeric hetairoi, and expose the way the Iliad and the Odyssey use hetaireia to portray pathos and character. The argument is informed by the etymology of heta(i)r- from the PIE reflexive *swe-, but rests on a catalogue and analysis of all scenes in which hetairoi appear. The four chapters of this dissertation argue that hetaireia is a major axis on which both epics turn. The two chapters on the Iliad show what the world is like when hetaireia dominates and consider how a poem about war focuses on the bond between warriors and their companions. The two chapters on the Odyssey show how the world changes when hetaireia disappears and consider how a poem about homecoming replaces the relationships of the battlefield with the relationship between the oikos and the gods. -

Research and Experiment in Early Greek Thought by Tyler Mayo A
Research and Experiment in Early Greek Thought by Tyler Mayo A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Classical Studies) in the University of Michigan 2019 Doctoral Committee: Professor Francesca Schironi, Chair Professor Sara Ahbel-Rappe Professor Richard Janko Associate Professor Ian Moyer Tyler Edward Mayo [email protected] ORCID iD: 0000-0002-2442-7127 To my mother and father ii ACKNOWLEDGMENTS First, ad consuetudinem maiorum, I would like to begin by acknowledging and expressing my gratitude to the members of my committee: Professors Richard Janko, Ian Moyer, and Sara Abhel-Rappe. Their suggestions and criticisms helped me to rethink some, and alter other, points within this dissertation to its improvement, and saved me from numerous errors within the text, many of which surely still lurk within these pages and are my responsibility alone. However, I owe a special debt to my chair, Francesca Schironi, whose support not only made this dissertation possible, but who acted as a mentor throughout my entire time at Michigan. Her honesty and counsel were always welcome, and her careful philology can be seen within these pages, although I fear only as an imperfect reflection. Outside Angell Hall, others made my studies in Ann Arbor possible. The Posch family— John, Dyanna, Isabel, and most recently, Jude—acted as a family away from home, not least for their generous hospitality in boarding me. I shall always remember and cherish their ξενία. My wife Liz is certainly owed a place of honor in the beginning of this dissertation. Her support was essential in its creation as in all other things. -

Catalogue of Potential Ancient Ports in the Black Sea Catalogue Des Abris Et Ports Antiques Potentiels En Mer Noire
129 no 126 - 2016 Catalogue of potential ancient ports in the Black Sea Catalogue des abris et ports antiques potentiels en mer Noire Arthur DE GRAAUW Coastal Engineering & Shiphandling Grenoble, France [email protected] Résumé – Un « havre » est un endroit où les bateaux peuvent trouver Abstract – A ‘harbour’ is a place where ships can seek shelter. un abri. Dans le concept d’abri il faut inclure les mouillages, les plages The concept of ‘shelter’ has to include anchorages, landing places sur lesquelles les bateaux peuvent être halés, et les ports avec des on beaches, and ports with infrastructures. Even though ancient infrastructures. Même si les marins de l’antiquité pouvaient parcourir seafarers could sail 50 to 100 nautical miles in a day, it was important 50 à 100 miles nautiques par jour, il était important de connaître les abris to know where they could find safe shelter within two to three hours sûrs dans un rayon de deux à trois heures de navigation ; c’est‑à‑dire of navigation, i.e. only approximately 10 miles. For safe sailing, a total environ 10 miles nautiques. Un total d’au moins 300 abris était donc of at least 300 shelters was therefore required around the Black Sea nécessaire pour une navigation sûre autour de la mer Noire et de la mer and Azov Sea. This paper presents a list and map of 388 known ancient d’Azov. Cet article présente une liste et une carte de 388 abris et ports harbours in the Black Sea and Azov Sea, and concludes that ancient ports antiques dans la région de la mer Noire et de la mer d’Azov, et conclut are probably still to be found in Ukraine and southern Russia. -

The Decline and Fall of the Roman Empire: Volume IV by Edward Gibbon
HISTORY OF THE DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE By Edward Gibbon VOLUME IV This is volume four of the six volumes of Edward Gibbon's History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire. I will be scanning and putting out on the net the remaining volumes as I find time to do this. So have patience. If you find any errors please feel free to notify me of them. I want to make this the best etext edition possible for both scholars and the general public. [email protected] and [email protected] are my email addresses for now. Please feel free to send me your comments and I hope you enjoy this. David Reed History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire Edward Gibbon, Esq. With notes by the Rev. H. H. Milman Vol. 4 1782 (Written), 1845 (Revised) Chapter XXXIX: Gothic Kingdom Of Italy. Part I. Zeno And Anastasius, Emperors Of The East. - Birth, Education, And First Exploits Of Theodoric The Ostrogoth. - His Invasion And Conquest Of Italy. - The Gothic Kingdom Of Italy. - State Of The West. - Military And Civil Government. - The Senator Boethius. - Last Acts And Death Of Theodoric. After the fall of the Roman empire in the West, an interval of fifty years, till the memorable reign of Justinian, is faintly marked by the obscure names and imperfect annals of Zeno, Anastasius, and Justin, who successively ascended to the throne of Constantinople. During the same period, Italy revived and flourished under the government of a Gothic king, who might have deserved a statue among the best and bravest of the ancient Romans. -

Catalogue of the Collection of Greek Coins, in Gold, Silver, Electrum And
I I . ■■ \ f ' i E>'d' Hvch Cats . V : ■ • \ \ L . J iV'islg HUNTINGTON FREE LIBRARY AND READING ROOM ■■V W THE AMERICAN NUMISMATIC SOCIETY ♦ ; .-. i h ' . v vhrf . • j . , • -. , - • *r • L .• . - . • -.- v* ■ ■' ' : - \ > * - ' . - - - ■ V ■ ■ ' * •; . ^ ' ' : ~ < x / • , , ■ '■'rv.v'' >v$ 'V*£ '.o\r ('o\r C'A^ 'o\' v \/v.,ix/>vV''0: v / v 7 <r- ■ 7V- *'V /?-'V V//-'V 'k'V !' A' 7C'1'7C - 7C- 7 -'- £ v>%;4 ««| SOTHEBY, WILKINSON & IIODGE WELLINGTON STREET, STKANI) LONDON !$&&& ;-s''A-v'i5iGvV''i^''i§lG<7YC'--''%-V'A;!,rv7C'-'VC'i'''LlXv'LV7C'-''v'%-N'%V'i;7C'- 71 rVt'-jtr-iV'ii Mr,\.i,i.N■^/>‘V/^,x'>'-/>'mA*^i^ iy.-N-nr,a*-'-,0n.'-, / 71 -I -;' CATALOGUE OF THE COLLECTION OF GREEK COINS OF A LATE COLLECTOR A' /',\C/V^ mm Baps of Scale. First Day . Monday. May 28th ... Lots 1 f/irv.L Second Day. Tuesday, May 29th ... Lots 130 Third Day . Wednesday, May 30th Lots 259 Fourth Day Thursday, May 31st..., Lots 388 C'Vx'/v/r vvVV AI Av'VX'Vv' •^/c-X|'i.\' .v\A > /-z"}^.i 'J \ \<, -j / \/\/\ n'\/v\0 ^'Xz-'CV^a >7v>^Ar^.W<>7^>^NC/V‘' A'(>7v>></V-'’Wi'<x< A *iUU ?T,>"?7>>*?7.;<?7',^7>'?7^7 A Limited Number of Catalogues with Ten Autotype Plates MAY BE HAD, PRICE SEVEN SHILLINGS AND SIXPENCE EACH. » CATALOGUE OF THE COLLECTION OF GREEK COINS In (Boltr, Jsnllm*, (BUctrmn anb IBron^ OF A LATE COLLECTOR. Many selected from the following well-known Collections: WIGAN, BOMPOIS, DE QUELEN, COMTE DE DUCHASTEL, BILLOIN. -
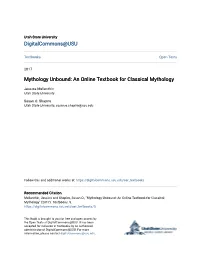
An Online Textbook for Classical Mythology
Utah State University DigitalCommons@USU Textbooks Open Texts 2017 Mythology Unbound: An Online Textbook for Classical Mythology Jessica Mellenthin Utah State University Susan O. Shapiro Utah State University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usu.edu/oer_textbooks Recommended Citation Mellenthin, Jessica and Shapiro, Susan O., "Mythology Unbound: An Online Textbook for Classical Mythology" (2017). Textbooks. 5. https://digitalcommons.usu.edu/oer_textbooks/5 This Book is brought to you for free and open access by the Open Texts at DigitalCommons@USU. It has been accepted for inclusion in Textbooks by an authorized administrator of DigitalCommons@USU. For more information, please contact [email protected]. Mythology Unbound: An Online Textbook for Classical Mythology JESSICA MELLENTHIN AND SUSAN O. SHAPIRO Mythology Unbound by Susan Shapiro is licensed under CC-BY-NC-SA 4.0 Contents Map vii Aegis 1 Agamemnon and Iphigenia 5 Aphrodite 9 Apollo 15 Ares 25 The Argonauts 31 Artemis 41 Athena 49 Caduceus 61 Centaurs 63 Chthonian Deities 65 The Delphic Oracle 67 Demeter 77 Dionysus/Bacchus 85 Hades 97 Hephaestus 101 Hera 105 Heracles 111 Hermes 121 Hestia 133 Historical Myths 135 The Iliad - An Introduction 137 Jason 151 Miasma 155 The Minotaur 157 The Odyssey - An Introduction 159 The Oresteia - An Introduction 169 Origins 173 Orpheus 183 Persephone 187 Perseus 193 Poseidon 205 Prometheus 213 Psychological Myths 217 Sphinx 219 Story Pattern of the Greek Hero 225 Theseus 227 The Three Types of Myth 239 The Twelve Labors of Heracles 243 What is a myth? 257 Why are there so many versions of Greek 259 myths? Xenia 261 Zeus 263 Image Attributions 275 Map viii MAP Aegis The aegis was a goat skin (the name comes from the word for goat, αἴξ/aix) that was fringed with snakes and often had the head of Medusa fixed to it. -

Pearl and Chank Fisheries of the Gulf of Manaar Ceylon
I I-T ! HARVARD UNIVERSITY. LIBRARY OF THE MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY. GIFT OF ALEXANDER AGASSIZ. ^vkjuu^^,^ ^\A%Y O ^zQ ^^^^^ GOVERNMENT CENTRAL MUSEUM, MADRAS. ox THE PEARL AND CHAM FISHERIES AND MARINE FAUNA OF THE GULF OF MANAAIL BY EDGAR JHURSTON, c.m.z.s., &c. SUPERINTENDENT, GOVKBNMENT CENTRAL MUSEUM. MADRAS : Feinted by the supeeintendent, goyt. peess. [Price, Re. 1-4-0. ""^890. ] . GOVERNMENT CENTRAL MUSEUM, MADRAS. KOTES ON THE PEARL AND CHAM FISHERIES AND MAEINE FAUNA OF THE GULF OF MANAAE. BY EDGAR ^HTJRSTON, c.m.z.s., &c., SUPERINTENDENT, GOVERNMENT CENTBAI, MUSEUM. c MADRAS: PRINTED BY THE SUPEEINTENDENT, GOVT. PRESS. J^ [Price, 1-4-0. 1 9 . Re. ] 8 wmmmmmim ""^'"-*' ' < I.—TUTICOEIN PEAEL FISHEEY. ^ IT.—PEAELS OF MYTILUS AND PLACUNA. •III.—TUTICOEIN CHANK FISHEEY. ^ IY._CEYLON PEAEL FISHEEY. * v.—EAMlfeSYAEAM ISLAND. * YI.-MAEINE FAUNA OF THE GULF OF MANAAE. 'YII.—INSPECTION OF CEYLON PEAEL BANKS. " Know you, perchance, how that poor formless wretch— The Oyster—gems his shallow moonlit chalice ? Where the shell irks him, or the sea-sand frets, This lovely lustre on his grief." Edwin Arnold. I.-THE TUTICOEIN PEAEL FISHEEY. TuTicoRiN, the " scattered town," situated on the south- west coast of the Gulf of Manaar, from which the Madras Government pearl fishery is conducted, is, according to Sir Edwin Arnold,^ " a sandy maritime little place, which fishes a few pearls, produces and sells the great pink conch shells, exports rice and baskets, and is surrounded on the landside by a wilderness of cocoa and palmyra palms." Summed up in these few words, Tuticorin does not appear the important place which, in spite of its lowly appearance when viewed from the sea and the apparent torpor which reveals itself to the casual visitor, it is in reality, not only as a medium of communication between Tinnevelly and Ceylon, to and from which hosts of coolies are transported in the course of every year, but as being an important mercantile centre for* the shipment of Tinnevelly cotton, jaggery, onions, chillies, &c. -

Athenaeus on Women D1
ATHENAEUS OF NAUCRATIS THE DEIPNOSOPHISTS TRANSLATED BY CHARLES BURTON GULICK Dr. D’s introduction: The Deipnosophists, which has been translated as anything from “the wise men at dinner” to “the dinner-geeks,” is purportedly a recounting by the author, Athenaeus, of clever conversations by groups of witty friends, with often differing opinions, on various topics; the interlocutors support their points with extensive quotes from poets, playwrights, and other writers (though often the original work does not survive). This chapter, “On Women,” discusses a number of topics having to do with wives, hetairai, pederastic relationships, and related issues. I have edited it heavily for length, eliminating sections where there are dozens of quotes and anecdotes that have much the same point. A lot of this chapter has anecdotes of witty sayings of hetairai, the humor of which is pretty well incomprehensible to the average non-ancient-Greek, but serve to show how tough, bold, and clever a hetaira might be. Although the comments and anecdotes are attributed to different speakers in the original, there is not a coherent theme of opposed positions (as there is in Plato’s Symposium) so I have more or less eliminated references to the speakers, and left us only with the miscellaneous attitudes and anecdotes as our focal point for our interpretations of Greek experiences and literature about love, sex, and the lack or opposite of both. There are a great many names here, since myths and anecdotes about historical personages are used as supporting material for the expressed views of women and love. Do not be confused by them or think that you need to know all of them – I don’t even get all the references. -
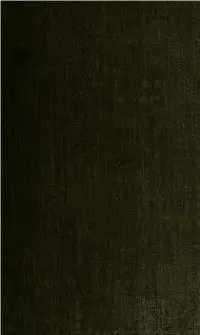
Atlas of Ancient & Classical Geography
mm '> Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Boston Library Consortium Member Libraries http://www.archive.org/details/atlasofancientclOO EVERYMAN'S LIBRARY EDITED BY ERNEST RHYS REFERENCE ATLAS OF ANCIENT AND CLASSICAL GEOGRAPHY this is no. 451 of ere'Rjr&izdstis LIB%tA CRjT. THE PUBLISHERS WILL BE PLEASED TO SEND FREELY TO ALL APPLICANTS A LIST OF THE PUBLISHED AND PROJECTED VOLUMES ARRANGED UNDER THE FOLLOWING SECTIONS! TRAVEL ^ SCIENCE ^ FICTION THEOLOGY & PHILOSOPHY HISTORY ^ CLASSICAL FOR YOUNG PEOPLE ESSAYS ^ ORATORY POETRY & DRAMA BIOGRAPHY REFERENCE ' ROMANCE THE ORDINARY EDITION IS BOUND IN CLOTH WITH GILT DESIGN AND COLOURED TOP. THERE IS ALSO A LIBRARY EDITION IN REINFORCED CLOTH J. M. DENT & SONS LTD. ALDINE HOUSE, BEDFORD STREET, LONDON, W.C.2 E. P. DUTTON & CO. INC. 286-302 FOURTH AVENUE, NEW YORK ATLAS OF>S ANCIENT Jg & CLASSICAL GEOGRAPHY (EVERY LONDON &.TORONTO PUBLISHED BYJ M DENT &SONS DP &.IN NEWYORK BY E P DUTTON & CO First Issue of this Edition . 1907 Reprinted .... 1908, 1909, 1910, 1912, 1914, i9*7> 1921, 1925, 1928 1 3"537& Or 1033 A8 All rights reserved PRINTED IN GREAT BRITAIN INTRODUCTION Dr. Butler's atlas, which for a time filled the place in the series taken by this volume, has only been laid aside in response to a demand for better maps, clearer in detail. The new maps are designed to lighten the search for the place-names and the landmarks they contain by a freer spacing and lettering of the towns, fortresses, harbours, rivers and so forth, likely to be needed by readers of the classical writers and the histories of Greece and Rome. -

The Metamorphic Tragedy of Anthony and Cleopatra AN1HONY MIILER
SYDNEY STUDIES The Metamorphic Tragedy of Anthony and Cleopatra AN1HONY MIILER When he turned the pages of Plutarch, his principal historical source for Anthony and Cleopatra, Shakespeare was confronted with the values of a sober ethical arbiter. Plutarch treats Anthony's tragic fall as the consequence of his subservience to fleshly pleasure. Such pleasure is a 'pestilent plague and mischief', a 'sweet poison'. It makes mature manhood regress to childishness: Anthony 'spent and lost in childish sports (as a man might say) and idle pastimes, the most precious thing a man can spend, ... and that is, time'. Even more shamefully, it makes courageous manhood descend to cowardliness. By his flight at the battle ofActium, Anthony 'had not only lost the courage and heart ofan Emperor, but also ofa valiant man.... In the end, as Paris fled from the battle and went to hide himself in Helen's arms, even so did he in Cleopatra's arms'.l Yet Shakespeare's management of his tragedy, like his understanding of Roman history in general, is not circumscribed by Plutarch. There are indications that Shakespeare looked far afield to furnish his play with quite minor details, such as Anthony's account ofEgyptian farming practices, which apparently derives from Pliny or from the Renaissance historian of Africa, Johannes Leo. The play's treatment of the historical significance of Augustus Caesar's victory over Anthony and Cleopatra derives not only from Plutarch, but from the Augustan poets Horace and VirgiI.2 In dramatizing the tragedy ofAnthony, and in amplifying it with the tragedy of Cleopatra, Shakespeare voices not only Plutarchan censoriousness.