I- Les Relations Extérieures Du Canada Manon Tessier
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
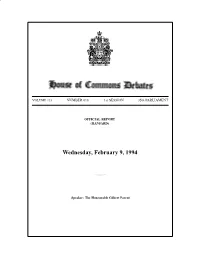
Wednesday, February 9, 1994
VOLUME 133 NUMBER 018 1st SESSION 35th PARLIAMENT OFFICIAL REPORT (HANSARD) Wednesday, February 9, 1994 Speaker: The Honourable Gilbert Parent HOUSE OF COMMONS Wednesday, February 9, 1994 The House met at 2 p.m. This biological dephosphorization project at the cost of $860,000 over two years will allow, among other things, to _______________ reduce discharges of phosphorus, thereby complying with the new environmental protection standards. Prayers I commend the instigators of this major initiative, who are _______________ showing a strong desire to develop a more performing technolo- gy while remaining aware of environmental laws and responsi- ble towards them. STATEMENTS BY MEMBERS * * * [English] [English] DEBT RECOVERY BONDS THE GOODMAN FAMILY Mrs. Dianne Brushett (Cumberland—Colchester): Mr. Mr. Jim Hart (Okanagan—Similkameen—Merritt): Mr. Speaker, during World War II the Government of Canada issued Speaker, I rise to pay tribute to a prominent family in the victory bonds as a means to pay for our war effort. Patriotic Okanagan—Similkameen—Merritt riding. With today’s rapid Canadians bought the bonds and thereby saved their children development and technological advances we rarely stop to think and grandchildren a legacy of heavy debt. about those people who shaped our communities in their forma- tive years. Today a new generation of patriotic Canadians is offering its financial support to pay down this country’s debt. Each year the South Okanagan Historical Society awards the pioneer award to a family that has made a great contribution to This government could issue a debt recovery bond and sell it the development of the Okanagan. This year the Goodman domestically to Canadians. -

House & Senate
HOUSE & SENATE COMMITTEES / 63 HOUSE &SENATE COMMITTEES ACCESS TO INFORMATION, PRIVACY AND Meili Faille, Vice-Chair (BQ)......................47 A complete list of all House Standing Andrew Telegdi, Vice-Chair (L)..................44 and Sub-Committees, Standing Joint ETHICS / L’ACCÈS À L’INFORMATION, DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS Omar Alghabra, Member (L).......................38 Committees, and Senate Standing Dave Batters, Member (CON) .....................36 PERSONNELS ET DE L’ÉTHIQUE Committees. Includes the committee Barry Devolin, Member (CON)...................40 clerks, chairs, vice-chairs, and ordinary Richard Rumas, Committee Clerk Raymond Gravel, Member (BQ) .................48 committee members. Phone: 613-992-1240 FAX: 613-995-2106 Nina Grewal, Member (CON) .....................32 House of Commons Committees Tom Wappel, Chair (L)................................45 Jim Karygiannis, Member (L)......................41 Directorate Patrick Martin, Vice-Chair (NDP)...............37 Ed Komarnicki, Member (CON) .................36 Phone: 613-992-3150 David Tilson, Vice-Chair (CON).................44 Bill Siksay, Member (NDP).........................33 Sukh Dhaliwal, Member (L)........................32 FAX: 613-996-1962 Blair Wilson, Member (IND).......................33 Carole Lavallée, Member (BQ) ...................48 Senate Committees and Private Glen Pearson, Member (L) ..........................43 ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE Legislation Branch Scott Reid, Member (CON) .........................43 DEVELOPMENT / ENVIRONNEMENT -

Provincial Solidarities: a History of the New Brunswick Federation of Labour
provincial solidarities Working Canadians: Books from the cclh Series editors: Alvin Finkel and Greg Kealey The Canadian Committee on Labour History is Canada’s organization of historians and other scholars interested in the study of the lives and struggles of working people throughout Canada’s past. Since 1976, the cclh has published Labour / Le Travail, Canada’s pre-eminent scholarly journal of labour studies. It also publishes books, now in conjunction with AU Press, that focus on the history of Canada’s working people and their organizations. The emphasis in this series is on materials that are accessible to labour audiences as well as university audiences rather than simply on scholarly studies in the labour area. This includes documentary collections, oral histories, autobiographies, biographies, and provincial and local labour movement histories with a popular bent. series titles Champagne and Meatballs: Adventures of a Canadian Communist Bert Whyte, edited and with an introduction by Larry Hannant Working People in Alberta: A History Alvin Finkel, with contributions by Jason Foster, Winston Gereluk, Jennifer Kelly and Dan Cui, James Muir, Joan Schiebelbein, Jim Selby, and Eric Strikwerda Union Power: Solidarity and Struggle in Niagara Carmela Patrias and Larry Savage The Wages of Relief: Cities and the Unemployed in Prairie Canada, 1929–39 Eric Strikwerda Provincial Solidarities: A History of the New Brunswick Federation of Labour / Solidarités provinciales: Histoire de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick David Frank A History of the New Brunswick Federation of Labour david fra nk canadian committee on labour history Copyright © 2013 David Frank Published by AU Press, Athabasca University 1200, 10011 – 109 Street, Edmonton, ab t5j 3s8 isbn 978-1-927356-23-4 (print) 978-1-927356-24-1 (pdf) 978-1-927356-25-8 (epub) A volume in Working Canadians: Books from the cclh issn 1925-1831 (print) 1925-184x (digital) Cover and interior design by Natalie Olsen, Kisscut Design. -

Tuesday, March 27, 2001
CANADA 1st SESSION · 37th PARLIAMENT · VOLUME 139 · NUMBER 20 OFFICIAL REPORT (HANSARD) Tuesday, March 27, 2001 THE HONOURABLE DAN HAYS SPEAKER CONTENTS (Daily index of proceedings appears at back of this issue.) Debates and Publications: Chambers Building, Room 943, Tel. 996-0193 Published by the Senate Available from Canada Communication Group — Publishing, Public Works and Government Services Canada, Ottawa K1A 0S9, Also available on the Internet: http://www.parl.gc.ca 438 THE SENATE Tuesday, March 27, 2001 The Senate met at 2 p.m., the Speaker in the Chair. champions. With one more step to climb, albeit a steep one, their dream of a world championship became a reality Saturday night Prayers. in Ogden, Utah. With Islanders in the stands and hundreds of others watching on television at the Silver Fox Curling Club in Summerside, SENATORS’ STATEMENTS these young women put on a show that was at once both inspiring and chilling. It was certainly a nervous time for everyone because those of us who have been watching all week QUESTION OF PRIVILEGE knew that the team Canada was playing in the finals was not only the defending world champion but the same team that had UNEQUAL TREATMENT OF SENATORS—NOTICE defeated Canada earlier in the week during the round robin. With steely determination, the young Canadian team overcame that The Hon. the Speaker: Honourable senators, I wish to inform mental obstacle and earned the world championship in the you that, in accordance with rule 43(3) of the Rules of the Senate, process. the Clerk of the Senate received, at 10:52 this morning, written notice of a question of privilege by the Honourable Senator The welcome the Canadian team received last night on their Carney, P.C. -

Tuesday, May 2, 2000
CANADA 2nd SESSION • 36th PARLIAMENT • VOLUME 138 • NUMBER 50 OFFICIAL REPORT (HANSARD) Tuesday, May 2, 2000 THE HONOURABLE ROSE-MARIE LOSIER-COOL SPEAKER PRO TEMPORE This issue contains the latest listing of Senators, Officers of the Senate, the Ministry, and Senators serving on Standing, Special and Joint Committees. CONTENTS (Daily index of proceedings appears at back of this issue.) Debates and Publications: Chambers Building, Room 943, Tel. 996-0193 Published by the Senate Available from Canada Communication Group — Publishing, Public Works and Government Services Canada, Ottawa K1A 0S9, Also available on the Internet: http://www.parl.gc.ca 1170 THE SENATE Tuesday, May 2, 2000 The Senate met at 2:00 p.m., the Speaker pro tempore in the Last week, Richard Donahoe joined this political pantheon and Chair. there he belongs, now part of the proud political history and tradition of Nova Scotia. He was a greatly gifted and greatly respected public man. He was much beloved, especially by the Prayers. rank and file of the Progressive Conservative Party. Personally, and from my earliest days as a political partisan, I recall his kindness, thoughtfulness and encouragement to me and to others. THE LATE HONOURABLE Dick was an inspiration to several generations of young RICHARD A. DONAHOE, Q.C. Progressive Conservatives in Nova Scotia. • (1410) TRIBUTES The funeral service was, as they say nowadays, quite “upbeat.” Hon. Lowell Murray: Honourable senators, I have the sad It was the mass of the resurrection, the Easter service, really, with duty to record the death, on Tuesday, April 25, of our former great music, including a Celtic harp and the choir from Senator colleague the Honourable Richard A. -

June 15, 2005
Debates - Issue 71 - June 15, 2005 http://www.parl.gc.ca/38/1/parlbus/chambus/senate/deb-e/071db_2005-... Debates of the Senate (Hansard) 1st Session, 38th Parliament, Volume 142, Issue 71 Wednesday, June 15, 2005 The Honourable Daniel Hays, Speaker Visitors in the Gallery SENATORS' STATEMENTS World Blood Donor Day The Honourable Viola Léger, O.C. Tribute on Retirement The Late Scott Young The Late Andy Russell, O.C. ROUTINE PROCEEDINGS The Senate Notice of Motion to Establish New Numbering System for Senate Bills Appropriation Bill No. 2 2005-06 First Reading Banking, Trade and Commerce Notice of Motion to Authorize Committee to Extend Date of Final Report on Study of Issues Dealing with Demographic Change Notice of Motion to Authorize Committee to Extend Date of Final Report on Study of Issues Dealing with Interprovincial Barriers to Trade Notice of Motion to Authorize Committee to Extend Date of Final Report on Study of Consumer Issues Arising in Financial Services Sector The Senate Notice of Motion to Strike Special Committee On Gap Between Regional and Urban Canada State of International Health Services Notice of Inquiry QUESTION PERIOD Information Commissioner Acceptability of Reports Extension of Term National Defence Gagetown—Testing of Agent Orange and Agent Purple House of Commons Ethics Commissioner—Report on Member for York West Ethics Commissioner—Hiring of Law Firms Canada-United States Relations 1 of 34 4/13/2006 2:28 PM Debates - Issue 71 - June 15, 2005 http://www.parl.gc.ca/38/1/parlbus/chambus/senate/deb-e/071db_2005-.. -
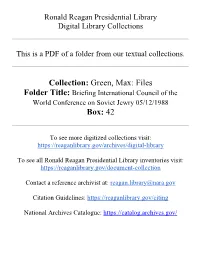
Collection: Green, Max: Files Box: 42
Ronald Reagan Presidential Library Digital Library Collections This is a PDF of a folder from our textual collections. Collection: Green, Max: Files Folder Title: Briefing International Council of the World Conference on Soviet Jewry 05/12/1988 Box: 42 To see more digitized collections visit: https://reaganlibrary.gov/archives/digital-library To see all Ronald Reagan Presidential Library inventories visit: https://reaganlibrary.gov/document-collection Contact a reference archivist at: [email protected] Citation Guidelines: https://reaganlibrary.gov/citing National Archives Catalogue: https://catalog.archives.gov/ WITHDRAWAL SHEET Ronald Reagan Library Collection Name GREEN, MAX: FILES Withdrawer MID 11/23/2001 File Folder BRIEFING INTERNATIONAL COUNCIL & THE WORLD FOIA CONFERENCE ON SOVIET JEWRY 5/12/88 F03-0020/06 Box Number THOMAS 127 DOC Doc Type Document Description No of Doc Date Restrictions NO Pages 1 NOTES RE PARTICIPANTS 1 ND B6 2 FORM REQUEST FOR APPOINTMENTS 1 5/11/1988 B6 Freedom of Information Act - [5 U.S.C. 552(b)] B-1 National security classified Information [(b)(1) of the FOIA) B-2 Release would disclose Internal personnel rules and practices of an agency [(b)(2) of the FOIA) B-3 Release would violate a Federal statute [(b)(3) of the FOIA) B-4 Release would disclose trade secrets or confidential or financial Information [(b)(4) of the FOIA) B-8 Release would constitute a clearly unwarranted Invasion of personal privacy [(b)(6) of the FOIA) B-7 Release would disclose Information compiled for law enforcement purposes [(b)(7) of the FOIA) B-8 Release would disclose Information concerning the regulation of financial Institutions [(b)(B) of the FOIA) B-9 Release would disclose geological or geophysical Information concerning wells [(b)(9) of the FOIA) C. -

Wednesday, May 1, 1996
CANADA 2nd SESSION 35th PARLIAMENT VOLUME 135 NUMBER 13 OFFICIAL REPORT (HANSARD) Wednesday, May 1, 1996 THE HONOURABLE GILDAS L. MOLGAT SPEAKER This issue contains the latest listing of Officers of the Senate, the Ministry and Senators. CONTENTS (Daily index of proceedings appears at back of this issue.) Debates: Victoria Building, Room 407, Tel. 996-0397 Published by the Senate Available from Canada Communication Group — Publishing, Public Works and Government Services Canada, Ottawa K1A 0S9, at $1.75 per copy or $158 per year. Also available on the Internet: http://www.parl.gc.ca 257 THE SENATE Wednesday, May 1, 1996 The Senate met at 2:00 p.m., the Speaker in the Chair. Someone once asked what Mr. du Plessis’ favourite day of the year was, and he responded, Boxing Day, because on that day he Prayers. could put his feet up, sit back and reflect on all that has gone on in the past year. Now, Mr. du Plessis, you may put your feet up every day and reflect not only on one year but on 20 remarkable SENATORS’ STATEMENTS years of a distinguished career in the Senate of Canada. We will miss not just your wisdom but your friendship and RAYMOND L. DU PLESSIS, Q.C. your wonderful sense of humour. We wish you well in all your future activities, be they badminton, tennis or dancing. We know TRIBUTES ON RETIREMENT AS LAW CLERK that your family will be delighted as well to be able to claim AND PARLIAMENTARY COUNSEL more of your time, your attention and your very good spirits. -

Wednesday, April 24, 1996
CANADA VOLUME 134 S NUMBER 032 S 2nd SESSION S 35th PARLIAMENT OFFICIAL REPORT (HANSARD) Wednesday, April 24, 1996 Speaker: The Honourable Gilbert Parent CONTENTS (Table of Contents appears at back of this issue.) The House of Commons Debates are also available on the Parliamentary Internet Parlementaire at the following address: http://www.parl.gc.ca 1883 HOUSE OF COMMONS Wednesday, April 24, 1996 The House met at 2 p.m. [English] _______________ LIBERAL PARTY OF CANADA Prayers Mr. Ken Epp (Elk Island, Ref.): Mr. Speaker, voters need accurate information to make wise decisions at election time. With _______________ one vote they are asked to choose their member of Parliament, select the government for the term, indirectly choose the Prime The Speaker: As is our practice on Wednesdays, we will now Minister and give their approval to a complete all or nothing list of sing O Canada, which will be led by the hon. member for agenda items. Vancouver East. During an election campaign it is not acceptable to say that the [Editor’s Note: Whereupon members sang the national anthem.] GST will be axed with pledges to resign if it is not, to write in small print that it will be harmonized, but to keep it and hide it once the _____________________________________________ election has been won. It is not acceptable to promise more free votes if all this means is that the status quo of free votes on private members’ bills will be maintained. It is not acceptable to say that STATEMENTS BY MEMBERS MPs will be given more authority to represent their constituents if it means nothing and that MPs will still be whipped into submis- [English] sion by threats and actions of expulsion. -

Wednesday, May 8, 1996
CANADA VOLUME 134 S NUMBER 042 S 2nd SESSION S 35th PARLIAMENT OFFICIAL REPORT (HANSARD) Wednesday, May 8, 1996 Speaker: The Honourable Gilbert Parent CONTENTS (Table of Contents appears at back of this issue.) OFFICIAL REPORT At page 2437 of Hansard Tuesday, May 7, 1996, under the heading ``Report of Auditor General'', the last paragraph should have started with Hon. Jane Stewart (Minister of National Revenue, Lib.): The House of Commons Debates are also available on the Parliamentary Internet Parlementaire at the following address: http://www.parl.gc.ca 2471 HOUSE OF COMMONS Wednesday, May 8, 1996 The House met at 2 p.m. [Translation] _______________ COAST GUARD Prayers Mrs. Christiane Gagnon (Québec, BQ): Mr. Speaker, another _______________ voice has been added to the general vehement objections to the Coast Guard fees the government is preparing to ram through. The Acting Speaker (Mr. Kilger): As is our practice on Wednesdays, we will now sing O Canada, which will be led by the The Quebec urban community, which is directly affected, on hon. member for for Victoria—Haliburton. April 23 unanimously adopted a resolution demanding that the Department of Fisheries and Oceans reverse its decision and carry [Editor’s Note: Whereupon members sang the national anthem.] out an in depth assessment of the economic impact of the various _____________________________________________ options. I am asking the government to halt this direct assault against the STATEMENTS BY MEMBERS Quebec economy. I am asking the government to listen to the taxpayers, the municipal authorities and the economic stakehold- [English] ers. Perhaps an equitable solution can then be found. -

Friday, April 30, 1999
CANADA VOLUME 135 S NUMBER 219 S 1st SESSION S 36th PARLIAMENT OFFICIAL REPORT (HANSARD) Friday, April 30, 1999 Speaker: The Honourable Gilbert Parent CONTENTS (Table of Contents appears at back of this issue.) All parliamentary publications are available on the ``Parliamentary Internet Parlementaire'' at the following address: http://www.parl.gc.ca 14527 HOUSE OF COMMONS Friday, April 30, 1999 The House met at 10 a.m. [Translation] _______________ This year is the fourth anniversary of the Open Skies Agreement and the 25th anniversary of the 1974 Air Transport Preclearance Agreement. Prayers These two agreements have worked hand in glove to transform _______________ air passenger travel between Canada and the United States. [English] In the past, travelling from Canada to the United States was long GOVERNMENT ORDERS and arduous because the airlines were often prevented from providing efficient routings by the outdated air agreement. Because of open skies, some 60 U.S. destinations can now be reached D (1005 ) non-stop from 19 Canadian cities and many more can be reached [English] by convenient connections at U.S. hubs. D (1010 ) PRECLEARANCE ACT Parenthetically, I should point out that in transporter traffic, Hon. David M. Collenette (for the Minister of Foreign since the open skies agreement has come in, Canadian carriers Affairs) moved that Bill S-22, an act authorizing the United States dominate that market. Canadian carriers carry more passengers in to preclear travellers and goods in Canada for entry into the United the transporter market than do U.S. carriers. That is a testament to States for the purposes of customs, immigration, public health, the efficiency of Canada’s various airlines. -

Debates, September 16, 2003
CANADA Debates of the Senate 2nd SESSION . 37th PARLIAMENT . VOLUME 140 . NUMBER 73 OFFICIAL REPORT (HANSARD) Tuesday, September 16, 2003 ^ THE HONOURABLE LUCIE PEÂ PIN SPEAKER PRO TEMPORE This issue contains the latest listing of Senators, Officers of the Senate, the Ministry, and Senators serving on Standing, Special and Joint Committees. CONTENTS (Daily index of proceedings appears at back of this issue). Debates and Publications: Chambers Building, Room 943, Tel. 996-0193 Published by the Senate Available from Communication Canada ± Canadian Government Publishing, Ottawa, Ontario K1A 0S9. Also available on the Internet: http://www.parl.gc.ca 1800 THE SENATE Tuesday, September 16, 2003 The Senate met at 2 p.m., the Speaker pro tempore in the Chair. (1430) Prayers. Hon. Sharon Carstairs (Leader of the Government): Honourable senators, it is a great privilege to welcome four new senators to our chamber this afternoon: the Honourable Percy Downe, the VISITOR IN THE GALLERY Honourable Paul J. Massicotte, the Honourable Madeleine Plamondon and the Honourable Marilyn Trenholme Counsell. The Hon. the Speaker pro tempore: I wish to draw the attention of honourable senators to the presence in the gallery of Dr. Wolfgang BoÈ hmer, President of the Bundesrat of the Senator Percy Downe is well known to all of us who serve on Federal Republic of Germany. this side of the chamber and some of us who have moved across the aisle because we have run out of room. He has served a premier in this country, our very own Senator Catherine On behalf of all senators, I welcome you to the Senate of Callbeck, three federal ministers and our Prime Minister.