Table Des Matieres
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
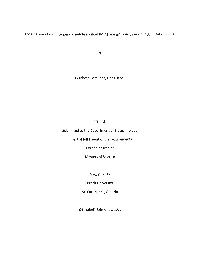
Biosynthesis by in Situ Hybridization (ISH)
Localization of monoterpenoid indole alkaloid (MIA) biosynthesis by in situ hybridization (ISH) By Elizabeth Edmunds, Hons. B.Sc. A Thesis Submitted to the Department of Biotechnology In partial fulfillment of the requirements For the degree of Masters of Science August, 2012 Brock University St. Catha rines, Ontario ©Elizabeth Edmunds, 2012 ii Acknowledgments First and foremost I would like to thank Dr. Vincenzo Deluca for the opportunity to work in his laboratory under his mentorship. I have appreciated the helpful insight that has guided me through the course of this project. I have gained a valuable experience being able to learn from such an established and knowledgeable researcher. Secondly, I would like to thank my committee members Dr. Jeffrey Atkinson and Dr. Heather Gordon for their support and advice and their time to serve on my advisory committee. Thirdly, I would like to thank my colleagues and co-workers for their patience and helpful advice throughout my project. Particular mention must be given to Dr. Carlone's lab for their assistance and insight into in situ hybridization techniques. Finally, I would like to express my sincerest gratitude and appreciation towards my family and friends for their support. I would not be where I am today without the support and love from my mother and father, as well as Craig Easton. iii Abstract Monoterpenoid indole alkaloids (MIA) are among the largest and most complex group of nitrogen containing secondary metabolites that are characteristic of the Apocynaceae plant family including the most notable Catharanthus roseus. These compounds have demonstrated activity as successful drugs for treating various cancers, neurological disorders and cardiovascular conditions. -

Flora of the Carolinas, Virginia, and Georgia, Working Draft of 17 March 2004 -- BIBLIOGRAPHY
Flora of the Carolinas, Virginia, and Georgia, Working Draft of 17 March 2004 -- BIBLIOGRAPHY BIBLIOGRAPHY Ackerfield, J., and J. Wen. 2002. A morphometric analysis of Hedera L. (the ivy genus, Araliaceae) and its taxonomic implications. Adansonia 24: 197-212. Adams, P. 1961. Observations on the Sagittaria subulata complex. Rhodora 63: 247-265. Adams, R.M. II, and W.J. Dress. 1982. Nodding Lilium species of eastern North America (Liliaceae). Baileya 21: 165-188. Adams, R.P. 1986. Geographic variation in Juniperus silicicola and J. virginiana of the Southeastern United States: multivariant analyses of morphology and terpenoids. Taxon 35: 31-75. ------. 1995. Revisionary study of Caribbean species of Juniperus (Cupressaceae). Phytologia 78: 134-150. ------, and T. Demeke. 1993. Systematic relationships in Juniperus based on random amplified polymorphic DNAs (RAPDs). Taxon 42: 553-571. Adams, W.P. 1957. A revision of the genus Ascyrum (Hypericaceae). Rhodora 59: 73-95. ------. 1962. Studies in the Guttiferae. I. A synopsis of Hypericum section Myriandra. Contr. Gray Herbarium Harv. 182: 1-51. ------, and N.K.B. Robson. 1961. A re-evaluation of the generic status of Ascyrum and Crookea (Guttiferae). Rhodora 63: 10-16. Adams, W.P. 1973. Clusiaceae of the southeastern United States. J. Elisha Mitchell Sci. Soc. 89: 62-71. Adler, L. 1999. Polygonum perfoliatum (mile-a-minute weed). Chinquapin 7: 4. Aedo, C., J.J. Aldasoro, and C. Navarro. 1998. Taxonomic revision of Geranium sections Batrachioidea and Divaricata (Geraniaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 85: 594-630. Affolter, J.M. 1985. A monograph of the genus Lilaeopsis (Umbelliferae). Systematic Bot. Monographs 6. Ahles, H.E., and A.E. -

Alkaloids – Secrets of Life
ALKALOIDS – SECRETS OF LIFE ALKALOID CHEMISTRY, BIOLOGICAL SIGNIFICANCE, APPLICATIONS AND ECOLOGICAL ROLE This page intentionally left blank ALKALOIDS – SECRETS OF LIFE ALKALOID CHEMISTRY, BIOLOGICAL SIGNIFICANCE, APPLICATIONS AND ECOLOGICAL ROLE Tadeusz Aniszewski Associate Professor in Applied Botany Senior Lecturer Research and Teaching Laboratory of Applied Botany Faculty of Biosciences University of Joensuu Joensuu Finland Amsterdam • Boston • Heidelberg • London • New York • Oxford • Paris San Diego • San Francisco • Singapore • Sydney • Tokyo Elsevier Radarweg 29, PO Box 211, 1000 AE Amsterdam, The Netherlands The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, UK First edition 2007 Copyright © 2007 Elsevier B.V. All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher Permissions may be sought directly from Elsevier’s Science & Technology Rights Department in Oxford, UK: phone (+44) (0) 1865 843830; fax (+44) (0) 1865 853333; email: [email protected]. Alternatively you can submit your request online by visiting the Elsevier web site at http://elsevier.com/locate/permissions, and selecting Obtaining permission to use Elsevier material Notice No responsibility is assumed by the publisher for any injury and/or damage to persons or property as a matter of products liability, negligence or otherwise, or from any use or operation -

Plant Ana Tomy
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ PLANT ANATOMY: TRADITIONS AND PERSPECTIVES Международный симпозиум, АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ: посвященный 90-летию профессора PLANT ANATOMY: TRADITIONS AND PERSPECTIVES AND TRADITIONS ANATOMY: PLANT ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ Людмилы Ивановны Лотовой 1 ЧАСТЬ 1 московский госУдАрствеННый УНиверситет имени м. в. ломоНосовА Биологический факультет АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ Ìàòåðèàëû Ìåæäóíàðîäíîãî ñèìïîçèóìà, ïîñâÿùåííîãî 90-ëåòèþ ïðîôåññîðà ËÞÄÌÈËÛ ÈÂÀÍÎÂÍÛ ËÎÒÎÂÎÉ 16–22 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.  двуõ ÷àñòÿõ ×àñòü 1 МАТЕРИАЛЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ PLANT ANATOMY: ТRADITIONS AND PERSPECTIVES Materials of the International Symposium dedicated to the 90th anniversary of Prof. LUDMILA IVANOVNA LOTOVA September 16–22, Moscow In two parts Part 1 CONTRIBUTIONS IN ENGLISH москва – 2019 Удк 58 DOI 10.29003/m664.conf-lotova2019_part1 ББк 28.56 A64 Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проекту 19-04-20097 Анатомия растений: традиции и перспективы. материалы международного A64 симпозиума, посвященного 90-летию профессора людмилы ивановны лотовой. 16–22 сентября 2019 г. в двух частях. – москва : мАкс пресс, 2019. ISBN 978-5-317-06198-2 Чaсть 1. материалы на английском языке / ред.: А. к. тимонин, д. д. соколов. – 308 с. ISBN 978-5-317-06174-6 Удк 58 ББк 28.56 Plant anatomy: traditions and perspectives. Materials of the International Symposium dedicated to the 90th anniversary of Prof. Ludmila Ivanovna Lotova. September 16–22, 2019. In two parts. – Moscow : MAKS Press, 2019. ISBN 978-5-317-06198-2 Part 1. Contributions in English / Ed. by A. C. Timonin, D. D. Sokoloff. – 308 p. ISBN 978-5-317-06174-6 Издание доступно на ресурсе E-library ISBN 978-5-317-06198-2 © Авторы статей, 2019 ISBN 978-5-317-06174-6 (Часть 1) © Биологический факультет мгУ имени м. -
![Breeding Medicinal Plant, Periwinkle [Catharanthus Roseus (L) G. Don]: a Review](https://docslib.b-cdn.net/cover/0873/breeding-medicinal-plant-periwinkle-catharanthus-roseus-l-g-don-a-review-4580873.webp)
Breeding Medicinal Plant, Periwinkle [Catharanthus Roseus (L) G. Don]: a Review
© NIAB 2016 Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization (2016) 14(4); 283–302 ISSN 1479-2621 doi:10.1017/S1479262116000150 Breeding medicinal plant, periwinkle [Catharanthus roseus (L) G. Don]: a review R. N. Kulkarni1*†, K. Baskaran1 and Tripta Jhang2 1CSIR – Central Institute of Medicinal Plants (CIMAP) Research Centre, Bangalore 560 065, Karnataka, India and 2Genetics & Plant Breeding Division, CSIR–CIMAP, Lucknow 226 015, UP, India Received 1 April 2016; Accepted 1 April 2016 – First published online 2 May 2016 Abstract Periwinkle [Catharanthus roseus (L) G. Don] has become one of the very extensively investigated medicinal plants after the discovery of two powerful anti-cancer alkaloids, vinblastine and vincris- tine, in its leaves more than 50 years ago. These alkaloidal drugs are still in clinical use. Also, peri- winkle is still the only source of these alkaloids and their precursors, catharanthine and vindoline. Low concentrations of these alkaloids in the plant and, therefore, high costs of their extraction have led to tremendous efforts towards understanding their biosynthesis and exploration of alternate ways of their production such as, chemical synthesis, cell, tissue and hairy root cultures, and meta- bolic engineering of heterologous organisms. Literature on this plant is quite voluminous, with an average of about 80 publications per year during last three decades (1985–2015). Nearly 60% of these publications are on physiology, biochemistry, cell and tissue culture, phytochemistry, meta- bolic and genetic engineering aspects. In spite of these efforts, an economically viable alternative to field-grown periwinkle plants as a source of these alkaloids has not yet been found. Biosynthesis of C. -

Alkaloid Chemistry in Biosynthesis, Models and Other Methodological Considerations and Basic Techniques Used
Elsevier AMS Prelims-N52736 Job code: ASLA 17-2-2007 12:35p.m. Page:xi Trimsize:165×240MM List of Figures 1 Contemporary scheme of morphine. 2 2 Some alkaloids isolated by pharmaceutists Pierre Joseph Pelletier and Joseph Beinamé Caventou during 1817–1821. 3 3 Schemes of taxol, vinblastine, vincristine and vincamine 5 4 An example of a true alkaloid 11 5 An example of protoalkaloids 11 6 An example of a pseudoalkaloid 12 7 The raw extraction of quinolizidine alkaloids 13 8 l-tryptophan with its aromatic side chain 15 9 The devil’s-pepper genus, Rauwolfia serpentina 15 10 l-phenylalanine is a precursor 17 11 l-ornithine is an important precursor 19 12 l-tyrosine, with its aromatic side chain 19 13 l-anthranilic acid is a precursor 23 14 l-histidine is a precursor 24 15 l-ornithine and l-nicotinic acids are precursors 26 16 l-lysine is a precursor 31 17 (a) Structure of seed testa of the Washington lupine (b) Alkaloidal Lupinus polyphyllus Lindl. 32 18 Jervine, cyclopamine and protoveratrine structures. 49 19 Basic alkaloids of mushrooms. 55 20 Ergotamine and LSD 56 21 Secondary metabolism blocks 65 22 Pyruvate derivation and acetyl CoA synthesis 66 23 General scheme of alkaloid synthesis 68 24 l-lysine-derived nuclei 69 25 Nuclei and skeletons of izidine alkaloids 70 26 The source and forms of the pyrrolidine ring 70 27 l-histidine and the nuclei of imidazole and manzamine alkaloids. 70 28 The nuclei produced by anthranilic acid in alkaloids 71 29 The nucleus of alkaloids derived from nicotinic acid 72 30 l-phenylanine-derived nuclei in alkaloid biosynthesis 72 31 Nuclei supplied to alkaloids by l-tyrosine in the synthesizing process 73 32 The l-tryptophan-supplied nucleus during synthesis 74 33 Synthesis of alkaloids from ornithine 75 34 Synthesis pathway of the pyrrolizidine alkaloids 76 35 Synthesis of hordeine and mescaline 77 Font Used:Times Margins:Top:18mm Gutter:20mm Font Size:11/13 Text Width:125mm Depth:43 Lines Elsevier AMS Prelims-N52736 Job code: ASLA 17-2-2007 12:35p.m. -
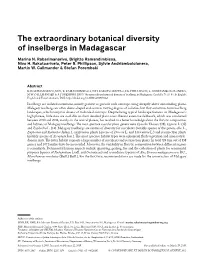
The Extraordinary Botanical Diversity of Inselbergs in Madagascar
The extraordinary botanical diversity of inselbergs in Madagascar Marina N. Rabarimanarivo, Brigitte Ramandimbisoa, Nivo H. Rakotoarivelo, Peter B. Phillipson, Sylvie Andriambololonera, Martin W. Callmander & Stefan Porembski Abstract RABARIMANARIVO, M.N., B. RAMANDIMBISOA, N.H. RAKOTOARIVELO, P.B. PHILLIPSON, S. ANDRIAMBOLOLONERA, M.W. CALLMANDER & S. POREMBSKI (2019). The extraordinary botanical diversity of inselbergs in Madagascar. Candollea 74: 65 – 84. In English, English and French abstracts. DOI: http://dx.doi.org/10.15553/c2019v741a8 Inselbergs are isolated mountains, mainly granitic or gneissic rock outcrops rising abruptly above surrounding plains. Malagasy inselbergs are often dome-shaped and occur in varying degrees of isolation, but they sometimes form inselberg landscapes, which comprise dozens of individual outcrops. Despite being typical landscape features on Madagascar’s high plateau, little data are available on their detailed plant cover. Recent extensive fieldwork, which was conducted between 2010 and 2014, mainly on the central plateau, has resulted in a better knowledge about the floristic composition and habitats of Malagasy inselbergs. The most speciose vascular plant genera were Cynorkis Thouars (18), Cyperus L. (15) and Euphorbia L. (14). Malagasy inselbergs are centres of diversity for succulents (notably species of the genera Aloe L., Euphorbia and Kalanchoe Adans.), carnivorous plants (species of Drosera L. and Utricularia L.) and resurrection plants (notably species of Xerophyta Juss.). The most speciose habitat types were ephemeral flush vegetation and monocotyle- donous mats. The latter habitat supports a large number of succulents and resurrection plants. In total 724 taxa out of 338 genera and 107 families have been recorded. Moreover, the variability in floristic composition between different regions is remarkable. -

Catharanthus Roseus, the Madagascar Periwinkle, a Review of Its Cultivars
WAGENINGEN AGRICULTURAL UNIVERSITY PAPERS 96-3 (1996) Revision of Catharanthus G. Don Series of Revisions of Apocynaceae XLI by M.A. van Bergen Catharanthus roseus, the Madagascar Periwinkle, a review of its cultivars by W. Snoeijer Date of publication: 22Decembe r 1996 Wageningen mm Agricultural University b^ 9 a i^s Revision of Catharanthus G. Don. Series of Revisions of Apocyna- ceae XLI / M.A. van Bergen Catharanthus roseus, the Madagascar Periwinkle, a review of its cultivars / W. Snoeijer ISBN 90-73348-60-9 NUGI 835 ISSN 0169 345 X Distribution: Backhuys Publishers, P.O.Box 321,230 0 AH Leiden, the Netherlands. Telephone: +31-71-5170208 Fax: +31-71-5171856 E-mail: [email protected] All rights reserved Printed in the Netherlands Contents Foreword - A.J.M. Leeuwenberg 7 Revision of Catharanthus G. Don. Series of Revisions of Apocyna- ceaeXLI- M.A. van Bergen 9 Abstract 9 Introduction 9 Geographical distribution 10 Relationships with other genera 10 History of the genus 11 Systematic part 13 Catharanthus G. Don 13 Key to the species 14 1. C. coriaceus Markgraf. 15 2. C. lanceus (Bojer ex A. DC.) 18 3. C. longifolius (Pichon) Pichon 22 4. C. ovalis Markgraf. 24 5. C. pusillus (Murray) G. Don 28 6. C. roseus (L.) G. Don 32 7. C. scitulus (Pichon) Pichon 36 8. C. trichophyllus (Bak.) Pichon 38 Nomen nudum 41 Acknowledgements 41 References 42 Index of exsiccatae 42 Index of scientific names 45 Catharanthus roseus, the Madagascar Periwinkle, a review of its cultivars - W. Snoeijer 47 Introduction 49 Catharanthus and the Apocynaceae family 50 History 50 Medicinal uses - R. -

Madagascar's Lemurs
Madagascar’s Lemurs Naturetrek Tour Report 9 – 23 October 2015 Baby Ring-tailed Lemur Greater Bamboo Lemur Lowland Streaked Tenrec Long-tailed Ground Roller Report & images compiled by Ed Drewitt Naturetrek Mingledown Barn Wolf's Lane Chawton Alton Hampshire GU34 3HJ UK T: +44 (0)1962 733051 E: [email protected] W: www.naturetrek.co.uk Madagascar’s Lemurs Tour Report Tour participants: Ed Drewitt (leader) & Claude Rambeloson (local guide) with eight Naturetrek clients Introduction During this two-week holiday we enjoyed seeing 20 species of day and night-time lemurs, from the critically endangered Greater Bamboo Lemur to the ever-energetic mouse lemurs. Many unique, endemic families of birds put on a good show from the warbler-like tetrakas to the dazzling Blue Coua and its relatives, as well as the vangas such as the bizarre Sickle-billed Vanga, and mesites, including ten Subdesert Mesites all lined up together as dawn broke. Owls put on a good show with five species seen or heard. A visit to Madagascar wouldn't be complete without the chameleons - we saw ten species from the minute Broad-browed Chameleon to the large Parson's and Oustalet's Chameleons. They were supported by a range of tiny tree and leaf litter frogs, plus a variety of snakes including tree and ground boas. Not forgetting the many colourful swallowtail butterflies, the beautifully patterned orb-web spiders, a scorpion, giant millipedes and a vast array of other weird and wonderful invertebrate including Hissing Cockroaches, Rainbow Locust and gigantic stick insects. A chance encounter with Madagascar's largest carnivore, the Fosa and the incredible diversity of plant life from the unique spiny forest to the rainforest flora, made this tour a very memorable, enjoyable and exciting experience for everyone. -

Genome and Transcriptome Guided Gene Discovery in Plant Secondary Metabolism
Genome and transcriptome guided gene discovery in plant secondary metabolism Franziska Kellner This thesis is submitted in fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy at the University of East Anglia Department of Biological Chemistry John Innes Centre Norwich June 2016 © This copy of the thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and that no quotation from the thesis, or information derived therefore, may be published without the author’s prior written consent. Abstract Plants produce a wide range of complex secondary metabolites that have many applications, for example as pharmaceutical agents. Gene discovery and the elucidation of these unique biosynthetic pathways is challenging since many of the enzymatic transformations are unprecedented. In Catharanthus roseus, the sole producer of the valuable anti-cancer compounds vinblastine and vincristine, the biosynthetic pathway for these alkaloids is highly complex and crucial steps are still unknown. Recently, the tight transcriptional co-regulation of the early part of this pathway enabled discovery of some of the central enzymatic steps by analysing the gene co-expression patterns and testing potential candidates using virus induced gene silencing. Additionally, it has become apparent that some plant secondary metabolite pathways exhibit physical clustering of pathway related genes in the genome. This thesis highlights how both strategies of gene discovery can be applied for the targeted discovery of genes for missing steps in biosynthesis of non-model plants. Co-expression analysis to identify candidates and subsequent testing of these candidates using virus induced gene silencing has led to the discovery and subsequent characterisation of the enzyme tabersonine 3-oxygenase (T3O), a key oxidation step in vindoline biosynthesis.