Chanson Du Collectif À L'intime Et Retour
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Shropshire Cover
Wolverhampton & Black Country Cover February 2020.qxp_Wolverhampton & Black Country Cover 22/01/2020 14:55 Page 1 THE RED SHOES RETURNS Your FREE essential entertainment guide for the Midlands TO THE MIDLANDS... WOLVERHAMPTON & BLACK COUNTRY WHAT’S ON FEBRUARY 2020 FEBRUARY ON WHAT’S COUNTRY BLACK & WOLVERHAMPTON Wolverhampton & Black Country ISSUE 410 FEBRUARY 2020 ’ WhatFILM I COMEDY I THEATRE I GIGS I VISUAL ARTS I EVENTSs I FOOD On wolverhamptonwhatson.co.uk inside: PART OF WHAT’S ON MEDIA GROUP GROUP MEDIA ON WHAT’S OF PART Yourthe 16-pagelist week by week listings guide AFTER HENRY Henry VIII’s wives visit the Grand Theatre in SIX TWITTER: @WHATSONWOLVES @WHATSONWOLVES TWITTER: BEN POOLE award-winning guitarist plays the blues at The Robin FACEBOOK: @WHATSONWOLVERHAMPTON FACEBOOK: @WHATSONWOLVERHAMPTON RAIN OR SHINE... places to visit during the WOLVERHAMPTONWHATSON.CO.UK February school holiday IFC Wolverhampton.qxp_Layout 1 22/01/2020 15:51 Page 1 Thursday 6th - Saturday 8th February at Thursday 13th February at 7.30pm Friday 14th February at 7.30pm 7.30pm, 1pm Friday Matinee Drama Drama Dance JANEJANE EYREEYRE LOOKING FOR WOLVERHAMTON'S EMERGENCEEMERGENCE TRIPLETR BILL LATIN QUARTER 2020 Tickets £10 Tickets £10 Tickets £10 Saturday 15th February at 7.30pm Friday 21st - Sunday 23rd February at Thursday 27th February at 7.30pm 7.00pm Friday and Saturday, 2.00pm Saturday and Sunday Drama Musical Theatre DRAMA YOURS SINCERELY FOOTLOOSE HOME OF THE WRIGGLER Tickets £10 Tickets £12, £10 conc Tickets £10 Contents February Wolves/Shrops/Staffs.qxp_Layout 1 22/01/2020 16:08 Page 2 February 2020 Contents The Queendom Is Coming.. -
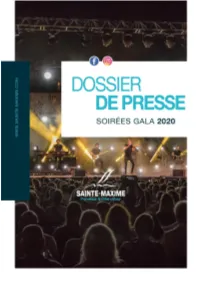
DP SOIREES GALA 2020.Pdf
1 CRÉDITS PHOTO @BrianYpperciel - @Renaud Corlouer - @Ben Dauchez -2 @ laurentseroussi - @Elodie Daguin @Studio Charrier Sainte-Maxime, le 28 février 2020 LES SOIRÉES GALA 2020 L'été approche et avec lui toutes les animations estivales désormais attendues des maximois et de ses visiteurs. À Sainte-Maxime, l’offre festive s’ouvre à tous les publics. Entre les feux d’artifice, les fêtes traditionnelles, les Summer DJ’s Party ou les Musiques Live en Ville. Points d’orgue, les prestigieuses « Soirées Gala ». Proposées par la Ville de Sainte-Maxime et le Casino Barrière, acteur engagé et impliqué dans la vie événementielle de la commune, les « Soirées Gala » assurent une expérience musicale autour des meilleurs artistes de la scène française et internationale. Une programmation variée autour de 6 artistes dans le cadre intimiste du Théâtre de la Mer. Une particularité : une ambiance festive, conviviale et familiale. 3 DIMANCHE 12 JUILLET 2020 GAROU Né à Sherbrooke (Québec, Canada), le petit Pierre est élevé par un père garagiste et mélomane, guitariste à ses heures : il se révèle vite doué pour la musique, maîtrisant la guitare, le piano et l'orgue. Au lycée, il est guitariste du groupe de son école, Windows & Doors. C'est en 1997 que Garou fait une rencontre décisive, en la personne du producteur et parolier Luc Plamondon. Assistant à une représentation de Garou and The Untouchables, Plamondon est frappé par la présence et la voix du chanteur, en qui il voit un interprète de choix pour sa comédie musicale, Notre-Dame de Paris. Après une audition en présence de Richard Cocciante, compositeur du spectacle, Garou décroche le rôle de Quasimodo. -

La Vague De Vandalisme Sur Velospot Touche Aussi Le
FRANC FORT Un fonds alimenté par la BNS contre le chômage? PAGES 7 ET 19 <wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytzQ0MwIAkRYDoQ8AAAA=</wm> <wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZmZLty0rSV2DIPgagub_FQ-HuMkVp3dPAV9LW_e2OcGoornS1KkMpTozAoqDSAraTGOlRuNPS8mAAuM1AgrSeIZFIsZkGq7jvAGd4s1zcAAAAA==</wm> 30 EN JANVIER OFFRES Sur toutes les Capsules 2 nouvelles variétés 0 lasemeuse.ch SAMEDI 9 JANVIER 2016 | www.arcinfo.ch | N 6 | CHF 2.70 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL PUBLICITÉ Pour loger «ses» requérants, Neuchâtel fera appel au privé AFFLUX La Suisse fait face au plus grand NEUCHÂTEL Le canton a fait face PROVISOIRE Le canton envisage de louer afflux de réfugiés depuis la guerre aux besoins du premier accueil en ouvrant des lieux capables d’accueillir au Kosovo. Les capacités d’accueil ordinaires des abris PC et en louant des chambres des requérants pour un temps suffisamment sont débordées. d’hôtel. Un «bricolage» qui a ses limites. long et pouvoir fermer les abris PC. PAGE 3 La vague de vandalisme sur Velospot touche aussi le Bas ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY CHRISTIAN ARCHIVES MAISON DE L’ABSINTHE Les visites de groupes désertent les distilleries PAGE 7 CABINETS MÉDICAUX Une solution transitoire à la fin du moratoire? PAGE 16 DJIHADISME Trois touristes blessés à l’arme blanche en Egypte PAGE 17 LA MÉTÉO DU JOUR pied du Jura à 1000m 6° 8° 3° 6° DAVID MARCHON LITTORAL Après Bienne et La Chaux-de-Fonds, une vague de vandalisme sur les vélos en libre-service SOMMAIRE a aussi déferlé sur le Littoral. Une soixantaine de petites reines ont vu leur cadenas fracassé Cinéma PAGE 11 Feuilleton PAGE 20 avant d’être abandonnés dans la nature. Un nouveau système de verrou doit être mis en place. -

Chansons Françaises
Médiathèque AGOS. Catalogue des CD : Chansons françaises 10/11/15 NB : Le prêt des livres, CD, DVD, CDROM et bandes dessinées est réservé au personnel de l’INRIA et aux membres de l’AGOS. 1 1500 Chansons françaises Salvatore Adamo Vous permettez, Mon- EMI 829072-2 1500 10816 sieur ? Aldebert Sur place ou à emporter UP MUSIC 1500 13098 Graeme Allwright Emmène-moi Philips 0-42284-81762-2 1500 10403 Graeme Allwright Jour de clarté Philips 0-42284-81772-1 1500 10404 Graeme Allwright Suzanne Philips 0-42284-81782-0 1500 10405 Amadou, Mariam Dimanche à Bamako Radio Bemba 1500 17019 Amandine Bourgeois 20 M2 Sony 1500 16637 Amélie-les-crayons Et pourquoi les L’Autre Distribution 1500 17035 crayons ? Amélie-les-crayons La porte plume Neômme 1500 16635 Anaïs A l’eau de Javel Polydor 1500 18000 Anaïs The Cheap Show Warner 1500 14767 Ange Vagabondages 8382462 1500 10423 Dick Annegarn Best of Bruxelles 8373572 1500 10127 Arno A poil commercial Delabel 1500 10771 Arthur-H Bachibouzouk Polydor 1500 11976 Aston Villa Extraversion Sony music 1500 12289 René Aubry Steppe As de Coeur AS CD 1500 10105 3014 Hugues Aufray Chacun sa mer! Wagram 1500 11086 Hugues Aufray Le rossignol anglais Barclay 1500 10924 Hugues Aufray Santiano Barclay 1500 10826 Autour de Lucie Echappée belle Sony 1500 12294 Autour de Lucie Faux mouvement Small 1500 11994 Charles Aznavour 40 chansons d’or EMI 7-24385-35052-8 (2 1500 10815 CD) Balavoine L’essentiel Barclay 1500 11133 Barbara Châtelet 87 vol.1 0-42283-40402-1 1500 10317 Barbara Châtelet 87 vol.2 0-42283-40412-0 1500 10318 Alain Bashung L’imprudence Barclay 1500 12527 Alain Bashung Osez Joséphine 5114852 1500 10406 Alain Bashung Roulette Russe Barclay 0-42282-96072- 1500 10128 6 André Baugé Les cloches de Corne- Forlane 1500 10673 ville, le Barbier de Sé- ville 2 Prêt réservé aux membres de l’AGOS. -

Sommaire Catalogue National Octobre 2011
SOMMAIRE CATALOGUE NATIONAL OCTOBRE 2011 Page COMPACT DISCS Répertoire National ............................................................ 01 SUPPORTS VINYLES Répertoire National ............................................................. 89 DVD / HDDVD / BLU-RAY DVD Répertoire National .................................................... 96 L'astérisque * indique les Disques, DVD, CD audio, à paraître à partir de la parution de ce bon de commande, sous réserve des autorisations légales et contractuelles. Certains produits existant dans ce listing peuvent être supprimés en cours d'année, quel qu'en soit le motif. Ces articles apparaîtront de ce fait comme "supprimés" sur nos documents de livraison. NATIONAL 1 ABD AL MALIK Salvatore ADAMO (Suite) Château Rouge Master Serie(MASTER SERIE) 26/11/2010 BARCLAY / BARCLAY 20/08/2009 POLYDOR / POLYDOR (557)CD (899)CD #:GACFCH=ZX]\[V: #:GAAHFD=V^[U[^: Dante Zanzibar + La Part De L'Ange(2 FOR 1) 03/11/2008 BARCLAY / BARCLAY 19/07/2010 POLYDOR / POLYDOR (561)CD (928)2CD #:GAAHFD=VW]\XW: #:GAAHFD=W]ZWYY: Isabelle ADJANI Château Rouge Pull marine(L'ORIGINAL) 14/02/2011 BARCLAY / BARCLAY 08/04/1991 MERCURY / MERCURY (561)CD (949)CD #:GACFCH=[WUZ[Z: #:AECCIE=]Y]ZW\: ADMIRAL T Gibraltar Instinct Admiral 12/06/2006 BARCLAY / BARCLAY 19/04/2010 AZ / AZ (899)CD (557)CD #:GACEJI=X\^UW]: #:GAAHFD=W[ZZW^: Le face à face des coeurs Instinct Admiral(ECOPAK) 02/03/2004 BARCLAY / BARCLAY 20/09/2010 AZ / AZ (606)CD (543)CD #:GACEJI=VX\]^Z: #:GAAHFD=W^XXY]: ADAM & EVE Adam & Eve La Seconde Chance Toucher l'horizon -

Pdf Liste Totale Des Chansons
40ú Comórtas Amhrán Eoraifíse 1995 Finale - Le samedi 13 mai 1995 à Dublin - Présenté par : Mary Kennedy Sama (Seule) 1 - Pologne par Justyna Steczkowska 15 points / 18e Auteur : Wojciech Waglewski / Compositeurs : Mateusz Pospiezalski, Wojciech Waglewski Dreamin' (Révant) 2 - Irlande par Eddie Friel 44 points / 14e Auteurs/Compositeurs : Richard Abott, Barry Woods Verliebt in dich (Amoureux de toi) 3 - Allemagne par Stone Und Stone 1 point / 23e Auteur/Compositeur : Cheyenne Stone Dvadeset i prvi vijek (Vingt-et-unième siècle) 4 - Bosnie-Herzégovine par Tavorin Popovic 14 points / 19e Auteurs/Compositeurs : Zlatan Fazlić, Sinan Alimanović Nocturne 5 - Norvège par Secret Garden 148 points / 1er Auteur : Petter Skavlan / Compositeur : Rolf Løvland Колыбельная для вулкана - Kolybelnaya dlya vulkana - (Berceuse pour un volcan) 6 - Russie par Philipp Kirkorov 17 points / 17e Auteur : Igor Bershadsky / Compositeur : Ilya Reznyk Núna (Maintenant) 7 - Islande par Bo Halldarsson 31 points / 15e Auteur : Jón Örn Marinósson / Compositeurs : Ed Welch, Björgvin Halldarsson Die welt dreht sich verkehrt (Le monde tourne sens dessus dessous) 8 - Autriche par Stella Jones 67 points / 13e Auteur/Compositeur : Micha Krausz Vuelve conmigo (Reviens vers moi) 9 - Espagne par Anabel Conde 119 points / 2e Auteur/Compositeur : José Maria Purón Sev ! (Aime !) 10 - Turquie par Arzu Ece 21 points / 16e Auteur : Zenep Talu Kursuncu / Compositeur : Melih Kibar Nostalgija (Nostalgie) 11 - Croatie par Magazin & Lidija Horvat 91 points / 6e Auteur : Vjekoslava Huljić -

Smash Hits Volume 57
H' II i.C'^Wf'«^i^i'>SSH"WS'^~'^'-"' 0!!^ Feb 5-18 1981 Vol.3 No 3 g^g^<nFG^gJJ^ Another issue already? I'd rather watch paint dry. Let's see what drivel they're trying to palm off on us this time. Features on Madness and Phil Collins? 1 mean, honestly, i don't suppose it's even occurred to them to interview The Strang ... oh, they have. But as for the rest of it, who really wants a colour poster of Adam or the chance to win the new Gen X album? What happened to the Sky pin-up they promised us? What about the feature on pencil sharpeners, the win a string bag competition, the paper clip giveaway? No sign of any of it. 1 mean, honestly. I'd write a letter if 1 were you . VIENNA Ultravox 2 ROMEO AND JULIET Dire Straits 8 ROCK THIS TOWN Stray Cats 10 TAKE MY TIME Sheena Easton 13 IN THE AIR TONIGHT Phil Collins 16 ZEROX Adam And The Ants 20 THE BEST OF TIMES Styx 21 GANGSTERS OF THE GROOVE Heatwave 22 MESSAGE OF LOVE Pretenders 26 TURN ME ON TURN ME OFF Honey Bane 26 BORN TO RUN Bruce Springsteen 33 TWILIGHT CAFE Susan Fassbender 36 1.0. U. Jane Kennaway 36 LONELY HEART U.F.O 43 1 SURRENDER Rainbow 43 MADNESS: Feature 4/5/6 PHIL COLLINS: Feature 14/15/16 ADAM AND THE ANTS: Colour Poster 24/25 THE STRANGLERS: Feature 34/35 DEBBIE HARRY: Colour Poster 44 DISC JOCKEYS 9 CARTOON 9 BITZ 11/12 CROSSWORD 18 INDEPENDENT BITZ 19 DISCO 22 REVIEWS 28/29 STAR TEASER 30 SOUNDAROUND/GEN X COMPETITION 31 BIRO BUDDIES 32 COMPETITION WINNERS ...! 37 LEHERS .„..39/40 GIGZ • 42 This magazine is published by EMAP Nationaf Publications Ltd, Peterborough, and is printed by East Midland Utbo Printers, Peterborough. -

4 April 2008 Page 1 of 6 SATURDAY 29 MARCH 2008 Dan Freedman and Nick Romero’S Comedy About the First Broadcast on BBC Radio 4 in May 1999
Radio 7 Listings for 29 March – 4 April 2008 Page 1 of 6 SATURDAY 29 MARCH 2008 Dan Freedman and Nick Romero’s comedy about the First broadcast on BBC Radio 4 in May 1999. swashbuckling exploits of Lord Zimbabwe, occultist and SAT 13:30 The Men from the Ministry (b007jqfn) SAT 00:00 Simon Bovey - Slipstream (b009mbjn) adventurer. Not on Your Telly Fight for the Future Lord Zimbabwe ...... Nick Romero The bungling bureaucrats spark bedlam during a BBC Jurgen and Kate are desperate to get the weapon away before all Dr Lilac ...... Dan Freedman 'Panorama' probe. is lost... Cletus ...... Owen Oakeshott Stars Richard Murdoch and Deryck Guyler. Conclusion of Simon Bovey's sci-fi adventure series set during Marylou Coyotecock ...... Sophie Aldred With Norma Ronald, Ronald Baddiley and John Graham. the Second World War. Vicar ...... Colin Guthrie Written by Edward Taylor and John Graham. Stars Rory Kinnear as Jurgen Rall, Tim McMullan as Major Theremin ...... Peter Donaldson 'The Men from the Ministry' ran for 14 series between 1962 Barton, Joannah Tincey as Kate Richey, Ben Crowe as Other parts played by the cast. and 1977. Deryck Guyler replaced Wilfrid Hyde-White from Lieutenant Dundas, Rachel Atkins as Trudi Schenk, Peter Producer: Helen Williams 1966. Sadly many episodes didn't survive in the archive, Marinker as Brigadier Erskine and Laura Molyneux as First broadcast on BBC Radio 4 in August 2000. however the BBC's Transcription Service re-recorded 14 shows Slipstream. SAT 05:00 The Barchester Chronicles (b007jpr1) in 1980 - never broadcast in the UK, until the arrival of BBC Other parts played by Simon Treves, Sam Pamphilon, Alex Framley Parsonage Radio 4 Extra. -

Titre Construit 1Er Responsable Série Edith Piaf
Titre construit 1er responsable Série Edith Piaf (1963-2003) (20) : Volume 20 : Carnegie Hall 1956-1957 Piaf, Edith Edith Piaf (1963-2003) / Edith Piaf [Emi Music] Edith Piaf (1963-2003) (19) : Volume 19 : Carnegie Hall 1956 Piaf, Edith Edith Piaf (1963-2003) / Edith Piaf [Emi Music] Edith Piaf (1963-2003) (18) : Volume 18 Piaf, Edith Edith Piaf (1963-2003) / Edith Piaf [Emi Music] Edith Piaf (1963-2003) (17) : Volume 17 Piaf, Edith Edith Piaf (1963-2003) / Edith Piaf [Emi Music] Léo chante Ferré (16) : Léo chante l'espoir Ferré, Léo (1916 - 1993) Léo chante Ferré / Léo Ferré [Universal Music S.A.] Edith Piaf (1963-2003) (16) : Volume 16 Piaf, Edith Edith Piaf (1963-2003) / Edith Piaf [Emi Music] Intégrale 1965-1995 (16) : Disque 16 Sardou, Michel Intégrale 1965-1995 / Michel Sardou [Universal Music France S.a] Léo chante Ferré (15) : Léo chante Et ... basta ! Ferré, Léo (1916 - 1993) Léo chante Ferré / Léo Ferré [Universal Music S.A.] Edith Piaf (1963-2003) (15) : Volume 15 Piaf, Edith Edith Piaf (1963-2003) / Edith Piaf [Emi Music] L'Intégrale (15) : Les Marquises Brel, Jacques L'Intégrale / Jacques Brel [Universal Music France S.a] Intégrale 1965-1995 (15) : Disque 15 Sardou, Michel Intégrale 1965-1995 / Michel Sardou [Universal Music France S.a] L'Intégrale studio de Claude Nougaro (14) : Embarquement immédiat Nougaro, Claude L'Intégrale studio de Claude Nougaro / Claude Nougaro [Mercury France] Intégrale 1965-1995 (14) : Disque 14 Sardou, Michel Intégrale 1965-1995 / Michel Sardou [Universal Music France S.a] Edith Piaf (1963-2003) -

3. Corona Java
«AGON» (ISSN 2384-9045), n. 3, ottobre-dicembre 2014 René Corona JAVA QU’EST-CE QUE TU FAIS ENCORE LÀ? LIRE LE POÈME DE LA JAVA RÉSUMÉ. Sur les rivages de la Poésie, il existe des contrées danseuses où les mots, discrets par rapport au vacarme d’une musique populaire en fête, en vérité laissent apparaître, çà et là, un chant populaire, familier et dense d’images poétiques. C’est dans un petit bal perdu que l’on peut retrouver ces mots provenant d’un monde qui a chaviré depuis longtemps mais qui a laissé dans l’imaginaire collectif plein de couplets et de visions que l’on a essayé, avec cet essai, de regrouper avec l’idée d’un inventaire élaboré pour une poétique différente et originale par sa forme-sens. La clef qui consent l’entrée dans ce monde interlope et mystérieux c’est le poète écrivain Francis Carco qui nous l’offre avec l’un de ces premiers poèmes en prose où il nous montre ce monde rutilant et dansant, là où s’épanouit la java, cette danse des filles et des mauvais garçons. Nous sommes dans les années folles, les années 1920, et la java bat son plein et nous allons voir comment les mots qui la célèbrent vont se modifier au courant des années, alors qu’aujourd’hui elle n’est plus qu’une danse parmi d’autres qui a perdu presque tout son pouvoir de séduction: O tempora o mores, les danses s’assagissent et les danseurs ne se touchent pratiquement plus, le couple évolue, virevolte, solitaire sur une piste éclairée au néon, danseurs solitaires ou presque, couple désuni car, aujourd’hui, ainsi va la chanson. -

Eurovision Karaoke
1 Eurovision Karaoke ALBANÍA ASERBAÍDJAN ALB 06 Zjarr e ftohtë AZE 08 Day after day ALB 07 Hear My Plea AZE 09 Always ALB 10 It's All About You AZE 14 Start The Fire ALB 12 Suus AZE 15 Hour of the Wolf ALB 13 Identitet AZE 16 Miracle ALB 14 Hersi - One Night's Anger ALB 15 I’m Alive AUSTURRÍKI ALB 16 Fairytale AUT 89 Nur ein Lied ANDORRA AUT 90 Keine Mauern mehr AUT 04 Du bist AND 07 Salvem el món AUT 07 Get a life - get alive AUT 11 The Secret Is Love ARMENÍA AUT 12 Woki Mit Deim Popo AUT 13 Shine ARM 07 Anytime you need AUT 14 Conchita Wurst- Rise Like a Phoenix ARM 08 Qele Qele AUT 15 I Am Yours ARM 09 Nor Par (Jan Jan) AUT 16 Loin d’Ici ARM 10 Apricot Stone ARM 11 Boom Boom ÁSTRALÍA ARM 13 Lonely Planet AUS 15 Tonight Again ARM 14 Aram Mp3- Not Alone AUS 16 Sound of Silence ARM 15 Face the Shadow ARM 16 LoveWave 2 Eurovision Karaoke BELGÍA UKI 10 That Sounds Good To Me UKI 11 I Can BEL 86 J'aime la vie UKI 12 Love Will Set You Free BEL 87 Soldiers of love UKI 13 Believe in Me BEL 89 Door de wind UKI 14 Molly- Children of the Universe BEL 98 Dis oui UKI 15 Still in Love with You BEL 06 Je t'adore UKI 16 You’re Not Alone BEL 12 Would You? BEL 15 Rhythm Inside BÚLGARÍA BEL 16 What’s the Pressure BUL 05 Lorraine BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA BUL 07 Water BUL 12 Love Unlimited BOS 99 Putnici BUL 13 Samo Shampioni BOS 06 Lejla BUL 16 If Love Was a Crime BOS 07 Rijeka bez imena BOS 08 D Pokušaj DUET VERSION DANMÖRK BOS 08 S Pokušaj BOS 11 Love In Rewind DEN 97 Stemmen i mit liv BOS 12 Korake Ti Znam DEN 00 Fly on the wings of love BOS 16 Ljubav Je DEN 06 Twist of love DEN 07 Drama queen BRETLAND DEN 10 New Tomorrow DEN 12 Should've Known Better UKI 83 I'm never giving up DEN 13 Only Teardrops UKI 96 Ooh aah.. -

1961 Et Ses Acteurs Peuvent Apparaître Comme Une Réplique De Ce Que La R.T.F
Lieu : Palais des Festivals de Cannes Orchestre de Franck Pourcel. ( France ). Présentation : Jacqueline Joubert. Date : Samedi 18 Mars. Réalisateur : Marcel Cravenne. Durée : 1h 35. La mise en scène du concours 1961 et ses acteurs peuvent apparaître comme une réplique de ce que la R.T.F. avait produit en 1959 : même salle, même film d’introduction, même orchestre, même présentateur et même réalisateur. Mais la France est en ce 18 Mars le premier pays à organiser pour la deuxième fois le concours Eurovision de la chanson. La scène a toutefois un aspect nouveau, les carrousels de 1959 ayant cédé la place à un escalier central entouré d’une terrasse. Après la présentation des chanteurs, Jacqueline Joubert souhaite le bonjour aux téléspectateurs dans leurs propres langues et n’utilisera plus que le français, à l’exception de quelques mots d’anglais pour les jurys qui lui donneront les votes dans cette langue. Nouveau record concernant le nombre de participants, ce sont 16 pays qui convoitent le titre, la Yougoslavie, l’Espagne et la Finlande se joignant aux pays déjà présents en 1960. La Belgique fait à nouveau confiance à son interprète de 1959, Bob Benny, tout comme en 1956, 1958 et 1960 ils avaient choisi Fud Leclerc. Le bilinguisme de ce pays ne semble pas lui avoir posé trop de problème puisque dès 1957 leurs chansons seront les années paires en Français, les années impaires en Flamand et ce jusqu’à ce qu’un système de relégation ne vienne gripper cette mécanique bien huilée, sans toutefois remettre en cause l’alternance.