Du Solidarisme Aux Communautes Europeennes. Le Concept De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

YEARBOOK of the INTERNATIONAL LAW COMMISSION 1957 Volume II Documents of the Ninth Session Including the Report of the Commission to the General Assembly
A/CN.4/SER.A/1957/Add.l YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION 1957 Volume II Documents of the ninth session including the report of the Commission to the General Assembly UNITED NAT.ONS YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION 1957 Volume II Documents of the ninth session including the report of the Commission to the General Assembly UNITED NATIONS New York, 1958 NOTE Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures. Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document. A/CN.4/SER.A/1957/Add.l September 1957 UNITED NATIONS PUBLICATION Sales No.: 1957. V. 5, Vol. II Price: $(U.S.) 1.75; 12/6 stg.; Sw.fr. 7.50 (or equivalent in other currencies) CONTENTS ARBITRAL PROCEDURE (agenda item 1) Page Document A/CN.4/109: Draft convention on arbitral procedure adopted by the Commission at its fifth session: report by Georges Scelle, Special Rapporteur (with a "model draft" on arbitral procedure annexed) 1 LAW OF TREATIES (agenda item 2) Document A/CN.4/107: Second report by G. G. Fitzmaurice, Special Rapporteur 16 CONSULAR INTERCOURSE AND IMMUNITIES (agenda item 4) Document A/CN.4/'108: Report by Jaroslav Zourek, Special Rapporteur .... 71 STATE RESPONSIBILITY (agenda item 5) Document A/CN.4/'106: International responsibility: Second report by F. V. Garcia Amador, Special Rapporteur 104 REPORT OF THE COMMISSION TO THE GENERAL ASSEMBLY Document A/3623: Report of the International Law Commission covering the work of its ninth session, 23 April-28 June 1957 131 LIST OF OTHER DOCUMENTS PERTAINING TO THE NINTH SESSION OF THE COMMISSION BUT NOT REPRODUCED IN THIS VOLUME 147 111 INTERNATIONAL LAW COMMISSION DOCUMENTS OF THE NINTH SESSION, INCLUDING THE REPORT OF THE COMMISSION TO THE GENERAL ASSEMBLY ARBITRAL PROCEDURE [Agenda item x] DOCUMENT A/CN.4/109 Draft convention on arbitral procedure adopted by the Commission at its fifth session Report by Georges Scelle, Special Rapporteur (with a "model draft" on arbitral procedure annexed) [Original text: French] [24 April 1957] Chapter Paragraphs Page I. -

Yearbook of the International Law Commission 1959 Volume II
YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION 1959 Volume II Documents of the eleventh session including the report of the Commission to the General Assembly UNITED NATIONS New York, 1 960 NOTE Symbols of United Nations documents are composed of capital letters com- bined with figures. Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document. A/CN.4/SER.A/ 1959/ADD. 1 UNITED NATIONS PUBLICATION Sales No.: 59. V. 1. Vol. II Price: $ U.S. 1.50 ; 10/6 stg.; Sw.fr. 6.50 (or equivalent in other currencies) u CONTENTS STATE RESPONSIBILITY (agenda item 4) Page Document A/CN.4/U9: International responsibility: Fourth report by F. V. Garcia Amador, Special Rapporteur 1 LAW OF TREATIES (agenda item 3) Document A/CN.41120 : Fourth report by Sir Gerald Fitzmaurice, Special Rapporteur 37 Document A/CN.4/121 : Practice of the United Nations Secretariat in relation to certain questions raised in connexion with the articles on the law of treaties : note by the Secretariat 82 CONSULAR INTERCOURSE AND IMMUNITIES (agenda item 2) Document A/CN.4/L.79: Proposals and comments submitted by Mr. Alfred Verdross regarding the draft provisional articles on consular intercourse and immunities (A/CN.4/108) 84 Document A/CN.4/L.82: Proposals and comments submitted by Mr. Georges Scelle regarding the draft provisional articles on consular intercourse and immunities (A/CN.4/108) 86 REPORT OF THE COMMISSION TO THE GENERAL ASSEMBLY Document A/4169: Report of the International Law Commission covering the work of its eleventh session, 20 April—26 June 1959 87 CHECK LIST OF COMMISSION DOCUMENTS REFERRED TO IN THIS VOLUME 124 111 INTERNATIONAL LAW COMMISSION DOCUMENTS OF THE ELEVENTH SESSION, INCLUDING THE REPORT OF THE COMMISSION TO THE GENERAL ASSEMBLY STATE RESPONSIBILITY [Agenda item 4] DOCUMENT A/CN.4/119 International responsibility. -

Dedoublement Fonctionnel) in International Law
Remarks on Scelle's Theory of "Role Splitting" (dedoublement fonctionnel) in International Law Antonio Cassese * It is the purpose of this paper to focus briefly on one of the main pillars of G. Scelle's contribution to the theory of international law, namely his construct of "role splitting" (^dedoublement fonctionner) in the international legal community. To this end, I shall first sketch out Scelle's view and then endeavour briefly to ap- praise it Finally, I shall raise the question of whether the doctrine is still vital today.1 Of the Board of Editors. On Scelle't doctrine of didoublemenl fonctionnel, see in particular the following works by him: Pric'u de droit des gens. Principes et systimatique CVol. I) (1932) 43, 54-56, 217; (VoL II) (1934) 10, 319, 450; (hereinafter Prfcis); 'La doctrine de L. Duguit et les fondements du droil des gens', in Archives de philosophic du droil el de sociologie juridique (1932) 98-99; 'Regies generates du droit de la paix', in 46 Recueil des cours de I'Acadimie de La Haye (1933) 356. (hereinafter: Regies gtnirales); 'Essai sur les sources formelles du droit international', in Recueil en I'honneur de F. Giny (Vol. El) (1934) 410; Thfiorie du gouvemement interna- tional', in Annuaire de Vlnstitut international de droit public (1935) 41-59; 'Theorie et pra- tique de la fonction executive en droit international', in 55 Recueil des cours de I'Acadimie de La Haye (1936) 91-106 (hereinafter. Thiorie et pratique); Manuel de droit international public (1948) 15-24, 799. (hereinafter Manueiy, 'Quelques reflexions sur l'abolition de la compe- tence de guerre', in Revue ginirale de droit international public (1954) 7-13 (hereinafter: 'Quelques reflexions'); 'Le phenomene juridique du dedoublement fonctionnel', in Rechtsfragen der Internationalen Organisation - Festschrift fur H. -

Custom in Present International Law
IlIIEUnEl lI ~il l tl. IEGO TO WAlIll'STlH. /</AUr;O I\'EGO r U 5ClurCU H DU U'UU DE ".OCU.' SI,:u.l ... !<I OK KAROl WOlfKE CU5'TOM IN PH ES ENT INTERNATIONAL LA IV WROCUW I9IN • PRACE WROCLAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO TRAVAUX DC LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTRES DE WROCLAW SERIA A. NR 101 KAROL WOLFKE CUSTOM IN PRESENT INTERNATIONAL LAW WROCLAW 1964 Redaktor tomu: Franciszek Longchamps Sekretarz redakcji: Anna KosiIiska Praca wydana na zle . olskiej Akademii Nauk ••~!"!'~ .ill'" A 'a \ ~~. \~ ,\.~ ~Mt~:, J ......." ~/ IIII 1111111 1180035289 PAd Zaldad Narodowy im. Ossollilskloh - Wydawniotwo. Wroolaw 1964 r. Wydanie I. Naldad 550+140 egz. ObjEltoS6 ark. wyd. 12,05, ark. druk. 11,63. Papier druk. sat. kl. Ill, 70 g, 61x86 (16). Oddano do sldadania 5 V 1964 r. Podpisano do drukn 17 IX 1964 r. Druk ukonozono we wrzesniu 1964 r. Wroolawska Drukarnia Naukowa. Nr zam. 146/64. Cena zl 36.- CONTENTS INTRODUCTION Object and Scope of the Study 9 Terminology. 11 CHAPTER ONE THE ELEMENTS OF INTERNATIONAL CUSTOM The Genesis of Subparagraph l(b) of Article 38 of the Statute of the Court. 20 Criticism of Subparagraph l(b) of Article 38 of the Statute of the Court. 26 The Elements of International Custom in the Decisions and Opinions of the Court 28 (a) The Elements of International Custom in the Process of Ascertaining Customary Rules . .. 29 (b) The Elements of International Custom in the Practice of Applying Rules Already Ascertained. .. 37 The Elements of International Custom in the Discussions of the United Nations International Law Commission 42 An Attempt at Interpretation of the Elements of International Custom . -
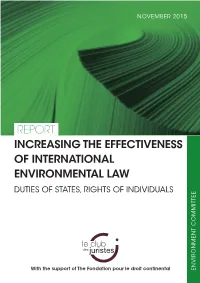
Report Increasing the Effectiveness Of
NOVEMBER 2015 REPORT INCREASING THE EFFECTIVENESS OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW DUTIES OF STATES, RIGHTS OF INDIVIDUALS With the support of The Fondation pour le droit continental ENVIRONMENT COMMITTEE INCREASING THE EFFECTIVENESS OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW DUTIES OF STATES, RIGHTS OF INDIVIDUALS REPORT FROM THE CLUB DES JURISTES Environment Committee NOVEMBER 2015 With the support of: Registered association - 4, rue de la Planche 75007 Paris - France Phone : +33 (0)1 53 63 40 04 - Fax : +33 (0)1 53 63 40 08 www.leclubdesjuristes.com © Getty Images Members of the Environment Committee of The Club des Juristes President: Yann AGUILA, Member of the Paris Bar Association, Bredin Prat Members: Pauline ABADIE, Senior lecturer at Paris-XI Sud University Alexandre FARO, Member of the Paris Bar Association, Faro & Gozlan Delphine HEDARY, Member of the Conseil d’État Christian HUGLO, Member of the Paris Bar Association, Huglo Lepage & Associates law firm Yann KERBRAT, Professor at the School of Law of Paris I Panthéon-Sorbonne University Pascale KROMAREK, Member of the Environmental Law Committee, MEDEF Gilles J. MARTIN, Professor emeritus at the University of Nice Sophia-Antipolis, Associate professor at Sciences Po Françoise NESI, Ordinary judge of the Cour de cassation, criminal division Laurent NEYRET, Professor at the University of Saint-Quentin-en-Yvelines Yvan RAZAFINDRATANDRA, Member of the Paris Bar Association Vincent REBEYROL, Professor of law at the EM Lyon Business School, Barrister Patricia SAVIN, Member of the Paris -

Treaties As a Source of General Rules of International Law Anthony D'amato Northwestern University School of Law, [email protected]
Northwestern University School of Law Northwestern University School of Law Scholarly Commons Faculty Working Papers 1962 Treaties As a Source of General Rules of International Law Anthony D'Amato Northwestern University School of Law, [email protected] Repository Citation D'Amato, Anthony, "Treaties As a Source of General Rules of International Law" (1962). Faculty Working Papers. Paper 120. http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/facultyworkingpapers/120 This Article is brought to you for free and open access by Northwestern University School of Law Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Faculty Working Papers by an authorized administrator of Northwestern University School of Law Scholarly Commons. Treaties As a Source of General Rules of International Law,* by Anthony D’Amato, 3 Harvard International Law Journal 1-43 (1962) Abstract: Attempts a theoretical explanation of the power of treaties to extend their rules to nations not parties to them—to rationalize, in a nonpejorative use of that term, the Court=s citation of the Bancroft treaties in Nottebohm and its use of treaty provisions in other cases—and to provide a basis for the continued use of the contents of treaties in assessing the requirements of international law. Thus this paper is basically argumentative—it attempts to state what the law ought to be by demonstrating that the law as it is logically compels the adoption of the present thesis. Tags: Treaties, International Law, Bancroft Treaties, Nottebohm Case, Asylum Case, Lotus Case [pg1]** I. INTRODUCTION In 1955 the International Court of Justice rendered its highly significant decision in the Nottebohm case. -

YEARBOOK of the INTERNATIONAL LAW COMMISSION 1952 Volume II Documents of the Fourth Session Including the Report of the Commission to the General Assembly
YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION 1952 Volume II Documents of the fourth session including the report of the Commission to the General Assembly UN.TED NATIONS^ YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION 1952 Volume II Documents of the fourth session including the report of the Commission to the General Assembly UNITED NATIONS New York, 1958 NOTE TO THE READER In accordance with General Assembly resolution 987 (X) of 3 December 1955, the documents reproduced in the present volume are printed in their original languages; translations of the same documents are available only in mimeographed form. However, the Report of the Commission is also issued as a Supplement to the Official Records of the General Assembly in the five official languages of the Organization. A/CN.4/SER.A/1952/Add.l UNITED NATIONS PUBLICATION Sales No.: 58. V. 5, Vol. II Price : $U.S. 0.70 ; 5/- stg.; 3.00 Sw. fr. (or equivalent in other currencies) TABLE OF CONTENTS Page ARBITRAL PROCEDURE Document A/CN.4/57 : Note complementaire par M. Georges Scelle, rapporteur special 1 NATIONALITY, INCLUDING STATELESSNESS Document A/CN.4/50: Report by Mr. Manley O. Hudson, Special Rapporteur 3 REGIME OF THE TERRITORIAL SEA Document A/CN.4/53 : Rapport de M. J. P. A. Franc,ois, rapporteur special 25 REGIME OF THE HIGH SEAS Document A/CN.4/51: Rapport de M. J. P. A. Francois, rapporteur special 44 LAW OF TREATIES Document AJCN.4/54 : Report by Mr. J. L. Brierly, Special Rapporteur. 50 REPORT OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION TO THE GENERAL ASSEMBLY Document A/2163: Report of the International Law Commission covering the work of its fourth session, 4 June - 8 August 1952 57 LIST OF OTHER DOCUMENTS RELATING TO THE WORK OF THE FOURTH SESSION OF THE COMMISSION NOT REPRODUCED IN THIS VOLUME 71 ill ARBITRAL PROCEDURE DOCUMENT A/CN.4/57 Note complémentaire du deuxième rapport par Georges Scelle, rapporteur spécial [Texte original en français] [6 juin 1952] 1. -

Une Contribution De 90 Ans Du Tribunal Administratif De L'organisation Internationale Du Travail À
NE U CONTRIBUTION DE du Tribunal administratif 90 ANS de l’Organisation internationale du Travail à la création d’un droit de la fonction publique internationale 90 YEARS OF CONTRIBUTION of the Administrative Tribunal of the International Labour Organization to the creation of international civil service law ILO Edited by: Dražen Petrović Administrative TRIBUNAL administratif de l’OIT 35 00 - 3894 3000 - 3500 3000 - 3500 Une contribution de 90 ans du TAOIT / 90 years of contribution of the ILOAT 2500 - 3000 2000 - 2600 1500 - 2500 500 - 1000 11- 500 UNE CONTRIBUTION DE 90 ANS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL À LA CRÉATION D’UN DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 90 YEARS OF CONTRIBUTION OF THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION TO THE CREATION OF INTERNATIONAL CIVIL SERVICE LAW Copyright © International Labour Organization 2017 First published 2017 Première édition 2017 Publications of the International Labour Office enjoy copyright under Protocol 2 of the Universal Copyright Convention. Nevertheless, short excerpts from them may be reproduced without authorization, on condition that the source is indicated. For rights of reproduction or translation, application should be made to ILO Publications (Rights and Licensing), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: [email protected]. The International Labour Office welcomes such applications. Libraries, institutions and other users registered with a reproduction rights organization may make copies in accordance with the licences issued to them for this purpose. Visit www.ifrro.org to find the reproduction rights organization in your country. 90 years of contribution of the Administrative Tribunal of the International Labour Organization to the creation of international civil service law - Geneva, ILO, 2017 Une contribution de 90 ans du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail à la création d’un droit de la fonction publique internationales. -

Georges Scelle (1878 - 1961) Biographical Note with Bibliography
Georges Scelle (1878 - 1961) Biographical note with bibliography edited by Antonio Tanca * Georges Scelle was bom in Avranches (Manche) on 19 March 1878. After excelling at his local school, he attended the Law Faculty and the "Ecole libre des Sciences Politiques" in Paris, where he was awarded a prize for his thesis, "La traite n6griere aux Indes de Castille", written under the supervision of A. Pillet. After two years at the University of Sofia (1908-10), he lectured at the Law Faculties of Dijon (1910-11) and Lille (1911-12). In 1912 he passed the agrigation and was ap- pointed to the Law Faculty of Dijon, where he remained for 20 years. In Dijon he taught Public International Law and Industrial Relations Law. Mobilized on 3 August 1914, he was promoted to lieutenant and then posted at the headquarters of the 8th army as a legal expert (1917). At the end of the war he resumed his work in Dijon. For a few months (June 1924 - July 1925) he acted as head of department at the Min- istry of Labour and played a decisive role in the drafting of the 16 January 192S decree which established the Economic Council. The proposal for his appointment in 1925 as a professor at the Paris Law Faculty was one of the reasons for a strike by right-wing stu- dents. A heated general debate followed at the Senate, where the Government was de- feated; as a consequence the Herriot cabinet resigned. From 1929 to 1932 he taught Pub- lic International Law both in Geneva and in Dijon. -

YEARBOOK of the INTERNATIONAL LAW COMMISSION 1958 Volume II Documents of the Tenth Session Including the Report of the Commission to the General Assembly
YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION 1958 Volume II Documents of the tenth session including the report of the Commission to the General Assembly UNITED NATIONS YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION 1 Volume II Documents of the tenth session including the report of the Commission to the General Assembly UNITED NATIONS New York, 1958 NOTE Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures. Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document. A/CN.4/SER.A/1958/Add.l UNITED NATIONS PUBLICATION Sales No.: 58. V. 1, Vol. II Price: $U.S. 1.50; 11/- stg.; Sw. fr. 6.50 (or equivalent in other currencies) CONTENTS Page ARBITRAL PROCEDURE (agenda item 2) Document A/CNA/113: Draft on arbitral procedure adopted by the Com- mission at its fifth session: report by Georges Scelle, Special Rapporteur (with a model draft on arbitral procedure annexed) 1 DIPLOMATIC INTERCOURSE AND IMMUNITIES (agenda item 3) Documents A/CN.4/116/Add.l and 2: Draft articles concerning diplomatic intercourse and immunities: Articles proposed by A. E. F. Sandstrom, Special Rapporteur 16 LAW OF TREATIES (agenda item 4) Document A/CN A/115: Third report by G. G. Fitzmaurice, Special Rap- porteur 20 STATE RESPONSIBILITY (agenda item 5) Document A/CN A/111: International responsibility: Third report by F. V. Garcia Amador, Special Rapporteur 47 PLANNING OF FUTURE WORK OF THE COMMISSION (agenda item 8) Document A/CNA/L.76: Comments and proposals submitted by Mr. Jaroslav Zourek 74 COMMUNICATION FROM THE SECRETARY-GENERAL Document A/CNA/L.74: Communication dated 2 May 1958 from the Sec- retary-General of the United Nations to the Chairman of the International Law Commission 77 REPORT OF THE COMMISSION TO THE GENERAL ASSEMBLY Document A/3859: Report of the International Law Commission covering the work of its tenth session, 28 April-4 July 1958 78 CHECK LIST OF COMMISSION DOCUMENTS REFERRED TO IN THIS VOLUME. -

Georges Scelle
The European Tradition in International Law: Georges Scelle The Thought of Georges Scelle Hubert Thierry* There are several key reasons why the thought of Georges Scelle has always pro- voked and continues to provoke interest The first of these reasons, and an obvious one, is that Georges Scelle was a great jurist, which is evidenced by both the range and reputation of his work and the influ- ence which he exerted on the community of French international legal scholars. The thought of Scelle was so influential that, for a time, the concept of sovereignty was all but banished from the research and teaching of the international law faculties of French universities. Knowledge of Scelle's works is still an integral part of legal culture and while it is true that several authors have now adopted voluntarist theories very much opposed to the thought of Scelle, their position is at least in part a reac- tion to Scelle's thought, which is used as a straw man and is thus found in their work. A second reason for the interest in the work of Scelle is its alluring nature from which, it seems, few readers are immune. This allure is rooted principally in the unity of elaborated and logically ordered work, with its view of the whole field of law, including not only international law, but also any legal phenomena. The Scel- lian concept of international law is derived from this vision. A single thread runs through all aspects of Scellian thought, linking them together. When Scelle tackled the burning legal questions of his day - whether they dealt with governing minori- ties, a subject which he addressed in 1919, or with the mandates of the League of Na- tions, or with the continental shelf, to which he devoted a study in 1955l - his Professor at the University of Paris X-Nanterre.