Bourg-De-Sirod
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 39 JURA INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 39 - JURA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 39-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 39-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 39-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 39-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -

1. Presentation Du Schema Departemental Des Carrieres Du Jura
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie Secrétariat d'Etat à l'Industrie RIRE FRANCHE-COMTÉ UNICEM Bourgogne PREFECTURE DU JURA Franche-Comte Schéma départemental des carrières du département du Jura Rapport de synthèse Etude réalisée dans le cadre des actions de Service public du BRGM 9S-G-043 octobre 1997 R 39052 BRGM itHiMram A« Mtmu M U> IUM Schéma départemental des carrières du Jura Mots clés : matériaux, carrières, granuláis, ressources, besoins, exploitation, environnement, département du Jura (France). En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : (1996) - Schéma départemental des carrières du département du Jura - Rapport de synthèse. Rapport BRGM R 39052, 105 p., 7 fig., 10 ann., 4 planches hors texte. © BRGM, 1996, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l'autorisation expresse du BRGM. Rapporf BRGM R 39052 Schéma départemental des carrières du Jura Synthèse Le schéma départemental des carrières du Jura, décidé en Commission des Carrières, a été réalisé conformément au décret du Ministère de l'Environnement n° 94-603 du 11 juillet 1994 qui fixe le contenu du document, ainsi que les modalités de son élaboration, de sa diffusion et de sa mise à jour ultérieure. L'élaboration du schéma a bénéficié d'une large concertation grâce à la création d'un groupe de travail piloté par la DRIRE et assisté par le BRGM en qualité de chargé de mission, réunissant divers organismes et administrations qui ont apporté leur concours. Le schéma des carrières du Jura concerne principalement les granulats qui, en tonnage, représentent environ 80% de la totalité des matériaux extraits dans le département. -

Journal De Crotenay 2016
Les Voies du Sel 2015 Départ de Crotenay (Août 2015) Photos : Nicolas Germain, Corentin et Jean-Pierre Chauville Bernard Plantard Éditorial Sommaire 3 - Éditorial 4 - Le mot du Maire ’est toujours avec grand plaisir que nous 5 - Infos diverses - Collectes déchets vous proposons une nouvelle édition du jour- 6 - Merci à Guy - Fleurissement Cnal de CROTENAY. Une fois encore, l’équipe 7 - Travaux à la salle des fêtes de bénévoles n’a pas ménagé ses efforts pour réaliser 8 - Point financier un support d’une grande qualité qui rend compte de la 9 - Etat civil 2015 vie de notre village, du dynamisme de ses associations, 10 - Une année à l’école primaire et des histoires des uns et des autres. 14 - Bibliothèque municipale 15 - Garderie - Cantine A l’heure où l’information va de plus en plus vite, 16 - Fête du village - 11 novembre 2015 sur des supports souvent dématérialisés et dans un en- 17 - Nettoyage de la forêt vironnement en perpétuelle évolution, avec une grande 18 - EREA La Moraine 19 - L’exposition-photos région, des intercommunalités aux contours fluctuants, 20 - Repas des ainés des fusions de communes... il est important de garder 21 - Halloween à Crotenay certains repères et de pouvoir témoigner des actions ré- 22 - Du côté des associations alisées par les diverses sociétés, associations qui ani- 23 - Calendrier des manifestations 2016 ment notre village, qui rythment le calendrier par leurs 24 - La société de musique manifestations et qui œuvrent pour le «vivre ensemble». - Le Club du «Montsaugeon» Comme à l’accoutumé, vous retrouverez les rubriques 25 - Société de pêche consacrées au mot du Maire, à l’état civil, et bien sûr, - Foyer Rural de Crotenay vos libres expressions et témoignages sur des événe- 26 - Association «L’Annie Bis» ments qui vous ont marqués. -

Sapois a Des Titres Aussi À Faire Valoir Pour Prouver Son Ancienneté
APOIS (39) S Extrait du Dictionnaire GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE et STATISTIQUE Des communes de la Franche-Comté De A. ROUSSET Tome V (1854) Sappois, village de l’arrondissement de Poligny ; canton, perception et bureau de poste de Cbampagnole ; à 3 km de Champagnole, 29 d’Arbois et 37 de Lons-le-Saunier. Altitude : 626 m. Le territoire est limité au nord par Équevillon, au sud par Champagnole et le Bourg-de-Sirod, à l’est par Mournans, Sirod et le Bourg-de-Sirod, à l’ouest par le bief de Malhus qui le sépare d'Équevillon et par Champagnole. Il est traversé par les chemins vicinaux tirant à Champagnole et à Bourg-de-Sirod ; par le chemin de la Vachette ; par les biefs de Fenu et de l’Etang. Le village est situé sur un petit plateau près du pied sud-est du mont Rivel. Les maisons, ombragées par des massifs d’arbres, sont peu isolées, mal bâties en pierre et couvertes en tavaillons, sauf quelques-unes qui ont leurs toitures en tuiles. Population : en 1790, 134 habitants ; en 1846, 180 ; en 1851, 177, dont 83 hommes et 92 femmes ; population spécifique par km carré, 49 habitants ;31 maisons ; 38 ménages. État civil : Les plus anciens registres de l'état civil datent de 1793. Vocable : saint Cyr et sainte Julie. Paroisse de Champagnole. Série communale à la mairie depuis 1793. La série du Greffe, déposée aux Archives Départementales, a reçu les cotes 3 E 2297, E 6942 à 6946, 3 E 3892, 3 E 8624, 3 E 9573 à 9575 et 3 E 13754. -

Assainissement Rapport Annuel Délégataire SYNTHESE
SYNTHÈSE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 Service public d’assainissement de Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura Le rappel du cadre de la délégation o Périmètre du service : ANDELOT EN MONTAGNE, ARDON, BIEF DU FOURG, BOURG DE SIROD, CENSEAU, CERNIEBAUD, CHAMPAGNOLE, CHAPOIS, CHARENCY, CHAUX DES CROTENAY, CIZE, CRANS, CROTENAY, CUVIER, DOYE, EQUEVILLON, FONCINE LE BAS, FONCINE LE HAUT, FRAROZ, GILLOIS, LA LATETTE, LE LARDERET, LE MOUTOUX, LE PASQUIER, LE VAUDIOUX, LENT, LOULLE, MIGNOVILLARD, MONNET LA VILLE, MONT SUR MONNET, MONTIGNY SUR L'AIN, MONTROND, MOURNANS CHARBONNY, NEY, NOZEROY, ONGLIERES, PILLEMOINE, PONT DU NAVOY, RIX TREBIEF, SAINT GERMAIN EN MONTAGNE, SAPOIS, SIROD, SUPT, SYAM, VALEMPOULIERES, VANNOZ, VERS EN MONTAGNE o Liste des avenants : Avenant N° Date d'effet Commentaire 4 01/01/2020 Intégration Saffloz, Marigny, Le Frasnois 3 01/01/2018 Intégration des ex-communes de la CC Nozeroy. 2 01/10/2015 Intégration nouveaux ouvrages et équipements 1 24/04/2012 Intégration nouveaux ouvrages Installations de dépollution Nombre de postes de 35 Réseau Déversoirs d’orage refoulement (hors pluvial) Capacité 38 648 éq. Hab. 34 251 km 84 Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura – 2019 2 CHIFFRES CLÉ DU SERVICE Assiette de la redevance Taux de conformité des rejets des stations d’épuration Habitants desservis 838 036 m3 (-0,8%) 21 553 92,4% 72 % en 2018 Volume traité par les stations d’épuration (A3) Taux d’évacuation des boues Abonnés suivant une filière conforme 9 655 (+0,7%) 2 126 513 m3 100% Communauté de Communes Champagnole -

33E Tour Des Commères Près De 400 Coureurs Au Rendez-Vous
ÉDITION NUMÉRIQUE Lundi 29 octobre 2018 - Supplément - Jura 33e Tour des Commères Près de 400 coureurs au rendez-vous ■ Malgré le froid, les coureurs étaient au rendez-vous à Sirod. 147 athlètes étaient au départ du 25 km. Photo Philippe TRIAS PAGES 2-6 LE PROGRÈS LUNDI 29 OCTOBRE 2018 02 SPORTS JURA ET RÉGION ■ Josselin Aberlenc remporte le trail de la 33 édition du Tour des Commères en 1’56’’. Photo Philippe TRIAS HORS STADE 33 E TOUR DES COMMÈRES Josselin Aberlenc sort du bois Pour sa première partici- indien dans le Jura, la 33e Une dizaine de secondes test. Et il est réussi », souf- RÉSULTATS pation au trail, Josselin édition du Tour des Commè- d’avance pour Bourgeois flait le vainqueur du jour, qui Aberlenc s’est adjugé la res n’a pas échappé, comme aux Pertes de l’Ain signe un temps en dessous TRAIL 25 KMS souvent, au froid. C’est d’ailleurs le solide des deux heures (1h56’). Un > Classement masculin victoire grâce à une tacti- membre de la Team Spartan résultat qui le motive à parti- que efficacement menée. Un quatuor Race qui mène les débats, ciper au Jura Trail’Tour l’an- 1. Josselin Aberlenc en pour mener comptant jusqu’à une dizai- née prochaine. 1h56’34’’ ; 2. Ivan Bour- e monde appartient à les débats ne de secondes d’avance aux Derrière, Ivan Bourgeois ap- geois (Lons Athlé 39) en Lceux qui se lèvent tôt, pa- Pertes de l’Ain, avant la mon- plaudissait le joli coup joué 1h57’19’’ ; 3. Jean-Paul raît-il. -

Sirod En 1404
S IROD (39) Extrait du Dictionnaire GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE et STATISTIQUE Des communes de la Franche-Comté De A. ROUSSET Tome VI (1854) Situation : le village est situé sur la rive gauche d la rivière d’Ain, au fond d’un bassin très fertile qu’entoure un cirque de montagnes peu élevées, à travers lesquelles l’Ain s’est frayé un passage. Village de l’arrondissement de Poligny ; canton et perception et bureau de poste de Champagnole ; succursale dont dépendent Lent, Bourg-de-Sirod, Conte et Treffay; à 9 km de Champagnole, 31 km d’Arbois et 43 km de Lons-le-Saunier. Altitude 620 m. Il est traversé par les chemins vicinaux tirant à Crans, Treffay, Gillois, Conte, Charency, Lent, Champagnole, Nozeroy, Syam, et par le chemin de Trémont ; par la rivière d’Ain, les biefs des Cent- Tours et du Mouillet qui y prennent leurs sources, les biefs de Préyat et des Chaux. Communes limitrophes : au nord Conte, Charency et Lent ; au sud Syam, Crans et les Chalesmes ; à l’est Conte, Gillois, Treffay et les Chalesmes ; à l’ouest Lent et Bourg-de-Sirod. La Grange de la Chancelle, le moulin en ruines sur le bief de Préyat, la Scie, le Moulin, la Papeterie et la chapelle font partie de la commune. Les maisons sont groupée, bien bâties en pierres et couvertes en tavaillons ou ancelles, sauf quatre qui ont des toitures en tuiles. Population : en 1790 : 742 habitants ; en 1846, 834 ; en 1851, 833, dont 397 hommes et 436 femmes ; 73 maisons ; 213 ménages. En 2002 : 539 habitants, les « Sirotiers ». -

Des Forges De Syam (Jura)
«HISTOIRE de MEMOIRE TECHNIQUE» Le savoir-faire des lamineurs des Forges de Syam (Jura) Richard LIOGER Laboratoire de Sociologie Anthropologie Faculté des Lettres - Besançon U.R.A. 1161 du C.N.R.S. Directeurs scientifíques : Bertrand HELL Claude ROYER Mission du Patrimoine Ethnologique 1988 SOMMAIRE Avant-propos 1 . Aspects généraux de l'étude 7 } Notes 13 2 . Les forges de Syam. Présentation 15 Notes 31 3 . Le chauffeur. Aspects d'un savoir-faire disparu de la petite métallurgie 32 Notes 45 4 . La technique du petit laminage des Forges de Syam 47 Notes 58 * Aspects sociaux du travail au laminoir des Forges de Syam 59 Notes 64 * Etre lamineur : de l'apprenti au chef lamineur 65 Notes 69 * L'équipe de laminage : historique 70 Notes 77 * La succession des chefs lamineurs 79 Notes 89 5 . La question du «savoir-faire» aux Forges de Syam 90 Notes 99 Glossaire 100 Bibliographie 105 Avant-propos Pourquoi les Forges de Syam et pourquoi cette question des «savoir-faire» ? Cet appel d'offre de la Mission du Patrimoine Ethnologique sur les savoir-faire en voie de disparition, conduisit rapidement les ethnologues franc-comtois à choisir le site des Forges de Syam (1). Ces forges, toujours en activité, comprennent un train de laminoir et plusieurs bancs d'étirage. Elles avaient déjà fait l'objet d'une étude d'histoire sociale (2) et elles sont dans un état technologique qui, au moins en apparence, rappelle plus une usine du 19e siècle qu'une merveille de la technologie modeme. On pouvait légitimement donc se poser le problème du maintien d'une technique de laminage, courante dans l'ensemble de la France métallurgique de la fin du 19e, et ainsi ranger les Forges de Syam au rang d'un des demiers dinosaures de la petite métallurgie (3). -

Publication D'une Demande D'autorisation D'exploiter
PREFET DU JURA Lons-le-Saunier, le 18 février 2020 direction départementale des territoires Jura service économie agricole PUBLICATION D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE SURFACE AGRICOLE En application des articles R331-4 et D 331-4 du code rural et de la pêche maritime DEMANDEUR : Monsieur PONCET Ludovic DESCRIPTION DU PROJET : Entrée de M. PONCET Ludovic au sein du GAEC CHATEAU- VILAIN sans capacité professionnelle IDENTIFICATION DES BIENS : Commune de BOURG-DE-SIROD Réf. Cadastrale Surface Propriétaires U 313 1 ha 41 a 20 ca M. DOMMAGE François U 617 4 ha 84 a 02 ca M. DOMMAGE François U 620 0 ha 00 a 14 ca M. DOMMAGE François U 332 0 ha 54 a 75 ca M. DOMMAGE François horaires d’ouverture : U 087 0 ha 29 a 35 ca GAEC CHATEAU-VILAIN 9h00 – 11h45 13h45 – 16h30 U 536 0 ha 81 a 92 ca GAEC CHATEAU-VILAIN U 566 0 ha 01 a 81 ca GAEC CHATEAU-VILAIN U 665 0 ha 36 a 21 ca GAEC CHATEAU-VILAIN 4, rue du Curé Marion BP 50356 39015 Lons-le-Saunier Cedex téléphone : 03 84 86 80 00 télécopie : 03 84 86 80 10 courriel : [email protected] Commune de BOURG-DE-SIROD (suite) Réf. Cadastrale Surface Propriétaires U 068 0 ha 22 a 70 ca GAEC CHATEAU-VILAIN U 162 0 ha 72 a 20 ca GAEC CHATEAU-VILAIN U 567 0 ha 36 a 19 ca GAEC CHATEAU-VILAIN U 062 0 ha 13 a 85 a GAEC CHATEAU-VILAIN U 549 0 ha 10 a 00 ca GAEC CHATEAU-VILAIN U 553 0 ha 73 a 00 ca GAEC CHATEAU-VILAIN U 021 0 ha 23 a 50 ca GAEC CHATEAU-VILAIN U 022 0 ha 34 a 25 ca GAEC CHATEAU-VILAIN U 086 0 ha 44 a 85 ca GAEC CHATEAU-VILAIN U 110 0 ha 30 a 50 ca M. -
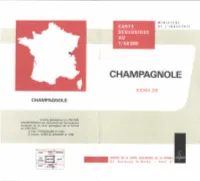
Notice Explicative
NOTICE EXPLICATIVE INTRODUCTION Deux régions naturelles du Jura central existent sur la feuille de Champagnole. Ce sont la zone des plateaux au Nord-Ouest et le Haut-Jura au Sud-Est. La zone des plateaux est largement représentée et comprend deux régions distinctes : les plateaux de Lons-le-Saunier — Champagnole (d'altitude moyenne 500 à 600 m envi ron) et de Châtelneuf — Nozeroy (d'altitude moyenne 750 à 800 m environ). Une partie du plateau de Lons-le-Saunier existe dans l'angle nord-ouest de la feuille. Elle est séparée du plateau de Champagnole par la chaîne de la forêt de l'Heute dont le relief souvent vigoureux est bien visible dans la morphologie. La vallée de l'Ain qui entaille le plateau de Champagnole depuis les Forges de Syam limite, sensiblement, vers le Nord le plateau de Châtelneuf. La butte du Mont Rivel forme, au nord de Champagnole, un témoin correspondant à ce plateau dont les bordures ouest et nord sont parfois profondément découpées par l'érosion (lacs de Chambly et de Chalain, Ferme de Balerne, Ney...). Le plateau de Nozeroy forme la partie nord-orientale de la feuille. Il est séparé des plateaux de Châtelneuf et de Champagnole par la chaîne du faisceau de Syam. Les reliefs parfois jeunes de cette chaîne sont orientés Nord-Sud. Au Sud cependant, ce faisceau, entaillé par les gouttières où sont logés les lacs de la région de Narlay, vient former la limite entre le plateau de Châtelneuf et le Haut-Jura. Le Haut-Jura n'est représenté que par les montagnes de la Haute-Joux et du Mont- Noir qui encadrent la grande dépression de Foncine. -

Projet D'arrêté Cadre Interdépartemental BFC 2021
PRÉFET DE LA COTE-D’OR PRÉFET DU DOUBS PRÉFET DU JURA PRÉFET DE LA NIÈVRE PRÉFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE PRÉFET DE LA HAUTE- SAÔNE PRÉFET DE L’YONNE PRÉFET DU TERRITOIRE-DE-BELFORT Liberté Égalité Fraternité Arrêté cadre interdépartemental n°2021 zzz-yyy relatif à la mise en place des principes communs de vigilance et de gestion de la ressource en eau en période d’étiage en BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE VU la Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.211-3 à L.213.3, L.214-7, L.214-18, L.215-1 à L.215-13, L.214-7, L.214-18, L.215-1 à L.215-13, R.211-66 à R.211-70 et R214-1 à R.214-56 ; VU le code du domaine public fluvial et notamment les articles 25, 33 et 35 ; VU le code civil et notamment les articles 640 et 645 ; VU le code de la santé publique et notamment les articles R.1321-1 à R.1321-66 ; VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l’article L.2212-5 et l’article L.2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant de l’État dans un département en matière de police ; VU le décret n°2010-0146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; VU la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse ; VU les SDAGE Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie en vigueur ; VU l’arrêté n° 2015103-0014 du 13 avril 2014 -

Jura Schéma Régional Eolien | Liste Des Communes Du Jura
Schéma Régional Éolien | Liste des communes du Jura Schéma Régional Eolien | Liste des communes du Jura Abergement-la-Ronce Les Chalesmes Crans Ivrey Montholier Pupillin Trenal Abergement-le-Grand Chambéria Crenans Jeurre Montigny-lès-Arsures Quintigny Uxelles Abergement-le-Petit Chamblay Cressia Jouhe Montigny-sur-l'Ain Rahon Vadans Abergement-lès-Thésy Chamole Crissey Lac-des-Rouges-Truites Montmarlon Rainans Val-d'Épy Aiglepierre Champagne-sur-Loue Crotenay Ladoye-sur-Seille Montmirey-la-Ville Ranchot Valempoulières Alièze Champagney Les Crozets Lains Montmirey-le-Château Rans Valfin-sur-Valouse Amange Champagnole Cuisia Lajoux Montmorot Ravilloles Vannoz Andelot-en-Montagne Champdivers Cuttura Lamoura Montrevel Recanoz Varessia Andelot-Morval Champrougier Cuvier Le Larderet Montrond Reithouse Le Vaudioux Annoire Champvans Dammartin-Marpain Largillay-Marsonnay Mont-sous-Vaudrey Relans Vaudrey Arbois Chancia Damparis Larnaud Mont-sur-Monnet Les Repôts Vaux-lès-Saint-Claude Archelange La Chapelle-sur-Furieuse Dampierre Larrivoire Morbier Revigny Vaux-sur-Poligny Ardon Chapelle-Voland Darbonnay Le Latet Morez Rix Vercia Aresches Chapois Denezières La Latette Mouchard La Rixouse Verges Arinthod Charchilla Le Deschaux Lavancia-Epercy La Mouille Rochefort-sur-Nenon Véria Arlay Charcier Desnes Lavangeot Mournans-Charbonny Rogna Vernantois Aromas Charency Dessia Lavans-lès-Dole Les Moussières Romain Le Vernois Arsure-Arsurette Charézier Les Deux-Fays Lavans-lès-Saint-Claude Moutonne Romange Vers-en-Montagne Les Arsures La Charme Digna Lavans-sur-Valouse