Diagnostic Archéologique Saint-Vincent-Sur-Oust (56)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mise En Page 1 26/11/2020 12:40 Page1
MAURY LIGNE 10 PRINTEMPS 2021.qxp_Mise en page 1 26/11/2020 12:40 Page1 LIGNE PRATIQUE LIGNE EN SAVOIR PLUS 10 10 Le réseau de transport de la Région Bretagne Calendrier de circulation (ne circule pas les dimanches et jours fériés) Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet S 19 V 1 L 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J 1 D 20 S 2 M 2 M 2 V 2 D 2 M 2 V 2 L 21 D 3 M 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S 3 M 22 L 4 J 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D 4 LIGNE M 23 M 5 V 5 V 5 L 5 M 5 S 5 L 5 J 24 M 6 S 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6 V 25 J 7 D 7 D 7 M 7 V 7 L 7 10 S 26 V 8 L 8 L 8 J 8 S 8 M 8 D 27 S 9 M 9 M 9 V 9 D 9 M 9 Pour une information en situation perturbée L 28 D 10 M 10 M 10 S 10 L 10 J 10 M 29 L 11 J 11 J 11 D 11 M 11 V 11 (retards, incidents, grèves, intempéries...) M 30 M 12 V 12 V 12 L 12 M 12 S 12 contactez directement le transporteur : PAYS DE REDON J 31 M 13 S 13 S 13 M 13 J 13 D 13 MAURY TRANSPORTS J 14 D 14 D 14 M 14 V 14 L 14 V 15 L 15 L 15 J 15 S 15 M 15 Saint-Roch - 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE S 16 M 16 M 16 V 16 D 16 M 16 T. -

Saint-Perreux Juillet 2019
Saint -Perreux Juillet 2019 Mairie - 1 rue de la Mairie - 56350 Saint-Perreux Tél. : 02 99 71 19 81 - Fax : 02 99 72 17 94 - [email protected] - www.saint-perreux.fr Horaires d’ouverture : Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 8h30/12h-15h/17h30 - Mercredi : 8h30-12h Fermé le Samedi Informations municipales Edito Evènement majeur cet été sur notre territoire… La commune de Saint-Perreux et l’association les marsouins (dont le but est de faire connaitre le syndrome de Prader Willy), auront le plaisir d’accueillir l’AVA France (Association des véhicules Amphibies de France) du 27 Juillet au 2 Août 2019. A l’occasion du plus grand rassemblement mondial de véhicules amphibies, ce n’est pas moins de 12 nations internationales, ce qui représente 80 équipages attendus au camp de base dans notre petite commune Morbihannaise, soit environ 250 personnes. De nombreuses communes du territoire de Redon seront impactées par cet évènement. La presse et la télévision régionales, nationales et internationales feront l’écho d’une manifestation inédite en France. Pour mémoire en 2010 c’est plus de 100 000 personnes qui ont suivi les véhicules sur nos trois départements. Une semaine festive inter-associations est organisée afin d’accueillir nos hôtes (Soirées musicales, danses, sosie, repas et en clôture un feu d’artifice). Pérusiennes, Pérusiens, vous êtes tous invités à participer à ce temps fort de notre commune. Vive Saint-Perreux ! Evénements communaux : Lionel Jouneau Maire de Saint-Perreux 12 juillet : P’tite causerie pour les aînés à la cale -

Direction Des Services Départementaux De L'éducation
Ste-Brigitte St-Aignan Gourin Langonnet Plouray Roudouallec Silfiac Kergrist Cléguérec Croixanvec Le Saint Langoëlan St-Gonnery St-Tugdual Ploerdut Séglien Neuillac St-Gérand Ménéac Le Gueltas Brignac Faouët Le Croisty Guémené/Scorff Rohan Guiscriff Priziac Pontivy La Trinité Porhoët Locmalo Evriguet St-Brieuc St-Caradec Malguénac Noyal-Pontivy de Mauron St-Léry Trégomel Lignol Bréhan Guern Le Sourn Kerfourn Mohon Mauron Lanvénégen Kernascléden Persquen Crédin Guilliers Concoret Meslan St Thuriau Les Forges Bieuzy Berné St-Malo des Les Eaux Naizin Trois Fontaines Néant/Yvel Bubry Moustoir Pleugriffet La Grée Melrand Réguiny St-Laurent Inguiniel Remungol Lannoué Tréhorenteuc Pluméliau Loyat La Croix Hélléan Plouay Radenac Hélléan Lantillac Taupont St-Barthélèmy Josselin Campénéac Beignon Moréac St-Malo de Beignon Lanvaudan Quistinic Remungol Guégon Buléon Guillac Gourhel Calan Guénin St-Allouestre St-Servant Cléguer Baud Plumelin Guéhenno Ploërmel Augan Porcaro Pont- sur Oust Locminé Bignan Montertelot Guer Scorff Inzinzac Quily La Chapelle Neuve Billio Cruguel Monterrein Languidic Le Roc La Chapelle Lizio St-AndréCaro Monteneuf Caudan Camors Moustoir-Ac Caro Gestel Hennebont St-Jean Réminiac Guidel St-Abraham Brandérion Brévelay Quéven Colpo Plumelec Sérent St-Marcel Missiriac Ruffiac Tréal Quelneuc Lanester Brandivy Malestroit Carentoir Kervignac Pluvigner Lorient Nostang Landévant GrandchampLocqueltas St-Laurent Plaudren Trédion Bohal sur Oust St-Nicolas Ploëmeur Merlevenez St-Guyomard St-Congard du Tertre La Chapelle Locmiquélic Landaul -
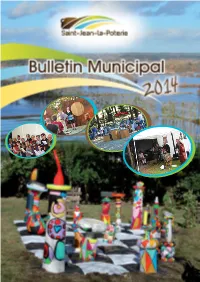
Ouverture D'un Nouveau Multi-Accueil À Allaire
2 3 Vœux du Maire Vœux du Maire p.3 Rythmes scolaires et Bibliothèque p.14 Vie Municipale p.6 CME p.15 Madame la Conseillère Régionale qui s’impose. 2013 aura été une année de mise en œuvre de plusieurs Quelques travaux p.8 Vie scolaire p.16 Mesdames, Messieurs les élus dossiers qui avaient vu projet s’inscrire dans le vade-me- CTMA p.9 Vie associative p.18 Mlles, MM les membres du CME Mmes, MM les représentants cum pour St-Jean-la-Poterie: « St-Jean 2020 ». Pact HD 56 p.10 Tarifs de location des salles p.25 du monde associatif Ces chantiers, nous aimerions tous les voir finis en Environnement et CCPR Liste des artisans et commerçants p.26 p.11 Mesdames, Messieurs, quelques semaines mais cela relève de l’impossible. CIAS et Multi-accueil p.12 Vie pratique p.27 Vous en subissez les désagréments, les habitants rive- Sommaire ADMR et CCAS p.13 rains et les commerçants encore plus intensément. J’en Bonjour, suis conscient et nous faisons le maximum pour que ces Je remercie Albert Euzenat, Maire travaux perturbent le moins possible la vie collective. L’ÉQUIPE DU PERSONNEL COMMUNAL : Trois nouvelles recrues au service de la commune Adjoint, qui vient de m’adresser les vœux protocolaires Les 3 gros chantiers actuellement engagés sont diffé- mais aussi, ainsi qu’à Christiane mon épouse, des vœux rents dans leurs usages, mais leur finalité est capitale personnels qui nous touchent et nous vont droit au cœur. dans le dessein de St-Jean-la-Poterie (écrivez dessin Je vous remercie toutes et tous car Albert, en y mettant comme vous l’entendez!). -

Pêche » Au Pays De Questembert
Guide « Pêche » au Pays de Questembert : Maxence Gross : Maxence Photo ©Maxence Gross Mise à jour : janvier 2020 Riches en salmonidés, en majorité des truites sauvages, les rivières et ruisseaux qui sillonnent notre territoire, le Tohon, le Kervily, l'Arz et le Trévelo, raviront les amoureux de la pêche. Communes du Pays de Questembert (Questembert Communauté) : Berric, Caden, Larré, Lauzach, La Vraie-Croix, Le Cours, Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert, Rochefort- en-Terre, Saint-Gravé. Cours d'eau 1ère catégorie : Tohon (St Eloi), Kervily, Arz, Trévelo (sauf sur la partie basse) Espèces : truites, brochets, perches, poissons blancs et carpes. Etangs communaux : Etang de Célac à Questembert, Etang de Larré, Étang de La Vraie Croix Etang de 2ème catégorie : Étang du Moulin Neuf à Malansac/Rochefort-en-Terre (14 ha). Ouverture générale 2020 : cours d’eau 1ère catégorie (du 11/03/20 à 8h au 20/09/20 inclus), cours d’eau 2ème catégorie : voir réglementation générale et particulière http://bit.ly/peche2020 Associations de pêche du territoire AAPPMA QUESTEMBERT "LA TRUITE QUESTEMBERGEOISE" M. RIGOT Jean-Pierre (Président) – Tél 02 90 79 03 08 – 06 08 28 54 80 – [email protected] [email protected] http://latruitequestembergeoise.jimdo.com AAPPMA PEILLAC "LA GAULE DE LANVAUX" M. MOUCHY Robert (Président) Mairie 56220 PEILLAC tél : 02 99 91 28 06 [email protected] AAPPMA SAINT-MARTIN "PECHES-LOISIRS DE L'OUST" M. TOUCHAIS Pascal (Président) Mairie 56200 SAINT MARTIN SUR OUST tél : 02 99 93 72 19 [email protected] -
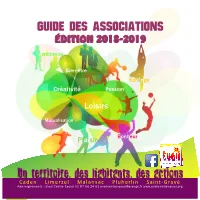
Guide Des Associations Édition 2018-2019
GUIDE DES ASSOCIATIONS ÉDITION 2018-2019 Ambiance Bien-être Échange Créativité Passion Loisirs Mutualisation Bonheur Plaisir Caden Limerzel Malansac Pluherlin Saint -G ravé Renseignements : Eveil Centre Social 02 97 66 24 63 [email protected] www.eveilcentresocial.org 2 EDITO met aux associations de se connaitre et quelquefois ème ’est à l’occasion de la 12 édition de Canton d’engager des partenariats. s’bouge que nous imprimons ce guide inter- C ère communal des associations de Caden, Li- La 1 édition du guide des associations, parue en merzel, Malansac, Pluherlin et Saint Gravé. 2016, a été bien utile pour faire connaitre la richesse associative de notre territoire. Vous allez pou- voir découvrir cette 3ème édition, avec toujours plus Canton s’bouge, c’est un moment phare dans l’an- d’associations répertoriées et d’informations mises à née pour promouvoir les activités associatives auprès jour. Le centre social EVEIL est heureux de contri- des habitants de notre territoire. Toujours sous sa buer à soutenir cette dynamique en regroupant dans forme itinérante, il se déroule de fin août à mi- ce guide plus de 100 associations, classées par septembre et propose un programme riche et varié grands thèmes. Il permet de mettre en avant la dy- d’animations organisées par plus d’une trentaine namique associative de notre territoire rural, tant au d’associations. niveau des loisirs, du sport, du patrimoine, des ser- vices, de l’éducation et de la jeunesse. Ce guide, c’est aussi une attention particulière por- tée aux nouveaux arrivants. En effet, depuis plu- sieurs années, nous constatons une demande d’information croissante de la part des habitants et des nouveaux arrivants, désireux de trouver une ac- tivité qui leur corresponde et/ou de s’investir dans la vie locale. -

Josselin / Peillac La Vélodyssée
http:www.lavelodyssee.com 19/05/2021 Josselin / Peillac La Vélodyssée Une balade à vélo sur La Vélodyssée sous le signe de l’époque médiévale, tant Josselin et Malestroit se reflètent l’une dans l’autre par leurs maisons à pans de bois et leur dédale de ruelles étroites. Prenez le temps de vous balader à Malestroit, « la perle de l’Oust », pour découvrir ses demeures de facture gothique ou Renaissance surmontées de gargouilles sculptées. Continuez sur le chemin de halage du Canal de Nantes à Brest : vallée de l’Oust et ses ondulations, contreforts des Landes de Lanvaux en arrière-plan, entre terres sauvages et forêts. Après la confluence avec la Claie, Saint-Congard et l’écluse de Guélin seront des haltes bienvenues. Départ Arrivée Josselin Peillac L'itinéraire à vélo de Josselin à Peillac Durée Distance 3 h 03 min 45,90 Km Revêtement roulant sur cette section en site propre. Prudence lors de la traversée du pont au Roc-St-André, Niveau Thématique changement de rive conformément au balisage. Je débute / En famille Au fil de l'eau, En Attention à la hauteur sous pont à Malestroit. famille, Nature et Revêtement très roulant entre l’écluse de Beaumont et St-Congard, irrégulier à l’approche de Peillac. patrimoine Voie verte La voie verte Mauron Questembert croise le canal à 3 reprises entre Guillac et Malestroit. Liaisons Passerelle à hauteur de St-Laurent-sur-Oust pour rejoindre le bourg. Les coups de cœur du parcours Côté découverte : émerveillement garanti à l'arrivée sur Josselin et son impressionnante forteresse juchée sur son éperon rocheux à l'aplomb de l'Oust ! Côté pile une façade Renaissance richement décorée, côté face une forteresse médiévale ornée de 3 tours rondes à toiture conique. -

CARRIERES RAULET Kerpellec 56250 ELVEN
CARRIERES RAULET Kerpellec 56250 ELVEN ---------------- Installation Classée pour la Protection de l’Environnement Demande d'Autorisation Environnementale pour le renouvellement de l’autorisation et l'extension de la carrière « Kermelec » à Elven (56) Février 2018 Version 2 SET Environnement - 26 ter rue de La Lande Gohin – 35430 ST-JOUAN-DES-GUERETS EURL au capital de 7700 € - Code APE: 7112B – RCS SAINT-MALO 443677877 Tel : 02 99 58 26 44 - Fax 02 99 58 26 42 Courriel : [email protected] - Site internet : http://www.setenvironnement.com/ 1 Table des matières INTRODUCTION.............................................................6 2.5 DESCRIPTIF DE LA ZONE RENONCÉE.......................46 LETTRE DE DEMANDE.................................................8 3 LA NATURE ET LE VOLUME DES ACTIVITÉS..47 RESUME NON TECHNIQUE.......................................11 3.1 NATURE DES ACTIVITÉS..........................................47 3.2 DEVENIR DES PRODUITS.........................................47 1 PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ET DE SON 3.3 OBJET DE LA DEMANDE..........................................47 PROJET............................................................................12 3.4 CLASSEMENT DE L'ACTIVITÉ...................................48 1.1 ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ........................................12 3.5 MOTIVATIONS DE LA DEMANDE..............................48 1.2 OBJET DE LA DEMANDE..........................................12 3.6 INSTITUTION DE SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE.49 1.3 CLASSEMENT DE L'ACTIVITÉ...................................13 -

Secteur Les Pays De Vilaine
SECTEUR LES PAYS DE VILAINE RENTREE DU FOOT SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 Les équipes sont convoquées à 13h30 précise sur le site Sont convoquées au stade de PEILLAC les équipes suivantes: 1-Peillac bleu 7- St Perreux/St Vincent 1 13- St perreux/St vincent 2 2- Rieux 2 8- Rieux 3 14- Peillac rouge 3-Allairejaune 9-Allaire rouge 4- Malansac noir 10- Malansac blanc 5- saint jacut 11- Rieux 1 6- Allaire bleu 12- Allaire noir Sont convoquées au stade de CADEN les équipes suivantes: 1- Caden 7- Pluherlin 1 13-Pluherlin 2 2- Péaule rouge 8- Péaule blanc 14- Péaule bleu 3- Basse vilaine A 9-Basse vilaine B 4- Marzan noir 10- Marzan rouge 5-Basse vilaine C 11-Basse vilaine D 6-Damgan 12- Marzan blanc Sont convoquées au stade de BERRIC les équipes suivantes : 1- Berric rouge 7- Berric bleu 13- Berric vert 2- Questembert rouge 8- Questembert bleu 14- Questembert jaune 3- Muzillac 2 9-Muzillac 1 4- le guerno/noyal 1 10-le guerno/noyal 2 5- Questembert vert 11-Larré/Molac 6- Arzal blanc 12-Arzal noir Début de la journée d'accueil à 14h00. Le programme de la journée (horaires des rencontres,horaires des ateliers techniques, règlement,...) vous sera transmis lors de votre arrivée sur le site par le club recevant. C'est pourquoi, il est demandé à tous de faire un effort pour respecter l'heure des convocations. Bonne journée à tous Hervé Noguet Tél: 06 33 83 43 86 Mail: [email protected] Rentrée du foot U9 Samedi 22 Septembre de CADEN Equipes : 1—Caden 5- Basse Vilaine C 9-Basse Vilaine B 13-Pluherlin 2 2- Péaule rouge 6- damgan 10-Marzan rouge 14- Péaule bleu 3- Basse Vilaine A 7- Pluherlin 1 11-Basse Vilaine D 4- Marzan noir 8-Péaule blanc 12- Marzan blanc Programme: La journée se déroule sous forme de 7 périodes de 7 minutes chacune. -

Collecte Des Déchets 2021
COLLECTE DES DÉCHETS 2021 www.redon-agglomeration.bzh w JOURS DE COLLECTE w BACS EMBALLAGES ▲ Rattrapage jour férié BACS JAUNES 2021 - BACS EMBALLAGES Communes Ordures Semaines Semaines ménagères Janvier Février Mars Avril Mai Juin paires impaires Allaire Mercredi H - Mardi Vend. 1 Lun. 1 A Lun. 1 A Jeu. 1 D Sam. 1 Mar. 1 G Avessac Bourg - Jeudi D Vendredi Sam. 2 E▲ Mar. 2 B Mar. 2 B Vend. 2 E Dim. 2 J▲ Merc. 2 H Avessac Campagne - Vendredi E Mercredi Dim. 3 Merc. 3 C Merc. 3 C Sam. 3 F▲ Lun. 3 F Jeu. 3 I Bains-sur-Oust - Mercredi C Jeudi Lun. 4 A Jeu. 4 D Jeu. 4 D Dim. 4 Mar. 4 G Vend. 4 J Béganne Vendredi J - Jeudi Mar. 5 B Vend. 5 E Vend. 5 E Lun. 5 Merc. 5 H Sam. 5 E Conquereuil Jeudi I - Lundi Merc. 6 C Sam. 6 I Sam. 6 J Mar. 6 G Jeu. 6 I Dim. 6 Fégréac Bourg - Jeudi D Jeu. 7 D Dim. 7 J Dim. 7 Merc. 7 H Vend. 7 J Lun. 7 A Vendredi Fégréac Campagne - Mercredi C Vend. 8 E Lun. 8 F Lun. 8 F Jeu. 8 I Sam. 8 Mar. 8 B Guémené-Penfao - Mardi B Lundi Sam. 9 I Mar. 9 G Mar. 9 G Vend. 9 J Dim. 9 E▲ Merc. 9 C La Chapelle-de-Brain Jeudi I - Lundi Dim. 10 J Merc. 10 H Merc. 10 H Sam. 10 E Lun. 10 A Jeu. 10 D Langon - Jeudi D Vendredi Lun. -

Circuit De Saint-Vincent-Sur-Oust 32/20 Km
Maison du Tourisme du Pays de Redon : 02 99 71 06 04 1211 www.tourisme-pays-redon.com modéré Circuit de Saint-Vincent-sur-Oust 32/20 km L e e Ca n nal de i Nan la tes i V à B La rest L'O l u a st PEFC/10-31-1238 z r A - o L l 'A a rz t-M 2 S Vélo e La Vilain omouvoir la gestion durable des forêts” - La Vilaine Imprimé sur papier certifié PEFC “pr Eur ov él o 1 Ro sc of f - N a n t F. Dom du Gavre 05 km es facile modéré soutenu Les vélo promenades ® Ce sont des boucles de promenade (de 15 à 40 km pour une journée, retour au point de départ) qui Quelques recommandations simples et utiles avant votre permettent de partir à la découverte du patrimoine balade : local et de profiter des services de proximité. Elles 1. Vérifiez l’état de votre vélo et munissez-vous d’une empruntent des petites routes communales mais trousse de réparation. ne sont pas prioritaires sur les véhicules à moteur 2. Prévoyez un en-cas et de l’eau. (Prudence !). A chaque fois que cela est possible, elles cheminent sur les itinéraires en site propre 3. Pour votre sécurité, respectez le code de la route, roulez bien à droite et en file indienne. Le port du casque est réservés aux circulations non motorisées. Le balisage recommandé. vous guide tout au long du parcours. ® Vélo promenades est une marque déposée de l’association Rando Breizh. -

SPANC Adresse Nom Des Communes N° Tél
SPANC Adresse Nom des communes n° Tél. Interlocuteur ARC SUD BRETAGNE Allée Raymond Le Duigou Ambon - Arzal - Billiers - Damgan - La Roche Bernard - Le Guerno - 02 99 91 40 90 Rodrigue LEVESQUE (Cté de Cnes) 56190 MUZILLAC Marzan - Muzillac - Nivillac - Noyal Muzillac - Péaule - St-Dolay Aurélie BURGUIN-GUILLAS Auray -Belz - Brech - Camors - Carnac - Crach - Etel - Erdeven - Hoedic - Espace Tertiaire Porte Océane 2 AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE Houat - La Trinité S/Mer - Locmariaquer - - Landaul - Landévant - Locoal 02 97 52 45 26 40 rue du Danemark - BP 70447 Mathieu ROLLAND (Cté de Cnes) Mendon -Ploemel - Plouharnel - Plumergat - Pluneret - Pluvigner - 56404 AURAY Cedex Quiberon - Ste Anne d'Auray - St Philibert - St Pierre Quiberon Gaëlle GL ÉMAREC Mairie des FOUGERETS Glénac - Les Fougerêts - Pleucadeuc - Pluherlin - Rochefort en Terre - St BASSE VALLEE DE L'OUST (SIAEP) 15 rue de l'Oust 02 99 91 54 42 Mme RIBOUCHON Gravé - St Martin Sur Oust 56200 LES FOUGERETS Samir GUERGOUR 02.97.31.28.47 BELLE-ILE en MER Haute Boulogne - 56360 LE PALAIS Bangor - Locmaria Belle Ile - Sauzon - Le Palais Morgan OLIVIER (Cté de Cnes) 02 97 31 35 81 Florian BESNIER 02 97 65 73 69 BLAVET-BELLEVUE-OCEAN PA de Bellevue - Allée de Ti Neùé - Kervignac - Merlevenez - Plouhinec - Nostang - Ste Hélène Maxime LEMAY (Cté de Cnes) 56700 MERLEVENEZ 02 97 65 62 90 Jean-Sébastien LEHUEDE CAP ATLANTIQUE 3 avenue des Noëlles Camoël - Férel - Pénestin 02 28 54 17 58 (remplace Sébastien (Cté d'Agglomération) 44503 LA BAULE ESCOUBLAC Bironneau le 11/09/2017) Mairie