SIVU Du PLU De ROQUEFORT-SARBAZAN
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

40990 Angoumé 40150 Angresse 40320 Arboucave 40110
40990 Angoumé 40150 Angresse 40320 Arboucave 40110 Arengosse 40700 Argelos 40430 Argelouse 40110 Arjuzanx 40330 Arsague 40190 Arthez-d'Armagnac 40120 Arue 40700 Aubagnan 40500 Audignon 40400 Audon 40320 Bahus-Soubiran 40380 Baigts 40700 Bassercles 40360 Bastennes 40320 Bats 40400 Bégaar 40410 Belhade 40120 Bélis 40300 Bélus 40180 Bénesse-lès-Dax 40230 Bénesse-Maremne 40250 Bergouey 40240 Betbezer-d'Armagnac 40370 Beylongue 40700 Beyries 40390 Biarrotte 40170 Bias 40390 Biaudos 40600 Biscarrosse 40330 Bonnegarde 40370 Boos 40270 Bordères-et-Lamensans 40190 Bourdalat 40330 Brassempouy 40320 Buanes 40120 Cachen 40300 Cagnotte 40430 Callen 40090 Campagne 40090 Canenx-et-Réaut 40400 Carcarès-Sainte-Croix 40400 Carcen-Ponson 40380 Cassen 40330 Castel-Sarrazin 40360 Castelnau-Chalosse 40320 Castelnau-Tursan 40700 Castelner 40500 Cauna 40300 Cauneille 40250 Caupenne 40700 Cazalis 40090 Cère 40320 Classun 40320 Clèdes 40180 Clermont 40210 Commensacq 40240 Créon-d'Armagnac 40360 Donzacq 40500 Dumes 40210 Escource 40290 Estibeaux 40240 Estigarde 40320 Eugénie-les-Bains 40500 Eyres-Moncube 40500 Fargues 40190 Frêche 40350 Gaas 40090 Gaillères 40380 Gamarde-les-Bains 40420 Garein 40180 Garrey 40110 Garrosse 40160 Gastes 40330 Gaujacq 40320 Geaune 40090 Geloux 40380 Gibret 40180 Goos 40990 Gourbera 40465 Gousse 40400 Gouts 40290 Habas 40700 Hagetmau 40300 Hastingues 40250 Hauriet 40180 Heugas 40190 Hontanx 40700 Horsarrieu 40230 Josse 40700 Labastide-Chalosse 40300 Labatut 40530 Labenne 40210 Labouheyre 40320 Lacajunte 40700 Lacrabe 40090 Laglorieuse -

Corrigé THÈME 1 LES Transformations Du Paysage
livret du jeune visiteur élèves du cycle 3 corrigé THÈME 1 LES transformations du paysage 1 COMMENSACQ La Mouleyre. Bergers près d’un parc Sans date, réf M.A. : 66.27.2186. Juillet 2005. 1 - Complète le tableau ci-dessous en faisant la liste des éléments vus sur les photographies 2 - Réponds aux questions suivantes : - A quoi servait la construction de la photographie prise par Félix Arnaudin ? Photographie en noir et blanc Photographie en couleur A parquer les moutons. La bergerie La maison Les moutons La moto - A quoi servait la construction de la photographie prise par Jean-Joël Le Fur ? A se loger. Les bergers sur échasses L’homme assis à l’ombre - A ton avis, quel était l’intérêt au XIXe siècle de se déplacer dans la lande avec les échasses comme les bergers ? La forêt au lointain Les chênes autour de la maison A faire de grands pas, voir au loin, enjamber les cours d’eau et les fossés. La forêt de pins au lointain 3 - Entoure sur les deux photos les moyens que les hommes utilisent pour se déplacer. Les échasses, la moto. THÈME 1 2 MORCENX Pêche au Lagouat à Cornalis 1 – Entoure sur les trois photographies la construction qui a servi de point de repère à Jean-Joël Le Fur. La bergerie. 2 – Réponds à la question suivante : Quel élément nouveau observe-t-on sur la photographie couleur (B) ? La forêt. A 13 février 1898, réf M.A. : 66.27.2163. 3 – Coche les bonnes réponses. Photographie Photographie en noir et blanc (A) en couleur (B) Lande rase ✓ Espace vide ✓ Espace plein ✓ Noir et blanc ✓ Couleur ✓ Forêt ✓ Eau ✓ 4 – Réponds aux questions suivantes : Quel événement est survenu avant la prise de la photographie appelée reconduite (C) ? La tempête KLAUS. -
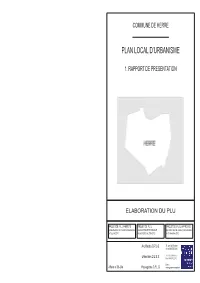
Plan Local D'urbanisme
COMMUNE DE HERRE PLAN LOCAL D’URBANISME 1. RAPPORT DE PRESENTATION ELABORATION DU PLU PROJET DE P.L.U. ARRETE PROJET DE P.L.U. PROJET DE P.L.U. APPROUVE par délibération du Conseil Communautaire soumis à ENQUETE PUBLIQUE par délibération du Conseil Communautaire le 12 juillet 2011 du 26/03/2012 au 27/04/2012 le 11 décembre 2012 Architectes D.P.L.G. 38, quai de Bacalan 33300 BORDEAUX Tél : 05 56 29 10 70 Urbanistes D.E.S.S. Fax : 05 56 43 22 81 Email : Affaire n°06-34e Paysagistes D.P.L.G. [email protected] SOMMAIRE PREAMBULE ............................................................................................................................. 1 II. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PAYSAGES 41 II–1. ENVIRONNEMENT ET MILIEUX NATURELS ..................................................................42 I. DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE ET URBAIN 3 II–1–1. Présentation physique générale........................................................................................42 II–1–2. Topographie .........................................................................................................................42 I–1. INTRODUCTION ............................................................................................................4 II–1–3. Formations géologiques .....................................................................................................44 II–1–4. Hydrologie ...........................................................................................................................46 -
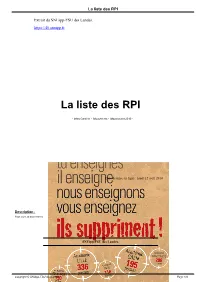
La Liste Des RPI
La liste des RPI Extrait du SNUipp-FSU des Landes. https://40.snuipp.fr La liste des RPI - Infos Carrière - Mouvement - Mouvement 2010 - Date de mise en ligne : lundi 12 avril 2010 Description : Pour aider au mouvement. SNUipp-FSU des Landes. Copyright © SNUipp-FSU des Landes. Page 1/4 La liste des RPI DAX CENTRE LANDES AZUR, MESSANGES, MOLIETS LEVIGNACQ, UZA BEYLONGUE, CARCEN PONSON LESGOR, LALUQUE, TALLER ARENGOSSE,OUSSE SUZAN, ST YAGUEN,VILLENAVE RPC CARCARES, AUDON, GOUTS DAX SUD ADOUR ESTIBEAUX,MOUSCARDES,OSSAGES,TILH MIMBASTE, MISSON ORTHEVIELLE, PORT DE LANNE ORIST, PEY BELUS, ST ETIENNE D'ORTHE ST CRICQ DU GAVE, SORDE L'ABBAYE HASTINGUES, SAMES (64) CANDRESSE, NARROSSE ST VINCENT DE PAUL, TETHIEU HEUGAS, ST PANDELON MONT DE MARSAN HAUTE LANDE BOSTENS,POUYDESSEAUX, STE FOY,GAILLERES BELIS,BROCAS,CANENX,CERE, MAILLERES LUCBARDEZ, SAINT AVIT ARUE, CACHEN, LENCOUACQ BOURRIOT,LOSSE,RETJONS,VIELLE, SOUBIRAN,ST GOR GAREIN,LABRIT,LE SEN,VERT CREON, LABASTIDE LE FRECHE, ST JUSTIN LUXEY, SORE MONT DE MARSAN SUD ARMAGNAC ARTASSENX, BASCONS, BRETAGNE Copyright © SNUipp-FSU des Landes. Page 2/4 La liste des RPI BORDERES, CASTANDET, MAURRIN FARGUES, MONTGAILLARD BOURDALAT,HONTANX,ST GEIN PUJO, SAINT CRICQ VILLENEUVE BOUGUE, LAGLORIEUSE, MAZEROLLES MONT DE MARSAN SUD CHALOSSE AUBAGNAN, BATS, VIELLE TURSAN BRASSEMPOUY, SAINT CRICQ CHALOSSE HORSARRIEU, Ste COLOMBE, SERRES GASTON LACRABE,MANT,MORGANX,PEYRE,MONSEGUR, POUDENX ARSAGUE, BONNEGARDE, CASTEL SARRAZIN CASTAIGNOS, MOMUY, NASSIET BASTENNES,CASTELNAU,DONZACQ,GAUJACQ GAMARDE,GOOS,PRECHACQ GARREY, SORT EN CHALOSSE CASSEN,GOUSSE,LOUER,ONARD,ST GEOURS D'AURIBAT, ST JEAN DE LIER,VICQ D'AURIBAT LAUREDE, POYANNE CAUPENNE,LARBEY,MAYLIS,ST AUBIN HAURIET,MONTAUT,TOULOUZETTE AURICE, CAUNA, LAMOTHE, LE LEUY COUDURES,MONTSOUE,SARRAZIET AUDIGNON,BANOS,DUMES,EYRES MONCUBE MONT DE MARSAN TURSAN ASH PHILONDENX, URGONS PIMBO, SORBETS, MIRAMONT CAZERES, LE VIGNAU LARRIVIERE, RENUNG MIMIZAN PAYS DE BORN BIAS, MEZOS Copyright © SNUipp-FSU des Landes. -

Avis Délibéré De La Mission Régionale D'autorité Environnementale
Région Nouvelle-Aquitaine Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de la Région Nouvelle-Aquitaine sur l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal du pays morcenais (Landes) N° MRAe : 2020ANA105 Dossier PP-2020-9830 Porteur du plan : Communauté de communes du pays morcenais Date de saisine de la Mission Régionale d’Autorité environnementale : 12 juin 2020 Date d’avis de l’Agence régionale de santé et des préfectures : 15 juillet 2020 Préambule Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis sur la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le dossier qui lui a été soumis. En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). Conformément au règlement intérieur du CGEDD et aux règles internes à la MRAe Nouvelle-Aquitaine, cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 2 septembre 2020 par délibération de la commission collégiale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine. Ont participé et délibéré :Hugues AYPHASSORHO, Françoise BAZALGETTE, Bernadette MILHÈRES, Freddie-Jeanne RICHARD. Chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis. -

ZRR - Zone De Revitalisation Rurale : Exonération De Cotisations Sociales
ZRR - Zone de Revitalisation Rurale : exonération de cotisations sociales URSSAF Présentation du dispositif Les entreprises en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) peuvent être exonérée des charges patronales lors de l'embauche d'un salarié, sous certaines conditions. Ces conditions sont notamment liées à son effectif, au type de contrat et à son activité. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Toute entreprise peut bénéficier d'une exonération de cotisations sociales si elle respecte les conditions suivantes : elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, elle a au moins 1 établissement situé en zone de revitalisation rurale (ZRR), elle a 50 salariés maximum. Critères d’éligibilité L'entreprise doit être à jour de ses obligations vis-à-vis de l'Urssaf. L'employeur ne doit pas avoir effectué de licenciement économique durant les 12 mois précédant l'embauche. Pour quel projet ? Dépenses concernées L'exonération de charges patronales porte sur le salarié, à temps plein ou à temps partiel : en CDI, ou en CDD de 12 mois minimum. L'exonération porte sur les assurances sociales : maladie-maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse, allocations familiales. URSSAF ZRR - Zone de Revitalisation Rurale : exonération de cotisations sociales Page 1 sur 5 Quelles sont les particularités ? Entreprises inéligibles L'exonération ne concerne pas les particuliers employeurs. Dépenses inéligibles L'exonération de charges ne concerne pas les contrats suivants : CDD qui remplace un salarié absent (ou dont le contrat de travail est suspendu), renouvellement d'un CDD, apprentissage ou contrat de professionnalisation, gérant ou PDG d'une société, employé de maison. -

Liste Des Cloches Protégées Dans Les Landes - Avril 2015
Export Liste des cloches protégées dans les Landes - avril 2015 Commune Immeuble de localisation Datation Protection Aire-sur-l'Adour Cathédrale Saint Jean-Baptiste 1803 Inscription 2003 Argelouse Eglise Saint-André 1726 Inscription 2003 Arue Eglise Saint Clair 1777 Inscription 2004 Bégaar Eglise Saint-Pierre-ès-Liens 1766 inscription 1992 Bégaar Eglise Saint-Pierre-ès-Liens 1817 inscription 1992 Beyries Eglise Saint Blaise ? Inscription 2006 Biscarrosse Eglise Saint-Martin 1659 Inscription 2006 Brassempouy Eglise Saint-Saturnin 1738 Classement 2005 Campet-et-Lamolère Eglise Sainte-Croix ? Inscription 2006 Castandet Eglise Saint Vincent-de-Xaintes 1780 Inscription 2004 Castets Eglise Saint-Barthélémy 15e siècle Classement 2005 Caupenne Eglise Saint-Martin 1627 Inscription 1992 Cazères-sur-l'Adour Eglise Saint Barthélémy 1750 Inscription 2004 Le Frêche Eglise de Saint Vidou 1814 Inscription 2004 Gabarret Eglise Saint Luperc 1778 Inscription 2004 Lacquy Eglise Saint Aignan 1840 Inscription 2003 Laglorieuse Eglise Notre-Dame 1768 Inscription 2004 Lauret Eglise Saint Jean-Baptiste 1748 Inscription 2003 Lencouacq Eglise paroissiale Saint Jean-l'Evangéliste 1814 Inscription 2003 Lesperon Eglise Saint Pierre 1509 Classement 2004 Lévignacq Eglise Saint-Martin 1757 Classement 1911 Lit-et-Mixe Eglise Saint Vincent de Mixe 1789 Inscription 2004 Lubbon Eglise Saint-Pierre 1603 Inscription 2003 Mazerolles Eglise de Beaussiet 1568 Classement 1910 Mazerolles Eglise paroissiale Sainte-Quitterie 1714 Classement 1910 Mimbaste Eglise Saint Jean-Baptiste -

Commune 40990 Angoumé 40150 Angresse 40320 Arboucave 40110
Commune 40990 Angoumé 40150 Angresse 40320 Arboucave 40110 Arengosse 40700 Argelos 40430 Argelouse 40110 Arjuzanx 40330 Arsague 40190 Arthez-d'Armagnac 40120 Arue 40700 Aubagnan 40400 Audon 40320 Bahus-Soubiran 40700 Bassercles 40360 Bastennes 40320 Bats 40400 Bégaar 40410 Belhade 40120 Bélis 40300 Bélus 40180 Bénesse-lès-Dax 40230 Bénesse-Maremne 40250 Bergouey 40240 Betbezer-d'Armagnac 40370 Beylongue 40700 Beyries 40390 Biarrotte 40170 Bias 40390 Biaudos 40600 Biscarrosse 40330 Bonnegarde 40370 Boos 40270 Bordères-et-Lamensans 40190 Bourdalat 40330 Brassempouy 40320 Buanes 40120 Cachen 40300 Cagnotte 40430 Callen 40090 Campagne 40090 Canenx-et-Réaut 40400 Carcarès-Sainte-Croix 40400 Carcen-Ponson 40380 Cassen 40330 Castel-Sarrazin 40360 Castelnau-Chalosse 40320 Castelnau-Tursan 40700 Castelner 40500 Cauna 40300 Cauneille 40250 Caupenne 40700 Cazalis 40090 Cère 40320 Classun 40320 Clèdes 40210 Commensacq 40360 Donzacq 40500 Dumes 40210 Escource 40290 Estibeaux 40240 Estigarde 40320 Eugénie-les-Bains 40500 Eyres-Moncube 40500 Fargues 40190 Frêche 40350 Gaas 40090 Gaillères 40420 Garein 40180 Garrey 40110 Garrosse 40160 Gastes 40330 Gaujacq 40320 Geaune 40090 Geloux 40380 Gibret 40180 Goos 40990 Gourbera 40465 Gousse 40400 Gouts 40290 Habas 40700 Hagetmau 40300 Hastingues 40190 Hontanx 40700 Horsarrieu 40230 Josse 40700 Labastide-Chalosse 40300 Labatut 40210 Labouheyre 40320 Lacajunte 40700 Lacrabe 40090 Laglorieuse 40240 Lagrange 40250 Lahosse 40465 Laluque 40250 Lamothe 40270 Larrivière-Saint-Savin 40800 Latrille 40320 Lauret 40550 Léon -

Rythmes Scolaires Des Écoles Du Département Des Landes, Rentrée
Rentrée scolaire 2021/2022 Rythmes scolaires des écoles du Département des Landes Libellé RNE Dénomination Rythmes scolaires Commune AIRE-SUR-L'ADOUR 0400442N ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CLAUDE NOUGARO 4 jours et demi AIRE-SUR-L'ADOUR 0400937B ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE F. GIROUD 4 jours et demi AMOU 0400754C ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 4 jours et demi AMOU 0400761K ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi ANGRESSE 0400290Y ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours ARENGOSSE 0400168R ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours ARJUZANX 0400170T ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours ARSAGUE 0400294C ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi ARTASSENX 0401008D ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours ARUE 0400533M ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 4 jours et demi AUBAGNAN 0400504F ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi AUDIGNON 0400377T ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 4 jours et demi AUREILHAN 0400223A ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours AURICE 0400378U ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours AZUR 0400346J ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours BANOS 0400379V ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi BASCONS 0400491S ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 4 jours BASTENNES 0400297F ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi BATS 0400474Y ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MATERNELLE 4 jours et demi BEGAAR 0400735G ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi BELIS 0400523B ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours BELUS 0400328P ECOLE PRIMAIRE 4 jours BENESSE-MAREMNE 0400733E ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE M. GENEVOIX 4 jours BENQUET 0400413G ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours BEYLONGUE 0400232K ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 4 jours BIARROTTE -

(EU) 2021/335 of 23 February 2021 Amending the Annex To
25.2.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Uni on L 66/5 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/335 of 23 February 2021 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2020/1809 concerning certain protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2021) 1386) (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra-Community trade with a view to the completion of the internal market (1), and in particular Article 9(4) thereof, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary checks applicable in intra-Union trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (2), and in particular Article 10(4) thereof, Having regard to Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC (3), and in particular Article 63(4) thereof, Whereas: (1) Commission Implementing Decision (EU) 2020/1809 (4) was adopted following outbreaks of highly pathogenic avian influenza (HPAI) in holdings where poultry or other captive birds were kept in certain Member States and the establishment of protection and surveillance zones by those Member States in accordance with Council Directive 2005/94/EC. (2) Implementing Decision (EU) 2020/1809 provides that the protection and surveillance zones established by the Member States listed in the Annex to that Implementing Decision, in accordance with Directive 2005/94/EC, are to comprise at least the areas listed as protection and surveillance zones in that Annex. -

Note Sarbazan
direction Service de Bureau départementale l’Environnement, Prévention des de l’Equipement des Risques Risques, des landes et de la Sécurité Aménagement Durable et Défense Dossier d’information sur le risque Inondation sur la commune de SARBAZAN août 2008 Préface Etape finale de la démarche de l’Etat et maillon clé du droit à l’information des citoyens, ce dossier présente le risque inondation qui menace votre commune.... Le document a été élaboré et validé grâce aux données recueillies et aux connaissances détenues aujourd’hui par les services de l’Etat. Malgré ses limites, il a cependant le mérite de décrire et figurer le mieux possible le phénomène inondation. Ainsi, je souhaite que ce Dossier d’Information serve de base à une information la plus large possible des responsables et citoyens concernés. Le Préfet A) GENERALITES I) QU’EST-CE QU’UNE INONDATION ? Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque inondation est la conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement ou apparaître et l’homme qui s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes de constructions, d’équipements et d’activités. II) COMMENT SE MANIFESTE –T-ELLE ? On distingue trois types d’inondations - La montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe phréatique . - La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes. - Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant l’infiltration des précipitations. -

CC Des Landes D'armagnac (Siren : 200035541)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC des Landes d'Armagnac (Siren : 200035541) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Roquefort Arrondissement Mont-de-Marsan Département Landes Interdépartemental non Date de création Date de création 17/12/2012 Date d'effet 01/01/2013 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Philippe LATRY Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 31 chemin de Bas de Haut Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 40120 ROQUEFORT Téléphone Fax Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 11 205 1/5 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 10,48 Périmètre Nombre total de communes membres : 27 Dept Commune (N° SIREN) Population 40 Arue (214000143) 357 40 Arx (214000150) 51 40 Baudignan (214000309) 52 40 Betbezer-d'Armagnac (214000390) 150 40 Bourriot-Bergonce (214000531) 312 40 Cachen (214000580) 238 40 Créon-d'Armagnac (214000879) 369 40 Escalans (214000937) 258 40 Estigarde (214000960) 115 40 Gabarret (214001026) 1 534 40 Herré (214001240) 143 40 Labastide-d'Armagnac (214001315) 694 40 Lagrange (214001406) 190 40 Lencouacq (214001497) 383 40 Losse (214001588)