Rapport En Français
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annuaire Du Guide Des Aidants
Annuaire Le Guide des aidants dans l’Eure Samu : 15 Urgences : 112 Union Européenne Pompiers : 18 Police : 17 Bernay, Pont-Audemer Le CLIC Pôle social Tél. : 02 32 41 76 74 Nord-Ouest du CLIC Ouest 9, rue des Papetiers Fax : 02 32 39 91 59 département 27500 Pont-Audemer LES DISPOSITIFS D’AIDES À DOMICILE Conseil Départemental de l’Eure Tél. : 02 32 31 96 84 Boulevard Georges Chauvin - 27021 Évreux Direction Solidarité Fax : 02 32 39 91 72 Autonomie 1 bis place Saint Taurin - BP 800 - 27000 CARSAT Tél. : 36 46 Évreux Maison Départementale Tél. : 02 32 31 96 13 11, rue Jean de la Bruyère- 27032 Évreux des Personnes Handicapées Fax : 02 32 60 45 40 MSA (service social) Tél. : 02 32 23 44 22 32, rue Georges Politzer - 27000 Évreux Centre national du chèque 63, rue de la Montat emploi-service universel Tél : 0 820 00 23 78 42961 Saint-Étienne Cedex 9 (CNCesu) Fédération des Particuliers Employeurs de France Tél. : 0825 07 64 64 79, rue de Monceau - 75008 Paris (FEPEM) LES SERVICES D’AIDES À DOMICILE (SAAD) SAAD du CIAS Intercom Ber- 41, rue Jules Prior Beaumont, le Roger et nay Terres de Normandie An- Tél. : 02 32 45 47 85 BP 80 - 27170 Beaumont-Le-Roger alentours tenne de Beaumont le Roger Place Gustave Héon CCAS Bernay Tél. : 02 32 46 63 16 Commune de Bernay BP 762 - 27307 Bernay Cedex SOUS MON TOIT Tél. : 02 38 22 94 43 130, rue Clément Ader - 27000 Évreux Département Alentours de Beaumesnil, Bernay, OASIS Tél. -
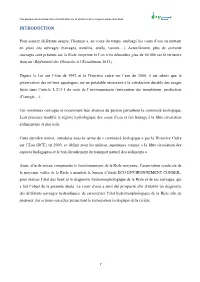
Introduction
Plan pluriannuel de restauration et d’entretien sur le territoire de la moyenne vallée de la Risle INTRODUCTION Pour assurer différents usages, l’homme a, au cours du temps, aménagé les cours d’eau en mettant en place des ouvrages (barrages, moulins, seuils, vannes…). Actuellement, plus de soixante ouvrages sont présents sur la Risle moyenne et l’on n’en dénombre plus de 60 000 sur le territoire français (Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement 2011). Depuis la Loi sur l’Eau de 1992 et la Directive cadre sur l’eau de 2000, il est admis que la préservation des milieux aquatiques, est un préalable nécessaire à la satisfaction durable des usages listés dans l’article L.211-1 du code de l’environnement (prévention des inondations, production d’énergie…). Ces nombreux ouvrages et notamment leur absence de gestion perturbent la continuité écologique. Leur présence modifie le régime hydrologique des cours d’eau et fait barrage à la libre circulation sédimentaire et piscicole. Cette dernière notion, introduite sous le terme de « continuité écologique » par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en 2000, se définit pour les milieux aquatiques comme « la libre circulation des espèces biologiques et le bon déroulement du transport naturel des sédiments » Ainsi, afin de mieux comprendre le fonctionnement de la Risle moyenne, l’association syndicale de la moyenne vallée de la Risle a mandaté le bureau d’étude ECO ENVIRONNEMENT CONSEIL, pour réaliser l’état des lieux et le diagnostic hydromorphologique de la Risle et de ses ouvrages, qui a fait l’objet de la présente étude. -

Évreux Pont-Audemer Honfleur
ÉVREUX PONT-AUDEMER 380 HONFLEUR HORAIRES VALABLES DU 1ER SEPTEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022 INCLUS Di & Fériés Lu au Ve Lu au Sa Lu au Sa Lu au Sa S Saisonnier(3) Période de fonctionnement PS TA PS - PVS Correspondance à Evreux/ Gare routière EVREUX / Gare Routière (4) - 08:00 09:20 09:45 - 13:00 16:50 EVREUX / Maréchal Foch - 08:03 09:23 09:48 - 13:03 16:53 GAUVILLE / Pont - 08:11 09:31 09:55 - 13:10 17:01 GAUVILLE / Eglise - 08:12 09:32 09:56 - 13:11 17:02 BACQUEPUIS / Carrefour RD93-RD60 - 08:16 09:36 10:00 - 13:15 17:06 QUITTEBEUF / Eglise - 08:19 09:39 10:04 - 13:18 17:09 SAINT AUBIN D'ECROSVILLE / RD39 - 08:28 09:45 10:09 - 13:22 17:13 LE NEUBOURG / Office de Tourisme - 08:34 09:51 10:15 - 13:26 17:18 LE NEUBOURG / Place du Vieux Château - 08:36 09:53 10:17 - 13:28 17:20 ROUGE PERRIERS / RD137 - 08:41 09:58 10:22 - 13:35 17:25 HARCOURT / Eglise - 08:45 10:03 10:25 - 13:38 17:28 CALLEVILLE / Carrefour RD137-RD26 - 08:50 10:07 10:30 - 13:42 17:33 BRIONNE / Ave du General Leclerc - 08:53 10:11 10:35 - 13:46 17:38 LE BEC-HELLOUIN / ST MARTIN DU PARC - RD39 - 08:59 10:18 10:40 - 13:53 17:46 LE BEC-HELLOUIN / Centre - 09:02 10:22 10:42 - 13:55 17:50 PONT-AUTHOU / Camping - 09:06 10:26 10:46 - 13:59 17:54 PONT-AUTHOU / Eglise - 09:07 10:27 10:47 - 14:00 17:55 GLOS SUR RISLE / Mangeants - 09:09 10:29 10:49 - 14:02 17:57 GLOS SUR RISLE / Mairie - 09:10 10:30 10:50 - 14:03 17:58 GLOS SUR RISLE / Forge - 09:12 10:32 10:52 - 14:05 17:56 MONFORT SUR RISLE / Place Annonciades - 09:15 10:35 10:58 - 14:10 17:59 APPEVILLE-ANNEBAULT / La Poste - 09:20 -

1 Arrival of the House of Wessex the Invaders of the 5Th and 6Th
1 Arrival of the House of Wessex The invaders of the 5th and 6th Centuries famously came from 3 tribes - the Jutes, Angles and Saxons, and each formed kingdoms that eventually became the 7 English Kingdoms - or the Heptarchy. At first the Britons appealed to Rome to come back and help them. They sent a piteous note to Aetius, the last effective Roman general which read: ‘ The Barbarians push us back to the sea, the sea pushes us back to the barbarians; between these two kind of deaths we are either drowned or slaughtered’. Who was Cerdic ? The background of the founder of the British Monarchy is not simple. Cerdic is a British name, not Saxon. So who was he ? He may simply have had a British mother - and so be a Saxon with a British name. Or he may have been a local Romano British official. Or maybe he was a British prince come to seek his fortune. Cerdic arrived at the mouth of the River Test, and over the next 6 years he fought the local British kings, as you can see in the map. These culminated in the battle at Netley Marsh, where he defeated Nathanleod. Cerdic died in 534, was buried at Hurstboourne Tarrant in Hampshire, and handed the kingdom on to his Grandson, Cynric. 2: The West Saxon Bretwalda Cynric, King of Wessex 534 - 560 Cerdic's grandson, Cynric, took over the leadership on Cerdic's death. During this time the kingdom of Arthur - or some other British warlord - remained stromg. But in the 550's we see a change. -

L'etrier Beaumontais Recto.Indd
v 2 Randonnées au pays RISLE CHARENTONNE CIRCUIT DE LA FORÊT DE BEAUMONT (8 KM) CIRCUIT DU HOM (9 KM) LE BOUCHE A OREILLE Situé dans l’ancienne église de Vieilles à Beamont-le-Roger, le long de la vallée de la Risle, le gourmand ou le chineur décou- vrira pêle-mêle, dans une joyeuse harmonie de couleurs et de musiques, tartines chaudes, dîners-spectacles, tapas grignotines, galerie d’art, bric à brac, cave à vin, boutique du terroir (02.32.45.57.27). Circuits au départ du Centre équestre l’Etrier Beaumontais - Beaumont-le-Roger - Tél : 02 32 45 23 25 Circuit du Hom Circuit de la forêt de Beaumont Les Essentiels Distance : 8 km Distance : 9 km Durée : 2 heures à 3 heures Durée : 1 à 2 heures • Hébergements : Balisage : aucun Balisage : bleu en partie (PR) Carte IGN : 1913 O Carte IGN : 1913 O Beaumont-le-Roger : Hostellerie du Lion d’Or Tél : 02 32 46 54 24 BEAUMONT-LE-ROGER Hôtel de la Gare LE CHATEAU DU CHAMP DE BATAILLE Tél : 02 32 45 23 35 Dans la vallée verdoyante de la Risle, Beaumont-le-Roger est une très ancienne Au milieu d’un parc de 100 hectares, ce superbe château ducal du cité, antérieure à l’occupation romaine. Le nom de Roger dans le patronyme du Beaumontel : XVIIème siècle est l’une des plus fastueuses demeures de Normandie. village vient de son fondateur, conseiller de Guillaume le Conquérant. Roger de gîtes ruraux de A l’intérieur, son riche décor, son mobilier et tout particulièrement Beaumont fi t également élever un puissant château-fort sur la colline ainsi que M. -

Grosley-Sur-Risle > Église
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de l'Eure (DRAC Normandie) Conseil ISSN 2492-9727 n°99 – ZFSP – 27 fév. 2019 – Alexia BOUTIGNY - Marie BUCHOU - France POULAIN Grosley-sur-Risle > Église Les périmètres de protections du L'église de Grosley-sur-Risle est inscrite en tant que monument historique depuis le 25 château de la Vacherie à Barquet, octobre 1954. La protection couvre l'ensemble de l'édifice (intérieur et extérieur). l’église de Barc, et le manoir du Cet édifice participe à la beauté des paysages eurois et à la richesse du patrimoine de la Hom à Beaumont-le-Roger France. Au cours des siècles, les constructions, qui sont venues se greffer ou s’agglomérer débordent partiellement sur la commune. aux alentours, l’ont été dans le cadre d’une structure sociale : la paroisse. Ces constructions constituent des références en matière d’architecture locale, car elles sont bien souvent faites avec des matériaux locaux : tuiles ou ardoises (à partir du XIXe siècle), pierres (silex, grison, vallée de seine, grès…), briques ou torchis, enduit à la chaux et des sables ou terres proches. Cela donne des couleurs qui vont souvent du beige au marron ou au rouge, et des volumes tout à fait adaptés au climat normand (pente des toits…). Ces églises ont fait l’objet d’un travail spécifique d’analyse car leurs abords ne sont pas complètement urbanisés et que les espaces de vides ou de respirations qui se trouvent à proximité participent à préserver leur écrin. Zonage Prescriptions De manière générale, il est préférable d’éviter les constructions qui viendraient au-dessus de la ligne de paysage existante (mais à deux niveaux plus combles, bâtiments agricoles de type silo, château d’eau, éolienne…). -

Eure 28 Normandie 251 700 40 238 166 273 123 166 273 267 166 273 410 45 189 247 45 189 493 45 189 740 251 700 211 462 101 639 209 481
Montant Montant moyen Montant Montant Montant Montant moyen Nombre de économisé Nombre de moyen Montant moyen moyen moyen économisé Nombre de foyers par les foyers économisé moyen Nombre de Nombre de économisé Nombre de économisé Nombre de économisé par les foyers Nombre de Nombre de parmi les foyers parmi les par les économisé foyers foyers par les foyers par les foyers par les foyers parmi les foyers Montant de foyers 20% les plus parmi les 20% les plus foyers Dont non par les soumis à la concernés foyers concernés foyers concernés foyers parmi les 20% les plus concernés la Code Libellé du exonérés de aisés 20% les plus aisés parmi les exonérés foyers Libellé de la Taxe par la concernés par la concernés par la concernés 20% les plus aisés par la suppression départemen départemen Code région Taxe concernés aisés concernés 20% les plus avant concernés région d'habitation suppression par la suppression par la suppression par la aisés concernés suppression de la TH en t t d'Habitation par la concernés par la aisés réforme (en par la pour de 30% de suppression de 65% de suppression de 100% de suppression concernés par la de la taxe 2023 (avant suppression par la suppression concernés nombre) suppression résidence la TH en de 30% de la TH pour de 65% de la TH pour de 100% de par la suppression d'habitation (euros) réforme) de 30% de suppression des 2/3 de par la complète de principale 2018 la taxe 2019 la taxe 2020 la taxe suppression de la TH en en 2023 la TH en de 30% de la TH en suppression la TH en d'habitation d'habitation d'habitation -

Liste Des Communes Dans Les Bassins Versants
NOM DES COMMUNES N° INSEE Bassins-Zones d'alerte ACLOU 27001 Risle aval ACON 27002 Avre moyen ACQUIGNY 27003 Iton aval AIGLEVILLE 27004 Eure moyenne AILLY 27005 Eure moyenne AIZIER 27006 Risle aval AJOU 27007 Risle amont ALIZAY 27008 Andelle AMBENAY 27009 Risle amont AMECOURT 27010 Epte AMFREVILLE-LA-CAMPAGNE 27011 Risle aval AMFREVILLE-LES-CHAMPS 27012 Andelle AMFREVILLE-SOUS-LES-MONTS 27013 Epte AMFREVILLE-SUR-ITON 27014 Iton aval ANDE 27015 Epte ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE 27017 Eure moyenne APPEVILLE-ANNEBAULT 27018 Risle aval ARMENTIERES-SUR-AVRE 27019 Avre amont ARNIERES-SUR-ITON 27020 Iton aval ASNIERES 27021 Calonne AUBEVOYE 27022 Eure moyenne AULNAY-SUR-ITON 27023 Iton aval AUTHEUIL-AUTHOUILLET 27025 Eure moyenne AUTHEVERNES 27026 Epte AUTHOU 27028 Risle aval AVIRON 27031 Iton aval AVRILLY 27032 Iton aval BACQUEPUIS 27033 Iton aval BACQUEVILLE 27034 Andelle BAILLEUL-LA-VALLEE 27035 Calonne BALINES 27036 Avre amont BARC 27037 Risle amont BARNEVILLE-SUR-SEINE 27039 Risle aval BARQUET 27040 Risle amont BARVILLE 27042 Calonne BAZINCOURT-SUR-EPTE 27045 Epte BAZOQUES 27046 Risle aval BEAUBRAY 27047 Iton amont BEAUFICEL-EN-LYONS 27048 Andelle BEAUMESNIL 27049 Risle amont BEAUMONTEL 27050 Risle amont BEAUMONT-LE-ROGER 27051 Risle amont BEMECOURT 27054 Iton amont BERENGEVILLE-LA-CAMPAGNE 27055 Iton aval BERNAY 27056 Charentonne NOM DES COMMUNES N° INSEE Bassins-Zones d'alerte BERNIENVILLE 27057 Risle aval BERNIERES-SUR-SEINE 27058 Eure moyenne BERNOUVILLE 27059 Epte BERTHENONVILLE 27060 Epte BERTHOUVILLE 27061 Risle aval BERVILLE-EN-ROUMOIS -

(Re)Découvrir
Vers Amiens Étretat C'est ici ! (Re)découvrir Le Havre Rouen Pont-AudemerPont-Audemer et le Val de Risle Honfleur Deauville Pont-Audemer EN Normandie Montfort-sur-Risle Bec-Hellouin Lisieux Fourmetot Vers Caen Vers Paris Manneville- sur-Risle Office de Tourisme Office de Tourisme Admirer les vestiges du passé - Circuits patrimoine 4 - 9 de Pont-AudemerTriqueville Val de Risle Illeville- 2 place du Général de Gaulle 5 place des Annonciades Admirer les vestiges dusur-Montfort passé 27500 Pont-Audemer 27290 Montfort-sur-Risle Admirer les vestiges du passé - Patrimoine médiéval 10 - 13 02 32 41 08 21 02 32 56 35 76 Campigny [email protected] [email protected] Découvrir le patrimoine A découvrir ... - Les circuits touristiques 14 - 23 Condé- Touville- Toute l’année : Selles D’avril à fin octobre : sur-Risle ouvert du lundi au samedi ouvert du mardi au samedi sur-Montfort Percevoir la lumière des impressionnistes 24 - 25 de 9h30 à 12h30 / 14h à 17h30 de 9h30 à 12h30 / 14h30 à 18h Percevoir la lumière des Impressionnistes Les jours fériés de 10h à 12h De novembre à fin mars : Montfort- Ecaquelon Musarder le long de la vallée 26 - 31 sur-Risle du lundi au vendredi De juin à septembre : sur-Risle de 9h30 à 12h30 / 14h30 à 17h30 les dimanches de 10h à 12h Taquiner le poisson Explorer les trésors de la forêt 32 - 33 Fermé le jeudi après-midi Glos- sur-Risle Thierville Au fil de l'eau ... 34 - 39 S’aventurer au fil de l’eau Affûter son esprit, son corps et sa curiosité 40 - 43 Musarder le long de la Vallee Marchés et produits du terroir, spécialités 44 - 47 Freneuse- Retrouvez toutes nos manifestations et sur-Risle- Pont- notre actualité sur nos pages facebook ! Authou Explorer les trésors de la forêt Savoir-faire et faire savoir .. -

Cie Pont-Audemer Cie Louviers Cie Bernay Cie Evreux Cie
BP QUILLEBEUF-Quillebeuf- SUR-SEINEsur-Seine Saint-Aubin- sur-Quillebeuf Saint-Samson- Marais- Berville- Vernier de-la-Roque Aizier Vascœuil sur-Mer Sainte-Opportune- Vieux- la-Mare Port Le Tronquay Fatouville- Conteville Perruel Trouville- Sainte-Croix- Fleury- Grestain la-Haule sur-Aizier Letteguives Les Hogues la-Forêt Lorleau Fiquefleur- Saint- Tocqueville Le Landin Équainville Thurien La Haye- Perriers- Saint-Ouen- de-Routot sur-Andelle Bosquentin Saint-Pierre- Foulbec Bouquelon Beauficel- des-Champs La Haye- du-Val Bourneville Hauville BPLyons- LYONS-LA- en-Lyons Lilly Aubrée Bézu- Bouchevilliers Barneville- Renneville la-Forêt FORET la-Forêt Martagny Charleval Saint-Sulpice- Saint-Mards- Fourmetot COBRoutot ROUTOT sur-Seine Mesnil- Bourg- Manneville- Boulleville de-Grimbouville de-Blacarville Étréville Honguemare- sous- Guenouville Beaudouin Vandrimare la-Raoult Éturqueraye Rosay- Vienne Manneville- Amécourt Saint- Valletot Caumont sur-Lieure Morgny Mainneville Toutainville sur-Risle Rougemontiers La Trinité- Maclou Cauverville- de-Thouberville COB FLEURY-SURFleury- Saint-Germain- Pont- en-Roumois Bouquetot sur-Andelle La Neuve- COB PONT-AUDEMER Bosgouet Ménesqueville Grange Village Saint-Ouen- Radepont Lisors Puchay Audemer Corneville- Colletot ANDELLE Hébécourt de-Thouberville Longchamps Sancourt sur-Risle Le Torpt Brestot Bourg- Pont- Touffreville Triqueville Flancourt- Saint-Pierre Grainville Fort- Achard BP BEUZEVILLEBeuzeville Catelon Nojeon- Moville Les Préaux Romilly- Gaillardbois- Coudray Tourville-sur- Appeville- Pîtres -

Meta UH Bassin De La Risle
3.3 BASSIN DE LA RISLE 142 143 BASSIN DE LA RISLE 3ème PARTIE LES ACTIONS PRIORITAIRES PAR META UH 144 145 BASSIN DE LA RISLE 144 145 BASSIN DE LA RISLE 3ème PARTIE LES ACTIONS PRIORITAIRES PAR META UH Sav21 - RISLE 2 300 km2 Ce grand bassin versant est caractérisé par une forte et de la Risle maritime (T07) est déclassé du fait d’une problématique pollutions diffuses, due à la fois à contamination par les HAP. une agriculture céréalière intensive à l’est (orientée 177 000 L’existence de zones protégées au titre de Natura davantage élevage à l’ouest) et à un habitat dispersé. 2000 (la vallée de la Corbie, les Vallées de la Risle, habitants La Risle - et ses affluents en partie basse - sont inté- de la Guiel et de la Charentonne, le Marais Vernier et gralement classés au titre du L432-6 pour la restau- basse vallée de la Risle) renforce l’enjeu de préserva- km ration de la libre circulation des poissons migrateurs, 421 tion des milieux aquatiques et humides des vallées. mais le décret de désignation des espèces n’est pas de cours Le développement de l’activité canoë-kayak existante pris sur la partie moyenne du cours de la Risle. d’eau est possible, sous réserve du respect du fonctionne- Le bon état écologique de la Charentonne (R267) et ment écologique de la rivière. de la Risle aval (R268) doit être préservé. Aucun enjeu La masse d’eau souterraine 3212 (91 % de la surface particulier n’a été identifié comme faisant atteinte au de l’UH) ne présente pas de contamination chimique, bon état sur le ruisseau de la Corbie (R270) ni sur le ni de déséquilibre quantitatif. -

CC Intercom Bernay Terres De Normandie (Siren : 200066413)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC Intercom Bernay Terres de Normandie (Siren : 200066413) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Bernay Arrondissement Bernay Département Eure Interdépartemental non Date de création Date de création 28/09/2016 Date d'effet 01/01/2017 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Nicolas GRAVELLE Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 299 rue du Haut des Granges Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 27300 Bernay Téléphone 02 32 43 50 06 Fax 02 32 43 56 44 Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF oui Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) oui Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 56 434 1/5 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 62,49 Périmètre Nombre total de communes membres : 75 Dept Commune (N° SIREN) Population 27 Aclou (212700017) 334 27 Barc (212700371) 1 225 27 Barquet (212700405) 454 27 Beaumontel (212700504) 662 27 Beaumont-le-Roger (212700512) 2 851 27 Bernay (212700561) 10 290 27 Berthouville (212700611) 324 27 Berville-la-Campagne (212700637) 249 27 Boisney (212700744) 288 27 Bosrobert (212700959) 673 27 Bray (212701098) 405 27 Brétigny (212701130) 138 27 Brionne (212701163)