12-MONOGRAPHIE-Pommereuil.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tryptique Plateforme-Sante 2017.Pdf
ASSOCIATION ACTION : 7, rue du 19 mars 1962 SITUATION S DE S ANTÉ PRÉCAIRE ET /OU 59129 Avesnes les Aubert OB S TACLE S À L’EMPLOI : N ACCOMPAGNEMENT DAN S LA PRI S E Téléphone : 03.27.82.29.82 - Télécopie : 03.27.82.29.89 PROJET EMPLOI PLATEFORME SANTÉ U Courriel : [email protected] EN COMPTE ET LA RÉ S OLUTION . Site Internet : www.association-action.org La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. Plateforme Santé - Territoire d'intervention 2017 LEGENDE : Limite de Communauté (Constitutions - 1946) Limite de Commune SOMMAING VENDEGIES UTPAS Cambrai Marcoing SUR ECAILLON HEM BERMERAIN AUBENCHEUL PAILLENCOURT UTPAS Avesnes- Solesmes LENGLET AU BAC FRESSIES SAINT MARTIN ESTRUN SAULZOIR CAPELLE UTPAS Caudry-Le Cateau SUR ECAILLON ACTION ABANCOURT BANTIGNY THUN VILLERS MONTRECOURT IWUY L'EVEQUE EN CAUCHIES ESCARMAIN BLECOURT THUN HAUSSY Réalisation CUVILLERS SAINT MARTIN ESWARS VERTAIN SANCOURT HAYNECOURT SAINT AUBERT CC du Pays du Solesmois RAMILLIES NAVES RIEUX SAILLY TILLOY ROMERIES SAINT LEZ CAMBRAI LEZ CAMBRAI SAINT-VAAST PYTHON RAILLENCOURT ESCAUDOEUVRES AVESNES-LES- STE OLLE NEUVILLE CAGNONCLES AUBERT SAINT-HILAIRE ST REMY LEZ CAMBRAI BEAURAIN SOLESMES FONTAINE CAUROIR BOUSSIERES NOTRE DAME CARNIERES CAMBRAI MOEUVRES BEVILLERS QUIEVY ANNEUX PROVILLE AWOINGT VIESLY BRIASTRE ESTOURMEL CANTAING CA de Cambrai BETHENCOURT /ESCAUT BOURSIES NOYELLES NIERGNIES BEAUVOIS /ESCAUT CATTENIERES NEUVILLY DOIGNIES RUMILLY FONTAINE AU BEAUMONT FLESQUIERES -

Plu Walincourt-Selvigny
9 6 d v 00001 0 e Rue des Charmilles o Terrain l d 'A b N multisports e C 4 s a 7 100 b m D Ferme é e z b Résidence Sa r n a Albert in 00005 t t i les Belles Terres s - e 5 A O e Dupont D1 u v d b e C t 100 i R er s t F io t e u Salle polyvalente h r u 00007 a R e R Chapelle e o 17626 iq Résidence Eglise de la nativité u n u l ie e 00022 M r R s b e u 00006 des Quatre Vents ap o u 100 R de la sainte vierge d 17614 17615 17616 00011 17618 17619 a 17620 17621 n 17622 17623 17624 17625 OUATINOR p 17627 17628 17613 00006 R L n é e Rue François e 17617 e 100 u r u R i h R 100 Cambrai u e e in i TISSU d ic è v r i a Richez M B l t r a e o 100 100 R r é l t i r u a s Ferme de u n co r P MATELASSE broderie R a R a au Mairie 00003 t l C e d H in en d' ie he d l'Eauette - t d e M r m 00004 impression u d R b 00005 ie n Place in e L u t 100 u a u Dominique a a Chapelle l r L r e e R ou François gra G 100 00002 G n e Haudegon-Haussy Ferme du grand e c d Cimetière civil d Rue 0N00e05 u u 100 uve é d l a Richez e 00020 R l u riot - Loïc 'H Ferme Jean Rue de la Renaissance R Nord t a C u r d 100 100 e y V e M a a Decaudin-Basquin r Galand-Gosselet Ferme u s Coopérative e u 100 B R o o a m l l Spice g e Maxel d d C u n Jean-Michel ns b e r t l e e agricole t e i i e ll i D e Rue de Lesdain a n o r h céréales u d d u u L m a R e v n m Masson u Ferme 00023 6 i e t R R D i e 00007 l e v e a a n e o i 1 R t o v R J Q 1 F -P b d u C ac Dominique t q D i o d u a o l n R a 1 u r t ra r e t e s 100 t a e G a e u 8 e 100 Godin-Quennesson adhap u R R t u n u d -

American Armies and Battlefields in Europe 533
Chapter xv MISCELLANEOUS HE American Battle Monuments The size or type of the map illustrating Commission was created by Con- any particular operation in no way indi- Tgress in 1923. In carrying out its cates the importance of the operation; task of commeroorating the services of the clearness was the only governing factor. American forces in Europe during the The 1, 200,000 maps at the ends of W or ld W ar the Commission erected a ppro- Chapters II, III, IV and V have been priate memorials abroad, improved the placed there with the idea that while the eight military cemeteries there and in this tourist is reading the text or following the volume records the vital part American tour of a chapter he will keep the map at soldiers and sailors played in bringing the the end unfolded, available for reference. war to an early and successful conclusion. As a general rule, only the locations of Ail dates which appear in this book are headquarters of corps and divisions from inclusive. For instance, when a period which active operations were directed is stated as November 7-9 it includes more than three days are mentioned in ail three days, i. e., November 7, 8 and 9. the text. Those who desire more com- The date giYen for the relief in the plete information on the subject can find front Jine of one division by another is it in the two volumes published officially that when the command of the sector by the Historical Section, Army W ar passed to the division entering the line. -

Milton's War Trophy #9563
Milton’s War Trophy #9563 - The 3rd Canadian Infantry Battalion at the Canal du Nord in September 1918 By Richard Laughton Most Canadians, like me, probably thought that the armaments that adorn our local parks, cenotaphs and memorials are Canadian. While researching the background to our “Milton War Trophy”I asked numerous friends, Legion Comrades and Veterans about our Milton Victoria Park War Trophy. Only one person knew it was of German origin, captured during the Great War (WW1 1914-1919). Specifically, it was captured during the famous period of “Canada’s Hundred Days”, from August 8th to November 11th 1918. This is the incredible story of the capture of that gun by the 3rd Canadian Infantry Battalion on Friday September 27th 1918. Lt. G. V. Laughton, M.C. Bill Smy of the Canadian Expeditionary Force Study Group (CEFSG) has written an excellent summary of history of War Trophies in Canada. For further details on that document, please refer to Note 1. The Milton War Trophy was captured by the 3rd Canadian Infantry Battalion, 1st Brigade, 1st Canadian Division during “Canada’s Hundred Days” 1. During this period the Canadian Expeditionary Force advanced through the Hindenburg Line to Cambrai, ending the stalemate of “Trench Warfare”. Specifically the Canadians crossed the Canal du Nord and captured Bourlon Wood, and in doing so captured a German Field Gun #9563, Milton’s War Trophy. More pictures of Milton’s War Trophy On-Line The battles that were fought by the Canadians to end the First World War were not inconsequential. As Christie reported 2, the final 100 days of the Great War accounted for one-fifth (20 percent) of all Canadian casualties during the war. -

Définition De L'aire D'étude
Schéma territorial éolien du Cambrésis DEUXIEME PARTIE : VOLET PAYSAGER Volet Paysager 41 Schéma territorial éolien du Cambrésis APPROCHE GLOBALE Source : Trame verte du Conseil Régional I - L’occupation du sol I - 1 - Une occupation du sol organisée sur la logique d‟un réseau de déplacement historique Dans la publication parue en décembre 1990 URBANISATION AGRESTE estime à 62% le pourcentage d‟exploitations qui pratiquent les grandes cultures contre environ 20 % les cultures liées à l‟élevage et 3 % l‟horticulture. Cette occupation des sols donne un aspect d’ouverture au paysage du Cambrésis, openfield (confère également carte page suivante). VEGETATION La lecture de la photo satellite ci-dessus montre que l‟occupation spatiale des parcelles est assez originale. En effet, les champs autour des villes et des villages ont une structure concentrique. Cet agencement ne se rencontre que dans l‟Artois et le Cambrésis. On distingue deux types de végétation, l’une dans les vallées et l’autre sur les plateaux. La végétation des vallées est liée à l’humidité du sol. Les principales essences arborescentes rencontrées Source : Cabinet DELVAUX sont : le Saule blanc et Saule fragile, l‟Aune glutineux, le Frêne élevé, l‟Orme. Les plantations de peupliers occupent une place prépondérante. Tout comme les bois et l’horizon dense des vallées, les villages et En plus de cette présence d‟arbres nous trouvons de vastes surfaces les bourgs du Cambrésis se posent comme des masses aux marécageuses et tourbeuses. contours bien lisibles. Structurés par la trame viaire (confère II - Les infrastructures terrestres et aériennes), et un parcellaire La végétation naturelle du plateau est en revanche plus retreinte. -

Horaires De La Ligne 850S
LIGNE 850 Horaires valables du 02/09/2021 au 06/07/2022 850 - Mazinghien / Le Cateau Course N° 10 20 30 Jours de circulation LMaMe LMaMe LMaMe Validité du JVS JVS JVS 02/09/2021 au 06/07/2022 Période scolaire (PS) Vacances scolaires (VS) MAZINGHIEN Eglise 06h47 07h52 13h25 REJET-DE-BEAULIEU Louviere 06h49 07h54 13h27 REJET-DE-BEAULIEU Eglise 06h51 07h56 13h29 REJET-DE-BEAULIEU Petit cambresis 06h52 07h57 13h30 LA GROISE Chapeau rouge 06h55 08h00 13h34 LA GROISE Route de guise 06h56 08h01 13h35 LA GROISE Mairie 06h57 08h02 13h36 LA GROISE Rue de catillon 06h58 08h03 13h37 LA GROISE Moulin 06h59 08h04 13h38 CATILLON-SUR-SAMBRE Laiterie 07h00 08h05 13h39 CATILLON-SUR-SAMBRE Centre 07h02 08h07 13h41 CATILLON-SUR-SAMBRE Poste 07h04 08h09 13h43 ORS Rue verte 07h11 08h16 13h46 ORS Centre 07h13 08h18 13h48 BAZUEL Centre 07h16 08h21 13h51 BAZUEL Cite 07h17 08h22 13h53 POMMEREUIL Saint andre 07h21 08h26 13h55 POMMEREUIL Place combattants 07h22 08h27 13h56 POMMEREUIL Ecole 07h23 08h28 13h57 POMMEREUIL Rue du cateau 07h24 08h29 13h58 LE CATEAU-CAMBRESIS Zone industrielle 07h26 08h31 14h00 LE CATEAU-CAMBRESIS Faubourg landrecies 07h27 08h32 14h01 LE CATEAU-CAMBRESIS Gare routiere 07h28 08h33 LE CATEAU-CAMBRESIS Gare 07h35 08h40 LE CATEAU-CAMBRESIS Octroi Faidherbe 07h37 08h42 LE CATEAU-CAMBRESIS Marechal mortier 07h38 08h43 14h04 LE CATEAU-CAMBRESIS Gare 14h09 LE CATEAU-CAMBRESIS Octroi Faidherbe 14h10 LE CATEAU-CAMBRESIS Gare routiere 14h13 LIGNE 850 Horaires valables du 02/09/2021 au 06/07/2022 850 - Le Cateau / Mazinghien Course N° 11 21 33 35 -

Sélection Des Manifestations Du Cambrésis - Jeudi 18 Septembre 2014 Bonjour, Newsletter Touristique Du Cambrésis
Merci de ne pas marquer ce message comme SPAM, pour vous désabonner cliquez ici. Pour nous contacter, merci de ne pas répondre à ce message mais d'utiliser [email protected] Pour vous assurer de recevoir nos newsletters, nous vous conseillons d'ajouter [email protected] à votre carnet d'adresse. Sélection des manifestations du Cambrésis - Jeudi 18 septembre 2014 Bonjour, Newsletter Touristique du Cambrésis Le Patrimoine a la vedette ce week-end : églises, tank, scie hydraulique, moulin, abbaye, chapelles,... plus d'une quarantaine de visites et animations vous sont proposées rien que dans le Cambrésis !!! C'est le moment ou jamais de pousser les portes des monuments ! A la semaine prochaine. Evènements et visite en Cambrésis Journées européennes du patrimoine dans le Cambrésis Pour cette 31e édition, à travers le thème " Patrimoine culturel - Patrimoine naturel ", de nombreuses animations sont proposées pour faire de chaque visite un moment exceptionnel et permettre aux visiteurs d'accéder, parfois pour la première fois mais aussi de redécouvrir sous un nouveau jour des lieux qui leur semblaient familiers. Les samedi 20 et dimanche 21 septembre, communes recensées dans le Cambrésis participant aux Journées Européennes du Patrimoine : Abancourt, Aubencheul-au-Bac, Briastre, Cambrai, Caudry, Esnes, Flesquières, Honnecourt-sur-Escaut, Le Cateau-Cambrésis, Les Rues des Vignes, Masnières, Ors, Proville, Solesmes, Walincourt-Selvigny : autant de lieux à découvrir et à apprécier. Le programme complet est à consulter sur : www.tourisme-cambresis.fr/agenda Attention, certaines visites nécessitent une réservation préalable... Visite de la Brasserie historique Samedi 20 septembre de 10h à 11h et de 15h à 16h, 16 rue du Marché aux Chevaux au Cateau-Cambrésis. -

Horaires Valables Du 01/09/2016 Au 31/08/2017
En correspondance avec les réseaux Horaires valables du 01/09/2016 au 31/08/2017 TARIFS 301 Le Cateau - Cambrai Retrouvez la gamme tarifaire sur www.arcenciel3.fr Course numéro 1 3 5 7 9 11 13 25 15 17 19 23 21 sur le site internet du Département du Nord lenord.fr L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me Jours de circulation DF DF M DF ou contactez-nous au J V J V S J V S J V J V S J V S J V J V J V S Particularités le 15/08 LE CATEAU CAMBRESIS Gare 05:45 06:30 07:00 07:35 08:35 12:55 09:00 14:00 14:00 17:00 Achetez vos titres LE CATEAU CAMBRESIS Octroi Boyer 05:46 06:31 07:01 07:36 08:36 12:56 09:01 14:01 14:01 17:01 TITRES DE TRANSPORT LE CATEAU CAMBRESIS Gare routière 05:50 06:40 07:10 07:45 08:45 13:0517:15 17:15 18:15 09:08 14:08 14:08 17:08 Pour recharger vos supports sans contact Pass Pass et rechargez votre carte pass pass nominative en ligne LE CATEAU CAMBRESIS Faubourg de Cambrai 05:53 06:43 07:13 07:48 08:48 13:08 17:18 17:18 18:18 09:10 14:10 14:10 17:10 (carte nominative, déclarative, anonyme TROISVILLES Carrefour 06:5007:20 07:55 08:55 13:1517:25 17:25 18:25 09:17 14:17 14:17 17:17 ou billet sans contact) en vous connectant TROISVILLES Eglise 06:5107:21 07:56 08:56 13:1617:26 17:26 18:26 09:18 14:18 14:18 17:18 ou obtenir un billet sans contact, rendez-vous sur arcenciel3.fr dans l’un des points de vente Arc en Ciel 3 suivants : TROISVILLES Chapelle 06:5207:22 07:57 08:57 13:1717:27 17:27 18:27 09:19 14:19 14:19 17:19 INCHY Eglise 05:58 06:5807:28 08:04 09:04 13:2317:33 17:34 18:33 09:23 14:23 14:23 -

Note Aux Rédactions
Vendredi 7 août 2020 - NOTE AUX RÉDACTIONS - [INFO TRAVAUX] Travaux d’entretien - Réalisation d’enduits superficiels (gravillonnage) Arrondissement de Cambrai Gestionnaire de près de 4 500 kilomètres de routes, le département du Nord agit chaque jour pour les rendre plus sûres et confortables. Dans le cadre de son programme d’amélioration des routes départementales, le Département procédera à des travaux de renouvellement de la couche de surface de la chaussée par la pose d’un enduit superficiel d’usure (gravillonnage). Cette technique redonne de l’adhérence à la chaussée tout en préservant la chaussée d’infiltrations. Les travaux, situés hors agglomération, s’effectueront entre le lundi 24 août et le vendredi 4 septembre 2020 par chantier d’une durée de 1 à 2 jours, sous réserve de conditions climatiques favorables et des aléas de chantier. Il se dérouleront successivement en chantiers mobiles entre 7 heures et 20 heures avec une remise sous circulation, sur les sections reprises ci-après : TRAVAUX SOUS DEVIATION DE CIRCULATION RD111 dite « Rue d’Elincourt » et « rue d’Avelu » sur le territoire des communes de Elincourt et de Maretz. Durée d’intervention : 1 à 2 jours Pendant les travaux, une déviation sera mise en place de 7h à 20h. Dans le sens Elincourt vers Maretz et inversement : La RD111 « Rue d’Elincourt » et « rue d’Avelu » sera fermée à la circulation. La déviation empruntera la RD45 (Rue de l’Eglise, Grand Rue) jusqu’au carrefour des RD45/15 puis la RD15 (Route de Maretz), où se situera la fin de la déviation. Montant des travaux : 36 500 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord. -
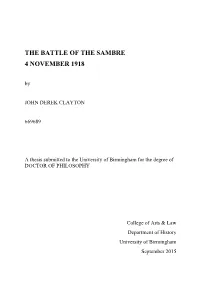
THE BATTLE of the SAMBRE 4 NOVEMBER 1918 By
THE BATTLE OF THE SAMBRE 4 NOVEMBER 1918 by JOHN DEREK CLAYTON 669689 A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY College of Arts & Law Department of History University of Birmingham September 2015 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Acknowledgements The completion of a PhD thesis can be at times a solitary occupation: the completion of this one would never have been possible, however, without help from a number of sources on the way. My thanks go particularly to my supervisor, Dr John Bourne, for his direction, support, encouragement and unfailingly wise counsel. I would also thank Professor Peter Simkins who supervised my MA dissertation and then suggested the Battle of the Sambre as a subject ripe for further study. He then kindly supplied data on the performance of divisions in the Hundred Days and permitted me to use it in this work. Thanks must also go to the staffs of the National Archive, the Imperial War Museum and the Bundesarchiv – Militärarchiv in Freiburg. Fellow PhD students have been a constant source of friendship and encouragement: my grateful thanks to Geoff Clarke, who allowed me to use some of his doctoral research on logistics, and to Trevor Harvey, Peter Hodgkinson, Alison Hine and Michael LoCicero. -

Palais Des Sports Aurélie Chatelain
Palais des sports Aurélie Chatelain Cambrai Caudry 18 11- CAUDRY 0007 sans changement Boulevard Dunant Palais des sports Aurélie Chatelain Cambrai Caudry 18 11-CAUDRY 0008 sans changement Boulevard Dunant Cambrai Cauroir 18 11-CAUDRY 0001 (unique) sans changement Salle des Fêtes Cambrai Clary 18 10 - CATEAU CAMBRESIS (le) 0001 (unique) sans changement Salle polyvalente, Place des Ecossais Salle polyvalente Cambrai Doignies 18 9- CAMBRAI 0001 (unique) sans changement Place de la mairie Salle des Fêtes Cambrai Esnes 18 10 - CATEAU CAMBRESIS (le) 0001 (unique) sans changement Rue de /'Industrie Salle des fêtes« Jean Lefer » Cambrai Estourmel 12 11- CAUDRY 0001 sans changement Rue de la Herse 0001 Cambrai Flesquieres 18 10 - CATEAU CAMBRESIS (le) sans changement salle des fêtes Salle Polyvalente Jean Marie LEMAIRE Cambrai Fontaine-Au-Pire 12 10 - CATEAU CAMBRESIS (le) 0001 (unique) sans changement Rue Gambetta Salle des Fêtes Cambrai Fontaine-Notre-Dame 18 9- CAMBRAI 0001 (unique) sans changement Rue Roger Salengro Salle des Fêtes Cambrai Gouzeaucourt 18 10- CATEAU CAMBRESIS (le) 0001 (unique) sans changement Avenue du Général de Gaulle Salle Mille-Clubs Cambrai Haynecourt 18 9-CAMBRAI 0001 (unique) sans changement 139rue de Bourlon Salle polyvalente Cambrai Honnecourt Sur Escaut 18 10 - CATEAU CAMBRESIS (le) 0001 (unique) sans changement 7 rue de l'église Cambrai La Groise 18 10 -CATEAU CAMBRESIS (le) 0001 (unique) sans changement Salle des fêtes Salle des Sports Cambrai Ligny-En-Cambrésis 18 10 - CATEAU CAMBRESIS (le) 0001 sans changement -

210712 PPRI Vallée De La Selle (59)
Décision de l’Autorité environnementale, après examen au cas par cas, sur la modification du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Vallée de la Selle (59) n° : F – 032-21-P-0032 Décision n°F – 032-21-P-0032 en date du 16 juillet 2021 Ae – Décision en date du 16 juillet 2021 relative à la modification du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Vallée de la Selle (59) Décision du 16 juillet 2021 après examen au cas par cas en application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement Le président de la formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (Ae), Vu la directive n°2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-5, R. 122-17 et R. 12218 ; Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ; Vu le règlement intérieur de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable adopté le 26 août 2020 ; Vu la décision prise par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable dans sa réunion du 31 mai 2017 portant exercice des délégations prévues à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ; Vu la demande d’examen au cas par cas (y compris ses annexes) enregistrée sous le numéro n° F – 032-21-P-0032, présentée par le préfet du Nord (Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)), l’ensemble des pièces constitutives du dossier ayant été reçues le 19 mai 2021.