Techniques & Culture, 48-49
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download the Complete Volume for 2017
Midlands Historical Review Volume 1 2017 Cover Image. Detail from Britannia Saxonica (1695) by Robert Morden. Held within the Public Domain and accessed via Wikimedia Commons. Midlands Historical Review ISSN 2516-8568 Volume I, 2017 Published by the Midlands Historical Review With thanks to the editorial board. David Civil, Founding Editor David Robinson, Founding Editor Jonathan Roche, Founding Editor Gary Fisher, Founding Editor With thanks to the assistant editors Thomas Black Christopher Booth Kate Garland Joe Himsworth Joanne Lord Darcie Mawby Marco Panato Thomas Rose James Smith Kimberley Weir Published by Midlands Historical Review © 2018 Midlands Historical Review Midlands Historical Review Founded 2017 Midlands Historical Review is an interdisciplinary, peer-reviewed, student-led journal which showcases the best student research in the Arts and Humanities. It was founded in 2017 by a group of PhD students from diverse academic backgrounds and receives support from the University of Nottingham’s Department of History and School of Humanities. Students in the Arts and Humanities produce valuable contributions to knowledge which, once a degree has been awarded, are often forgotten. High quality research deserves an audience regardless of the level of education it was produced for. The research published by the Midlands Historical Review encourages and enables later cohorts of students to build upon previous students’ work. Contents Human Nature and the Joint Social Project: Towards a Coherent 1 Notion of Alienation Gaby Beckley Guess Who’s Coming to Dinner and Hollywood’s 17 Misrepresentation of the Politics of Interracial Relationships in 1960s America Sarah Dunne Ants and Cicadas: South American Football and National Identity 28 Mark Orton Pierre Nora, Memory, and the Myth of Elizabeth I 49 Tom Rose The Iconography of Kingship: Masques, Antimasques, and 66 Pastorals Thomas Black The “Russian” Woman? Cultural Exceptionalism among 88 Noblewomen in Late Imperial and Revolutionary Russia Darcie Mawby Book Reviews Belief and Unbelief in Medieval Europe. -

ISLAMIC NARRATIVE and AUTHORITY in SOUTHEAST ASIA 1403979839Ts01.Qxd 10-3-07 06:34 PM Page Ii
1403979839ts01.qxd 10-3-07 06:34 PM Page i ISLAMIC NARRATIVE AND AUTHORITY IN SOUTHEAST ASIA 1403979839ts01.qxd 10-3-07 06:34 PM Page ii CONTEMPORARY ANTHROPOLOGY OF RELIGION A series published with the Society for the Anthropology of Religion Robert Hefner, Series Editor Boston University Published by Palgrave Macmillan Body / Meaning / Healing By Thomas J. Csordas The Weight of the Past: Living with History in Mahajanga, Madagascar By Michael Lambek After the Rescue: Jewish Identity and Community in Contemporary Denmark By Andrew Buckser Empowering the Past, Confronting the Future By Andrew Strathern and Pamela J. Stewart Islam Obscured: The Rhetoric of Anthropological Representation By Daniel Martin Varisco Islam, Memory, and Morality in Yemen: Ruling Families in Transition By Gabrielle Vom Bruck A Peaceful Jihad: Negotiating Identity and Modernity in Muslim Java By Ronald Lukens-Bull The Road to Clarity: Seventh-Day Adventism in Madagascar By Eva Keller Yoruba in Diaspora: An African Church in London By Hermione Harris Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia: From the 16th to the 21st Century By Thomas Gibson 1403979839ts01.qxd 10-3-07 06:34 PM Page iii Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia From the 16th to the 21st Century Thomas Gibson 1403979839ts01.qxd 10-3-07 06:34 PM Page iv ISLAMIC NARRATIVE AND AUTHORITY IN SOUTHEAST ASIA © Thomas Gibson, 2007. All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles or reviews. First published in 2007 by PALGRAVE MACMILLAN™ 175 Fifth Avenue, New York, N.Y. -

The Hadrami Diaspora: Community-Building on the Indian Ocean Rim by Leif Manger (Review)
The Hadrami Diaspora: Community-Building on the Indian Ocean Rim by Leif Manger (review) Daniel Martin Varisco Mashriq & Mahjar: Journal of Middle East and North African Migration Studies, Volume 1, Number 2, 2013, (Review) Published by Moise A. Khayrallah Center for Lebanese Diaspora Studies For additional information about this article https://muse.jhu.edu/article/779786/summary [ Access provided at 25 Sep 2021 20:00 GMT with no institutional affiliation ] Mashriq & Mahjar 1, no. 2 (2013), 130-133 ISSN 2169-4435 LEIF MANGER, The Hadrami Diaspora: Community-Building on the Indian Ocean Rim (New York: Berghahn Books, 2010). Pp. 220. $60.00 cloth. REVIEWED BY DANIEL MARTIN VARISCO, Department of Anthropology, Hofstra University, email: [email protected] “The present book is thus the end result of a rather long anthropological journey, filled with interesting moments of discovery but also a feeling of anxiety as I struggled with my inclination to deal with the ‘totality’ of Hadarami (sic) immigration history: My anthropological instincts told me to settle for a discussion of things less speculative, more focused on stories in which we can see real people” (x). Before I prepared to live in North Yemen in 1978 to conduct ethnographic fieldwork on tradition irrigation and water rights, I benefited greatly from earlier ethnographic work on irrigation in South Yemen’s Hadramawt from Abdulla Bujra’s The Politics of Stratification: A Study of Political change in a South Arabian Town.1 Based on a year’s research in the town of Hureidah in 1962-63, Bujra provided one of the few on-the-ground anthropological studies of Yemen at the time. -

The Archaeologist's Spade and the Apologist's Stacked Deck
The Archaeologist ’s Spade and the Apologist’s Stacked Deck: The Near East through Conser vative Christian Bibliolatr y Daniel Martin Varisco I want to suggest to you, in the first place, that you should be very suspicious of all archaeologists who tell you that they have proved conclusively the truth in Holy Scripture. ( Re v. A. C. Headlam 1931:123). The hermeneutics are so variable, and the preju - dices so strong that, in these archaeological con - troversies, all the fallacies known to logicians have flourished luxuriantly. (Cobern 1891:312) In 1956 a popular book of essays was published by the noted Sumerologist, Samuel Noah Kramer; it was called History Begins at Sumer. About that time I was introduced to Sunday School in a local Baptist Church in northern Ohio, where it was definitely taught that history was begotten with a literal Adam and Eve around 4004 B.C., give or take a divine day. That church no longer exists. I went on to major in “Biblical Archaeology” at the conservative evangelical Wheaton College in Illinois and then further afield for a degree in anthropology at the Un i versity of Pe n n s y l vania, the institution where Kramer spent most of his life deciphering Sumerian tablets. A Daniel Martin Varisco, Associate Professor of Anthropology Department of Anthropology & Sociology Hofstra University, Hempstead, New York, USA 57 quarter of a century ago I wrote an M.A. thesis entitled Archaeology as Apologetic: Towards an Understanding of the Fundamentalist Paradigm. I never published the thesis, in part because I went off in different directions as a Middle East anthropologist and Arabist. -

Throughout the Book, Rappaport Traces a Distinction Between Culturalist Pro- Jects and Discourses of Sovereignty
1052 C S S H N O T E S Throughout the book, Rappaport traces a distinction between culturalist pro- jects and discourses of sovereignty. While culturalist projects are characterized by “an inward-looking emphasis on the revitalization of cultural specificity,” dis- courses of sovereignty “stress . transnational languages of minority rights that discursively and practically link the indigenous movement to other progressive social sectors and make possible negotiation with the state” (15). Through these categories, Rappaport explores “the articulation of the indigenous cultural project with the movement’s political objectives” (15). This move leads her to consider “the positioning of indigenous intellectuals in local and regional venues, as well as . the fluidity of their discursive practices within the diverse political contexts in which they operate” (15). Based on ethnographic inquiry into specific cultural projects such as the PEB (Bilingual Education Program), the Nasa School of Thought, and shamanic research, Rappaport unearths the political underpinnings of these practices, and forces us to rethink the frontier between ‘culture’ and ‘politics;’ or between “culturalist discourses” and “discourses of sovereignty.” She provides eloquent examples of how indigenous leaders and politicians face “the contradiction of simultaneously leading an indigenous community and representing the state” (265). She not only unearths how the practices of local and regional activists are intertwined, but also how “culturalist dis- courses” and “discourses of sovereignty” cannot be understood separately, as referring to mutually exclusive domains. Rappaport invites us to think of culture as “a utopia, a projection toward the future” (273). Her book shows us how to do collaborative research in ways that are both political and academically relevant. -

Orientalism’S Wake: the Ongoing Politics of a Polemic
Viewpoints Orientalism’s Wake: The Ongoing Politics of a Polemic The Middle East Institute Washington, DC No. 12 September 2009 Edward W. Said, who passed away at the age of 67 on September 25, 2003, was a towering “public intellectual” — a man of extraordinary erudition, a path-breaking scholar, and a passionate activist. Said was a man of many interests, talents, and accomplishments — pianist, opera critic, newspaper columnist, popular essayist, television celebrity, and public lecturer. From 1963 until his death, he was Professor of English and Comparative Literature at Columbia University. Said, the distinguished man of letters, also was deeply immersed in the politics of Palestine. Born in Jerusalem in 1935, he moved with his family to Cairo following the outbreak of the Arab-Israeli War, and later to the United States. He subsequently emerged as one of the best known advocates of the Palestinian cause in the United States. From 1977 until 1991, he served as an independent member of the Palestinian National Council. He later became one of the most trenchant critics of the Oslo peace process and of US policy in the Middle East. This special edition of MEI Viewpoints recalls and reconsiders Edward Said’s seminal work, Orientalism (1978) — the critique it proffered, the controversy it aroused, and the influence it has had. MEI is grateful to Dr. Daniel Varisco of Hofstra University for his inspiration, assistance, and contribution to this collection of essays. Middle East Institute Viewpoints • www.mei.edu Orientalism’s Wake: The Ongoing Politics of a Polemic Daniel Martin Varisco More than any other individual scholar in recent history, Edward Said laid bare the dis- cursive ideological undertones that have infested the public and academic representation of an idealized Orient. -

GULF STUDIES CENTER Monographic Series
Drone Strikes in the War on Terror DRONE STRIKES IN THE WAR ON TERROR: The Case of Post-Arab-Spring Yemen Dr. Daniel Martin Varisco GULF STUDIES CENTER Monographic Series N°1 N°1 December 2015 1 Gulf Studies Center Monographic Series N°1 About Gulf Studies Center The Gulf Studies at the College of Arts and Sciences at Qatar University is the world’s first to focus exclusively on the Gulf within the region itself, which aims to advance teaching and scholarship in the Gulf Studies field. It was initially developed in 2011, by offering MA in Gulf Studies. Due to the increasing regional and global interest in this strategic area, the Gulf Studies Research Center was established in the fall of 2013. The Center is committed to advancing cutting-edge research and scholarship on the Gulf region. It also hosts a number of conferences and research events in collaboration with other regional and international partners. To complement the success and to cater for the increasing interest and demand, the PhD Program in Gulf Studies was launched in 2015. The Center engages in interdisciplinary, Gulf-focused studies and research in three main areas: Politics and Security; Energy and Economics; and Social Issues. Each of these areas is headed by a research coordinator supported by faculty and research assistants forming specialist research groups. The Center accepts a number of distinguished scholars, visiting researchers and graduate students who engage with the center’s areas of research. About monographic series The Gulf Monographic Series is aimed to improve publication portfolio of the Center, and provide opportunities for affiliated faculty and students as well and reputed non-affiliated scholars to publish in coordination with the center. -

An Anthropological View Presentation
Presentation The End of Life, the Ends of Life: An Anthropological View Article DOI: http://dx.doi.org/10.5915/43-7037 Video DOI: http://dx.doi.org/10.5915/43-7037V Daniel Martin Varisco, PhD Professor of Anthropology Hofstra University Long Island, New York Abstract All known human societies have a worldview that deserves to be called reli- gion; all religions must explain death. Anthropologists study the diversity of reli- gious systems, present and past, in order to understand what is common to humanity. Rather than starting from the view of a particular revelation or set of doctrines, the anthropologist tries to step outside his or her own subjective worldview and identify patterns in the evolution of human thinking about the reality of physical death. Are humans the only animals that are conscious of death, or do we share sentiments observable in our closest living relatives, the chimpanzees? At what point in history did the concept of an afterlife, life in some spiritual sense after physical death, appear? Is the religious explanation of life and death a mere reflection of a communal social fact, as the sociologist Emil Durkheim suggested, or a shared psychological trait, as more recent scholars assert? Can and should the modern scientist make a definitive statement about the finality of death and human consciousness? Key Words: Anthropology of religion, mortality, mortuary rituals, end of life. or a conference of Muslim physicians and I was with the Prophet, when some bedouin health-care professionals, it is fitting to begin came and asked: ’O Messenger of God, should with a quote from the Prophet Muhammad we treat the sick?’ He replied: ‘Yes, O servants This is a hadith with several variants, including of God, treat your sick. -
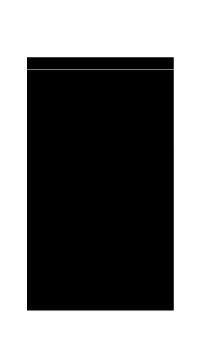
Islam Obscured: the Rhetoric of Anthropological Representation Daniel Martin Varisco New York: Palgrave Macmillan, 2005
Book Reviews 123 Islam Obscured: The Rhetoric of Anthropological Representation Daniel Martin Varisco New York: Palgrave Macmillan, 2005. 226 pages. Daniel Martin Varisco’s Islam Obscured: The Rhetoric of Anthropological Representation provides a very sound and well-informed literary critique of Clifford Geertz’s Islam Observed (1968), Ernest Gellner’s Muslim Society (1981), Fatima Mernissi’s Beyond the Veil (1975), and Akbar Ahmed’s Dis- covering Islam (1988). The author, an experienced ethnographer of Middle Eastern societies, examines the treatments and representations of Islam in these seminal texts. After presenting his topic and background in the intro- duction, he demonstrates how these four authors obscured, misrepresented, and elided the everyday lives of Muslims. In the epilogue, Varisco gleans some important lessons for the study of Islam from his entertaining and witty exploration of these social science texts. In the book’s introduction, the author briefly discusses the intellectual history of anthropology and ethnographic studies of Muslims. He notes that the discipline of anthropology has encountered numerous problems, includ- ing its recognition of Victorian traveler’s reports, Spencerian “evolution- ism,” and the postcolonial critique of Eurocentric textual representations of non-western others. Addressing the current state of anthropological theory, Varisco mentions the blurring of boundaries between established disciplines as well as the particularly American problem over whether to maintain the four-field approach of holistically studying human beings. In keeping with this Eurocentric slant toward “primitives,” he observes that there were very few ethnographic studies of Muslims, except Evans- Pritchard’s 1940s work on Cyrenaican Bedouins and those by others follow- ing his example, until ethnographers began to produce Robert Redfield- influenced community studies. -

Edward Said and the Culture Behind Orientalism
[Expositions 7.2 (2013) 52–54] Expositions (online) ISSN: 1747–5376 Edward Said and the Culture behind Orientalism DANIEL MARTIN VARISCO Hofstra University A decade after the passing of Edward Said, his legacy lives on. As an intellectual committed to secular humanism and at the same time a relentless critic of the Western colonial enterprise that perpetuated the notion that Western culture was the only vehicle for that humanism, Said wrote with passion about the discourse he labeled “Orientalism.” Said’s much debated Orientalism was published in 19781 on the cusp of a growing “Islamic” opposition to both the Soviets in Afghanistan and the Americans in Iran. His timely text was a polemic necessary for speaking a variety of truths to both the intellectual and political currents of the day. Whether one idealizes his text or recognizes its manifest faults, the force of his polemic sparked a debate that successfully challenged the rigid binary of East/West and inspired a wide range of critical scholarship across disciplines. In 2007 I published Reading Orientalism: Said and the Unsaid,2 a critical survey of Orientalism, the text, and the extensive debate pro-and-con over both it and its author. As I stated in the “To the Reader” of my book, my intent was “to show why I think Said is at time prone to error, but I categorically reject the politically motivated ad hominem diatribe that ridicules Said because of where he was born, how he chooses to align himself politically, and how many pebbles he once tossed unphotogenetically at a border fence inside Lebanese territory.”3 Because my survey documented the historical errors and theoretical problems with his use of Foucault’s “discourse” and Gramsci’s “egemonia” in his text,4 some critics have assumed I am following in the curmudgeon mold of old-school historian Bernard Lewis. -

THE OBSERVER OBSERVED Clifford Geertz on Religion
DOI: 10.21274/epis.2021.16.1.1-14 THE OBSERVER OBSERVED Clifford Geertz on Religion Nico J.G. Kaptein1 Leiden University-The Netherlands Abstract In his seminal Islam Observed: Religious Developments in Morocco and Indonesia from 1968, the American anthropologist Clifford Geertz (1926- 2006) placed the comparative study of Muslim societies on the research agenda. In view of my knowledge on the history of Islam in Indonesia, it stroke me that the political dimension of religion did not take an important place in the book. This is the more remarkable because during Geertz’s fieldwork in Java in 1953-4 manifestations of political Islam regularly popped up, and Geertz did not only notice those, but also recorded them in his book The Religion of Java from 1960. In this paper I will go into the question of why Geertz did not give a more prominent place to political Islam in his analysis of Muslim cultures, and what concepts of both Islam and religion he used. [Melalui Islam Observed: Religious Developments in Morocco and Indonesia pada tahun 1968, seorang antropolog Amerika Clifford Geertz (1926-2006) mengetengahkan perbandingan masyarakat Muslim dalam agenda riset. Sepengetahuan saya mengenai Islam di Indonesia, yang mengejutkan dalam pembahasan bukunya, Geertz sama sekali tidak mengulas secara dalam 1 This paper was originally prepared for the workshop “Islam (re) Observed: Geertz’s Comparative Study of Morocco and Indonesia 50 years”, to commemorate the 50th anniversary of the publication of Islam Observed, which was held at NIMAR (Nederlands Institut Marokko), in Rabat, Morocco, on 27-28 October 2018, and organised by LUCIS (Leiden University Centre for the Study of Islam and Society) and NIMAR. -

Early Orientalism
Early Orientalism The history of western notions about Islam is of obvious scholarly as well as popular interest today. This book investigates Christian images of the Muslim Middle East, focusing on the period from the Renaissance to the Enlightenment, when the nature of divine as well as human power was under particularly intense debate in the West. Ivan Kalmar explores how the controversial notion of submission to ultimate authority has in the western world been discussed with reference to Islam’s alleged recommendation to obey, unquestioningly, a merciless Allah in heaven and a despotic government on earth. He discusses how Abrahamic faiths – Christianity and Judaism as much as Islam – demand devotion to a sublime power, with the faith that this power loves and cares for us, a concept that brings with it the fear that, on the contrary, this power only toys with us for its own enjoyment. For such a power, Kalmar borrows Slavoj Zizek’s term “obscene father”. He discusses how this describes exactly the western image of the Oriental despot - Allah in heaven, and the various sultans, emirs and ayatollahs on earth – and how these despotic personalities of imagined Muslim society function as a projection, from the West on to the Muslim Orient, of an existential anxiety about sublime power. Making accessible academic debates on the history of Christian perceptions of Islam and on Islam and the West, this book is an important addition to the existing literature in the areas of Islamic studies, religious history and philosophy. Ivan Kalmar is a professor at the University of Toronto.