Where Is Holden Caulfield?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Journal of Theory and Practice Fall 2016 (8:3)
Teaching American Literature: A Journal of Theory and Practice Fall 2016 (8:3) Allie, Phoebe, Robert Emmet, and Daisy Mae: Love, Loss, and Grief in J.D. Salinger's The Catcher in the Rye and Alice McDermott's Child of My Heart Gail S. Corso, Neumann University Abstract: Adolescents in literature often leave their significant losses understated, especially the death of one's sibling or a surrogate type of sibling, or suicide of a peer. Each causes certain behaviors that seem to express inconsolable grief, and when left unaddressed, aberrant behavior, and resistance to cultural norms. The surviving adolescent may rebel against family and societal norms that he/she observes, norms that seem unjust or phony. Each adolescent, too, may seem ambivalent about their sexuality and unaware of their vulnerabilities. While Holden and Theresa share some of these features, they differ with regard to the presence of love in their lives. In each story, The Catcher in the Rye by J.D. Salinger, and Child of My Heart by Alice McDermott, parents of the narrator-protagonist seem to repress their own feelings about the loss, or they neglect to communicate openly about the loss with the surviving adolescent sibling. The structure and breaks in the narrative which are evident in each character's story return to pivotal moments—often a minimally-described traumatic event in the narrative which seems silenced by parents in each adolescent's family. In this comparison of character's responses to loss, interpersonal relationships are examined, as are results of psychological research about how adolescents respond to a sibling death. -
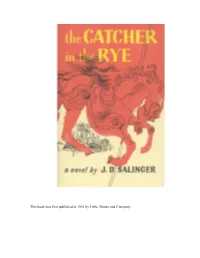
This Book Was First Published in 1951 by Little, Brown and Company
This book was first published in 1951 by Little, Brown and Company. THE CATCHER IN THE RYE By J.D. Salinger © 1951 CHAPTER 1 If you really want to hear about it, the first thing you'll probably want to know is where I was born, an what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind of crap, but I don't feel like going into it, if you want to know the truth. In the first place, that stuff bores me, and in the second place, my parents would have about two hemorrhages apiece if I told anything pretty personal about them. They're quite touchy about anything like that, especially my father. They're nice and all--I'm not saying that--but they're also touchy as hell. Besides, I'm not going to tell you my whole goddam autobiography or anything. I'll just tell you about this madman stuff that happened to me around last Christmas just before I got pretty run-down and had to come out here and take it easy. I mean that's all I told D.B. about, and he's my brother and all. He's in Hollywood. That isn't too far from this crumby place, and he comes over and visits me practically every week end. He's going to drive me home when I go home next month maybe. He just got a Jaguar. One of those little English jobs that can do around two hundred miles an hour. -

Tactile Imagery and Narrative Immediacy in JD Salinger's
Virginia Commonwealth University VCU Scholars Compass Theses and Dissertations Graduate School 2011 Shaken and Stirred: Tactile Imagery and Narrative Immediacy in J. D. Salinger's "Blue Melody," "A Girl I Knew," and "Just Before the War with the Eskimos" Angelica Bega-Hart Virginia Commonwealth University Follow this and additional works at: https://scholarscompass.vcu.edu/etd Part of the English Language and Literature Commons © The Author Downloaded from https://scholarscompass.vcu.edu/etd/2641 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at VCU Scholars Compass. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of VCU Scholars Compass. For more information, please contact [email protected]. © Angelica E. Bega-Hart, 2011 All Rights Reserved Shaken and Stirred: Tactile Imagery and Narrative Immediacy in J.D. Salinger’s “Blue Melody,” “A Girl I Knew,” and “Just Before the War with the Eskimos” A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts at Virginia Commonwealth University. by Angelica Elizabeth Bega-Hart A.S. Richard Bland College, May 1998 B.A. Virginia Commonwealth University, May 2001 M.A. Virginia Commonwealth University, December 2011 Director: A. Bryant Mangum, Ph.D. Professor, Department of English Virginia Commonwealth University Richmond, Virginia December, 2011 ii Acknowledgements A thesis is such a large undertaking; and this one, like most, could never have come to fruition without the support of many friends and colleagues. First and foremost, I gratefully acknowledge the patience, rigor and support put forth by my thesis advisor, Dr. -

The Catcher in the Rye by J.D
Reading Guide The Catcher in the Rye by J.D. Salinger The Catcher in the Rye By J.D.Salinger About the book Although The Catcher in the Rye caused considerable controversy when it was first published in 1951, the book was also an instant hit (it was #1 on the New York Times Bestseller list for thirty weeks in a row). Catcher as ever since remained popular, especially with teenagers who embrace Holden Caulfield’s brash style and anti-establishment attitude. The book has also been the bane to many parents because of its sexual themes and use of obscene language. J.D. Salinger, the author, was aware of the controversy: “I’m aware that many of my friends are saddened and shocked over some of the chapters in The Catcher in the Rye. Some of my best friends are children. It’s almost unbearable for me to realize that my book will be kept on a shelf out of their reach.” For some reason-- perhaps the controversy over Catcher-- Salinger retreated from the literary world in the 1960s to a country house in Cornish, New Hampshire, where he lived a private life and avoided almost all press until his death. About the author Born in 1919 to a prosperous Manhattan family, Jerome David Salinger grew up in a New York City not unlike that of young Holden Caulfield. Salinger was never a diligent student: after he flunked out of several prep schools, including the prestigious McBurney School, his parents sent him to Valley Forge Military academy in Pennsylvania, from which he graduated in 1936. -
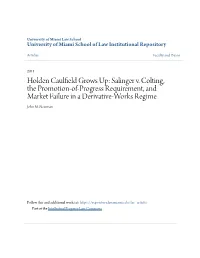
Holden Caulfield Grows Up: Salinger V. Colting, the Promotion-Of-Progress Requirement, and Market Failure in a Derivative-Works Regime John M
University of Miami Law School University of Miami School of Law Institutional Repository Articles Faculty and Deans 2011 Holden Caulfield Grows Up: Salinger v. Colting, the Promotion-of-Progress Requirement, and Market Failure in a Derivative-Works Regime John M. Newman Follow this and additional works at: https://repository.law.miami.edu/fac_articles Part of the Intellectual Property Law Commons Content downloaded/printed from HeinOnline Fri Oct 4 12:34:05 2019 Citations: Bluebook 20th ed. John M. Newman, Holden Caulfield Grows Up: Salinger v. Colting, the Promotion-of-Progress Requirement, and Market Failure in a Derivative-Works Regime, 96 Iowa L. Rev. 737 (2011). ALWD 6th ed. John M. Newman, Holden Caulfield Grows Up: Salinger v. Colting, the Promotion-of-Progress Requirement, and Market Failure in a Derivative-Works Regime, 96 Iowa L. Rev. 737 (2011). APA 6th ed. Newman, J. M. (2011). Holden caulfield grows up: Salinger v. colting, the promotion-of-progress requirement, and market failure in derivative-works regime. Iowa Law Review, 96(2), 737-760. Chicago 7th ed. John M. Newman, "Holden Caulfield Grows Up: Salinger v. Colting, the Promotion-of-Progress Requirement, and Market Failure in a Derivative-Works Regime," Iowa Law Review 96, no. 2 (January 2011): 737-760 McGill Guide 9th ed. John M Newman, "Holden Caulfield Grows Up: Salinger v. Colting, the Promotion-of-Progress Requirement, and Market Failure in a Derivative-Works Regime" (2011) 96:2 Iowa L Rev 737. MLA 8th ed. Newman, John M. "Holden Caulfield Grows Up: Salinger v. Colting, the Promotion-of-Progress Requirement, and Market Failure in a Derivative-Works Regime." Iowa Law Review, vol. -

Bakalářská Práce
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra anglistiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Images of Childhood in Books of J.D.Salinger and W.Saroyan Obraz dětství v díle J. D. Salingera a W. Saroyana Autor: Veronika Jeřábková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alice Sukdolová, Ph.D. Rok odevzdání: 2013 Prohlášení Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů. V Českých Velenicích, dne 13. 4. 2013 ________________ Veronika Jeřábková Poděkování Tímto bych ráda poděkovala vedoucí své bakalářské práce Mgr. Alici Sukdolové, Ph.D. za odbornou pomoc a cenné připomínky v průběhu vedení mé bakalářské práce. Dále bych ráda poděkovala oběma svým rodičům za podporu během celého mého studia, speciálně děkuji svému otci za následnou jazykovou korekci mé práce. Anotace Cílem práce je srovnání povídkové tvorby W. Saroyana s románem J. D. Salingera Kdo chytá v žitě a také s několika Salingerovými povídkami. -

Open Censor in the Rye.Pdf
THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY SCHREYER HONORS COLLEGE DEPARTMENT OF ENGLISH CENSOR IN THE RYE JOSHUA D. YOM SPRING 2016 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for a baccalaureate degree in English with honors in English Reviewed and approved* by the following: Robert Caserio Professor of English Thesis Supervisor Marcy North Associate Professor of English Honors Adviser * Signatures are on file in the Schreyer Honors College. i ABSTRACT J.D. Salinger’s 1951 novel The Catcher in the Rye is a cult-classic in the canon of American literature, most commonly recognized as a “vulgar” book, subject to censorship and banning. This thesis argues that Catcher not only draws censorship, but offers treatment of censorship, particularly in the novel’s conclusion, in conjunction with a selection of Salinger’s preceding, developmental writings on Holden and the Caulfield family. Five of Salinger’s pre- Catcher writings are analyzed, examining the chronological development of Holden Caulfield, citing recurring themes regarding childhood, adulthood, and beauty as related to censorship. I intend to argue that Salinger’s novel presents the final form of the character Holden Caulfield as constituted by these preceding fragments. Identification and analysis of these fragments contributes to analysis of Salinger’s treatment of censorship or “catching” in the novel; Catcher is Salinger’s final development of Holden and his thesis on censorship. ii TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGMENTS ........................................................................................... iii Chapter 1 Five Stories .................................................................................................. 1 "Last Day in the Last Furlough"…………………………………………………2 "This Sandwich Has No Mayonnaise"…………………………………………...8 "The Stranger"…………………………………………………………………..13 "I'm Crazy"……………………………………………………………………...18 "Slight Rebellion Off Madison"……………………………………………….. 27 Fragments of Holden………….………………………………………………. -

Alienation in J. D Salinger's the Catcher in the Rye (1952)
People’s Democratic Republic of Algeria Ministry of Higher Education and Scientific Research جامعة 8 ماي 1945\ قالمة University of 8 Mai 1945 / Guelma كلية اﻻداب و اللغات Faculty of Letters and Languages قسم اﻻداب و اللغة اﻹنجليزية Department of Letters and English Language Alienation in J. D Salinger’s The Catcher in the Rye (1952) A Dissertation Submitted to the Department of English in Partial Fullfilment of the Requirements for the Degree of Master in Anglophone Language, Literature and Civilizations Board of Examiners Chair: Ms. Soumia MOUMENE - (MAB) University of 8 Mai 1945/ Guelma Supervisor: Mrs. Meryem BOUREGAA - (MAB) University of 8 Mai 1945/ Guelma Examiner: Mrs. Laila AIOUNI - (MAB) University of 8 Mai 1945/ Guelma Submitted by: Supervised by: Marwa HADJABI Mrs. Meryem BOUREGAA 2016/2017 Acknowledgments First and foremost, I would like to thank God whose never-ending grace and provision encourages me to successfully accomplish this work. I would like to express my sincere gratitude to my supervisor Mrs. BOUREGAA Meryem for her patience and immense knowledge. Her guidance and extraordinary support helped me in this thesis process. I could not have had imagined having a better supervisor and mentor. A special consideration goes to my family, for their advice, their patience, and their faith, because they always understand. Dedication I dedicate this work to God who is my chief guider. I dedicate it to my supervisor Mrs. BOUREGAA Meryem for her valuable guidance and support, i am forever grateful. For my parents, i hope that this humble achievement will complete the dream that you had for me all those many years ago when you chose to give me the best education you could. -

The Genesis of Theme in Salinger: a Study of the Early Stories
The genesis of theme in Salinger: a study of the early stories Item Type text; Thesis-Reproduction (electronic) Authors Taiz, Nard Nicholas, 1939- Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 07/10/2021 05:33:52 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/317934 THE GENESIS OF THEME IN SALINGER: A STUDY OF THE EARLY STORIES by Nard Nicholas Taiz A Thesis Submitted to the Faculty of the DEPARTMENT OF ENGLISH In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF ARTS In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 19 6 6 STATEMENT BY AUTHOR This thesis has been submitted in partial fulfill ment of requirements for an advanced degree at The University of Arizona and is deposited in the University Library to be made available to borrowers under rules of the Library. Brief quotations from this thesis are allowable without special permission? provided that accurate acknowl edgment of source is made. Requests for permission for extended quotation from or reproduction of this manuscript in whole or in part may be granted by the head of the major department or the Dean of the Graduate College when in his judgment the proposed use of the material is in the inter ests of scholarship« In all other instances9 however, permission must be obtained from the author. -

Holden Caulfield's Goddam
NAME UNIT 1: Catcher in the Rye Reading Packet -1- February 2011 Biography Holden Caulfield’s Goddam War As army sergeant J. D. Salinger hit the beach on D-day, drank with Hemingway in newly liberated Paris, and marched into concentration camps, the hero of The Catcher in the Rye was with him. In an adaptation from his Salinger biography, the author reveals how the war changed both Holden Caulfield and his creator. By Kenneth Slawenski The author in 1952—a year after Catcher was published. By Anthony Di Gesu/San Diego Historical Society/Hulton Archive Collection/Getty Images. In the autumn of 1950, at his home in Westport, Connecticut, J. D. Salinger completed The Catcher in the Rye. The achievement was a catharsis. It was confession, purging, prayer, and enlightenment, in a voice so distinct that it would alter American culture. Holden Caulfield, and the pages that held him, had been the author’s constant companion for most of his adult life. Those pages, the first of them written in his mid-20s, just before he shipped off to Europe as an army sergeant, were so precious to Salinger that he carried them on his person throughout the Second World War. Pages of The Catcher in the Rye had stormed the beach at Normandy; they had paraded down the streets of Paris, been present at the deaths of countless soldiers in countless places, and been carried through the concentration camps of Nazi Germany. In bits and pieces they had been re-written, put aside, and re-written again, the nature of the story changing as the author himself was changed. -

Jerome David Salinger
Jerome David Salinger Jerome David Salinger was born in Manhattan, New York, on New Year's Day, 1919.He was an American author, best known for his novel The Catcher in the Rye. Salinger began writing short stories while in secondary school. His last original published work was in 1965 and he gave his last interview in 1980. The young Salinger attended public schools on the West Side of Manhattan. Then the family moved to Park Avenue and Salinger went to the McBurney School,a private school in Manhattan. Salinger was not a good student, he had failing grades, and therefore was kicked out.Then he went to the Valley Forge Military Academy,where he graduated in 1936. At this school he began writing stories and he was the literary editor of the class yearbook. During the Second World War, Salinger arranged to meet with Ernest Hemingway, a writer who had influenced him. Salinger was impressed with Hemingway's friendliness and modesty.In June 1955, at the age of 36, Salinger married Claire Douglas. They had two children, Margaret and Matthew.Salinger died of natural causes at his home in New Hampshire, United States on January 27, 2010. He was 91. His main creations were books: The Catcher in the Rye (1951),Nine Stories (1953),Franny and Zooey (1961) and a few more stories Go See Eddie, A Boy in France, This Sandwich Has No Mayonnaise, A Girl I Knew, I'm Crazy, Blue Melody. The Catcher in the Rye is a 1951 novel by J. D. Salinger.Originally published for adults, it has since become popular with adolescent readers for its themes of teenage confusion, angst, alienation, language, and rebellion. -

Symbolism in the Catcher in the Rye by J.D. Salinger
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ANGLISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SYMBOLISM IN THE CATCHER IN THE RYE BY J.D. SALINGER Vedoucí práce: Richard Stock, Ph.D. Autor práce: Jana Šojdelová Studijní obor: Bohemistika – Anglistika Ročník: 2. 2014 Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů. České Budějovice, 1. 5. 2014 …………………………… Acknowledgements I would like to sincerely thank my supervisor Richard Stock, Ph.D. for his valuable suggestions, insight and help. I am grateful for the constant support from my family and friends, and their willingness to listen to my endless “catcher” talk. Finally, my thanks also belong to J.D. Salinger and Holden, for making me feel understood and not alone. Anotace Nejpodstatnějším motivem románu J. D. Salingera, Kdo chytá v žitě, je všudypřítomný boj hlavního hrdiny Holdena Caulfielda s dospíváním, který ho nakonec po neúspěšném hledání svého místa ve společnosti dožene k nervovému zhroucení.